Les Relations Extérieures Du Québec Manon Tessier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Université Du Québec Mémoire Présenté À L'université Du Québec À Trois-Rivières Comme Exigence Partielle De La Maîtri
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC MÉMOIRE PRÉSENTÉ À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN ÉTUDES QUÉBÉCOISES PAR LAURÉANNE DANEAU LA RÉGIONALISATION DE L'IMMIGRATION AU QUÉBEC: LE DÉBAT PUBLIC ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LA SOCIÉTÉ CIVILE À L'ORIGINE DE LA POLITIQUE, 1987-2000 AVRIL 2015 Université du Québec à Trois-Rivières Service de la bibliothèque Avertissement L’auteur de ce mémoire ou de cette thèse a autorisé l’Université du Québec à Trois-Rivières à diffuser, à des fins non lucratives, une copie de son mémoire ou de sa thèse. Cette diffusion n’entraîne pas une renonciation de la part de l’auteur à ses droits de propriété intellectuelle, incluant le droit d’auteur, sur ce mémoire ou cette thèse. Notamment, la reproduction ou la publication de la totalité ou d’une partie importante de ce mémoire ou de cette thèse requiert son autorisation. 11 RÉSUMÉ À la fin des années 1980, dans le cadre de consultations publiques préparées par le ministère de l'Immigration, plusieurs acteurs de la société civile québécoise expriment leurs préoccupations face à la concentration de la population immigrante à Montréal. En effet, plus de 87 % des immigrants établis au Québec vivent alors dans la métropole. Dès 1990, le gouvernement québécois annonce son intention de favoriser la régionalisation, de l'immigration dans une perspective de développement régional. Or, la concentration métropolitaine des immigrants n'est ni un phénomène récent ni propre au Québec. Pourquoi dans ce cas devient-il, à cette époque, un problème public? Une analyse de politique publique basée sur le modèle théorique séquentiel développé par Charles Jones nous permet d'étudier le processus par lequel la concentration métropolitaine de l'immigration au Québec est construite socialement et politiquement comme un problème public par les autorités gouvernementales et des représentants de la société civile. -

Montreal, Quebec May 31, 1976 Volume 62
MACKENZIE VALLEY PIPELINE INQUIRY IN THE MATTER OF THE APPLICATIONS BY EACH OF (a) CANADIAN ARCTIC GAS PIPELINE LIMITED FOR A RIGHT-OF-WAY THAT MIGHT BE GRANTED ACROSS CROWN LANDS WITHIN THE YUKON TERRITORY AND THE NORTHWEST TERRITORIES, and (b) FOOTHILLS PIPE LINES LTD. FOR A RIGHT-OF-WAY THAT MIGHT BE GRANTED ACROSS CROWN LANDS WITHIN THE NORTHWEST TERRITORIES FOR THE PURPOSE OF A PROPOSED MACKENZIE VALLEY PIPELINE and IN THE MATTER OF THE SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC IMPACT REGIONALLY OF THE CONSTRUCTION, OPERATION AND SUBSEQUENT ABANDONMENT OF THE ABOVE PROPOSED PIPELINE (Before the Honourable Mr. Justice Berger, Commissioner) Montreal, Quebec May 31, 1976 PROCEEDINGS AT COMMUNITY HEARING Volume 62 The 2003 electronic version prepared from the original transcripts by Allwest Reporting Ltd. Vancouver, B.C. V6B 3A7 Canada Ph: 604-683-4774 Fax: 604-683-9378 www.allwestbc.com APPEARANCES Mr. Ian G. Scott, Q.C. Mr. Ian Waddell, and Mr. Ian Roland for Mackenzie Valley Pipeline Inquiry Mr. Pierre Genest, Q.C. and Mr. Darryl Carter, for Canadian Arctic Gas Pipeline Lim- ited; Mr. Alan Hollingworth and Mr. John W. Lutes for Foothills Pipe- lines Ltd.; Mr. Russell Anthony and pro. Alastair Lucas for Canadian Arctic Resources Committee Mr. Glen Bell, for Northwest Territo- ries Indian Brotherhood, and Metis Association of the Northwest Territories. INDEX Page WITNESSES: Guy POIRIER 6883 John CIACCIA 6889 Pierre MORIN 6907 Chief Andrew DELISLE 6911 Jean-Paul PERRAS 6920 Rick PONTING 6931 John FRANKLIN 6947 EXHIBITS: C-509 Province of Quebec Chamber of Commerce - G. Poirier 6888 C-510 Submission by J. -

Mémoire Des Délibérations Du Conseil Exécutif, Séance Du 16 Décembre
MtMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1992 A 11HOO SOUS LA PRÉSIDENCE DU PREMIER MINISTRE MONSIEUR ROBERT BOURASSA Membres du Conseil exécutif présents: Monsieur Robert Bourassa, Premier ministre Madame Lise Bacon, Vice-Première ministre; ministre de l'Énergie et des Ressources Monsieur Gaston Blackburn, Ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Monsieur André Bourbeau, Ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle Monsieur Lawrence Cannon, Ministre des Communications Monsieur Normand Cherry, Ministre du Travail; ministre délégué aux Communautés culturelles Monsieur John Ciaccia, Ministre des Affaires internationales Monsieur Marc-Yvan Côté, Ministre de la Santé et des Services sociaux; ministre délégué à la Réforme électorale Monsieur Robert Outil, Ministre des Approvisionnements et Services Monsieur Sam Elkas, Ministre des Transports Madame Liza Frulla-Hébert, Ministre des Affaires culturelles Madame Monique Gagnon-Tremblay, Ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration Monsieur Daniel Johnson, Ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, Président du Conseil du trésor Monsieur Gérard D. Levesque, Ministre des Finances Monsieur Robert Middlemiss, Ministre délégué aux Transports Monsieur Pierre Paradis, Ministre de l'Environnement Monsieur Yvon Picotte, Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 1 'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales Monsieur Gil Rémillard, Ministre de la Justice; ministre délégué aux -

The James Bay and Northern Quebec Agreement (JBNQA) Electronic Version Obtained from Table of Contents
The James Bay and Northern Quebec Agreement (JBNQA) Electronic Version obtained from http://www.gcc.ca/ Table of Contents Section Page Map of Territory..........................................................................................................................1 Philosophy of the Agreement...................................................................................................2 Section 1 : Definitions................................................................................................................13 Section 2 : Principal Provisions................................................................................................16 Section 3 : Eligibility ..................................................................................................................22 Section 4 : Preliminary Territorial Description.....................................................................40 Section 5 : Land Regime.............................................................................................................55 Section 6 : Land Selection - Inuit of Quebec,.........................................................................69 Section 7 : Land Regime Applicable to the Inuit..................................................................73 Section 8 : Technical Aspects....................................................................................................86 Section 9 : Local Government over Category IA Lands.......................................................121 Section 10 : Cree -
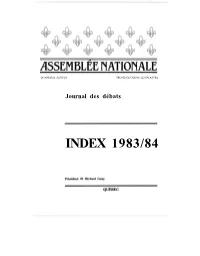
Index 1983/84 Table Des Matières
QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Journal des débats INDEX 1983/84 TABLE DES MATIÈRES Assemblée nationale du Québec I Conseil des ministres II Adjoints parlementaires III Membres de l'Assemblée nationale du Québec IV Liste des membres de l'Assemblée nationale par comté VI Note aux usagers VIII Participants 1-184 Sujets 195-346 commissions parlementaires 211-264 projets de loi 303-330 Intersession Participants 185-194 Sujets 347-355 SESSION 1983-1984 Quatrième session de la 32 Législature du Québec 23 mars 1983 au 20 juin 1984 Volume 27, tomes I à XVIII Tomes I - V pages 1-7378 Chambre Tomes VI - XV pages B-l - B-15022 Commissions parlementaires Tomes XVI - XVIII Nouvelles commissions Tome XIX INDEX DE LA SESSION I à la prorogation de la quatrième session de la 32e Législature du Québec PRÉSIDENT M. Richard Guay Vice-présidents MM. Jean-Pierre Jolivet Réal Rancourt Présidents des commissions élues permanentes Présidents (1983) Présidents (1984) MM. Harry Blank MM. Jean-Pierre Charbonneau René Blouin Élie Fallu Jules Boucher Richard French Raymond Brouillet Richard Guay Jean-Paul Champagne Louise Harel Hubert Desbiens Claude Lachance Marcel Gagnon Thérèse Lavoie-Roux Patrice Laplante Hermann Mathieu Roger Paré Yvon Vallières Yvon Vallières Denis Vaugeois Premier ministre et président du Conseil M. René Lévesque Chef de l'Opposition officielle M. Gérard D. Levesque (PLQ) Leaders parlementaires: ministériels: M. Marc-André Bédard adjoints: MM. Jean-François Bertrand René Blouin Opposition: M. Michel Gratton adjoint: M. Marc-Yvan Côté Whips: ministériels: M. Jacques Brassard adjointe: Mme Huguette Lachapelle adjoints: MM. Jacques Baril Léopold Marquis Patrice Laplante Opposition: M. -

Mémoires Des Délibérations Du Conseil Exécutif
.i MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF SÉANCE DU Il JANVIER 1989 A 10 H 30 SOUS LA PRÉSIDENCE DU PREMIER MINISTRE MONSIEUR ROBERT BOURASSA Membres du Conseil exécutif présents: Monsieur Robert Bourassa, Premier ministre Madame Lise Bacon, Vice-Première ministre; ministre des Affaires culturelles et ministre de 1 1 Environnement Monsieur André Bourbeau, Ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Monsieur John Ciaccia, Ministre de l 1 Énergie et des Ressources Monsieur Marc-Yvan Côté, Ministre des Transports Monsieur Robert Outil, Ministre des Communications Monsieur Pierre Fortier, Ministre délégué aux Finances et à la Privatisation Monsieur Paul Gobeil, Ministre des Affaires internationales Monsieur Daniel Johnson, Ministre délégué à l'Administration, Président du Conseil du trésor Madame Thérèse Lavoie-Roux, Ministre de la Santé et des Services sociaux Monsieur Gérard D. Levesque Ministre des Finances Monsieur Pierre MacDonald, Ministre de 1 1 Industrie, du Commerce et de la Technologie Monsieur Gil Rémillard, Ministre de la Justice, ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre de la Sécurité publique Monsieur Guy Rivard, Ministre délégué aux Affaires culturelles Madame Louise Robic, Ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration Monsieur Claude Ryan, Ministre de 1 1 Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science Monsieur Raymond Savoie, Ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones Monsieur André Vallerand, Ministre des Approvisionnements et Services MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS LE Il JANVIER 1989 POLITIQUE DE LA SANTÉ MENTALE AU QUÉBEC (Réf.: 8-0327) La mi ni stre de 1a Santé et des Servi ces soci aux soumet un mémoi re portant sur 1a politique de 1a santé mentale au Québec. -

Journal Des Débats
journal des Débats TROISIÈME SESSION - 32e Législature INDEX 1981/83 TABLE DES MATIÈRES Assemblée nationale du Québec I Conseil des ministres II Adjoints parlementaires III Membres de l'Assemblée nationale du Québec IV-VI Note aux usagers VII-VIII Participants 1-153 Sujets 157-285 commissions parlementaires 167-207 projets de loi 238-270 SESSION 1981-1983 Troisième session de la 32 Législature du Québec 9 novembre 1981 au 10 mars 1983 et INDEX 1981-1983 Volume 26, tomes I à XV et incluant INDEX Tomes I à V: pages 1 à 7906: Débats de la Chambre Tomes VI à XIV: pages B-l à B-13569 et intersession, pages B-l à B-88: Commissions parlementaires Tome XV: INDEX 1981-1983 I à la prorogation de la troisième session de la 32 Législature du Québec PRÉSIDENT M. Claude Vaillancourt Vice-présidents MM, Jean-Pierre Jolivet Réal Rancourt Présidents des commissions élues permanentes MM. Harry Blank Jean-Paul Bordeleau Jules Boucher Hubert Desbiens Marcel Gagnon Patrice Laplante Jacques Rochefort Jean-Guy Rodrigue Yvon Vallières Premier ministre et président du Conseil M. René Lévesque Chef de l'Opposition officielle M. Gérard D. Levesque (PLQ) Leaders parlementaires: ministériels: M. Jean-François Bertrand adjoint: M. Raynald Fréchette Opposition: M. Fernand Lalonde adjoint: M. Michel Gratton Whips: ministériels: M. Jacques Brassard adjointe: Mme Huguette Lachapelle adjoints: MM. Jacques Baril Léopold Marquis Opposition: M. Michel Pagé adjoint: M. Yvon Picotte Direction des services de l'Assemblée Secrétaire général M. René Blondin Secrétaires adjoints M. Jacques Lessard M. Pierre Duchesne Direction générale des services parlementaires M. -

Icite Et Vous Offre Mes Meilleurs Vœux De Succès Pour L’Avenir
A I E Q ANS 00 1 ANS D ’ E HISTOIR AIEQ.NET 1 100 ANS, ÇA SE FÊTE ! 2 Le 17 décembre 2015 Chères amies, chers amis, Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à tous ceux et celles qui soulignent le 100e anniversaire de l’Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ). Cet événement constitue une merveilleuse occasion de célébrer les nombreuses réalisations de l’AIEQ. En effet, voilà maintenant 100 ans que cette dernière fait la promotion des meilleures pratiques et de la qualité au sein d’un secteur en forte croissance tout en appuyant les intérêts de ses membres. Vous pouvez tirer une grande fierté de représenter un poumon économique du Québec et de faire partie d’une organisation qui encourage l’excellence et le professionnalisme. À l’heure où l’ensemble de la planète fait face à l’urgence climatique, il est plus que jamais nécessaire d’évoluer vers de nouveaux modèles et d’adopter des produits plus innovants susceptibles de réduire notre dépendance à l’énergie fossile. Je suis persuadé que les acteurs du secteur industriel électrique relèveront ce défi majeur en mettant en place une stratégie au service de la croissance, mais aussi du développement durable et responsable. Au nom du gouvernement du Canada, je vous félicite et vous offre mes meilleurs vœux de succès pour l’avenir. Cordialement, Le très hon. Justin P.J. Trudeau, C.P., député Premier ministre du Canada 3 À titre de premier ministre, je tiens à saluer l’Association de l’industrie électrique du Québec, qui souligne son 100e anniversaire. -

The October Crisis Appendix Z the Place of the Crisis in Quebec and Canadian History
1 The October Crisis Appendix Z The Place of the Crisis in Quebec and Canadian History “L’histoire n’est que le tableau des crimes et des malheurs.” (Voltaire, 1694-1778) “History is bunk.” (Henry Ford, 1863-1947) “Some historians are adverse to explicit explanation, instead preferring to ‘let the facts speak for themselves.’ Others will elaborate a preferred explanation, but they rarely set contending explanations against one another, as one must to fully evaluate an explanation. Historians are also (with some exceptions) generally averse to writing evaluative history. However, without explanatory historical work, history is never explained; and without evaluative historical work we learn little from the past about present and future problem-solving.” (Stephen Van Evera, 1997 at p. 93) An Evauative History -Action and Reaction I am not an historian and do not attempt to write history in this text. That is left to professional historians. Rather I have attempted, as an ex-politician, to evaluate the evolution of French-Canadian nationalism, from the founding of Quebec in 1608 to the present day. To do so, I have arbitrarily divided the saga into eighteen major stages and in each stage I have described 2 what happened (“the action”) and what resulted (“the reaction”). This evaluative style at least has the merit of being in the briefest of terms and is the first specific positioning of the October Crisis in Canadian history, to my knowledge, albeit by a biased, ex-politician. The action/reaction methodology may also be surprising, although, I now understand that Karl Marx and others used it. -

Impacts De La Loi 101 Sur La Culture Politique Au Québec De 1977 À 1997
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL IMPACTS DE LA LOI 101 SUR LA CULTURE POLITIQUE AU QUÉBEC DE 1977 À 1997 MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN HISTOIRE PAR PIERRE-LUC BILODEAU AVRIL 2016 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs (SDU-522- Rév.07-2011). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et noh commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» RÉSUMÉ La Charte de la langue française, également connue sous le nom de loi 101, survient à la suite de plusieurs années de tensions sur le plan linguistique. Celle-ci fait basculer les francophones québécois du statut de groupe minoritaire à celui de majoritaire. -

Full Text (PDF)
Document generated on 09/25/2021 11:07 a.m. Études internationales II – Les relations extérieures du Québec Hélène Galarneau Volume 21, Number 1, 1990 URI: https://id.erudit.org/iderudit/702625ar DOI: https://doi.org/10.7202/702625ar See table of contents Publisher(s) Institut québécois des hautes études internationales ISSN 0014-2123 (print) 1703-7891 (digital) Explore this journal Cite this article Galarneau, H. (1990). II – Les relations extérieures du Québec. Études internationales, 21(1), 144–152. https://doi.org/10.7202/702625ar Tous droits réservés © Études internationales, 1990 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ 144 Hélène GALARNEAU et Manon TESSIER au Zimbabwe, M. Dean John Browne, ambassadeur en Colombie avec accréditation simultanée en Equateur, Mme Ingrid Marianne Hall est nommée ambassadrice en Indonésie et M. Peter Julian Arthur Hancock, ambassadeur en Pologne avec accréditation simultanée en République démocratique allemande. MM. Ernest Hé bert, Claude Laverdure et Allan Norman Lever sont respectivement nommés ambassadeur en Grèce, ambassadeur au Zaïre avec accréditation simultanée au Burundi et au Rwanda et ambassadeur en Arabie Saoudite avec accréditation simultanée au Yémen du Nord et au Yémen du Sud. Mme Anne Leahy sera dorénavant ambassadrice au Cameroun avec accréditation simultanée au Tchad; quand à Mme Nancy Stiles, elle sera Haut-Commissaire au Sri Lanka avec accrédi tation simultanée au Nicaragua, au El Salvador et au Honduras et ambassadeur au Mexique. -

Mémoire Des Délibérations Du Conseil Exécutif Séance Du 13 Octobre 1993 Sous La Présidence Du Premier Ministre Monsieur Ro
MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1993 À 11 H 00 SOUS LA PRÉSIDENCE DU PREMIER MINISTRE MONSIEUR ROBERT BOURASSA Membres du Conseil exécutif présents: Monsieur Robert Bourassa, Premier ministre Monsieur Gaston Blackburn, Ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Monsieur André Bourbeau, Ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle Monsieur Lawrence Cannon, Ministre des Communications Monsieur Normand Cherry, Ministre du Travail; ministre délégué aux Communautés culturelles Monsieur John Ciaccia, Ministre des Affaires internationales Monsieur Albert Côté, Ministre des Forêts Monsieur Marc-Yvan Côté, Ministre de la Santé et des Services sociaux; ministre dé 1égué à 1a Réforme électorale Monsieur Robert Outil, Ministre des Approvisionnements et Services Monsieur Sam Elkas, Ministre des Transports Madame Monique Gagnon-Tremblay, Ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration Monsieur Daniel Johnson, Ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, Président du Conseil du trésor Monsieur Gérard D. Levesque, Ministre des Finances Monsieur Robert Middlemiss, Ministre délégué aux Transports Monsieur Pierre Paradis, Ministre de l'Environnement Monsieur Gil Rémillard, Ministre de la Justice; ministre délégué aux Affaires intergouver nementales canadiennes Madame Louise Robic, Ministre déléguée aux Finances Madame Lucienne Robillard, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et Ministre de l'Ëducation Monsieur Claude Ryan, Ministre