Full Text (PDF)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mémoires Des Délibérations Du Conseil Exécutif
.i MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF SÉANCE DU Il JANVIER 1989 A 10 H 30 SOUS LA PRÉSIDENCE DU PREMIER MINISTRE MONSIEUR ROBERT BOURASSA Membres du Conseil exécutif présents: Monsieur Robert Bourassa, Premier ministre Madame Lise Bacon, Vice-Première ministre; ministre des Affaires culturelles et ministre de 1 1 Environnement Monsieur André Bourbeau, Ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Monsieur John Ciaccia, Ministre de l 1 Énergie et des Ressources Monsieur Marc-Yvan Côté, Ministre des Transports Monsieur Robert Outil, Ministre des Communications Monsieur Pierre Fortier, Ministre délégué aux Finances et à la Privatisation Monsieur Paul Gobeil, Ministre des Affaires internationales Monsieur Daniel Johnson, Ministre délégué à l'Administration, Président du Conseil du trésor Madame Thérèse Lavoie-Roux, Ministre de la Santé et des Services sociaux Monsieur Gérard D. Levesque Ministre des Finances Monsieur Pierre MacDonald, Ministre de 1 1 Industrie, du Commerce et de la Technologie Monsieur Gil Rémillard, Ministre de la Justice, ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre de la Sécurité publique Monsieur Guy Rivard, Ministre délégué aux Affaires culturelles Madame Louise Robic, Ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration Monsieur Claude Ryan, Ministre de 1 1 Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science Monsieur Raymond Savoie, Ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones Monsieur André Vallerand, Ministre des Approvisionnements et Services MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS LE Il JANVIER 1989 POLITIQUE DE LA SANTÉ MENTALE AU QUÉBEC (Réf.: 8-0327) La mi ni stre de 1a Santé et des Servi ces soci aux soumet un mémoi re portant sur 1a politique de 1a santé mentale au Québec. -

Impacts De La Loi 101 Sur La Culture Politique Au Québec De 1977 À 1997
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL IMPACTS DE LA LOI 101 SUR LA CULTURE POLITIQUE AU QUÉBEC DE 1977 À 1997 MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN HISTOIRE PAR PIERRE-LUC BILODEAU AVRIL 2016 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs (SDU-522- Rév.07-2011). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et noh commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» RÉSUMÉ La Charte de la langue française, également connue sous le nom de loi 101, survient à la suite de plusieurs années de tensions sur le plan linguistique. Celle-ci fait basculer les francophones québécois du statut de groupe minoritaire à celui de majoritaire. -

Mémoire Des Délibérations Du Conseil Exécutif, Séance Du 31 Mars 1993
••---.· MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF SÉANCE DU 31 MARS 1993 A 16 h 15 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DE L1 ÉNERGIE ET DES RESSOURCES MADAME LISE BACON Membres du Conseil exécutif présents: Madame Lise Bacon, Vice-Première ministre; ministre de l'Ënergie et des Ressources Monsieur Gaston Blackburn, Ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Monsieur André Bourbeau, Ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle Monsieur Lawrence Cannon, Ministre des Communications Monsieur Albert Côté, Ministre des Forêts Monsieur Marc-Yvan Côté, Ministre de la Santé et des Services sociaux; ministre délégué à la Réforme électorale Monsieur Robert Outil, Ministre des Approvisionnements et Services Monsieur Sam Elkas, Ministre des Transports Madame Monique Gagnon-Tremblay, Ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration Monsieur Daniel Johnson, Ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, Président du Conseil du trésor Monsieur Gérard D. Levesque, Ministre des Finances Monsieur Robert Middlemiss, Ministre délégué aux Transports Monsieur Pierre Paradis, Ministre de l'Environnement Monsieur Yvon Picotte, Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales Monsieur Gil Rémillard, Ministre de la Justice; ministre délégué aux Affaires intergouver nementales canadiennes Monsieur Guy Rivard, Ministre délégué aux Affaires internationales Madame Louise Robic, Ministre déléguée aux Finances -

Les Relations Extérieures Du Québec Manon Tessier
Document généré le 2 oct. 2021 08:18 Études internationales II- Les relations extérieures du Québec Manon Tessier XXème anniversaire d’Études internationales Volume 22, numéro 1, 1991 URI : https://id.erudit.org/iderudit/702796ar DOI : https://doi.org/10.7202/702796ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Institut québécois des hautes études internationales ISSN 0014-2123 (imprimé) 1703-7891 (numérique) Découvrir la revue Citer ce document Tessier, M. (1991). II- Les relations extérieures du Québec. Études internationales, 22(1), 156–162. https://doi.org/10.7202/702796ar Tous droits réservés © Études internationales, 1991 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ 156 Manon TESSIER II - Les relations extérieures du Québec (octobre à décembre 1990) A — Aperçu général Conséquence de la crise amérindienne qui avait marqué l'été 1990 au Québec, un remaniement ministériel était annoncé sitôt le trimestre amorcé. Bien que quatorze changements aient été apportés à la formation du Conseil des ministres, le remanie ment ne transférait pas de nouveaux titulaires aux ministères de l'Énergie, de l'Immigration, de l'Industrie et du Commerce ou des Finances. -

Journal Des Débats
Journal des débats Le mardi 14 mars 1989 Vol. 30 - No 87 Table des matières Affaires courantes Dépôt de documents Crédits supplémentaires no 3,1988-1989 4711 Renvoi à la commission plénière 4711 Rapports annuels du ministère des Affaires culturelles, de la Société du Grand Théâtre de Québec et de la Régie du cinéma 4711 Rapport annuel du Conseil des collèges 4711 Décret concernant l'approbation du plan quinquennal d'investissements universitaires 1988-1993 4711 Rapport sur la mise en oeuvre de la Loi sur la fonction publique 4711 Dépôt de rapports de commissions Vérification des engagements financiers 4711 Consultation générale sur l'énoncé de politique sur les services de garde à l'enfance 4712 Vérification des engagements financiers 4712 Examen des orientations, des activités et de la gestion de la Société de la Place des Arts 4712 Vérification des engagements financiers 4712 Étude du rapport d'activités 1987-1988 de la Commission d'accès à l'information 4712 Vérification des engagements financiers 4712 Étude trimestrielle de la politique budgétaire du gouvernement et de l'évolution des finances publiques 4712 Examen du rapport annuel du Vérificateur général 4712 Consultation générale sur l'opportunité de maintenir en vigueur et de modifier la Loi sur les valeurs mobilières et examen de l'avant-projet de loi sur les valeurs mobilières 4713 Étude détaillée du projet de loi 104 - Loi électorale 4713 Consultations particulières sur les volets "réseau routier" et "transport collectif du plan d'action 1988-1998 - "Le transport dans la région de Montréal" 4713 Intervention portant sur une question de fait personnel 4713 M. -

Journal Des Débats
Journal des débats Le jeudi 22 décembre 1988 Vol. 30 - No 85 Table des matières Affaires courantes Déclarations ministérielles Déduction supplémentaire de 33 1 /3 % à l'égard des frais d'exploration des ressources engagés au Québec et autres mesures fiscales M. Gérard D. Levesque 4603 M. Jean-Guy Parent 4604 M. Gérard D. Levesque (réplique) 4605 Présentation de projets de loi Projet de loi 108 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables et modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 4605 Mme Lise Bacon 4605 Projet de loi 112 - Loi sur la voirie et modifiant diverses dispositions législatives 4606 M. Marc-Yvan Côté 4606 Dépôt de documents Rapport annuel du Musée du Québec 4606 Rapport annuel du Conseil supérieur de l'éducation (CSE) 4606 Rapport annuel du ministère des Transports 4606 Rapport annuel du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration 4606 Organismes invités dans le cadre des consultations particulières sur le transport dans la région de Montréal 4607 Dépôt de rapports de commissions Étude détaillée du projet de loi 58 - Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Éducation 4607 Dépôt de pétitions Confirmer l'usage exclusif de la langue française tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des commerces 4607 Questions et réponses orales Affichage à l'intérieur des commerces 4608 Les plaintes pour affichage illégal qui avaient déjà été portées 4610 Incendie au dépotoir de pneus usés de Franklin 4611 Vente des actifs de l'institut Armand-Frappier 4612 Indexation des prestations d'aide sociale 4613 Fichier des fournisseurs de services ouvert aux compagnies ontariennes 4614 Statut de l'équipe québécoise aux Jeux de la francophonie 4615 Subventions du fédéral pour promouvoir l'anglais dans les établissements de santé et les municipalités du Québec 4616 Motions sans préavis Condoléances à la famille de M. -

Journal Des Débats
Journal des débats Le lundi 16 décembre 1985 Vol. 29 - No 1 Table des matières Affaires du jour Dépôt des listes des candidats proclamés élus à la suite des élections du 2 décembre 1985 1 Démission de M. Germain Leduc comme député de Saint-Laurent 1 Élection du président, M. Pierre Lorrain 1 Allocution d'acceptation 1 Élection du vice-président, M. Jean-Pierre Saintonge 2 Élection de la vice-présidente, Mme Louise Bégin 2 Voeux au président M. Pierre-Marc Johnson 2 Allocution d'ouverture Le lieutenant-gouverneur 3 Discours d'ouverture Mme Lise Bacon 5 Renseignements sur les travaux de l'Assemblée 9 Ajournement 10 Annexe: Membres du Conseil des ministres 11 Liste des membres de l'Assemblée nationale 12 Adjoints parlementaires 14 1 (Quinze heures sept minutes) M. Johnson (Anjou): M. le doyen de la députation et Mme la première ministre par Dépôt des listes des candidats intérim, ou vice-première ministre, j'ai en proclamés élus à la suite effet été informé par le chef du gouver- des élections du 2 décembre nement qu'il désirait attribuer la fonction de président de la Chambre à celui que nous Le Secrétaire général: J'ai l'honneur de allons bientôt élire. Je voudrais simplement déposer les listes des candidats proclamés m'assurer de faire un certain nombre de élus à la suite des élections générales du 2 rappels dans ces circonstances. Je crois que décembre 1985. je dois le faire maintenant, M. le doyen, ou dois-je attendre que le nouveau président soit Démission de M. Germain Leduc parmi nous par la suite? Nous sommes comme député de Saint-Laurent sûrement consentants à aller chercher le député. -

C-10 CANADA YEAR BOOK the Hon. Michel Page Minister Of
C-10 CANADA YEAR BOOK The Hon. Michel Page The Hon. Sean Conway Minister of Agriculture, Fisheries and Food Minister of Mines and Government House Leader The Hon. Yvon Picotte The Hon. James Bradley Minister of Recreation, Hunting and Fishing, and Minister of the Environment Minister responsible for Fisheries The Hon. Ian G. Scott The Hon. John Ciaccia Attorney General and Minister responsible for Native Minister of Energy and Resources Affairs The Hon. Marc-Yvan Cote The Hon. Jack Riddell Minister of Transport Minister of Agriculture and Food The Hon. Therese Lavoie-Roux The Hon. John Eakins Minister of Health and Social Services Minister of Municipal Affairs The Hon. Pierre Paradis The Hon. Vincent Kerrio Minister of Municipal Affairs Minister of Natural Resources The Hon. Daniel Johnson The Hon. Hugh O'Neil President of the Treasury Board and Minister respon Minister of Tourism and Recreation sible for Administration The Hon. John Sweeney The Hon. Pierre Fortier Minister of Community and Social Services Minister responsible for Finance and Privatization The Hon. Murray Elston Chairman of the Management Board, Minister of The Hon. Andre Bourbeau Financial Institutions and Chairman of Cabinet Minister of Manpower and Income Security The Hon. William Wrye The Hon. Pierre MacDonald Minister of Consumer and Commercial Relations Minister of Industry, Commerce and Technology The Hon. Bernard Grandmaitre The Hon. Paul Gobeil Minister of Revenue and Minister responsible for Minister of International Affairs Francophone Affairs The Hon. Yves Seguin The Hon. Alvin Curling Minister of Revenue and Minister of Labour Minister of Skills Development The Hon. Andre Vallerand The Hon. -
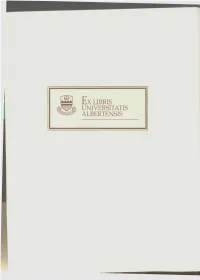
Nsri Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS
n s r i AAAA Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS nh-t? gouvernement du Québec public accounts for the year ended March 31, 1984 cfl volume 2 details of expenditure Published under section 71 of the Financial Administration Act (R.S.Q., c. A-6) Gouvernement du Québec Ministère des Finances ISSN 0706-2869 ISBN 2-551-08944-1 (Complete Edition) ISBN 2-551-08947-6 (Volume 2) Legal deposit — 4th Quarter, 1984 Bibliothèque nationale du Québec University library UNIVERSITY OF A! Of-DT TABLE OF CONTENTS SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES 1 LIST OF CAPITAL ASSETS 2 1-1 SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES The list of suppliers or bénéficiai ries for each category of expenditure NOTES except “Transfer Payments” is issued by department according to the following publishing limits and criteria: Sums paid to "Various persons" have not been detailed by supplier or (a) Salaries, wages, allowances and other remuneration: beneficiary in the following cases — Ministers, deputy ministers and senior executives of equivalent allowances to private forest owners in the framework of interest on their rank: complete listing borrowings from forestry credit (Office du crédit agricole du Québec) and — Managerial staff (managers, executive assistants and public to farmers in the framework of interest on their borrowings from the Office servants of equivalent rank): complete listing; du crédit agricole du Québec, farm credit provided by private institutions, farm improvement, production assistance, special assistance, farm loans — Any allowance: $11 000 or more; (Société du crédit agricole du Canada), development of farming operations — Employer’s contributions: $22 000 or more. -

L'office Franco-Québécois Pour La Jeunesse
L’Office franco-québécois pour la jeunesse 177 L’Offi ce franco-québécois pour la jeunesse, un acteur majeur de la coopération franco-québécoise 178 L’Office franco-québécois pour la jeunesse L’Office franco-québécois C’est au cours du voyage historique pour la jeunesse, un du président de Gaulle au Québec en 1967, que naît l’idée de créer l’Office acteur majeur de la franco-québécois pour la jeunesse. Le coopération franco- général, qui soumet l’idée au Premier québécoise ministre québécois Daniel Johnson, souhaite ainsi « rebâtir les ponts entre le Québec et la France » en favo risant Créé en 1968 par les gouvernements de le rapprochement des jeunes adultes. la République française et du Québec, l’Office franco-québécois pour la Le protocole fondant l’OFQJ est signé jeunesse (OFQJ) a pour mission initiale le 9 février 1968, par François Misoffe, de contribuer au rapprochement des ministre de la Jeunesse et des Sports du jeunesses française et québécoise. gouvernement français et Jean-Marie Morin, ministre québécois de la Jeunesse, Organisme bigouvernemental implanté des Loisirs et des Sports. Jean-Claude en France et au Québec, il est régi par Quyollet, collaborateur de François un conseil d’administration composé Misoffe, et Jean-Paul L’Allier, alors de huit membres français et de huit directeur de la Coopération au ministère membres québécois, coprésidé par le des Affaires culturelles du Québec, ministre français de la Jeunesse, des Sports les artisans de ce protocole, seront les et de la Vie associative et par le ministre premiers secrétaires généraux de l’OFQJ. -

Bibliothèque De L'assemblée Nationale Du Québec
gouvernement du Québec comptes publics année financière terminée le 31 mars 1985 il des dépenses F5A 1 C6/ 1984/85 2 EX.B QL P. Gouv Québec:::: gouvernement du Québec comptes publics année financière terminée le 31 mars 1985 di □ volum e 2 / détail des dépenses ^ , MAI 23 1986 \ Publiés conformément aux dispositions de l’article 71 de la Loi sur l’administration financière (L.R.Q., c. A-6) Gouvernement du Québec Ministère des Finances ISSN 0706-2869 ISBN 2-551-09111-X (édition complète) ISBN 2-551-09115-2 (volume 2) Dépôt légal — 4e trimestre 1985 Bibliothèque nationale du Québec TABLE DES MATIERES SECTION LISTE DES FOURNISSEURS ET BÉNÉFICIAIRES 1 LISTE DES BIENS EN CAPITAL 2 1-1 SECTION LISTE DES FOURNISSEURS ET BÉNÉFICIAIRES Pour chaque catégorie de dépenses, sauf « Dépenses de transfert», NOTES la liste des fournisseurs ou bénéficiaires est émise au niveau du ministère selon les limites et critères de publication suivants: Ne sont pas détaillées au nom des fournisseurs ou bénéficiaires les sommes a) Traitements, salaires, allocations et autres rémunérations: ayant été versées à «Diverses personnes» à savoir: — Ministres, sous-ministres et hauts fonctionnaires de rang Allocations aux propriétaires de forêts privées dans le cadre des intérêts sur équivalent: tout montant; leurs emprunts auprès du crédit forestier (Office du crédit agricole du Québec) — Personnel cadre (administrateurs, directeurs de cabinet et et aux agriculteurs dans le cadre des intérêts sur leurs emprunts auprès de fonctionnaires de rang équivalent): tout montant; l’Office du crédit agricole du Québec, du crédit agricole par les institutions — Toute allocation: 11 000 $ et plus; privées, de l’amélioration des fermes, du crédit à la production, du crédit spécial, du prêt agricole (Société du crédit agricole du Canada), de la mise — Contributions de l’employeur: 22 000 $ et plus. -

Journal Des Débats
Journal des débats Le mardi 21 octobre 1986 Vol. 29 - No 50 Table des matières Affaires courantes Déclarations ministérielles L'état des négociations dans les secteurs public et parapublic M. Paul Gobeil 3327 M. François Gendron 3328 M. Paul Gobeil (réplique) 3329 Dépôt de documents Avis de la Commission des biens culturels sur: le classement de l'église de Cap-Santé, le classement de l'Uniyersity Club de Montréal, le déclassement du site d'établissement de Jos. Morin Auclair Rapports annuels du Musée de la civilisation Rapport annuel de la Commission des biens culturels Rapport annuel de l'Institut québécois du cinéma Rapport annuel du Musée d'art contemporain de Montréal 3330 Rapport annuel de l'Office des professions du Québec Rapport annuel de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec Rapport annuel de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Rapport annuel de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Rapport annuel de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Rapport annuel de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec Rapport annuel de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec Rapport annuel de l'Ordre des architectes du Québec Rapport annuel de l'Ordre des chimistes du Québec Rapport annuel de l'Ordre des audioprothésistes du Québec 3330 Documents sur la privatisation de Quebecair 3330 Décisions du Bureau de l'Assemblée 3330 Diagramme de l'Assemblée