World Bank Document
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

August – October 2017 – Projected Situation: November to March 2018 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
INTEGRATED FOOD SECURITY CLASSIFICATION Current situation: August – October 2017 – Projected situation: November to March 2018 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA IPC analysis carried out from 9 to 15 October 2017 for the South and the South East of Madagascar KEY OUTPUTS OF FOOD INSECURITY FROM AUGUST TO OCTOBER 2017 % POPULATION NEEDING EMERGENCY ACTION (PHASE 3 & 4 OF The most affected areas: IPC) Districts in emergency without humanitarian assistance (IPC Phase 3 !): AMBOASARY SUD and Percentage1 of household and number of people who need emergency the four communes in the district of Taolagnaro (Ranopiso, Analapatsy, Andranobory, action to proctect their livelihood and reduce food shortage from August Ankariera) to October 2017, in the areas affected by natural disaster (drought/flood) Districts in crisis (IPC Phase 3): VANGAINDRANO, FARAFANGANA, TULEAR II – (Commune of in the districts of the South and South East of Madagascar and compared Beheloka/Efoetse), AMPANIHY, BETIOKY, AMBOVOMBE, BELOHA, BEKILY, TSIHOMBE to the situation from March to May 2017. Districts in stressed (IPC Phase 2) : VOHIPENO and MANAKARA. For all the analyzed geographical area, 9% of the population (approximately 261 388 persons) are in emergency phase (IPC phase 4) and 34% of the population (approximately 1 027 783 persons) is classified in crisis phase (IPC phase 3). Food consumption: In the South East, the District of Farafangana records a high proportion of households having a poor FCS (Food Consumption Score) (20,1%) ; the other districts have a rate ranging from 3 and 7,8%. With regard to the South, Ampanihy, Beloha, Tsihombe, the 4 Communes of Taolagnaro, Bekily, and Toliara II recorded an FCS exceding 20%. -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin de la première décade de janvier 2015 (2015-D01) SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation éco-météorologique : page 1 Situation acridienne : page 3 Ministère de l’Agriculture Situation antiacridienne : page 8 Synthèse : page 10 Annexes : page 13 SITUATION ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUE Durant la 1ère décade de janvier 2015, un fort gradient pluviométrique Nord-Est/Sud-Ouest concernait Madagascar induisant une très forte pluviosité dans l’Aire d’invasion Nord, une pluviosité moyenne à forte dans l'Aire d’invasion Centre et une pluviosité souvent faible à moyenne dans l'Aire grégarigène. Les informations pluviométriques étaient contradictoires, selon les sources : x les estimations de FEWS-NET (figure 1) indiquaient que la pluviosité était supérieure à 125 mm au nord de la Grande-Île et qu’elle diminuait progressivement de 20 à 30 mm sur des bandes diagonales successives de 100 à 200 km de large à partir du nord et jusqu’au sud du pays ; x le peu de relevés transmis par le Centre National Antiacridien (annexe 1) indiquait que la pluviosité était très forte dans l’Aire grégarigène transitoire, moyenne à forte dans l’Aire de multiplication initiale ainsi que dans la majeure partie de l’Aire transitoire de multiplication et faible à moyenne dans l’Aire de densation, ce qui différait des estimations de FEWS-NET pour l’Aire grégarigène. Dans l’Aire grégarigène, compte tenu des relevés pluviométriques faits par le CNA, les conditions hydriques étaient fort erratiques : dans l’Aire grégarigène transitoire, elles étaient excédentaires par rapport aux besoins du Criquet migrateur malgache solitaire, dans l’Aire de multiplication initiale Centre, elles étaient favorables au développement et à la reproduction du Locusta migratoria capito et dans les secteurs Sud de l’Aire transitoire de multiplication et de l’Aire de densation, les pluies restaient peu abondantes. -

Rano HP Et Ranon'ala
EVALUATION OF THE USAID/MADAGASCAR WATER SUPPLY, SANITATION AND HYGIENE BILATERAL PROJECTS: RANO HP ET RANON’ALA September 2014 This publication was produced at the request of the United States Agency for International Development. It was prepared independently by CAETIC Développement ACKNOWLEDGEMENTS The authors would like to acknowledge Jean-Claude RANDRIANARISOA, COR, for his constant guidance during this whole assignment. Discussions and exchanges we had with him were always fruitful and encouraging and of a high technical level. This document could not have reached this level of quality without the invaluable inputs from Jacky Ralaiarivony and from USAID Madagascar Program Office staff, namely Vololontsoa Raharimalala. The authors: Balsama ANDRIANTSEHENO Jean Marie RAKOTOVAO Ramy RAZAFINDRALAMBO Jean Herivelo RAKOTONDRAINIBE FINAL EVALUATION OF USAID/MADAGASCAR WSSH PROJECTS: EVALUATION OF THE USAID/MADAGASCAR WATER SUPPLY, SANITATION AND HYGIENE BILATERAL PROJECTS: RANO HP ET RANON’ALA SEPTEMBER 9, 2014 CONTRACT N° AID-687-C-13-00004 DISCLAIMER The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. CONTENTS ...................................................................................................................................................................... 1 LIST OF ACRONYMS ................................................................................................................................... -

Distr. GENERAL CRC/C/8/Add.5 13 September 1993 ENGLISH Original
Distr. GENERAL CRC/C/8/Add.5 13 September 1993 ENGLISH Original: FRENCH COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES PURSUANT TO ARTICLE 44 OF THE CONVENTION Initial reports of States parties due in 1993 Addendum MADAGASCAR [20 July 1993] CONTENTS Paragraphs Page Introduction ........................ 1- 4 4 I. GENERAL PRINCIPLES .................. 5-34 4 A. Non-discrimination ................ 7-20 4 B. Best interests of the child............ 21-26 7 C. Right to life, survival and development...... 27-31 8 D. Respect for the views of the child ........ 32-34 9 II. BASIC HEALTH AND WELFARE ............... 35-64 10 A. Survival and development ............. 36-43 10 B. Disabled children................. 44-49 11 C. Health and health services ............ 50-61 12 GE.93-18558 (E) CRC/C/8/Add.5 page 2 CONTENTS (continued) Paragraphs Page D. Social security.................. 62- 64 14 E. Standard of living ................ 65- 66 14 III. CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS............... 67-154 15 A. Right of the child to an identity (art. 7) and preservation of identity (art. 8)......... 70-101 15 B. Freedom of expression (art. 13), freedom of thought, conscience and religion (art. 14) and access to information (art. 17).......... 102-139 21 C. Freedom of association and peaceful assembly (art. 15)..................... 140 28 D. Protection of privacy (art. 16).......... 141 28 E. Right not to be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 37 (a)) ............. 142-154 28 IV. FAMILY ENVIRONMENT AND ALTERNATIVE CARE........ 155-210 31 A. Parental guidance (art. 5) ............ 155-166 31 B. -

Rep 2 out Public 2010 S Tlet Sur of Ma Urvey Rvey Adagas Repor Scar Rt
Evidence for Malaria Medicines Policy Outlet Survey Republic of Madagascar 2010 Survey Report MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE www. ACTwatch.info Copyright © 2010 Population Services International (PSI). All rights reserved. Acknowledgements ACTwatch is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This study was implemented by Population Services International (PSI). ACTwatch’s Advisory Committee: Mr. Suprotik Basu Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Rik Bosman Supply Chain Expert, Former Senior Vice President, Unilever Ms. Renia Coghlan Global Access Associate Director, Medicines for Malaria Venture (MMV) Dr. Thom Eisele Assistant Professor, Tulane University Mr. Louis Da Gama Malaria Advocacy & Communications Director, Global Health Advocates Dr. Paul Lavani Executive Director, RaPID Pharmacovigilance Program Dr. Ramanan Senior Fellow, Resources for the Future Dr. Matthew Lynch Project Director, VOICES, Johns Hopkins University Centre for Dr. Bernard Nahlen Deputy Coordinator, President's Malaria Initiative (PMI) Dr. Jayesh M. Pandit Head, Pharmacovigilance Department, Pharmacy and Poisons Board‐Kenya Dr. Melanie Renshaw Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Oliver Sabot Vice‐President, Vaccines Clinton Foundation Ms. Rima Shretta Senior Program Associate, Strengthening Pharmaceutical Systems Dr. Rick Steketee Science Director, Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa Dr. Warren Stevens Health Economist Dr. Gladys Tetteh CDC Resident Advisor, President’s Malaria -
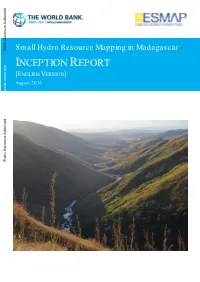
Small Hydro Resource Mapping in Madagascar
Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -

Expérimentation Et Diffusion De La Variété De Pomme De Terre Bandy Akama Dans Le District De Betroka
Développement des chaînes de valeur et augmentation du revenu Expérimentation et diffusion de la variété de pomme de terre Bandy Akama dans le District de Betroka La pomme de terre occupe la quatrième 1. Trouver une solution pour l’augmentation du revenu place derrière le riz, le manioc et la patate des paysans afin de réduire la période de soudure douce en termes d’alimentation de base de la population Malagasy. Elle est surtout produite en milieu rural comme une culture Les divers ateliers de concertation avec les comme : l’aménagement et la préparation de rente, mais peut constituer un producteurs en 2014 dans 21 communes du sol, la fertilisation, le semis, l’entretien complément alimentaire lorsque le riz vient avaient mis en exergue que i) le district de à manquer. Initialement cultivée dans les et la récolte. Durant la phase de diffusion régions des hauts plateaux de Madagascar, Betroka dispose une potentialité agricole des résultats, les PL ont assuré l’appui et la pomme de terre commence à se cultiver pour cette spéculationà peine exploitée conseil des producteurs-adoptants. dans d’autres régions tempérées du pays, ii) les principales cultures vivrières, dont le grâce au développement d’itinéraires riz et le manioc, ne sont plus suffisantes Les PL sont des paysans volontaires, mais techniques améliorés. pour répondre aux besoins alimentaires de ils sont conscients du risque d’échec comme la population. de réussite au cours de l’expérimentation. Ainsi, ADRA, dans le cadre du projet ASARA, a introduit cette spéculation par des tests De 2015 à 2016, des tests variétaux ont L’existence d’une intervention antérieure variétaux dans 21 communes du district d'abord été réalisés pour identifier les variétés de Betroka, durant 2 contre-saisons du Fert, en 2005 dans la commune de successives, avant de diffuser les variétés de pomme de terre les plus adaptées aux Tsaraitso, qui a initié la promotion de la adaptées dans l’ensemble de la zone. -

6303 Benenitra
RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: BENENITRA Commune: AMBALAVATO Code Bureau: 630301010101 AMBALAVATO EPP AMBALAVATO INSCRITS: 357 VOTANTS: 143 BLANCS ET NULS: 10 SUFFRAGE EXPRIMES: 133 N° Partie Voix Poucentage 1 IRD 5 3,76% 2 INDEPENDANT RANDRIANANDRAINA THÉOPHILE CHRISTI 12 9,02% 3 FIASIA ALIMINE MAHANDRISOA 12 9,02% 4 INDEPENDANT NOMENJANAHARY ANDRÉ TOJISOA 11 8,27% 5 INDEPENDANT RADIMBISOLONDRAINY SEVERIN HERVET 93 69,92% Total des voix 133 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: BENENITRA Commune: AMBALAVATO Code Bureau: 630301020101 ANGODOGODO BUR FKT ANGODOGODO INSCRITS: 158 VOTANTS: 74 BLANCS ET NULS: 5 SUFFRAGE EXPRIMES: 69 N° Partie Voix Poucentage 1 IRD 5 7,25% 2 INDEPENDANT RANDRIANANDRAINA THÉOPHILE CHRISTI 25 36,23% 3 FIASIA ALIMINE MAHANDRISOA 8 11,59% 4 INDEPENDANT NOMENJANAHARY ANDRÉ TOJISOA 20 28,99% 5 INDEPENDANT RADIMBISOLONDRAINY SEVERIN HERVET 11 15,94% Total des voix 69 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: BENENITRA Commune: AMBALAVATO Code Bureau: 630301030101 ANKATRAFAY BUR FKT ANKATRAFAY INSCRITS: 130 VOTANTS: 100 BLANCS ET NULS: 0 SUFFRAGE EXPRIMES: 100 N° Partie Voix Poucentage 1 IRD 6 6,00% 2 INDEPENDANT RANDRIANANDRAINA THÉOPHILE CHRISTI 30 30,00% 3 FIASIA ALIMINE MAHANDRISOA 10 10,00% 4 INDEPENDANT NOMENJANAHARY ANDRÉ TOJISOA 24 24,00% 5 INDEPENDANT RADIMBISOLONDRAINY SEVERIN HERVET 30 30,00% Total des voix 100 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: BENENITRA Commune: AMBALAVATO Code Bureau: 630301040101 BEFAMATA EPP BEFAMATA INSCRITS: 166 VOTANTS: 108 BLANCS ET NULS: 2 SUFFRAGE -

Mineral Rights to Human Rights: Mobilising Resources from the Extractive Industries for Water, Sanitation and Hygiene
Mineral rights to human rights: mobilising resources from the Extractive Industries for water, sanitation and hygiene Case Study: Madagascar October 2018 Case Study : Madagascar TABLE OF CONTENTS 1. CONTEXT ........................................................................................................ 4 2. SCOPE OF THE WORK .................................................................................. 4 3. KEY CHALLENGES ........................................................................................ 5 3.1. Data availability and quality ..................................................................... 5 3.2. Attribution and impact of Extractive Industry contributions ...................... 5 4. APPROACH AND METHODOLOGY .............................................................. 6 4.1. Countries for study .................................................................................. 6 4.2. Methodology ............................................................................................ 6 5. CONTEXTUAL INFORMATION ON THE EXTRACTIVE INDUSTRIES .......... 7 5.1. Overview of Madagascar and the Extractive Industries (EI) .................... 7 5.2. Reforms undertaken to increase transparency ...................................... 10 5.3. Institutional and legal framework for the EI ............................................ 11 5.4. Contribution of the EI to the economy ................................................... 19 5.5. Collection and distribution of revenues from the EI .............................. -

Résultats Détaillés Toliary
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 6 TOLIARY BV reçus: 304 sur 304 HVM IND OBAMA FITIBA AVOTS AREMA MAPAR IND IND TIM IND IND MONIM AJFO E OMBILA MIARA- MASOA TSIMAN A TANIND HY DIA NDRO AVAKE N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E RAZA MAHER Y REGION 61 ANDROY BV reçus 58 sur 58 DISTRICT: 6101 AMBOVOMBE ANDROY BV reçus21 sur 21 01 AMBANISARIKA 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 02 AMBAZOA 0 0 8 7 1 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 03 AMBOHIMALAZA 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 04 AMBONAIVO 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 05 AMBONDRO 0 0 8 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 AMBOVOMBE ANDRO 1 0 12 12 2 10 7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 07 AMPAMATA 1 0 8 8 1 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 08 ANALAMARY 0 0 6 6 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 09 ANDALATANOSY 0 0 8 7 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 ANDOHARANO 1 0 6 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ANDRAGNANIVO 0 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 ANJEKY ANKILIKIRA 1 0 8 8 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 ANTANIMORA SUD 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 ERADA 0 0 8 8 1 7 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 15 IMANOMBO 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 16 JAFARO 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 17 MAROALOMAINTE 1 0 8 8 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 18 MAROALOPOTY 0 7 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 MAROVATO BEFENO 0 0 8 7 0 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 SIHANAMARO 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 TSIMANANADA 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 TOTAL DISTRICT 5 7 166 160 18 142 91 1 0 0 2 1 3 7 9 0 0 0 28 DISTRICT: 6102 BEKILY BV reçus20 sur -

Exploitation Traditionnelle Du Sel 2
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE -------------------- UNIVERSITE DE TOLIARA -------------------- FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ---------------------- DÉPARTEMENT D ’H ISTOIRE Mémoire de maîtrise Présenté par : RASOLONDRAINY Tanambelo Vassili Reinaldo Sous la direction de Monsieur MANJAKAHERY Barthélemy Maître de conférences à l’Université de Toliara Date de soutenance : 26 Mars 2009 ANNEE UNIVERSITAIRE : 2007 - 2008 AVANT-PROPOS Au début de ce travail, nous voudrions faire connaître aux lecteurs, que nous dédions ce Mémoire de Maîtrise aux sauniers de la Commune rurale de Tameantsoa, pour mettre en valeur leur activité, et pour les remercier de nous avoir accepté parmi eux pendant notre séjour sur le terrain. Cette initiation à la recherche intitulée « L’exploitation traditionnelle du sel gemme dans la commune rurale de Tameantsoa (moyenne vallée de l’Onilahy) » est encore un nouveau thème dans la recherche déjà effectuée dans la région. La rareté des ouvrages et des articles concernant le thème traité, la réticence des personnes ressources,… rendent le travail pénible. Néanmoins, notre grande foi en l’archéologie, comme source privilégiée de l’Histoire malgache, nous a incité de réaliser cette étude ethnoarchéologique. Nous n’aurions peut-être pas pu la finir sans la bonté de l’Eternel, et l’appui de nombreuses personnes que nous devons remercier ici : De prime abord, nous tenons à remercier grandement Monsieur MANJAKAHERY Barthélemy, Directeur de mémoire, de nous avoir conseillé pour la réalisation de cette étude. Son encadrement nous a été tellement utile. Qu’il trouve ici l’expression de notre profonde reconnaissance. Nous avons aussi un énorme devoir de gratitude à Madame Chantal RADIMILAHY, Coordinatrice nationale du Projet « AFRICAN ARCHAEOLOGY NETWORK » à Madagascar, de nous avoir accordé ses appuis et qui nous a permis de terminer notre travail. -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin de la première décade de juin 2014 (2014-D16) SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Conditions éco-météorologiques : page 1 Situation acridienne : page 2 Situation antiacridienne : page 6 Annexes : page 10 CONDITIONS CONDITIONS ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUES ECO-METEOROLOGIQUES DURANT DURANT LA LA PREMIÈRE DEUXIEME DÉCADE DECADE DEDE JUIN JANVIER 2014 2014 Durant la 1ère décade, la pluviosité était nulle à très faible et donc hyper-déficitaire par rapport aux besoins du Criquet migrateur malgache dans toute la Grande-Île (figure 1). Les relevés (CNA) effectués dans l’Aire grégarigène montraient cependant que la plage optimale pluviométrique (annexe 1) était atteinte dans certaines localités des compartiments Centre et Sud de l’Aire de densation (11,5 mm à Efoetse, 38,0 mm à Beloha et 28,0 mm à Lavanono). Dans les zones à faible pluviosité, à l’exception de l’Aire d’invasion Est, les réserves hydriques des sols devenaient de plus en plus difficilement utilisables, le point de flétrissement permanent pouvant être atteint dans les biotopes les plus arides. Les strates herbeuses dans les différentes régions naturelles se desséchaient rapidement. En général, la hauteur des strates herbeuses variait de 10 à 80 cm selon les régions naturelles, les biotopes et les espèces graminéennes. Le taux de verdissement variait de 20 à 40 % dans l’Aire grégarigène et de 30 à 50 % dans l’Aire d’invasion. Les biotopes favorables au développement des acridiens se limitaient progressivement aux bas-fonds. Dans l’Aire grégarigène, le vent était de secteur Est tandis que, dans l’Aire d’invasion, les vents dominants soufflaient du Sud-Est vers le Nord- Ouest.