Exploitation Traditionnelle Du Sel 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin de la première décade de janvier 2015 (2015-D01) SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation éco-météorologique : page 1 Situation acridienne : page 3 Ministère de l’Agriculture Situation antiacridienne : page 8 Synthèse : page 10 Annexes : page 13 SITUATION ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUE Durant la 1ère décade de janvier 2015, un fort gradient pluviométrique Nord-Est/Sud-Ouest concernait Madagascar induisant une très forte pluviosité dans l’Aire d’invasion Nord, une pluviosité moyenne à forte dans l'Aire d’invasion Centre et une pluviosité souvent faible à moyenne dans l'Aire grégarigène. Les informations pluviométriques étaient contradictoires, selon les sources : x les estimations de FEWS-NET (figure 1) indiquaient que la pluviosité était supérieure à 125 mm au nord de la Grande-Île et qu’elle diminuait progressivement de 20 à 30 mm sur des bandes diagonales successives de 100 à 200 km de large à partir du nord et jusqu’au sud du pays ; x le peu de relevés transmis par le Centre National Antiacridien (annexe 1) indiquait que la pluviosité était très forte dans l’Aire grégarigène transitoire, moyenne à forte dans l’Aire de multiplication initiale ainsi que dans la majeure partie de l’Aire transitoire de multiplication et faible à moyenne dans l’Aire de densation, ce qui différait des estimations de FEWS-NET pour l’Aire grégarigène. Dans l’Aire grégarigène, compte tenu des relevés pluviométriques faits par le CNA, les conditions hydriques étaient fort erratiques : dans l’Aire grégarigène transitoire, elles étaient excédentaires par rapport aux besoins du Criquet migrateur malgache solitaire, dans l’Aire de multiplication initiale Centre, elles étaient favorables au développement et à la reproduction du Locusta migratoria capito et dans les secteurs Sud de l’Aire transitoire de multiplication et de l’Aire de densation, les pluies restaient peu abondantes. -

6303 Benenitra
RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: BENENITRA Commune: AMBALAVATO Code Bureau: 630301010101 AMBALAVATO EPP AMBALAVATO INSCRITS: 357 VOTANTS: 143 BLANCS ET NULS: 10 SUFFRAGE EXPRIMES: 133 N° Partie Voix Poucentage 1 IRD 5 3,76% 2 INDEPENDANT RANDRIANANDRAINA THÉOPHILE CHRISTI 12 9,02% 3 FIASIA ALIMINE MAHANDRISOA 12 9,02% 4 INDEPENDANT NOMENJANAHARY ANDRÉ TOJISOA 11 8,27% 5 INDEPENDANT RADIMBISOLONDRAINY SEVERIN HERVET 93 69,92% Total des voix 133 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: BENENITRA Commune: AMBALAVATO Code Bureau: 630301020101 ANGODOGODO BUR FKT ANGODOGODO INSCRITS: 158 VOTANTS: 74 BLANCS ET NULS: 5 SUFFRAGE EXPRIMES: 69 N° Partie Voix Poucentage 1 IRD 5 7,25% 2 INDEPENDANT RANDRIANANDRAINA THÉOPHILE CHRISTI 25 36,23% 3 FIASIA ALIMINE MAHANDRISOA 8 11,59% 4 INDEPENDANT NOMENJANAHARY ANDRÉ TOJISOA 20 28,99% 5 INDEPENDANT RADIMBISOLONDRAINY SEVERIN HERVET 11 15,94% Total des voix 69 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: BENENITRA Commune: AMBALAVATO Code Bureau: 630301030101 ANKATRAFAY BUR FKT ANKATRAFAY INSCRITS: 130 VOTANTS: 100 BLANCS ET NULS: 0 SUFFRAGE EXPRIMES: 100 N° Partie Voix Poucentage 1 IRD 6 6,00% 2 INDEPENDANT RANDRIANANDRAINA THÉOPHILE CHRISTI 30 30,00% 3 FIASIA ALIMINE MAHANDRISOA 10 10,00% 4 INDEPENDANT NOMENJANAHARY ANDRÉ TOJISOA 24 24,00% 5 INDEPENDANT RADIMBISOLONDRAINY SEVERIN HERVET 30 30,00% Total des voix 100 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: BENENITRA Commune: AMBALAVATO Code Bureau: 630301040101 BEFAMATA EPP BEFAMATA INSCRITS: 166 VOTANTS: 108 BLANCS ET NULS: 2 SUFFRAGE -

Résultats Détaillés Toliary
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 6 TOLIARY BV reçus: 304 sur 304 HVM IND OBAMA FITIBA AVOTS AREMA MAPAR IND IND TIM IND IND MONIM AJFO E OMBILA MIARA- MASOA TSIMAN A TANIND HY DIA NDRO AVAKE N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E RAZA MAHER Y REGION 61 ANDROY BV reçus 58 sur 58 DISTRICT: 6101 AMBOVOMBE ANDROY BV reçus21 sur 21 01 AMBANISARIKA 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 02 AMBAZOA 0 0 8 7 1 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 03 AMBOHIMALAZA 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 04 AMBONAIVO 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 05 AMBONDRO 0 0 8 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 AMBOVOMBE ANDRO 1 0 12 12 2 10 7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 07 AMPAMATA 1 0 8 8 1 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 08 ANALAMARY 0 0 6 6 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 09 ANDALATANOSY 0 0 8 7 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 ANDOHARANO 1 0 6 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ANDRAGNANIVO 0 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 ANJEKY ANKILIKIRA 1 0 8 8 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 ANTANIMORA SUD 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 ERADA 0 0 8 8 1 7 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 15 IMANOMBO 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 16 JAFARO 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 17 MAROALOMAINTE 1 0 8 8 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 18 MAROALOPOTY 0 7 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 MAROVATO BEFENO 0 0 8 7 0 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 SIHANAMARO 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 TSIMANANADA 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 TOTAL DISTRICT 5 7 166 160 18 142 91 1 0 0 2 1 3 7 9 0 0 0 28 DISTRICT: 6102 BEKILY BV reçus20 sur -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin N°18 Août 2014 SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation générale : page 1 Situation éco-météorologique : page 3 Situation acridienne : page 4 Situation agro-socio-économique : page 10 Situation antiacridienne : page 10 Annexes : page 13 SITUATION GÉNÉRALE En août 2014, la pluviosité était faible, variant de 15 à 50 mm dans l’Aire grégarigène et de 0 à 50 mm dans l’Aire d’invasion sauf dans l’Aire d’invasion Nord Betsiboka Hautes-Terres (AINB-HT) où elle était supérieure à 50 mm. Par rapport au mois précédent, une légère augmentation de la pluviosité a été constatée mais celle-ci restait généralement déficitaire par rapport à l'optimum hydrique de développement du Criquet migrateur malgache. Par conséquent, les sites offrant des conditions favorables aux criquets solitaires ou plus ou moins transiens se limitaient aux zones de dépression et bas-fonds où une certaine humidité persistait. Les populations solitaires ou plus ou moins transiens se réfugiaient dans ces zones alors que les grégaires continuaient à nomadiser au gré des vents. Les températures minimales étaient comprises entre 11 et 17 °C dans l’Aire grégarigène et 7 et 19 °C dans l’Aire d’invasion. Les températures maximales variaient de 23 à 28 °C dans l’Aire grégarigène et de 21 à 32 °C dans l’Aire d’invasion. Par rapport au mois de juillet 2014, dans l’Aire grégarigène, les températures augmentaient très légèrement. Dans l’Aire d’invasion, l’augmentation de la température diurne rendait plus actives les populations essaimantes qui restaient sexuellement immatures. -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin de la première décade de juin 2014 (2014-D16) SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Conditions éco-météorologiques : page 1 Situation acridienne : page 2 Situation antiacridienne : page 6 Annexes : page 10 CONDITIONS CONDITIONS ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUES ECO-METEOROLOGIQUES DURANT DURANT LA LA PREMIÈRE DEUXIEME DÉCADE DECADE DEDE JUIN JANVIER 2014 2014 Durant la 1ère décade, la pluviosité était nulle à très faible et donc hyper-déficitaire par rapport aux besoins du Criquet migrateur malgache dans toute la Grande-Île (figure 1). Les relevés (CNA) effectués dans l’Aire grégarigène montraient cependant que la plage optimale pluviométrique (annexe 1) était atteinte dans certaines localités des compartiments Centre et Sud de l’Aire de densation (11,5 mm à Efoetse, 38,0 mm à Beloha et 28,0 mm à Lavanono). Dans les zones à faible pluviosité, à l’exception de l’Aire d’invasion Est, les réserves hydriques des sols devenaient de plus en plus difficilement utilisables, le point de flétrissement permanent pouvant être atteint dans les biotopes les plus arides. Les strates herbeuses dans les différentes régions naturelles se desséchaient rapidement. En général, la hauteur des strates herbeuses variait de 10 à 80 cm selon les régions naturelles, les biotopes et les espèces graminéennes. Le taux de verdissement variait de 20 à 40 % dans l’Aire grégarigène et de 30 à 50 % dans l’Aire d’invasion. Les biotopes favorables au développement des acridiens se limitaient progressivement aux bas-fonds. Dans l’Aire grégarigène, le vent était de secteur Est tandis que, dans l’Aire d’invasion, les vents dominants soufflaient du Sud-Est vers le Nord- Ouest. -
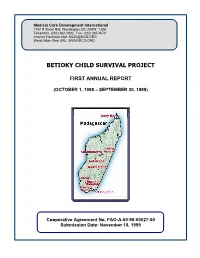
M C D I World Wide Web URL
Medical Care Development International 1742 R Street NW, Washington, DC 20009 * USA Telephone: (202) 462-1920; Fax: (202) 265-4078 Internet Electronic Mail: [email protected] M C D I World Wide Web URL: WWW.MCD.ORG BETIOKY CHILD SURVIVAL PROJECT FIRST ANNUAL REPORT (OCTOBER 1, 1998 – SEPTEMBER 30, 1999) Cooperative Agreement No. FAO-A-00-98-00027-00 Submission Date: November 18, 1999 Betioky Sud Child Survival Project Annual Report FY 1999 Translation of French original The staff of Medical Care Development International wish to thank BHR/PVC, CSTS Project, USAID Mission personnel as well as MOH staff for their counsel and support during Fiscal Year 1999. MEDICAL CARE DEVELOPMENT INTERNATIONAL 1 Betioky Sud Child Survival Project Annual Report FY 1999 Translation of French original TABLE OF CONTENTS 1- EXECUTIVE SUMMARY .......................................................................... 4 2- BACKGROUND INFORMATION AND OVERVIEW OF PLANNED ACTIVITIES........................................................................................... 5 2.1 REORIENTATION OF MCDI’S STRATEGY ...............................................................5 2.2 PROJECT CONTEXT .........................................................................................6 2.3 PLANNED ACTIVITIES/REVISED PLAN ...................................................................7 3- RESULTS AND COMMENTS .................................................................. 13 3.1 BIRTH SPACING ...........................................................................................13 -

Fokontany Etrobeke Commune Ampanihy, Madagascar
ANNEXES Tableaux de description des sites 1.Etrobeke Site Name (in local language and in English) Etrobeke signifie ventre ou milieu du corps en français C’est un lieu, relativement pluvieux et productif par rapport au voisinage (à cause de la forêt ?) Country (include State and Province) Fokontany Etrobeke Commune Ampanihy, District Ampanihy Ouest, Région du Sud Ouest, Madagascar Area encompassed by the CCA (specify unit of Pour ce site : 1000 ha, faisant partie d’une mosaïque measurement). d’environ 8000 ha pour toutes les communautés de 4 fokontany appartenant à la même commune GIS Coordinates (if available) Voir annexe : partie la plus sacrée : (S:24°49’00.4”, E:044°29’43.8”) Whether it includes sea areas (Yes or no) Non Whether it includes freshwater (Yes or no) Un petit lac éphémère Marine (Y or N) Non Concerned community (name and approx. number of Fokonolona Etrobeke (4000 personnes) persons) Is the community considering itself an indigenous Non people? (Please note Yes or No; if yes note which people) Is the community considering itself a minority? Non (Please note Yes or No, if yes on the basis of what, e.g. religion, ethnicity) Is the community permanently settled? (Please note Oui. Cependant, une partie de la population pratique Yes or No; if the community is mobile, does it have a l’élevage extensif de brebis et de zébus et vont les faire customary transhumance territory? ) paître ailleurs Is the community local per capita income inferior, Moyenne de revenu inférieure à la moyenne du pays. basically the same or superior to national value? Cependant, la propriété de zébus ou de brebis devrait (please note how confident you are about the être mieux considérée dans le calcul de la richesse des information) familles. -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin de la première décade de mars 2015 (2015-D07) SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation éco-météorologique : page 1 Situation acridienne : page 3 Ministère de l’Agriculture Situation antiacridienne : page 7 Synthèse : page 9 Annexes : page 11 SITUATION ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUE Durant la 1ère décade de mars, une zone dépressionnaire tropicale, accompagnée de rafales de vent de 50 km/h en moyenne, s’est formée dans le canal de Mozambique. Cette dépression est entrée sur la côte ouest de Madagascar vers le 06 mars 2015 et a traversé le pays, de Maintirano à Mananjary, sur une bande de 200 km de large. Elle a engendré des pluies importantes surtout dans le grand Nord-Ouest de la Grande-Île. Les informations pluviométriques étaient contradictoires, selon les sources : les estimations de FEWS-NET (figure 1) indiquaient que la pluviosité variait de 4 à 40 mm dans la majeure partie de la Grande-Île, sauf dans le grand Nord et Nord-Ouest, où la pluviosité était généralement supérieure à 40 mm et pouvait localement dépasser 125 mm. Dans l'Aire grégarigène, les pluies semblaient faibles (inférieures à 10 mm), sauf dans le compartiment Sud (10 à 40 mm) ; le peu de relevés transmis par le Centre National Acridien (62 % pour la décade et 34 % pour le mois, annexe 1) indiquait que, dans la majeure partie de l’Aire grégarigène, la pluviosité était faible à forte (variant de 0 à 241 mm). L'Aire de multiplication initiale Nord, les Aires transitoires de multiplication Nord et Centre ont encore été bien, voire trop, arrosées. -

Liste Candidatures Maires Atsimo Andrefana
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 VAKISOA (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 INDEPENDANT SOLO (INDEPENDANT SOLO) BESADA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 AVI (ASA VITA NO IFAMPITSARANA) TOVONDRAOKE AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) REMAMORITSY AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) SORODO INDEPENDANT MOSA Jean Baptiste (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 FOTOTSANAKE MOSA Jean Baptiste) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 TOVONASY (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 ESOLONDRAY Raymond (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) LAHIVANOSON Jacques AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 MMM (MALAGASY MIARA MIAINGA) KOLOAVISOA René INDEPENDANT TSY MIHAMBO RIE (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EMANINTSINDRAZA TSY MIHAMBO RIE) INDEPENDANT ESOATEHY Victor (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EFANOMBO ESOATEHY Victor) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 ZOENDRAZA Fanilina (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) INDEPENDANT TAHIENANDRO (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 EMAZINY Mana TAHIENANDRO) AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) RASOBY AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) MAHATALAKE ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin N°16 Juin 2014 SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation générale: page 1 Situation éco-météorologique: page 2 Situation acridienne: page 3 Situation agro-socio-économique: page Situation antiacridienne: page Annexes: page SITUATION GÉNÉRALE En juin 2014, l’installation de la saison sèche et fraîche se confirmait dans l'ensemble du pays. Les strates herbeuses devenaient de plus en plus sèches en raison de l’insuffisance des réserves hydriques des sols des biotopes xérophiles et mésophiles. Dans l'Aire grégarigène, les populations diffuses entamaient leur regroupement dans les biotopes hygrophiles ; l'humidité édaphique permettant le maintien d'une végétation verte. Dans les régions prospectées, le taux de verdissement des strates herbeuses variait de 10 à 40 %. Des essaims de taille petite à moyenne ont été observés dans les compartiments Centre et Nord de l’Aire grégarigène et de l’Aire d’invasion. Des taches et bandes larvaires ont également été observées dans le compartiment Centre de l’Aire grégarigène. Les larves étaient de stade L2 à L5 et de phase transiens à grégaire. Les essaims étaient composés d’ailés immatures grégaires. Cependant, des traitements intenses effectués au cours de ce mois ont permis de diminuer les effectifs des populations acridiennes groupées. Du 1er au 30 juin 2014, 39 866 ha ont été identifiés comme infestés et 38 870 ha ont été traités ou protégés. Le traitement des superficies infestées restantes est programmé pour le mois prochain (annexe 1). Depuis le début de la campagne 2013/2014 et jusqu’au 30 juin 2014, 1 204 660 ha ont été traités ou protégés. -

Mandoliny: Die Halslaute Südwestmadagaskars
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Mandoliny: Die Halslaute Südwestmadagaskars Verfasserin Elisabeth Magesacher angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 316 Studienrichtung lt. Studienblatt: Musikwissenschaft Betreuer: Ass.-Prof. Mag. Dr. August Schmidhofer Meinen Eltern Danksagung An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen Personen bedanken, die zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen haben. Zunächst danke ich meinem Diplomarbeitsbetreuer Ass.-Prof. Mag. Dr. August Schmidhofer für das zur Verfügung gestellte Material und die Unterstützung bei der Erstellung dieser Arbeit. Ihm und Univ.-Prof. Mag. Dr. Regine Allgayer-Kaufmann gilt Dank für die Organisation und Durchführung der Exkursion nach Madagaskar im Sommersemester 2007, die mich zur weiteren Auseinandersetzung mit der Musik Madagaskars angeregt und zur Themenwahl der vorliegenden Arbeit geführt hat. Für die Recherche meines Themas habe ich gemeinsam mit meinen StudienkollegInnen Cornelia Gruber, Johanna Stöckl und Thomas Hovden eine dreimonatige Feldforschung in Südwestmadagaskar durchgeführt. Ihnen sei gedankt für ihre Zusammenarbeit, für Diskussionen, Anregungen und eine großartige Zeit in Madagaskar. Auch sei hier nochmals August Schmidhofer für seine Unterstützung bei der Planung und Durchführung der Forschungsreise dankend erwähnt. Davonjy, Niri, unserem Übersetzer und Begleiter Clarc sowie den restlichen Familienmitgliedern sei herzlich für die freundliche Aufnahme und Unterstützung während