Chapitre I : Le Climat
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rep 2 out Public 2010 S Tlet Sur of Ma Urvey Rvey Adagas Repor Scar Rt
Evidence for Malaria Medicines Policy Outlet Survey Republic of Madagascar 2010 Survey Report MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE www. ACTwatch.info Copyright © 2010 Population Services International (PSI). All rights reserved. Acknowledgements ACTwatch is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This study was implemented by Population Services International (PSI). ACTwatch’s Advisory Committee: Mr. Suprotik Basu Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Rik Bosman Supply Chain Expert, Former Senior Vice President, Unilever Ms. Renia Coghlan Global Access Associate Director, Medicines for Malaria Venture (MMV) Dr. Thom Eisele Assistant Professor, Tulane University Mr. Louis Da Gama Malaria Advocacy & Communications Director, Global Health Advocates Dr. Paul Lavani Executive Director, RaPID Pharmacovigilance Program Dr. Ramanan Senior Fellow, Resources for the Future Dr. Matthew Lynch Project Director, VOICES, Johns Hopkins University Centre for Dr. Bernard Nahlen Deputy Coordinator, President's Malaria Initiative (PMI) Dr. Jayesh M. Pandit Head, Pharmacovigilance Department, Pharmacy and Poisons Board‐Kenya Dr. Melanie Renshaw Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Oliver Sabot Vice‐President, Vaccines Clinton Foundation Ms. Rima Shretta Senior Program Associate, Strengthening Pharmaceutical Systems Dr. Rick Steketee Science Director, Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa Dr. Warren Stevens Health Economist Dr. Gladys Tetteh CDC Resident Advisor, President’s Malaria -

Résultats Détaillés Toliary
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 6 TOLIARY BV reçus: 304 sur 304 HVM IND OBAMA FITIBA AVOTS AREMA MAPAR IND IND TIM IND IND MONIM AJFO E OMBILA MIARA- MASOA TSIMAN A TANIND HY DIA NDRO AVAKE N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E RAZA MAHER Y REGION 61 ANDROY BV reçus 58 sur 58 DISTRICT: 6101 AMBOVOMBE ANDROY BV reçus21 sur 21 01 AMBANISARIKA 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 02 AMBAZOA 0 0 8 7 1 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 03 AMBOHIMALAZA 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 04 AMBONAIVO 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 05 AMBONDRO 0 0 8 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 AMBOVOMBE ANDRO 1 0 12 12 2 10 7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 07 AMPAMATA 1 0 8 8 1 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 08 ANALAMARY 0 0 6 6 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 09 ANDALATANOSY 0 0 8 7 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 ANDOHARANO 1 0 6 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ANDRAGNANIVO 0 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 ANJEKY ANKILIKIRA 1 0 8 8 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 ANTANIMORA SUD 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 ERADA 0 0 8 8 1 7 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 15 IMANOMBO 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 16 JAFARO 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 17 MAROALOMAINTE 1 0 8 8 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 18 MAROALOPOTY 0 7 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 MAROVATO BEFENO 0 0 8 7 0 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 SIHANAMARO 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 TSIMANANADA 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 TOTAL DISTRICT 5 7 166 160 18 142 91 1 0 0 2 1 3 7 9 0 0 0 28 DISTRICT: 6102 BEKILY BV reçus20 sur -

Liste Candidatures Maires Atsimo Andrefana
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 VAKISOA (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 INDEPENDANT SOLO (INDEPENDANT SOLO) BESADA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 AVI (ASA VITA NO IFAMPITSARANA) TOVONDRAOKE AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) REMAMORITSY AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) SORODO INDEPENDANT MOSA Jean Baptiste (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 FOTOTSANAKE MOSA Jean Baptiste) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 TOVONASY (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 ESOLONDRAY Raymond (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) LAHIVANOSON Jacques AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 MMM (MALAGASY MIARA MIAINGA) KOLOAVISOA René INDEPENDANT TSY MIHAMBO RIE (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EMANINTSINDRAZA TSY MIHAMBO RIE) INDEPENDANT ESOATEHY Victor (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EFANOMBO ESOATEHY Victor) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 ZOENDRAZA Fanilina (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) INDEPENDANT TAHIENANDRO (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 EMAZINY Mana TAHIENANDRO) AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) RASOBY AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) MAHATALAKE ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST -

Annuaire Des Entreprises Exportatrices De Madagascar
Annuaire des entreprises exportatrices de Madagascar International GROUPE AGENCE FRANÇAISE DE Finance Corporation DÉVELOPPEMENT EDBM IFC World Bank Group ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR PrésentaMadat on de gascar Antsiranana Grande Ile située dans l’Océan Indien à l’Est de l’Afrique, Madagascar reste unique dans ses richesses naturelles. Sa population, issue de Nosy be 1 mélanges entre plusieurs origines (asiatiques, africaines et européennes) compte aujourd’hui 2 dix huit millions. Le pays dispose d’une Antalaha biodiversité endémique, soit près de 200 000 Mahajanga espèces uniques à Madagascar. Son sous-sol 7 regorge de minerais tels que l’or, la chromite, le 8 nickel, le fer et le pétrole. Madagascar appelé 13 Sainte Marie aussi l’île rouge dispose d’un potentiel réel de 9 production de par sa super cie et surtout sa 10 diversité climatique permettant de travailler sur 11 des cultures tropicales et tempérées. En n ses 6 4 Antananarivo Toamasina 12 longueurs de côte lui donne accès à la capture 3! de produits halieutiques de différentes natures, dont la majorité est orientée à l’export. Antsirabe Régions/regions 5 1 Diana Super cie 587 000 Km2 Morondava 19 2 Sava 14 3 Itasy Longueur de côtes 4 800 Km 4 Analamanga 5 Vakinankaratra Population 18 000 000 habitants 6 Bongolava Fianarantsoa 7 Sofia Monnaie Ariary (1 USD =+/- 1800 Ariary) 16 8 Boeny 15 9 Betsiboka Langue Malagasy, Français, Anglais 10 Melaky 11 Alaotra-Mangoro Capital Antananarivo 12 Atsinanana 18 13 Analanjirofo Port principal Toamasina 14 Amoron'i Mania 15 Haute Matsiatra Aéroport principal Ivato international Antananarivo (TNR) Toliara 16 Vatovavy-Fitovinany 20 17 Atsimo-Atsinanana 17 18 Ihorombe 19 Menabe 20 Atsimo-Andrefana 21 Androy 22 22 Anosy 21 Tolagnaro Edito de l’EDBM L’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) s’engage pour développer le potentiel d’exportation de Madagascar, c’est pourquoi nous soutenons la réalisation de cet annuaire qui vise à vous offrir, vous partenaire, un outil able qui répertorie les entreprises exportatrices, issues de divers secteurs. -

Transfert De Subvention Par FDL Aux Communes : Réalisation 2017 Et Prévision 2018
2018 Transfert de subvention par FDL aux communes : Réalisation 2017 et prévision 2018 Fonds de Développement Local Rue, Pierre Stibbe Anosy Antananarivo. e-mail: [email protected] Tel: 0 34 05 522 75 Tel: 0 33 37 690 99 www.fdl.mg Page 1 23/04/2018 Sommaire RECAPITULATION DES TRANSFERTS ......................................................................................................................................................................................... 3 Récapitulation des transferts réalisation 2017 et prévision 2018 ...................................................................................................................................................... 4 REALISATION DE TRANSFERT DE SUBVENTION DES COMMUNES POUR 2017 ..................................................................................................................... 5 Ressource Propre Interne (RPI)......................................................................................................................................................................................................... 6 Fonds National de Péréquation (FNP) ............................................................................................................................................................................................ 8 Programme de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation (PDCID) : Phase d'études : Conventions, APS, APD, Appels d'offres .................... 9 Projet d'Appui à la Réforme de la Sécurisation Foncière (ARSF) ................................................................................................................................................ -

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DES POPULATIONS RURALES DU SUD-OUEST DE MADAGASCAR Diagnostic Et Perspectives
ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DES POPULATIONS RURALES DU SUD-OUEST DE MADAGASCAR Diagnostic et Perspectives Caroline BROUDIC (c.broudic@geoecoalternatives) Tsiory RAZAFINDRIANILANA Février 2020 Avant-propos Ce rapport a été produit par le bureau d’études GEOECO Alternatives dans le cadre du projet Confluences/HIAKE mis en œuvre à Madagascar par Action contre la Faim (ACF) et son partenaire Action Socio-sanitaire et Organisation Secours (ASOS). Le projet Confluences est financé par l’Agence française de développement (Afd) et a pour objectif global de Contribuer à la sécurité nutritionnelle dans 5 pays d’Afrique en améliorant la prise en charge des victimes de la sous nutrition, en développant des actions préventives et en proposant des politiques publiques adéquates. Les auteur-e-s de ce rapport tiennent à remercier les équipes d’ACF et d’ASOS pour leur disponibilité, la facilitation logistique et les discussions tout au long de la phase de collecte des informations. Des remerciements particuliers sont adressés à Bara Asah Razafindramalika pour son appui à la traduction au cours des entretiens de groupe (focus group) et à Bonaventure. Les consultant-e-s remercient également toutes les personnes interrogées dans le cadre de cette étude. Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des deux consultant-e-s, et ne reflètent pas nécessairement celles d’Action contre la Faim. La publication de ce document ne signifie pas qu’ACF appuie les opinions contenues dans ce rapport. 2 SOMMAIRE Avant-propos ........................................................................................................................................ -

DEA Sociologie Travail Des Enfants Et Décrochage Scolaire La Réalité
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ------------------------------- FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE --------------------------- DEPARTEMENT SOCIOLOGIE ---------------- TROISIEME CYCLE Mini-mémoire de D.E.A en Sociologie Travail des enfants et décrochage scolaire : la réalité dans le milieu rural malgache Cas de la Commune rurale d’Ampanihy Ouest Présenté par : RAKOTOARISON Paul Ghislain Encadreur : Docteur SOLOFOMIARANA RAPANOEL Allain Bruno Année Universitaire : 2006-2007 (Soutenance du 24 mai 2007) Travail des enfants et décrochage scolaire : la réalité dans le milieu rural malgache Cas de la Commune rurale d’Ampanihy Ouest R E M E R C I E M E N T S Je rends grâce à Dieu pour sa bénédiction dans la réalisation de mini-mémoire. Je présente mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à cette recherche : A Monsieur SOLOMIARANA RAPANOEL Allain Bruno, Chef de Département de Sociologie, à la Faculté D.E.G.S, Université d’Antananarivo Qui a suivi pas à pas mon travail malgré ses différentes obligations. A tous les interviewés et aux villageois de Behavandra, qui ont bien voulu répondre à mes questions au cours de la recherche sur terrain. A ma famille qui m’a soutenu financièrement, matériellement et moralement, surtout pendant l’élaboration de cette recherche. A toutes les personnes qui ont collaboré avec moi pour la réalisation de cette recherche, Que Dieu les bénisse pour leur bonté. SOMMAIRE INTRODUCTION Partie I ESPACE THEORIQUE ET ESPACE GEOGRAPHIQUE DU TRAVAIL DES ENFANTS I. Concept de travail des enfants en sociologie du travail et notion de sociologie de l’éducation II. -

World Bank Document
Ministry of Transportation and Meteorology World Bank Ministry of Public Works E524 Volume 1 Public Disclosure Authorized Rural Transportation Project Environmental and Social Public Disclosure Authorized Impact Assessment Public Disclosure Authorized December 2001 Prepared by Transport Sector Project (TSP) NGO Lalana Basler & Hofmann Based on the preliminary designs of the following consulting firms: Public Disclosure Authorized DINIKA (Tananarive) MICS - ECR - AEC - SECAM (Fianarantsoa) ESPACE - MAHERY (Taomasina) EC PLUS - JR SAINA (Mahajanga) 4 A OSIBP - SOMEAH (Toliary) F CO PY EIIRA - ANDRIAMBOLA - BIC (Antsiranana) Projet de Transport Rural, Madagascar - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux Table of Contents 1 Summary of Environmental and Social Assessment .................................................. 1 1.1 Proposed Project ........................................ 1 1.2 Transport Sector Environmental Assessment ...................................... 1 1.3 Environmental Assessment for APL 2 ...................................... 1 1.4 Policy and Legislative Framework ....................................... 1 1.5 Methodology ...................................... 2 1.6 Participatory approach ...................................... 2 1.7 Rural transport rehabilitation component ....................................... 3 1.8 Potential environmental impacts ...................................... 3 1.9 Resettlement and cultural heritage ....................................... 4 1.10 Rail and port infrastructure rehabilitation -
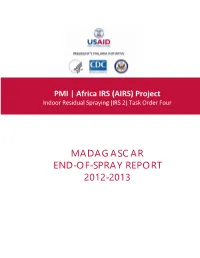
IRS Technical Report Template
PMI | Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT 2012-2013 Recommended Citation: PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four. June 2013. Madagascar End-of-Spray Report2012-2013. Bethesda, MD. PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four, Abt Associates Inc. Contract No.: GHN-I-00-09-00013-00 Task Order: AID-OAA-TO-11-00039 Submitted to: United States Agency for International Development/PMI Abt Associates Inc. 1 4550 Montgomery Avenue 1 Suite 800 North 1 Bethesda, Maryland 20814 1 T. 301.347.5000 1 F. 301.913.9061 1 www.abtassociates.com 2012-2013 MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT CONTENTS Contents …. .................................................................................................................................. iii Acronyms … .................................................................................................................................vii Executive Summary ..................................................................................................................... ix 1. Introduction ............................................................................................................................ 1 1.1 Background of IRS in Madagascar ................................................................................ 1 1.2 Objectives for AIRS Madagascar during the 2012-2013 IRS Campaigns .................. 2 2. Pre-IRS Campaign Activities ............................................................................................... -

Annulation Partielle Toliary
LISTE DES BUREAUX DE VOTE OBJETS D'ANNULATION PARTIELLE FARITANY: 6 TOLIARY DISTRICT 6101 AMBOVOMBE ANDROY COMMUNE Voix annulées Motif 610106 AMBOVOMBE ANDROY 1 Bulletin portant un signe intérieur de reconnaissance 610107 AMPAMATA 1 Bulletin portant un signe intérieur de reconnaissance 610110 ANDOHARANO 1 Bulletin portant un signe intérieur de reconnaissance 610112 ANJEKY ANKILIKIRA 1 Bulletin portant un signe intérieur de reconnaissance 610117 MAROALOMAINTE 1 Bulletins portant un signe intérieur de reconnaissance Total des voix annulées du District 5 DISTRICT 6102 BEKILY COMMUNE Voix annulées Motif 610203 ANIVORANO MITSINJO 1 Bulletin portant un signe intérieur de reconnaissance 610215 MAROVIRO 1 Bulletin portant un signe intérieur de reconnaissance 610217 TANANDAVA 1 Bulletin portant un signe intérieur de reconnaissance Total des voix annulées du District 3 DISTRICT 6104 TSIHOMBE COMMUNE Voix annulées Motif 610401 ANJAMPALY 6 Bulletins portant des signes intérieurs de reconnaissance 610405 FAUX CAP 1 Bulletin portant un signe intérieur de reconnaissance 610408 NIKOLY 1 Bulletin portant un signe intérieur de reconnaissance 610409 TSIHOMBE 3 Bulletins portant des signes intérieurs de reconnaissance Total des voix annulées du District 11 DISTRICT 6202 BETROKA COMMUNE Voix annulées Motif 620210 IABOROTRA 2 Bulletins portant des signes intérieurs de reconnaissance 620219 NANARENA BESAKOA 2 Bulletins portant des signes intérieurs de reconnaissance 620222 TSARAITSO 1 Bulletin portant un signe intérieur de reconnaissance Total des voix annulées -

Madagascar BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE
Madagascar BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE 2ème DÉCADE DE MARS 2013 1 SITUATION ECOMÉTÉOROLOGIQUE Le cyclone Haruna (22-23 février 2013) à traversé l'aire grégarigène en diagonale (direction NO/SE); entré au niveau de l'embouchure du fleuve Mangoky, il est sorti au Nord de Fort- Dauphin, balayant ainsi la majeure partie de l’aire grégarigène du Criquet migrateur, moteur de l’invasion acridienne en cours. Les vents et les pluies furent violents, engendrant d'importants dégâts (inondations, habitations détruites, arbres arrachés...). Ces pluies violentes (200 à 500 mm en quelques jours, selon les régions) ont, dans un premier temps, provoqué un engorgement hydrique des sols, entraînant une mortalité embryonnaire importante par asphyxie des œufs partout où la saturation a excédé 3 jours. Passé cette période critique, les réserves hydriques des sols ont été partout rechargées, offrant à la végétation comme aux acridiens des conditions favorables de développement durant plusieurs décades (de l’ordre de 3 à 4 décades mais jusqu’à 5 à 6 dans certaines dépressions, après le retrait des eaux). Ordinairement, à cette période de l’année, les conditions écologiques des biotopes du Criquet migrateur commencent à se dessécher sur les deux-tiers de l’aire grégarigène, les conditions favorables se rencontrant essentiellement dans la partie la plus orientale de celle-ci (correspondant aux ATM puis, surtout, aux AMI). Tel n’est pas le cas cette année, ce qui offre au Criquet migrateur une opportunité de réaliser sa dernière reproduction de saison des pluies dans d’excellentes conditions. 2 SITUATION ACRIDIENNE 2.1 Aire Grégarigène 2.1.1 Compartiment Nord-Ouest de l'Aire grégarigène L’Aire de Multiplication Initiale (AMI) et l’Aire Grégarigène Transitoire (AGT) (Manja, Beroroha et Bas de Betisiriry) sont fortement infestées. -
Réhabilitation Et Appui À La Gestion Des Réseaux D'eau D'atsimo
28.01.2019 Réhabilitation et appui à la gestion des réseaux d’eau d’Atsimo Andrefana, Madagascar (Mai 2018 – Mai 2021) Communes Ankazoabo, Manombo, Anakao, Soalary Mairie d’Ankazoabo Une coopération décentralisée du SEDIF Jean-Pierre Mahé, Camille Marconnet Experts-Solidaires Bat B1, Parc Scientifique Agropolis II, 2196 Bvd de la Lironde, 34980 Montferrier sur Lez, France. Tel : 06 04 18 26 94, [email protected] 1 RESUME Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une coopération décentralisée entre le SEDIF et les communes de la province d’Atsimo Andrefana, dans le Sud Ouest de Madagascar. Cette coopération dure depuis 2008 avec le financement des réseaux de Saint Augustin, Manombo Sud, Ambahikily et Ankililoaka. En parallèle, a été mis en place un système de suivi technique et financier des réseaux d’eau sur la province d’Atsimo Andrefana, non seulement ceux financés par le SEDIF mais tous les réseaux d’AEP de la région. Les activités présentées ci après sont développés en collaboration entre les communes de la région Atsimo Andrefana et la DREAH de la région. Le présent projet soumis au financement consiste en 4 parties : Partie 1 : La réhabilitation du réseau d’Ankazoabo Partie 2 : La réhabilitation du réseau de Manombo Partie 3 : La Réhabilitation des réseaux de Soalary et Anakao Partie 4 : Un renforcement du suivi technique et financier et un soutien aux délégataires pour tous les réseaux d’eau et aux communes Maitre d’Ouvrage de ces réseaux dans la région Atsimo Andrefana. Communes Ce projet concerne essentiellement les