Modèle De Rapport
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Gestion Durable Des Infrastructures D'eau
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DÉPARTEMENT DES EAUX ET FORETS Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) Foresterie- Développement- Environnement Promotion HAIKA (2013-2014) LA GESTION DURABLE DES INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE, D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIENE Présenté par : RAKOTOARISOA Hery Vonjy Soutenu le 19 Décembre 2014 Devant le jury composé de Président : Professeur RAKOTOZANDRINY Jean de Neupomuscène Rapporteur : Docteur REJO Robert Examinateurs : Madame ANDRIAMANANTENALucia Dorès Monsieur RAZOLALAINA Toavina UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DÉPARTEMENT DES EAUX ET FORETS Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) Foresterie- Développement- Environnement Promotion HAIKA (2013-2014) LA GESTION DURABLE DES INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE, D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIENE Présenté par : RAKOTOARISOA Hery Vonjy Soutenu le 19 Décembre 2014 Devant le jury composé de Président : Professeur RAKOTOZANDRINY Jean de Neupomuscène Rapporteur : Docteur REJO Robert Examinateurs : Madame ANDRIAMANANTENA Lucia Dorès Monsieur RAZOLALAINA Toavina La gestion durable des infrastructures d`eau potable, d`assainissement et d`hygiène. REMERCIEMENTS Nous remercions DIEU, Notre Seigneur Tout Puissant qui nous a offert la santé, la force, la connaissance et tous les autres moyens nécessaires durant la réalisation de ce mémoire de DEA. Nous adressons nos vifs remerciements : Au Professeur RAMAMONJISOA Bruno Salomon, Directeur de la formation doctorale, -

RANDRIAMAMPIANINA Andy GEO N°17
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE FILIERE FORMATION GENERALE DYNAMIQUE ET ECHELLEECHELLESSSS D’INTERVENTION DES TRANSPORTEURS D’AMBATOLAMPY MEMOIRE DE MAITRISE Présenté par RANDRIAMAMPIANINA Andy Sous la Direction de Monsieur James RAVALISON Maître de conférences UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE FILIERE FORMATION GENERALE DYNAMIQUE ET ECHELLEECHELLESSSS D’INTERVENTION DES TRANSPORTEURS D’AMBATOLAMPY MEMOIRE DE MAITRISE Présenté par RANDRIAMAMPIANINA Andy Promotion FANEVA Sous la Direction de Monsieur James RAVALISON Maître de conférences Président : Mme RAMAMONJISOA Jocelyne, Professeur Titulaire Rapporteur : M James RAVALISON, Maître de Conférences Juge : Mme RATOVOSON Céline, Maître de Conférences 14 Décembre 2006 Tables des matières ..................................................................... page Remerciements ................................................................................................... I Résumé ............................................................................................................... II Listes des tableaux ............................................................................................. III Liste des croquis ................................................................................................. IV Liste des photos .................................................................................................. IV Liste des figures ................................................................................................. -

Table Des Matieres La Region…………………………………………………….…………………..……………….1 1 Milieu Physique
TABLE DES MATIERES LA REGION…………………………………………………….…………………..……………….1 1 MILIEU PHYSIQUE ........................................................................................................................13 1.1 RELIEF .......................................................................................................................................13 1.2 GEOLOGIE .................................................................................................................................13 1.3 CLIMAT ......................................................................................................................................14 1.3.1 Le réseau de stations météorologiques ................................................................................15 1.3.2 Température ........................................................................................................................16 1.3.3 Pluviométrie ........................................................................................................................17 1.3.4 Diagrammes ombrothermiques ...........................................................................................18 1.3.5 Cyclones ..............................................................................................................................19 1.4 HYDROLOGIE ...........................................................................................................................19 1.5 SOLS ET VEGETATIONS .........................................................................................................20 -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

Cas Des Trois Communes Ambatolampy Ville
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ---------------------- FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE ---------------------- DEPARTEMENT GESTION ---------------------- MEMOIRE DE MAITRISE EN GESTION OPTION : ORGANISATION ET ADMINISTRATION D’ENTREPRISE ANALYSE DES POTENTIELS TOURISTIQUES DANS LE DISTRICT D’AMBATOLAMPY : CAS DES TROIS COMMUNES AMBATOLAMPY VILLE, TSINJOARIVO ET TSIAFAJAVONA-ANKARATRA Présenté par : RANDRIAMBOLOLONA Raobelina Hery Nambinintsoa Sous l’encadrement de : ENCADREUR PEDAGOGIQUE ENCADREUR PROFESSIONNEL RANDRIAMBOLOLONDRABARY Corinne RANDRIAMISATA Abdon Maître de conférences Coordonnateur national de l’ONG Ressources Vertes A.U. : 2008 /2009 Session : 28 Novembre 2008 Remerciements Nous tenons à rendre gloire à Dieu qui nous a guidés sans limite dans nos pas vers l’achèvement de ce travail. Je tiens aussi, à travers ces quelques lignes, à témoigner mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin à la réalisation de ce mémoire de fin d’études. Il s’agit notamment de : Monsieur RAJERISON Wilson, Professeur Titulaire, Président de l’Université d’Antananarivo qui m’a accepté d’être son étudiant et sous sa responsabilité ; Monsieur RANOVONA Andriamaro, Maître de conférences, Doyen de la Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie de m’avoir autorisé à présenter ce mémoire ; Monsieur ANDRIAMASIMANANA Origène Olivier, Maître de conférences, Chef de Département GESTION de la Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie de l’Université d’Antananarivo ; Madame -

Encadreur Technique Monsieur RABE Tsimahafotsy : Andriamaro
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DEPARTEMENT BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur en Bâtiment et Travaux Publics Présenté par : ANDRIAMALALA Jean Mahefasoa Arivelo Directeur de mémoire : Monsieur RALAIARISON Moïse Encadreur technique Monsieur RABE Tsimahafotsy : Andriamaro Soutenu le Jeudi, 14 Décembre 2006 - Promotion 2006 – U NIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DEPARTEMENT BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur en Bâtiment et Travaux Publics Présenté par : ANDRIAMALALA Jean Mahefasoa Arivelo Monsieur RALAIARISON Moise Directeur de Maître de conférence, : mémoire Enseignant à l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo Encadreur Monsieur RABE Tsimahafotsy Andriamaro : Ingénieur Principal des Travaux Publics technique Directeur Régional des Travaux Publics de la Région du Vakinankaratra Soutenu le Jeudi, 14 Décembre 2006 Promotion 2006 REMERCIEMENTS Les cinq années que j’ai passées à l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo sont aujourd’hui écoulées et me voici arrivé au terme de mes études pour la formation d’Ingénieur en Bâtiment et Travaux Publics. Ce mémoire, non seulement témoigne mon passage à l’Université mais aussi traduit ce désir d’apporter ma modeste contribution à l’amélioration des techniques et méthodes relatives aux réhabilitations et Entretiens des routes. Je ne peux, loin de là, me vanter de faire mieux que les autres Ingénieurs en activité, mais je pense que les quelques propositions relevant de mes créations personnelles auraient leurs rôles à jouer au sein de la Communauté des gestionnaires et techniciens en matière de route. La conception et l’élaboration du mémoire ont exigé une grande part de réflexion et de dévouement dans lesquels les théories étudiées en salle, les expériences vécues au cours des stages effectués sur terrain ainsi que la récolte de toutes les données nécessaires m’ont demandé beaucoup de temps et beaucoup d’efforts : tout cela n’était pas chose facile. -
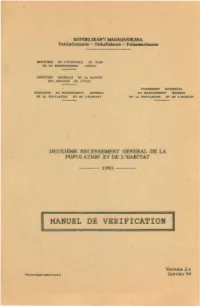
[ Manuel De Verification'i
~POBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahanâ - Fahamarinana YIN1ST~RB DE L' ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRBSSBMENT SOCIAL DIRBCTION' GBNERALE DE LA BANQUE DES DON NEES DE L'BTAT COMMISSION N'ATIONALE DIRECTION DV RECENSEMBNT GENERAL- DU iECBNSENENT ~ENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DB LA 1'OPULATION ST J)E L'HABITAT ,. DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 1993 --- 1 / [ MANUEL DE VERIFICATION ' I Version 2.s . fO\<l.ocrsph\lIIanveT2.8 Janvier 94 REPOBLlKAN'I MADAGASlKARA 'farundrazalla - Fahafahana - Fahamarinana UINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRESSEMENT SOCIAL DIRECTIO:-: GENERALE DE LA BANQUE DES DONNEES DE L'ETAT COMMISSION NATIONALE DIREC1ION Dl! RECENSEMENT GENERAL DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POP U LATIO:i ET DE l' HABITAT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DEUXIEME RECENSEMEl\rrr GEN]~RAL DE LA POPULATION Err DE L ~HA,BI'TAT 1993 MANUEL DE VERIFICATION 1 Il Version 2.s fb\docrBPh\manver2.s Janvier 94 SOI\.iMA1RE INTRODUCTIO~~ . 2 l - GENERALITES SUR LA VERIFICATION 1.1 - LA SECTION V"ERIFICATION ..•.........' , . ,........... 2 1.2 - LE TR~ VAIL DU \lt:RlFICATEUR ..................... 2 1.3 - L'IDEN1IFICATION DES QUESTIONNAIRES .. ,.... ~, ...... 3 1.4- LES QUESTIOl'.~.AIRES-SUITE ...................... 5 ,2 '- METIIODE DE'VERIFICATION o - MILIEU ..............................••........ 5 l - 'FARITA.N1" 2 - F IVONDRONA1\fPOK0l'41 Al"\""l , 3 - FIRAISM1POKONTMry· ..............•...•..........• 5 4 -. N°DE LA ZONE 5 - N e DU S EGME?\l . ~ . .. .... 6 6 "- FOKONTAl~l'· 7 - LOCALITE .... ' .....•..............•..... la ••' • • • • • • 8 8 - N ~ 'DU B.ATIMEr1T .•..-. _ .....•.. ~ ..••.•' .•••.•..•• · • 8 . 9 - TI'1>E' D'UTILISATION . '........................ · . 8 , <> DU ,..,.-c.... TAGE .. 9 ,~ 10. ~ _N Ir}...!::..l'" .• • . -

Sample Procurement Plan Agriculture and Land Growth Management Project (P151469)
Sample Procurement Plan Agriculture and Land Growth Management Project (P151469) Public Disclosure Authorized I. General 2. Bank’s approval Date of the procurement Plan: Original: January 2016 – Revision PP: December 2016 – February 2017 3. Date of General Procurement Notice: - 4. Period covered by this procurement plan: July 2016 to December 2017 II. Goods and Works and non-consulting services. 1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: [Thresholds for applicable Public Disclosure Authorized procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency’s capacity.] Type de contrats Montant contrat Méthode de passation de Contrat soumis à revue a en US$ (seuil) marchés priori de la banque 1. Travaux ≥ 5.000.000 AOI Tous les contrats < 5.000.000 AON Selon PPM < 500.000 Consultation des Selon PPM fournisseurs Public Disclosure Authorized Tout montant Entente directe Tous les contrats 2. Fournitures ≥ 500.000 AOI Tous les contrats < 500.000 AON Selon PPM < 200.000 Consultation des Selon PPM fournisseurs Tout montant Entente directe Tous les contrats Tout montant Marchés passes auprès Tous les contrats d’institutions de l’organisation des Nations Unies Public Disclosure Authorized 2. Prequalification. Bidders for _Not applicable_ shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines. July 9, 2010 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: - 4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Manuel de procedures (execution – procedures administratives et financières – procedures de passation de marches): décembre 2016 – émis par l’Unite de Gestion du projet Casef (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière) 5. -

Carte Des Isohyètes De Madagascar
RêpubUque Démocratique Malagasy Ministère de la. Recherche Scientifique , et Technologique pour le Développement ( M.R.S.T.D.I Centre National de Recherches sur li envronnement ( C.N.R.EJ Laboratoire de Recherche sur les Sr-;tèmes AquatKjues et leur Environnement ( L.R.S.A.E.) CARTE DES ISOHYETES DE MADAGASCAR - NOTICE - Document de Travail) L. FERRY L. ROB/SON Rapport LRSAE nI! 9 Octobre 1991 République Française Il"5tit\â FrarQis de Recherthe Sdentifique pour le DMloppement en Cooperation ( Q.R.S.T.Q.M.) INTRODUCTION Un inventaire des observations pluviométriques et hydrométriques de Madagascar et leur archivage sur support informatique est en cours de réalisation dans le cadre d'un programme [*] mené par la DMH, le CNRE et l'ORSTOM. Après un an de travail, 972 stations pluviométriques ont été inventoriées et plus de 7000 années stations de pluviométrie journalière saisies. Les quelques estima tions faites laissent à penser que le nombre d'années-station de pluie journalière serait proche de 10 000 pour Madagascar. Mais, déjà, les documents et les fichiers actuellement disponibles don nent une bonne image du réseau d'observation pluviométrique depuis 1880 ainsi que du volume et de la qualité des observations. HISTORIQUE DU RESEAU PLUVIOMETRIQUE La pluviométrie a commencé à être mesurée de façon régulière à partir de 1880 à la station de "Tananarive Observatoire" puis à Majunga et Tamatave (vers 1897 et,1889). Entre 1901 et 1903 ont été mises en place quelques stations plu viométriques dans les grandes villes des côtes Est (Mananjary, Fa rafangana, Diégo-Suarez, Fort Dauphin) et Ouest (Majunga, Moronda va, Tuléar) ainsi que quelques postes sur les hautes terres (Fia narantsoa, Arivonimamo). -

World Bank Document
Ministry of Transportation and Meteorology World Bank Ministry of Public Works E524 Volume 1 Public Disclosure Authorized Rural Transportation Project Environmental and Social Public Disclosure Authorized Impact Assessment Public Disclosure Authorized December 2001 Prepared by Transport Sector Project (TSP) NGO Lalana Basler & Hofmann Based on the preliminary designs of the following consulting firms: Public Disclosure Authorized DINIKA (Tananarive) MICS - ECR - AEC - SECAM (Fianarantsoa) ESPACE - MAHERY (Taomasina) EC PLUS - JR SAINA (Mahajanga) 4 A OSIBP - SOMEAH (Toliary) F CO PY EIIRA - ANDRIAMBOLA - BIC (Antsiranana) Projet de Transport Rural, Madagascar - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux Table of Contents 1 Summary of Environmental and Social Assessment .................................................. 1 1.1 Proposed Project ........................................ 1 1.2 Transport Sector Environmental Assessment ...................................... 1 1.3 Environmental Assessment for APL 2 ...................................... 1 1.4 Policy and Legislative Framework ....................................... 1 1.5 Methodology ...................................... 2 1.6 Participatory approach ...................................... 2 1.7 Rural transport rehabilitation component ....................................... 3 1.8 Potential environmental impacts ...................................... 3 1.9 Resettlement and cultural heritage ....................................... 4 1.10 Rail and port infrastructure rehabilitation -

Haute Matsiatra)
Zoosyst. Evol. 97 (2) 2021, 315–343 | DOI 10.3897/zse.97.63936 Uncovering the herpetological diversity of small forest fragments in south-eastern Madagascar (Haute Matsiatra) Francesco Belluardo1, Darwin Díaz Quirós1, Javier Lobón-Rovira1, Gonçalo M. Rosa2,3, Malalatiana Rasoazanany4, Franco Andreone5, Angelica Crottini1,6 1 CIBIO Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto, Rua Padre Armando Quintas, Campus de Vairão, 4485–661, Vairão, Portugal 2 Institute of Zoology, Zoological Society of London, Outer Circle, Regent’s Park, NW1, 4RY, London, United Kingdom 3 Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes (CE3C), Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Campo Grande, Edifício C2, 5° Piso, Sala 2.5.46, 1749–016, Lisboa, Portugal 4 Mention Zoologie et Biodiversité Animal, Domaine des Sciences et Technologies, Université d’Antananarivo, B.P. 906, 101, Antananarivo, Madagascar 5 Museo Regionale di Scienze Naturali, Via G. Giolitti, 36, 10123, Torino, Italy 6 Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Rua Campo Alegre, 4169–007, Porto, Portugal http://zoobank.org/5381781A-2801-4240-9ACE-F53CE3264B70 Corresponding author: Francesco Belluardo ([email protected]) Academic editor: Johannes Penner ♦ Received 3 February 2021 ♦ Accepted 20 May 2021 ♦ Published 1 July 2021 Abstract Madagascar has historically suffered from high fragmentation of forested habitats, often leading to biodiversity loss. Neverthless, forest fragments still retain high levels of biological diversity. The Haute Matsiatra Region (south-eastern Madagascar) hosts the renowned Andringitra National Park and several surrounding isolated forest fragments embedded in a matrix of human-dominated landscape. During a herpetological survey conducted in the Region, we visited a total of 25 sites. -

Projet D'amelioration De La Delimitation Administrative, Outil De La Gestion Fonciere Decentralisee
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana -Ecole Nationale d’Administration de Madagascar- PROJET DE FIN D’ETUDES POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION DE MADAGASCAR SECTION: Ingénieur des Services Topographiques PROJET D’AMELIORATION DE LA DELIMITATION ADMINISTRATIVE, OUTIL DE LA GESTION FONCIERE DECENTRALISEE CAS : REGION VAKINANKARATRA Présenté par RAOELIARIMANANA Tsiry Aina Nomenjanahary PROMOTION ILAINA : 2014-2016 PRESUDENT DU JURY : Monsieur RAOELSON Harilanto Enseignant permanent à l’ENAM EXAMINATEUR : Monsieur RAZAFINDRAKOTOHARY Tiana GEOMETRE EXPERT RAPPORTEUR : Monsieur RMAROJOHN Landry Juriste, membre du comité de révision des textes fonciers Janvier 2016 Androhibe Ecole Nationale d’Administration de Madagascar Site web : www.enam.mg Antananarivo 101 Etablissement Public à caractère Administratif e-mail : [email protected] BP 1163 Placé sous tutelle du Ministère de la Fonction Publique [email protected] 020 24 553 79 Du Travail et des Lois Sociales et du Ministère des Finances et du Budget tél: 020 24 553 86 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana -Ecole Nationale d’Administration de Madagascar- PROJET DE FIN D’ETUDES POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION DE MADAGASCAR SECTION: Ingénieur des Services Topographiques PROJET D’AMELIORATION DE LA DELIMITATION ADMINISTRATIVE, OUTIL DE LA GESTION FONCIERE DECENTRALISEE CAS : REGION VAKINANKARATRA Présenté par RAOELIARIMANANA Tsiry Aina Nomenjanahary PROMOTION ILAINA : 2014-2016 PRESUDENT