Cas Du Mca-Madagascar a Amoron'i Mania
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pezzottaite from Ambatovita, Madagascar: a New Gem Mineral
PEZZOTTAITE FROM AMBATOVITA, MADAGASCAR: A NEW GEM MINERAL Brendan M. Laurs, William B. (Skip) Simmons, George R. Rossman, Elizabeth P. Quinn, Shane F. McClure, Adi Peretti, Thomas Armbruster, Frank C. Hawthorne, Alexander U. Falster, Detlef Günther, Mark A. Cooper, and Bernard Grobéty Pezzottaite, ideally Cs(Be2Li)Al2Si6O18, is a new gem mineral that is the Cs,Li–rich member of the beryl group. It was discovered in November 2002 in a granitic pegmatite near Ambatovita in cen- tral Madagascar. Only a few dozen kilograms of gem rough were mined, and the deposit appears nearly exhausted. The limited number of transparent faceted stones and cat’s-eye cabochons that have been cut usually show a deep purplish pink color. Pezzottaite is distinguished from beryl by its higher refractive indices (typically no=1.615–1.619 and ne=1.607–1.610) and specific gravity values (typically 3.09–3.11). In addition, the new mineral’s infrared and Raman spectra, as well as its X-ray diffraction pattern, are distinctive, while the visible spectrum recorded with the spec- trophotometer is similar to that of morganite. The color is probably caused by radiation-induced color centers involving Mn3+. eginning with the 2003 Tucson gem shows, (Be3Sc2Si6O18; Armbruster et al., 1995), and stoppaniite cesium-rich “beryl” from Ambatovita, (Be3Fe2Si6O18; Ferraris et al., 1998; Della Ventura et Madagascar, created excitement among gem al., 2000). Pezzottaite, which is rhombohedral, is Bcollectors and connoisseurs due to its deep purplish not a Cs-rich beryl but rather a new mineral species pink color (figure 1) and the attractive chatoyancy that is closely related to beryl. -

TDR Annexe7 Rapport Analyse 322 Communes OATF
ETAT DES LIEUX DES 319 COMMUNES POUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET CASEF Février 2019 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................ iii Liste des tableaux ......................................................................................................................... v Listes des Cartes ........................................................................................................................... v Liste des figures ............................................................................................................................vi Liste des photos ...........................................................................................................................vi I INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 II METHODOLOGIES .................................................................................................................... 2 II.1 CHOIX DES 322 COMMUNES OBJETS D’ENQUETE ............................................................... 2 II.2 CHOIX DES CRITERES DE SELECTION DES COMMUNES ........................................................ 5 II.3 METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES ET ACTIVITES ................................................. 6 -

Ambositra Est La Suivante
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO École Supérieure Polytechnique d’Antananarivo UFR Sciences Economiques et de Gestion de Bordeaux IV MEMOIRE DE DIPLOME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES OPTION : « ÉTUDES D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX » En co-diplômation entre L’Université d’Antananarivo et l’Université Montesquieu-Bordeaux IV Intitulé : EETTUUDDEE DD’’’IIIMMPPAACCTTSS EENNVVIIIRROONNNNEEMMEENNTTAAUUXX EETT SSOOCCIIIAAUUXX DDUU PPRROOJJEETT «VVIIITTRRIIINNEE DDEE LL’’’EENNTTRREETTIIIEENN RROOUUTTIIIEERR NN°° 0022 »» SSUURR LL’’’AAXXEE :: AAmmbboossiiittrraa –– IIImmaaddyy IIImmeerriiinnaa –– MMaahhaazzooaarriiivvoo -- FFaannddrriiiaannaa Présenté le 09 octobre 2012 par Monsieur: RANDRIAMANANJO Dina Lalaina D E S S - E I E 2011 – 2012 D E S S EIE 2011 - 2012 École Supérieure Polytechnique d’Antananarivo UFR Sciences Economiques et de Gestion de Bordeaux IV MEMOIRE DE DIPLOME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES OPTION : « ÉTUDES D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX » En co-diplômation entre L’Université d’Antananarivo et l’Université Montesquieu-Bordeaux IV Intitulé : EETTUUDDEE DD’’’IIIMMPPAACCTTSS EENNVVIIIRROONNNNEEMMEENNTTAAUUXX EETT SSOOCCIIIAAUUXX DDUU PPRROOJJEETT «VVIIITTRRIIINNEE DDEE LL’’’EENNTTRREETTIIIEENN RROOUUTTIIIEERR NN°° 0022 »» SSUURR LL’’’AAXXEE :: AAmmbboossiiittrraa –– IIImmaaddyy IIImmeerriiinnaa –– MMaahhaazzooaarriiivvoo -- FFaannddrriiiaannaa Présenté le 09 octobre 2012 par Monsieur : RANDRIAMANANJO Dina Lalaina Devant le jury composé de : Président : - Monsieur ANDRIANARY Philippe Antoine Professeur Titulaire Examinateurs : - Mme Sylvie -

Répartition De La Caisse-École 2020 Des Collèges D'enseignement
Repartition de la caisse-école 2020 des Collèges d'Enseignement Général DREN ALAOTRA-MANGORO CISCO AMBATONDRAZAKA Prestataire OTIV ALMA Commune Code Etablissement Montant AMBANDRIKA 503010005 CEG AMBANDRIKA 1 598 669 AMBATONDRAZAKA 503020018 C.E.G. ANOSINDRAFILO 1 427 133 AMBATONDRAZAKA 503020016 CEG RAZAKA 3 779 515 AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE 503030002 C.E.G. ANDINGADINGANA 1 142 422 AMBATOSORATRA 503040001 CEG AMBATOSORATRA 1 372 802 AMBOHIBOROMANGA 503070012 CEG ANNEXE AMBOHIBOROMANGA 878 417 AMBOHIBOROMANGA 503150018 CEG ANNEXE MARIANINA 775 871 AMBOHIBOROMANGA 503150016 CEGFERAMANGA SUD 710 931 AMBOHIDAVA 503040017 CEG AMBOHIDAVA 1 203 171 AMBOHITSILAOZANA 503050001 CEG AMBOHITSILAOZANA 1 671 044 AMBOHITSILAOZANA CEG TANAMBAO JIAPASIKA 622 687 AMPARIHINTSOKATRA 503060013 CEG AMPARIHINTSOKATRA 1 080 499 AMPITATSIMO 503070001 CEG AMPITATSIMO 1 530 936 AMPITATSIMO 503070015 CEG ANNEXE AMBOHITANIBE 860 667 ANDILANATOBY 503080025 CEG ANDRANOKOBAKA 760 039 ANDILANATOBY 503080001 CEG ANDILANATOBY 1 196 620 ANDILANATOBY 503080026 CEG ANNEXE SAHANIDINGANA 709 718 ANDILANATOBY 503080027 CEG COMMUNAUTAIRE AMBODINONOKA 817 973 ANDILANATOBY 503080031 CEG COMMUNAUTAIRE MANGATANY 723 676 ANDILANATOBY 503080036 CEG COMMUNAUTAIRE RANOFOTSY 668 769 ANDROMBA 503090005 CEG ANDROMBA 1 008 043 ANTANANDAVA 503100020 CEG ANTANANDAVA 1 056 579 ANTSANGASANGA 503110004 CEG ANTSANGASANGA 757 763 BEJOFO 503120016 C.E.G. -

Infected Areas As on 2 August 1984 — Zones Infectées Au 2 Août 1984 for Cntena Used in Compiling This List, See No 12
Wkly Epidem, Rec No, 31-3 August 1984 - 243 - Relevé èpuièm, hebd. N° 31 - 3 août 1984 INFLUENZA SURVEILLANCE SURVEILLANCE DE LA GRIPPE P a p u a New G u in e a (19 July 1984), — Seven strains of P a p o u a s ie N o u v e l l e -G u in é e (19 juillet 1984). — Sept souches du influenza B virus were isolated, mainly from young children, virus grippal B ont été isolées, suitout chez de jeunes enfants, au cours de during outbreaks in the Eastern Highland Province during J une poussées qui se sont produites en juin et juillet dans la provmce des and July. An additional strain was isolated from a child in the Eastern Highlands. Une autre souche a été isolée chez un enfant dans la Southern Highland Province where influenza also was reported province des Southern Highlands où l’on a aussi rapporté une forte inci widespread. Similar illness has been reported in other highland dence de la grippe. Des affections similaires ont été signalées dans provinces. These were the first isolates of influenza B virus since d’autres provinces des Highlands. Ces isolements de virus grippal B November 1982. étaient les premiers depuis novembre 1982. Infected Areas as on 2 August 1984 — Zones infectées au 2 août 1984 For cntena used in compiling this list, see No 12. page 92 - Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publies dans le N° 12, page 92. X Newly reported areas - Nouvelles zones signalées. PLAGUE - PESTE Province Ouest Mandya Distnct MALAYSIA - MALAISIE Africa — Afrique Haul-Nkam Département Mysore Distnct Peninsular Malaysia Rafang Arrondissement South Kanara Distnct Kedah State MADAGASCAR EQUATORIAL GUINEA Maharashtra State Kuala Muda H D istna Antananarivo Province GUINÉE ÉQUATORIALE Akola Distnct Sabah Antananarivo- Ville Fernando Poo Province Aurangabad Distnct Kota Kinabalu D istna 3e Arrondissement Ratnagin Distnct Artvommamo S. -
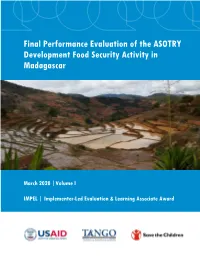
Download Final Performance Evaluation of the ASOTRY Development Food Security Activity in Madagascar
Final Performance Evaluation of the ASOTRY Development Food Security Activity in Madagascar March 2020 |Volume I IMPEL | Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award ABOUT IMPEL The Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award works to improve the design and implementation of Food for Peace (FFP) funded development food security activities (DFSAs) through implementer-Led evaluations and knowledge sharing. Funded by the USAID Office of Food for Peace (FFP), the Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award will gather information and knowledge in order to measure performance of DFSAs, strengthen accountability, and improve guidance and policy. This information will help the food security community of practice and USAID to design projects and modify existing projects in ways that bolster performance, efficiency and effectiveness. The Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award is a two-year activity (2019-2021) implemented by Save the Children (lead), TANGO International, and Tulane University, in Haiti, the Democratic Republic of Congo, Madagascar, Malawi, Nepal, and Zimbabwe. RECOMMENDED CITATION IMPEL. (2020). Final Performance Evaluation of the ASOTRY Development Food Security Activity in Madagascar (Vol. 1). Washington, DC: The Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award PHOTO CREDITS Douglas R. Brown. Rice fields in central Madagascar at various stages of planting. September 2019. DISCLAIMER This report is made possible by the generous support of the American people through the United States -

EITI-Madagascar
Rapport de réconciliation 2018 – EITI-Madagascar EITI-Madagascar Rapport de réconciliation 2018 Annexes Version finale Novembre 2019 Confidentiel – Tous droits réservés - Ernst & Young Madagascar Rapport final | 1 Rapport de réconciliation 2018 – EITI-Madagascar Sommaire ANNEXES .......................................................................................................................................................... 3 Annexe 1 : Points de décision en matière de divulgation de la propriété réelle ........................................ 4 Annexe 2 : Tableau de correspondance entre flux de paiements et entités réceptrices ............................ 9 Annexe 3 : Données brutes pour sélectionner les compagnies ............................................................... 11 Annexe 4 : Identification des sociétés ..................................................................................................... 12 Annexe 5 : Arbres capitalistiques des sociétés ........................................................................................ 26 Annexe 6 : Présentation des flux de paiement ........................................................................................ 31 Annexe 7 : Matérialité des régies et des flux concernés par les taxes et revenus pour 2015 et 2016 (#4.1) 35 Annexe 8 : Cas Mpumalanga – Lettre du Ministre ................................................................................... 36 Annexe 9 : Cas Mpumalanga – Acte de rejet du BCMM ......................................................................... -

Le Cas De La Commune Rurale D'ivato-Centre Ambositra
UNIVERSITE D‟ANTANANARIVO FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT GEOGRAPHIE PROMOTION « MANDRESY » LE « DAHALOÏSME » DANS LE BETSILEO NORD : LE CAS DE LA COMMUNE RURALE D’IVATO-CENTRE AMBOSITRA (REGION AMORON’I MANIA) Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Maîtrise en Géographie PRESENTE PAR : Voahary Mihaja Lucille RAVELOSON SOUS LA DIRECTION DE : Monsieur James RAVALISON Ŕ Maitre de Conférences Le 11 Mai 2012 UNIVERSITE D‟ANTANANARIVO FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT GEOGRAPHIE PROMOTION « MANDRESY » LE « DAHALOÏSME » DANS LE BETSILEO NORD : LE CAS DE LA COMMUNE RURALE D’IVATO-CENTRE AMBOSITRA (REGION AMORON’I MANIA) Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Maîtrise en Géographie PRESENTE PAR : Voahary Mihaja Lucille RAVELOSON DEVANT LE JURY COMPOSE DE : Président du jury : Madame Josette RANDRIANARISON, Professeur Titulaire Rapporteur : Monsieur James RAVALISON, Maître de Conférences Juge : Madame RAZAFIMAHEFA-RASOANIMANANA, Maître de Conférences Le 11 Mai 2012 REMERCIEMENTs Nous adressons ici nos vifs remerciements à tous ceux qui par leur appui, leur sollicitude, leur bonne volonté, leurs conseils et enseignements, nous ont aidé à mener à terme ce travail. Tout d‟abord nous tenons à exprimer notre gratitude à : Madame Josette RANDRIANARISON, Professeur Titulaire au sein du Département de Géographie, qui, malgré ses multiples obligations, nous fait l‟honneur de présider cette soutenance de mémoire. Madame, veuillez trouver ici l‟expression de nos respects les plus sincères. Madame RAZAFIMAHEFA-RASOANIMANANA, Maître de Conférences au sein du Département de Géographie, qui a bien voulu siéger en tant que juge de notre travail et nous apporter son expérience. Madame, veuillez accepter nos sincères remerciements pour l‟honneur que vous nous faites. -

Toerana Azo Antonina Amin'izany
FAMPAHAFANTARANA Vaccinodrome manerana ny Nosy Ho antsika mpiara-miasa rehetra eto amin’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, izay maniry ny hanao na eto amin’ny faritra Analamanga na any amin’ny Faritra, dia omena antsika eto ireo toerana azo antonina amin’izany. Faritra Analamanga ATSINANANA TOAMASINA I CHUM TOAMASINA CSB Urbain AMBOHIDRATRIMO TOAMASINA II BSD TOAMASINA II CSB 2 Ivato Aeroport, CSB 2 Mahitsy, CSB 2 Antehiroka, CSB 2 CSB FANANDRANA Soavinimerina, CSB 2 Talatamaty, CSB 2 Ambohitrimanjaka, CSB FOULPOINTE CSB 2 Ambodirano, CSB 2 Ampangabe, CSB 2 Ambatolampy BRICKAVILLE CSB URBAIN BRICKAVILLE tsimahafotsy, CSB 2 Antanetibe Mahazaza, CSB 2 Anosiala. CHRD2 BRICKAVILLE MAHANORO CHRD MAHANORO ANTANANARIVO ATSIMONDRANO CSB U MAHANORO Hopitaly Itaosy, CSB 2 Andoharanofotsy, CSB 2 Ankadivoribe, CSB1 AMPITAKIHOSY CSB 2 Faliarivo, CSB 2 Itaosy Bemasoandro, CSB 2 Anosizato, VATOMANDRY BSD VATOMANDRY CSB 2 Itaosy Cité, CSB 2 Anjomakely, CSB 2 Tanjombato, CSB URBAIN VATOMANDRY CSB 2 Fenoarivo, CSB 2 Tsararivotra, CSB 2 Soavina, CSB 2 MAROLAMBO CHRD MAROLAMBO Ambohijafy, CSB 2 Ankaraobato, CSB 2 Ambohijanaka, CSB 2 CSB2 MAROLAMBO Ambaniala Itaosy. ANTANAMBAO MANAMPONTSY CHRD ANTANAMBAO MANAMPOTSY ANTANANARIVO AVARADRANO CSB 2 Anosiavaratra, CSB 2 Ankadikely, CSB 2 Ampahimanga, DIANA CSB 2 Masindray, CSB 2 Ambohimangakely, CSB 2 Alasora, ANTSIRANANA 1 CSBU TANAMBAO CSB 2 Sabotsy Namehana, CSB 2 Talata Volonondry, CSB 2 AMBILOBE CSB2 AMBILOBE Anjeva, CSB 2 Ankadinandrina, CSB 2 Ambohimanga Rova, CSB2 AMPONDRALAVA CSB 2 Ambohimalaza. -

3102 Ambositra
dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 310201010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBALAVAO CENTRE dfggfdgffhCommune: ALAKAMISY AMBOHIJATO dfggfdgffhDistrict: AMBOSITRA dfggfdgffhRegion: AMORON'I MANIA dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 663 Votants: 238 Blancs et Nuls: 9 Soit: 3,78% Suffrages exprimes: 229 Soit: 96,22% Taux de participation: 35,90% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 197 86,03% 25 RAVALOMANANA Marc 32 13,97% Total voix: 229 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 310201020101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBATOVIHINA dfggfdgffhCommune: ALAKAMISY AMBOHIJATO dfggfdgffhDistrict: AMBOSITRA dfggfdgffhRegion: AMORON'I MANIA dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 191 Votants: 122 Blancs et Nuls: 1 Soit: 0,82% Suffrages exprimes: 121 Soit: 99,18% Taux de participation: 63,87% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 107 88,43% 25 RAVALOMANANA Marc 14 11,57% Total voix: 121 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm -

Amoron'i Mania
LISTE DES ENSEIGNANTS FRAM NON SUBVENTIONNES BENEFICIAIRES "AIDE-SPECIALE" FINANCEMENT "ETAT" REGION : AMORON'I MANIA N° DREN CISCO ZAP NIVEAU CODE ETAB ETABLISSEMENT NOM ET PRENOMS CIN EPP AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN RAMANATSIHOARANA MIRANA 0001 PRESCO 304010002 AMBATOFINANDRAHANA 202 012 007 769 MANIA NA A NORD AUGUSTINE CENTRALE EPP AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN ANJARASOAMAHAZAVO 0002 PRESCO 304010002 AMBATOFINANDRAHANA 203 012 017 932 MANIA NA A NORD HERINIRINA ELISA CENTRALE AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN LALAONIRINA NOMENJANAHARY 0003 PRESCO 304010004 EPP AMBATOMENALOHA 202 012 014 510 MANIA NA A NORD OLIVIA AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN RAZAFIMAMPIONONA 0004 PRESCO 304010004 EPP AMBATOMENALOHA 202 012 014 509 MANIA NA A NORD HANITRINIAINA MARIETTE AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN RASOARIMALALA HASINIAINA 0005 PRESCO 304010004 EPP AMBATOMENALOHA 202 012 009 515 MANIA NA A NORD VERONIQUE AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN RASOLONOMENJANAHARY 0006 PRESCO 304010004 EPP AMBATOMENALOHA 202 012 009 462 MANIA NA A NORD SOAMIARANA PHILOMENE AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN RAZANANIRINA HERILALAO 0007 PRESCO 304010004 EPP AMBATOMENALOHA 202 012 005 075 MANIA NA A NORD CHRISTINE AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN EPP AMBOHIBARY RASOAMILANTO NIVOHARISOLO 0008 PRESCO 304010007 202 012 014 513 MANIA NA A NORD RANOMAFANA CLAUDINE AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN HARIMALALA MBININA 0009 PRESCO 304010009 EPP AMBOHIMIARINA 108 072 008 636 -

Pezzottaite from Ambatovita, Madagascar: a New Gem Mineral
PEZZOTTAITE FROM AMBATOVITA, MADAGASCAR: A NEW GEM MINERAL Brendan M. Laurs, William B. (Skip) Simmons, George R. Rossman, Elizabeth P. Quinn, Shane F. McClure, Adi Peretti, Thomas Armbruster, Frank C. Hawthorne, Alexander U. Falster, Detlef Günther, Mark A. Cooper, and Bernard Grobéty Pezzottaite, ideally Cs(Be2Li)Al2Si6O18, is a new gem mineral that is the Cs,Li–rich member of the beryl group. It was discovered in November 2002 in a granitic pegmatite near Ambatovita in cen- tral Madagascar. Only a few dozen kilograms of gem rough were mined, and the deposit appears nearly exhausted. The limited number of transparent faceted stones and cat’s-eye cabochons that have been cut usually show a deep purplish pink color. Pezzottaite is distinguished from beryl by its higher refractive indices (typically no=1.615–1.619 and ne=1.607–1.610) and specific gravity values (typically 3.09–3.11). In addition, the new mineral’s infrared and Raman spectra, as well as its X-ray diffraction pattern, are distinctive, while the visible spectrum recorded with the spec- trophotometer is similar to that of morganite. The color is probably caused by radiation-induced color centers involving Mn3+. eginning with the 2003 Tucson gem shows, (Be3Sc2Si6O18; Armbruster et al., 1995), and stoppaniite cesium-rich “beryl” from Ambatovita, (Be3Fe2Si6O18; Ferraris et al., 1998; Della Ventura et Madagascar, created excitement among gem al., 2000). Pezzottaite, which is rhombohedral, is Bcollectors and connoisseurs due to its deep purplish not a Cs-rich beryl but rather a new mineral species pink color (figure 1) and the attractive chatoyancy that is closely related to beryl.