Bulletin De L'institut Natidnal Des Appellationsd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
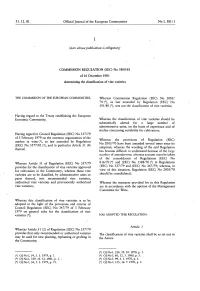
Determining the Classification of Vine Varieties Has Become Difficult to Understand Because of the Large Whereas Article 31
31 . 12 . 81 Official Journal of the European Communities No L 381 / 1 I (Acts whose publication is obligatory) COMMISSION REGULATION ( EEC) No 3800/81 of 16 December 1981 determining the classification of vine varieties THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Whereas Commission Regulation ( EEC) No 2005/ 70 ( 4), as last amended by Regulation ( EEC) No 591 /80 ( 5), sets out the classification of vine varieties ; Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, Whereas the classification of vine varieties should be substantially altered for a large number of administrative units, on the basis of experience and of studies concerning suitability for cultivation; . Having regard to Council Regulation ( EEC) No 337/79 of 5 February 1979 on the common organization of the Whereas the provisions of Regulation ( EEC) market in wine C1), as last amended by Regulation No 2005/70 have been amended several times since its ( EEC) No 3577/81 ( 2), and in particular Article 31 ( 4) thereof, adoption ; whereas the wording of the said Regulation has become difficult to understand because of the large number of amendments ; whereas account must be taken of the consolidation of Regulations ( EEC) No Whereas Article 31 of Regulation ( EEC) No 337/79 816/70 ( 6) and ( EEC) No 1388/70 ( 7) in Regulations provides for the classification of vine varieties approved ( EEC) No 337/79 and ( EEC) No 347/79 ; whereas, in for cultivation in the Community ; whereas those vine view of this situation, Regulation ( EEC) No 2005/70 varieties -

European Commission
29.9.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 321/47 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2020/C 321/09) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF A STANDARD AMENDMENT TO THE SINGLE DOCUMENT ‘VAUCLUSE’ PGI-FR-A1209-AM01 Submitted on: 2.7.2020 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Description of the wine(s) Additional information on the colour of wines has been inserted in point 3.3 ‘Evaluation of the products' organoleptic characteristics’ in order to add detail to the description of the various products. The details in question have also been added to the Single Document under the heading ‘Description of the wine(s)’. 2. Geographical area Point 4.1 of Chapter I of the specification has been updated with a formal amendment to the description of the geographical area. It now specifies the year of the Geographic Code (the national reference stating municipalities per department) in listing the municipalities included in each additional geographical designation. The relevant Geographic Code is the one published in 2019. The names of some municipalities have been corrected but there has been no change to the composition of the geographical area. This amendment does not affect the Single Document. 3. Vine varieties In Chapter I(5) of the specification, the following 16 varieties have been added to those listed for the production of wines eligible for the ‘Vaucluse’ PGI: ‘Artaban N, Assyrtiko B, Cabernet Blanc B, Cabernet Cortis N, Floreal B, Monarch N, Muscaris B, Nebbiolo N, Pinotage N, Prior N, Soreli B, Souvignier Gris G, Verdejo B, Vidoc N, Voltis B and Xinomavro N.’ (1) OJ L 9, 11.1.2019, p. -

A Molecular Marker Set Combining a Retrotransposon Insertion and SSR Polymorphisms Is Useful for Assessing Diversity in Vitis
Received: 17 August 2020 y Accepted: 11 May 2021 y Published: 25 June 2021 DOI:10.20870/oeno-one.2021.55.2.4473 A molecular marker set combining a retrotransposon insertion and SSR polymorphisms is useful for assessing diversity in Vitis Frédérique Pelsy, Lucie Bevilacqua, Sophie Blanc and Didier Merdinoglu Université de Strasbourg, INRAE, SVQV UMR-A 1131, F-68000 Colmar, France *corresponding author: [email protected] Associate editor: Laurent Jean-Marie Torregrosa ABSTRACT Molecular markers, based on DNA polymorphisms, are useful tools for identifying individuals, establishing phylogenetic relationships, managing collections of genetic material or assisting breeding. In the present study, we developed a marker set to differentiate Vitis species, grapevine varieties or clones belonging to the same variety. This novel marker set combines, in four PCR amplifications, the presence/absence of a remarkable retrotransposon, Tvv1-Δ3460, inserted at its single locus and the SSR polymorphism present within its two LTRs. By studying a collection of Vitaceae accessions, we showed the prevalence of two allelic forms of Tvv1-Δ3460 - one of which was partially truncated - in Vitis species. Out of the twenty-five studiedVitis species, the insertion of a Tvv1-Δ3460 element was detected in twenty, including Vitis vinifera. The homozygous vs heterozygous state of the element insertion was determined by amplifying the empty site. Additionally, each Tvv1-Δ3460 LTRs included a microsatellite sequence useful for designing markers based on LTR length. The LTR-SSR markers distinguished most of the fifty-two cultivars and revealed polymorphism within five of the seven varieties studied. KEYWORDS molecular markers, grapevine, retrotransposon, SSR OENO One 2021, 2, 403-414 © 2021 International Viticulture and Enology Society - IVES 403 Fréderique Pelsy et al. -

Canada-EU Wine and Spirits Agreement
6.2.2004 EN Official Journal of the European Union L 35/3 AGREEMENT between the European Community and Canada on trade in wines and spirit drinks THE EUROPEAN COMMUNITY, hereafter referred to as ‘the Community', and CANADA, hereafter jointly referred to as ‘the Contracting Parties', RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in the wine and spirits sector, DESIROUS of creating more favourable conditions for the harmonious development of trade in wine and spirit drinks on the basis of equality and mutual benefit, HAVE AGREED AS FOLLOWS: TITLE I — ‘labelling' shall mean any tag, brand, mark, pictorial or other descriptive matter, written, printed, stencilled, marked, embossed or impressed on, or attached to, a INITIAL PROVISIONS container of wine or a spirit drink, Article 1 — ‘WTO Agreement' refers to the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organisation, Objectives 1. The Contracting Parties shall, on the basis of — ‘TRIPs Agreement' refers to the Agreement on trade-related non-discrimination and reciprocity, facilitate and promote aspects of intellectual property rights, which is contained trade in wines and spirit drinks produced in Canada and the in Annex 1C to the WTO Agreement, Community, on the conditions provided for in this Agreement. 2. The Contracting Parties shall take all reasonable measures — ‘1989 Agreement' refers to the Agreement between the to ensure that the obligations laid down in this Agreement are European Economic Community and Canada concerning fulfilled and that the objectives set out in this Agreement are trade and commerce in alcoholic beverages concluded on attained. 28 February 1989. Article 2 2. -

Report of a Working Group on Vitis: First Meeting
European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources Report of a Working ECP GR Group on Vitis First Meeting, 12-14 June 2003, Palić, Serbia and Montenegro E. Maul, J.E. Eiras Dias, H. Kaserer, T. Lacombe, J.M. Ortiz, A. Schneider, L. Maggioni and E. Lipman, compilers IPGRI and INIBAP operate under the name Bioversity International Supported by the CGIAR European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources Report of a Working ECP GR Group on Vitis First Meeting, 12-14 June 2003, Palić, Serbia and Montenegro E. Maul, J.E. Eiras Dias, H. Kaserer, T. Lacombe, J.M. Ortiz, A. Schneider, L. Maggioni and E. Lipman, compilers ii REPORT OF A WORKING GROUP ON VITIS: FIRST MEETING Bioversity International is an independent international scientific organization that seeks to improve the well-being of present and future generations of people by enhancing conservation and the deployment of agricultural biodiversity on farms and in forests. It is one of 15 centres supported by the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), an association of public and private members who support efforts to mobilize cutting-edge science to reduce hunger and poverty, improve human nutrition and health, and protect the environment. Bioversity has its headquarters in Maccarese, near Rome, Italy, with offices in more than 20 other countries worldwide. The Institute operates through four programmes: Diversity for Livelihoods, Understanding and Managing Biodiversity, Global Partnerships, and Commodities for Livelihoods. The international -

Annexe Définie À L'article 1Er De L'arrêté Du 7 Juillet 2015 Modifié Par
Publié au BO du MAA le 26 mars 2020 Annexe définie à l’article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2015 Modifié par arrêté du 10 mars 2020 publié au JORF du 17 mars 2020 LISTE DES VARIETES DE RAISINS DE CUVE POUVANT ETRE PLANTEES, REPLANTEES OU GREFFEES AUX FINS DE LA PRODUCTION VITIVINICOLE Les variétés de raisins de cuve peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production vitivinicole : a) sur l’ensemble du territoire métropolitain pour les variétés suivantes : Dénomination Couleur de la baie Synonyme(s) Abondant (6) Blanche Abouriou Noire Agiorgitiko (4) Noire Aléatico(4) Noire Alicante Henri Bouschet (3) Noire Aligoté (5) Blanche Altesse (5) Blanche Alvarinho Blanche Albariño Aramon(6) Noire Aramon Aramon blanc (6) Blanche Aramon Aramon gris (6) Grise Aramon Aranel Blanche Arbane Blanche Arinarnoa Noire Arriloba Blanche Arrouya Noire Arrufiac Blanche Arrufiat Arvine Blanche Petite Arvine Artaban (*) Noire Assyrtico Blanche Aubin (6) Blanche Aubin vert (6) Blanche Aubun Noire Murescola Auxerrois(6) Blanche Bachet Noire Baco blanc (*) Blanche Barbaroux (6) Rose Barbera (4) Noire Publié au BO du MAA le 26 mars 2020 Baroque Blanche Beaugaray Noire Béclan Noire Petit Béclan Béquignol Noire Bia Blanche Bia blanc Biancu Gentile Blanche Blanc Dame Blanche Bouchalès Noire Bouillet Noire Bouquettraube Blanche Bourboulenc Blanche Doucillon blanc Bouysselet Blanche Brachet Noire Braquet Bronner (*) Blanche Brun argenté Noire Vaccarèse Brun Fourca Noire Cabernet blanc (*) Blanche Cabernet cortis (*) Noire Cabernet franc Noire Cabernet-Sauvignon -

Official Journal of the European Communities Wines Derived from Vine Varieties Appearing in the Recommended Or Authorised Vine V
Official Journal of the European Communities 623 10.10.70 Official Journal of the European Communities No L 224/ 1 REGULATION ( EEC) No 2005/70 OF THE COMMISSION of 6 October 1970 on the classification of vine varieties THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COM wines derived from vine varieties appearing in the MUNITIES , classification of vine varieties may be considered as table wines ; Having regard to the Treaty setting up the European Economic Community; Whereas strict application of Regulation ( EEC ) No 1388/70 would, in certain cases , lead to considerable Having regard to Council Regulation ( EEC ) No difficulties, since the classification is intended to serve 816/701 of 28 April 1970 laying down additional as guidance for vine-planting ; whereas, therefore, provisions for the common organisation of the exceptions in respect of table grape varieties used by market in wine, as amended by Regulation ( EEC ) No the canning industry which are not subject to the 1253/70,2 and in particular the second subparagraph common quality standards applicable to table grapes of Article 16 ( 1 ) and Article 37 thereof ; should be allowed for a transitional period ; Whereas Article 16 ( 1 ) of Regulation ( EEC ) No Whereas the measures provided in this Regulation are 816/70 provides for a classification of vine varieties in accordance with the Opinion of the Management approved for cultivation in the Community ; whereas Committee for Wines ; those vine varieties should be classified, by administrative units or parts thereof, into HAS ADOPTED THIS REGULATION : recommended vine varieties, authorised vine varieties and provisionally authorised vine varieties ; Article 1 Whereas this classification of vine varieties should be adopted in the light of the provisions and criteria of The classification of vine varieties shall be as shown Council Regulation (EEC) No 1388/703 of 13 July, in the Annex to this Regulation . -

Plan De La Ville De Héricourt
A B C D E F G H I J K ECHENANS MANDREVILLARS CHALONVILLARS 1 3 1 GUINNOTTES 2 4 rue du Chêne Sec EST BELFORT A36 rt cy fo u Sa du in d a ute em u D meron ro ch d n i m e ch tin ran o 2 om 19 2 R RN t GUINNOTTES 1 er u V d in n ub i LUZE l’A m e de h in c CHAGEY m rue des Guinnottes he rt c RONCHAMP o CHENEBIER f u 3 LURE d CHAMPAGNEY te y ou nt r Sai nc EST VESOUL n Bla e ea ais h J ou p ue G impasse a r du r in g Marie-catherine é em l ch rue Hans Andersen é d’Aulnoy t impasse u du Chat Botté D d D 130 n 2 i rt 0 scal ve n m é 4 ro Pa Pr o e u ise ues h te h Bla cq d rue des Frères Grimm c e Ja u d 5 u e r ru o u r f P COUTHENANS or rue Emile Zola t t n rce r t i e blot ndo e r u b r o R o u e u rr d C e o d e C e in i m P i BREVILLIERS he e COISEVAUX c ru artes e P c s e e u 3 u 3 rue Voltaire r D r u r e rue Gustave Effeil ARGIESANS n impasse du Muguet i R 9 1 t N N R 83 1 er 6 9 D R s nard e b R BAVILLIERS s impasse des écureuils i e u u r o o t u L n ro e C e e 6 P on r g id i e ru rue de la Combe aux loups i D e u e d ru rre h e V BELFORT 1 d s C u u d e o r z . -

Aglianico from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Aglianico From Wikipedia, the free encyclopedia Aglianico (pronounced [aʎˈʎaːniko], roughly "ahl-YAH-nee- koe") is a black grape grown in the Basilicata and Campania Aglianico regions of Italy. The vine originated in Greece and was Grape (Vitis) brought to the south of Italy by Greek settlers. The name may be a corruption of vitis hellenica, Latin for "Greek vine."[1] Another etymology posits a corruption of Apulianicum, the Latin name for the whole of southern Italy in the time of ancient Rome. During this period, it was the principal grape of the famous Falernian wine, the Roman equivalent of a first-growth wine today. Contents Aglianico from Taurasi prior to veraison Color of Black 1 History berry skin 2 Relationship to other grapes Also called Gnanico, Agliatica, Ellenico, 3 Wine regions Ellanico and Uva Nera 3.1 Other regions Origin Greece 4 Viticulture Notable Taurasi, Aglianico del Vulture 5 Wine styles wines 6 Synonyms Hazards Peronospera 7 References History The vine is believed to have first been cultivated in Greece by the Phoceans from an ancestral vine that ampelographers have not yet identified. From Greece it was brought to Italy by settlers to Cumae near modern-day Pozzuoli, and from there spread to various points in the regions of Campania and Basilicata. While still grown in Italy, the original Greek plantings seem to have disappeared.[2] In ancient Rome, the grape was the principal component of the world's earliest first-growth wine, Falernian.[1] Ruins from the Greek Along with a white grape known as Greco (today grown as Greco di Tufo), the grape settlement of Cumae. -

Liste Des Variétés De Raisins De Cuve Pouvant Être
Annexe définie à l’article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2015, modifié par arrêtés du 19 avril 2017, 3 juillet 2017 et 7 mars 2018 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve Annexe définie à l’article 1er de l’ arrêté du 7 juillet 2015 modifié par l 'arrêté du 19 avril 2017, l' arrêté du 3 juillet 2017 et par l'arrêté du 7 mars 201 8 publié au JORF du 14 mars 2018 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve LISTE DES VARIÉTÉS DE RAISINS DE CUVE POUVANT ÊTRE PLANTÉES, REPLANTÉES OU GREFFÉES AUX FINS DE LA PRODUCTION VITIVINICOLE Annexe définie à l’article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2015, modifié par arrêtés du 19 avril 2017, 3 juillet 2017 et 7 mars 2018 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve Les variétés de raisins de cuve peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production vitivinicole : a) sur l’ensemble du territoire métropolitain pour les variétés suivantes : Variété Synonyme(s) Abondant B (6) Abouriou B Agiorgitiko N (4) Aléatico N (4) Alicante Henri Bouschet N (3) Aligoté B (5) Altesse B (5) Alvarinho Albariño Aramon blanc B (6) Aramon gris G (6) Aramon N (6) Aranel B Arbane B Arinarnoa N Arriloba B Arrouya N Arrufiac B Arrufiat Arvine B Petite Arvine Assyrtico B Artaban N (*) Aubin B (6) Aubin vert B (6) Aubun N Murescola Auxerrois B (6) Bachet N Baco blanc B (*) Barbaroux Rs (6) Barbera N (4) Baroque B Beaugaray N Béclan N Petit Béclan Béquignol N Bia B Bia blanc Biancu Gentile B Blanc Dame B Bouchalès N Bouillet N Annexe définie -

Liste Des Variétés De Raisins De Cuve Pouvant Être Plantées, Replantées Ou Greffées Aux Fins De La Production Vitivinicole
Annexe définie à l’article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2015, établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve Version mise à jour par l'arrêté du 2 février 2021 publié au JORF du 11 février 2021 Publié au au BO du MAA le 11 février 2021 LISTE DES VARIÉTÉS DE RAISINS DE CUVE POUVANT ÊTRE PLANTÉES, REPLANTÉES OU GREFFÉES AUX FINS DE LA PRODUCTION VITIVINICOLE Les variétés de raisins de cuve peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production vitivinicole : a) sur l’ensemble du territoire métropolitain pour les variétés suivantes : Dénomination Couleur de la baie Synonyme(s) Abondant (6) Blanche Abouriou Noire Agiorgitiko (4) Noire Airen Blanche Aléatico(4) Noire Alicante Henri Bouschet (3) Noire Aligoté (5) Blanche Altesse (5) Blanche Alvarinho Blanche Albariño Aramon(6) Noire Aramon Aramon blanc (6) Blanche Aramon Aramon gris (6) Grise Aramon Aranel Blanche Arbane Blanche Arinarnoa Noire Arriloba Blanche Arrouya Noire Arrufiac Blanche Arrufiat Arvine Blanche Petite Arvine Artaban (*) Noire Assyrtico Blanche Aubin (6) Blanche Aubin vert (6) Blanche Aubun Noire Murescola Auxerrois(6) Blanche Bachet Noire Baco blanc (*) Blanche Barbaroux (6) Rose Barbera (4) Noire Baroque Blanche Beaugaray Noire Béclan Noire Petit Béclan Béquignol Noire Bia Blanche Bia blanc Annexe définie à l’article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2015, établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve Version mise à jour par l'arrêté du 2 février 2021 publié au JORF du 11 février 2021 Publié au au BO du MAA le -

Origini, Genetica E Sviluppo Storico Del Pinot Bianco
SPATIUM PINOT BLANC I Pinot bianchi europei ad Appiano 29 agosto 2014 Il pinot: origini, genetica e sviluppo storico del Pinot bianco Erika Maul Istituto per la selezione della vite di Geilweilerhof www.jki.bund.de Nozioni storiche: la domesticazione della vite Il cremotartaro = I siti archeologici in cui biomarcatore del vino. sono stati rinvenuti riscontrato in residui su questi reperti si cocci e recipienti antichi. trovano, per esempio, nelle seguenti località: Shulaveri (ca. 6.000 a.C.) Hajji Firuz Tepe (5.000 – 5.400 a.C..) McGovern Abydos (Mc Govern, 2003) (3.150 a.C.) La domesticazione della vite: dove avvenne davvero? Nella Transcaucasia o nell‘Anatolia meridionale? Secondo Vavilov (botanico e genetista russo): Transcaucasia = centro genetico per la spiccata varietà di forme e la presenza di fitte popolazioni di vite selvatica. Vite selvatica nella Vite selvatica Vite selvatica nella Georgia nell‘Azerbaigian Georgia Foto: David Maghradze Foto: Prof. Amanov Foto: David Maghradze Quale fattore fu determinante per la domesticazione della vite? Mutazione ereditaria del locus sessuale Vite selvatica Vite coltivata Pianta e pianta Pianta maschio femmina ermafrodita Quale vantaggio economico produsse la domesticazione? Grappoli e acini più grandi Vite selvatica Vite coltivata Frutti piccoli Frutti medi e grandi Quali altre modifiche derivarono dalla domesticazione? Modifiche nella morfologia delle foglie e dei semi: Vite selvatica Vite coltivata Foglia Semplice, aperta sul Grande varietà strutturale : picciolo Semi: Rotondi, a becco Oblunghi con becco corto allungato Quale altra mutazione genetica si rivelò fondamentale? La mutazione nel locus genetico della colorazione degli acini: Vite selvatica Vite coltivata Colorazione blu Diverse colorazioni, da verde e scura, omozigote giallo a blu scuro Diverse varietà di vite coltivata si diffusero da Oriente, trasportate dai colonizzatori fenici, greci e romani.