À Madagascar P
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Recommended publications
-

F a S T Update Madagascar Semi-Annual Risk Assessment June to November 2006
F A S T Update Madagascar Semi-annual Risk Assessment June to November 2006 T S A F © swisspeace FAST Update Madagascar | June to November 2006 | Page 2 Contents Country Stability and Cooperative International Events (relative) 3 Conflictive Government and Non-Government Events (relative) 5 Cooperative and Conflictive Domestic Events (relative) 8 Appendix: Description of indicators used 11 The FAST International Early Warning Program 12 FAST Update Subscription: www.swisspeace.org/fast/subscription_form.asp Contact FAST International: Country Expert: Phone: +41 31 330 12 19 Richard Marcus Fax: +41 31 330 12 13 mailto:[email protected] www.swisspeace.org/fast © swisspeace FAST Update Madagascar | June to November 2006 | Page 3 Country Stability and Cooperative International Events (relative) Average number of reported events per month: 127 Indicator description: see appendix Risk Assessment: • During the second half of 2006 Country Stability and Cooperative International Events in Madagascar were primarily a function of the social and political actions in the run-up to the much anticipated 3 December 2006 presidential elections. Promises for extended economic aid and long term program planning on the part of donors and other international actors slowed as the administration of President Marc Ravalomanana drew towards political action. Considering the large number of challengers to the presidency, and the volatility of the opposition, Country Stability remained notably high. The downward trend in the Country Stability index in November 2006 is a reflection primarily of a single event, and its repercussions: the weak effort by General Andrianafidisoa (Fidy) to stage a military challenge to the Ravalomanana regime. • The first half of 2006, like much of Ravalomanana’s presidency, was characterized by high levels of foreign assistance. -

Madagascar, D'une Crise À L'autre : Ruptures Et Continuités
Mireille Razafindrakoto, François Roubaud et Jean-Michel Wachsberger (dir.) Madagascar, d'une crise l'autre: ruptures et continuité KARTHALA - IRD MADAGASCAR, D'UNE CRISE L'AUTRE: RUPTURES ET CONTINUITÉ KARTHALA sur internet: www.karthala.com (paiement sécurisé) Couverture: Alakamisy Ambohimaha, 2007, © Pierrot Men. Éditions Kartha/a, 2018 ISBN Karthala: 978-2-8111-1988-1 ISBN IRD: 978-2-7099-2640-9 DIRECfEURS SCIENTIFIQUES Mireille Razafindrakoto, François Roubaud etJean-~icheIVVachsberger Madagascar, d'une crise l'autre: ruptures et continuité Édition Karthala IRD 22-24, boulevard Arago 44, bd de Dunkerque 75013 Paris 13572 Marseille À tous ceux qui ont contribué à la formation et au partage des connaissances pour le développement de Madagascar. À Philippe Hugon. INTRODUCfION GÉNÉRALE La trajectoire de Madagascar au prisme de ses crises Mireille RAzAFiNDRAKOTO, François RouBAuD et Jean-Michel WACHSBERGER Deux représentations de Madagascar sont aujourd'hui concurrentes. La première, héritée d'une longue histoire, est celle d'un quasi-eldorado. Dès le xvu" siècle, la description apologétique, par Étienne de Hacourt (1661), des richesses du pays, des savoir-faire des populations et de leur malléabilité avait abondamment nourri l'imaginaire colonial. Plus tard, dans les années 1930, c'est la propagande du gouverneur Cayla qui avait contribué à propager l'idée d'une «Île heureuse» (Fremigacci, 2014). Aujourd'hui, de nombreux récits de voyage et livres de photos présentent le pays comme un Éden à préserver: beauté époustouflante des paysages, gentillesse et douceur des habitants, diversité de la faune et de la flore. La banque de photographie Shutterstock sur Madagascar, où la Banque mondiale a puisé en 2016 les illustrations d'une publication sur la pauvreté (Banque mondiale, 2016), traduit à merveille ce capital imaginaire. -

602243 (1).Pdf (1.105Mb)
T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER ANABĠLĠM DALI FRANÇAFRIQUE - FRANSA’NIN AFRĠKA’DA SĠYASĠ VE EKONOMĠK ETKĠSĠ: MADAGASKAR ÖRNEĞĠ Yüksek Lisans Tezi Faly Heriniaina Francky Randrianarison Ankara – 2019 1 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER ANABĠLĠM DALI FRANÇAFRIQUE - FRANSA’NIN AFRĠKA’DA SĠYASĠ VE EKONOMĠK ETKĠSĠ: MADAGASKAR ÖRNEĞĠ Yüksek Lisans Tezi Faly Heriniaina Francky Randrianarison Tez Danışmanı Prof. Dr. Melek FIRAT Ankara - 2019 2 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER ................................................................................................................ i KISALTMALAR ........................................................................................................... iv GĠRĠġ ............................................................................................................................... 1 I. BÖLÜM: FRANSA’NIN AFRĠKA POLĠTĠKASI 1. SÖMÜRGESĠZLEġTĠRMEDEN GÜNÜMÜZE FRANSA’NIN ETKĠSĠNĠ SÜRDÜRME POLĠTĠKASI .......................................................................................... 6 1.1. Askeri ve Savunma Alanında ĠĢbirliği AnlaĢmaları ................................. 6 1.2. Parasal ĠĢbirliği AnlaĢmaları .................................................................... 13 1.3. KarĢılıklı Kalkınma Yardımı .................................................................... 17 1.3.1. Bağlı Yardım ............................................................................... 17 1.3.2. BaĢlangıçta Fransız Etkisindeki -

Carrie Antal
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2010 Educating for Democratic Citizenship: An Analysis of the Role of Teachers in Implementing Civic Education Policy in Madagascar Carrie Kristin Antal Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF EDUCATION EDUCATING FOR DEMOCRATIC CITIZENSHIP: AN ANALYSIS OF THE ROLE OF TEACHERS IN IMPLEMENTING CIVIC EDUCATION POLICY IN MADAGASCAR By CARRIE KRISTIN ANTAL A Dissertation submitted to the Department of Educational Leadership and Policy Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Fall Semester, 2010 The members of the committee approved the dissertation of Carrie Kristin Antal defended on October 27, 2010. ________________________ Peter Easton Professor Directing Dissertation ________________________ Jim Cobbe University Representative ________________________ Sande Milton Committee Member ________________________ Jeff Milligan Committee Member Approved: _________________________________________________________________ Patrice Iatarola, Chair, Department of Educational Leadership and Policy Studies The Graduate School has verified and approved the above-named committee members. ii I dedicate this work to all those seeking security and fulfillment in the face of daily tyranny and poverty. May humanity‟s collective efforts one day prove successful in ensuring equal opportunity for all. iii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my advisor, Dr. Peter Easton, for his guidance, insight and generous support throughout the course of my graduate studies and particularly in the completion of this project. His experience and wisdom have been an invaluable source of knowledge and inspiration that will shape my perspective for a lifetime to come. -

The World Factbook
The World Factbook Africa :: Madagascar Introduction :: Madagascar Background: Formerly an independent kingdom, Madagascar became a French colony in 1896 but regained independence in 1960. During 1992-93, free presidential and National Assembly elections were held ending 17 years of single-party rule. In 1997, in the second presidential race, Didier RATSIRAKA, the leader during the 1970s and 1980s, was returned to the presidency. The 2001 presidential election was contested between the followers of Didier RATSIRAKA and Marc RAVALOMANANA, nearly causing secession of half of the country. In April 2002, the High Constitutional Court announced RAVALOMANANA the winner. RAVALOMANANA achieved a second term following a landslide victory in the generally free and fair presidential elections of 2006. In early 2009, protests over increasing restrictions on opposition press and activities resulted in RAVALOMANANA handing over power to the military, which then conferred the presidency on the mayor of Antananarivo, Andry RAJOELINA, in what amounted to a coup d'etat. Numerous attempts have been made by regional and international organizations to resolve the subsequent political gridlock by forming a power-sharing government. Madagascar's independent electoral commission and the UN originally planned to hold a presidential election in early May 2013, but postponed the election until late July 2013, due to logistical delays. Geography :: Madagascar Location: Southern Africa, island in the Indian Ocean, east of Mozambique Geographic coordinates: 20 00 S, -

AC Vol 42 No 11
www.africa-confidential.com 1 June 2001 Vol 42 No 11 AFRICA CONFIDENTIAL ANGOLA 2 ANGOLA Lev Leviev takes on De Beers Who blinks first? Government and UNITA rebels edge reluctantly towards a ceasefire De Beers announced on 24 May that it was halting its diamond and new negotiations in one of Africa’s longest-running wars business in Angola. This is a Rebel leader Jonas Savimbi has a cruel sense of timing. For 18 months, he has been calling on the triumph for Israeli-based tycoon Leviev, whose diamond interests ruling Movimento Popular de Libertação de Angola to start talking again to his União Nacional para spread across Africa and Russia. a Independência Total de Angola. On 2 May, President José Eduardo dos Santos made his most conciliatory statement for a year, talking of a ‘route to peace’ and a dialogue with UNITA (AC Vol 42 No 9). Three days later, Savimbi’s fighters killed at least 80 people in Caxito, abducting 60 GHANA 3 children from a local orphanage. Many in Luanda believe both leaders are inching towards new negotiations but want to save face Ole Kufuor! and get the best negotiating position beforehand. Dos Santos is under pressure from the growing Coup rumours don’t faze President popularity of Luanda’s peace movement and needs a ceasefire if he’s to hold elections next year. John Kufuor. This week Kufuor Savimbi is feeling the pressure of sanctions, the government’s military efforts and the factionalising flew into Valencia to speak at the African Development Bank’s of his UNITA organisation. -

Madagascar, 1Er Semestre 2002: Une Crise Politique Et Ses Conséquences
Madagascar, 1er semestre 2002 : une crise politique et ses conséquences dans un pays en développement Wilfrid Bertile To cite this version: Wilfrid Bertile. Madagascar, 1er semestre 2002 : une crise politique et ses conséquences dans un pays en développement. Travaux & documents, Université de La Réunion, Faculté des lettres et des sciences humaines, 2003, Espaces, sociétés et environnements de l’océan Indien, pp.69–88. hal-02181282 HAL Id: hal-02181282 https://hal.univ-reunion.fr/hal-02181282 Submitted on 19 Oct 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Madagascar, 1er semestre 2002 : une crise politique et ses conséquences dans un pays en développement WILFRID BERTILE Professeur de Géographie Résué : Au cours du l" semestre 2002, Madagascar a connu une grave crise politique née de la contestation des résultats des élections présidentielles du 16 décembre 2001. Largement vainqueur sur les Hautes Terres, le Maire de Tananarive, Marc Ravalomanana, s'est proclamé Président de la République de Madagascar, estimant l'avoir emporté dès le premier tour alors que les résultats officiels en exigeaient un second. Il s'appuie sur les manifestations de masse, notamment dans la capitale. -

Power Struggles and Conflict Recurrence: an Examination Of
POWERS fRUUGLES AND CONFLICT RECURRENCE: AN EXAMINATION OF POIXI !CAL COMPETITION IN MADAGASCAR By Sawyer Lee Blazek Submitted to the Faculty of the School oflnternational Service of American Umvers1ty Ill Partwl Fulfillment of the Requ~rcments Cor the Degree of rvla::,ter or Arts In InterncltJOnal Poht1c:-, Cha.r:~- Dr. Boa:z Atzilt / ~" '• - -~"'" ;.-:> <'~~·~-""' > -~ ------- --- >-y-- ;,;;..~--- ..,....-- ~:~ Dr. Kwaku Nuamah / w ~A__ ~---------- ---- Dean of the Sehoul of InternatiOnal Service -~_l __ ~ :2<J J I Date ~y 2011 American Umvers1ty Washmgton, D.C. 20016 AMERICAN UMVERSITY UBRMY I q12 \ ' UMI Number: 1504737 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. UMI ___.Dissertation Publishing..___ UMI 1504737 Copyright 2011 by ProQuest LLC. All rights reserved. This edition of the work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Pro uesr ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml48106-1346 (()COPYRIGHT by Sawyer Lee Blazek 2011 ALL RIGHTS RESERVED POWER STRUGGLES AND CONFLICT RECURRENCE: AN EXAMINATION OF POLITICAL COMPETITION JN MADAGASCAR BY SAWYER LEE BLAZEK ABSTRACT This study examines the extent to which political power struggles have an effect on the recunence of conflict in a state. l create a model to examine the process of a political power struggle for the legitimate control of a state to measure the impact of particular events on an actor's political support. -

Political Change in Madagascar: Populist Democracy Or Neopatrimonialism by Another Name?
INSTITUTE FOR Political Change in Madagascar: Populist democracy or neopatrimonialism by another name? Richard R. Marcus SECURITY STUDIES ISS Paper 89 • August 2004 Price: R10.00 INTRODUCTION The paper concludes by offering a tentative answer to the question in the sub-title, considering whether Madagascar’s political space is defined by the Madagascar has gone through a momentous change country’s social movements. This is in contrast to in the nature of its democracy1 or whether it has given many African states which have been shaped by a birth to a new incarnation of neopatrimonial rule in history of domination by “big men”. In the case of which the president’s office is used more for personal Madagascar, no leader has had as much influence on gain than public benefit.2 the nature of the political system, or its dynamics, as the anti-colonial uprising of 1947, the military’s dissolution of the First Republic in 1972, the strikes of MALAGASY POLITICS BEFORE 2002 1991, or the populist support for “democracy” that Balkanised the country in 2002. Former President The colonial period Didier Ratsiraka was the single largest figure in Malagasy politics from 1975 to Madagascar became a French colony in 1992, yet the nature of his rule was 1896. Previously, the island had been defined by the events of 1972 and the President Marc largely centralised under the Merina way he came to office, just as the monarchy of the central highlands. An administration of Madagascar’s first Ravalomanana created earlier attempt by the French to govern president, Philibert Tsirinana, was the 2002 uprising that indirectly through the Merina had failed, defined by what had happened in 1947 so in 1896 the French colonial authorities and Zafy Albert’s 1993 – 96 presidency brought him to power, resorted to the model of direct rule. -

Democracy and Governance Strategic Assessment for USAID/Madagascar Integrated Country Strategic Plan (FY 2003-2008)
Democracy and Governance Strategic Assessment for USAID/Madagascar Integrated Country Strategic Plan (FY 2003-2008) Submitted to: USAID/Madagascar Submitted by: ARD, Inc. 159 Bank Street, Ste. 300 Burlington, Vermont 05401 telephone: (802) 658-3890 fax: (802) 658-4247 email: [email protected] Task Order No. 806 Under USAID Contract No. AEP-I-00-99-00041-00 General Democracy and Governance Analytical Support and Implementation Services Quantity Contract Democracy and Governance Strategic Assessment for USAID/Madagascar Integrated Country Strategic Plan (FY 2003-2008) by Sheldon Gellar Laura McPherson Jean-Eric Rakotoarisoa October 2001 Task Order No. 806 Under USAID Contract No. AEP-I-00-99-00041-00 General Democracy and Governance Analytical Support and Implementation Services Quantity Contract Table of Contents Acronyms and Glossary of Malagasy Terms....................................................................... iii Executive Summary.............................................................................................................. vi I. Assessment of the State of Democratic Development in Madagascar......................... 1 A. Political Climate for Democracy ............................................................................... 1 1. Historical Background and Influences..................................................................1 2. Consensus on the Rules of the Game ....................................................................3 3. Rule of Law..........................................................................................................5 -
The Contribution of Constitutional Courts to the Democratic Quality of Elections in Sub-Saharan Africa: a Comparative Case Study of Madagascar and Senegal
The Contribution of Constitutional Courts to the Democratic Quality of Elections in Sub-Saharan Africa: A Comparative Case Study of Madagascar and Senegal Von der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. genehmigte Dissertation von Heyl, Charlotte Elisabeth aus Darmstadt 1. Gutachter: Prof. Dr. Christof Hartmann 2. Gutachter: Prof. Dr. Tobias Debiel Tag der Disputation: 13. Dezember 2017 Acknowledgments Writing a doctoral thesis entails a lot of time spent alone at the desk between piles of data and the occasional feeling of being lost in the deep woods of your own thoughts. At the same time a doctoral thesis is a highly social enterprise, which would not have been possible without the support of many people, who I am very grateful to. First of all, I feel privileged having had the opportunity to study the rich political history of Madagascar and Senegal. I am indebted to my interview partners who generously granted me their precious time and shared their valuable insights, to the registrars who provided me access to data and the Madagascan and Senegalese people who helpfully guided me through the streets of Antananarivo and Dakar. Misaotra and Jërejëf! More specifically, in Madagascar, I would like to thank Antonia Rakotoarivelo Grund for her excellent research assistance. In Senegal, Ismaïla Madior Fall served as crucial door opener for my research. Babacar Kanté also facilitated several valuable contacts and answered many of my questions. I am also grateful to my supervisor Christof Hartmann who accepted me as an external doctoral student. His genuine enthusiasm for African politics inspired me to dig deeper into the politics of Madagascar’s and Senegal’s constitutional courts. -
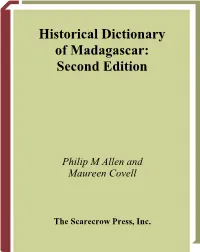
Historical Dictionary of Madagascar: Second Edition
05-242 (01) FM.qxd 8/4/05 4:02 PM Page i HISTORICAL DICTIONARIES OF AFRICA Edited by Jon Woronoff 1. Cameroon, by Victor T. Le Vine and Roger P. Nye. 1974. Out of print. See No. 48. 2. The Congo, 2nd ed., by Virginia Thompson and Richard Adloff. 1984. Out of print. See No. 69. 3. Swaziland, by John J. Grotpeter. 1975. 4. The Gambia, 2nd ed., by Harry A. Gailey. 1987. Out of print. See No. 79. 5. Botswana, by Richard P. Stevens. 1975. Out of print. See No. 70. 6. Somalia, by Margaret F. Castagno. 1975. Out of print. See No. 87. 7. Benin (Dahomey), 2nd ed., by Samuel Decalo. 1987. Out of print. See No. 61. 8. Burundi, by Warren Weinstein. 1976. Out of print. See No. 73. 9. Togo, 3rd ed., by Samuel Decalo. 1996. 10. Lesotho, by Gordon Haliburton. 1977. Out of print. See No. 90. 11. Mali, 3rd ed., by Pascal James Imperato. 1996. 12. Sierra Leone, by Cyril Patrick Foray. 1977. 13. Chad, 3rd ed., by Samuel Decalo. 1997. 14. Upper Volta, by Daniel Miles McFarland. 1978. 15. Tanzania, by Laura S. Kurtz. 1978. 16. Guinea, 3rd ed., by Thomas O’Toole with Ibrahima Bah-Lalya. 1995. Out of print. See No. 94. 17. Sudan, by John Voll. 1978. Out of print. See No. 53. 18. Rhodesia/Zimbabwe, by R. Kent Rasmussen. 1979. Out of print. See No. 46. 19. Zambia, 2nd ed., by John J. Grotpeter, Brian V. Siegel, and James R. Pletcher. 1998. 20. Niger, 3rd ed., by Samuel Decalo.