Le Sgraffite Dans Le Bâti Bruxellois
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

If You Decide to Join Us, Send Your Reservation Form and Deposit Right Away
Wallonia, Brussels, and Champagne April 27 to May 12, 2017 We encourage you to look over the description below; if you decide to join us, send your reservation form and deposit right away. Interest in this tour is exceptionally strong, with 75% of the space tentatively reserved, even before the announcement of specific dates and prices. The overall size of the group will not exceed 25 participants, with certain elements limited to only 20. Wallonia, the French-speaking southern half of Belgium, is a land of charming old cities, picturesque castles, peaceful abbeys, gently rolling hills, breathtaking river valleys, and lush forests. Join us in May 2017 to discover the artistic, historical, cultural, and culinary heritage of Wallonia, plus Belgium's capital, Brussels. We will also visit the Champagne region of Northern France including the city of Reims before ending up in Paris; you can either spend a few days on your own there or return directly to the States. Musically speaking, the main attraction is four days at the International Chamber Music Festival Resonances, which takes places in the peaceful environment of Halloy Castle and involves a whole roster of major international musicians. Following one of our three concerts, we will enjoy dinner with the artists. From our base in another chateau, our spare time will be dedicated to visiting the charming chateaux, villages, and gardens nearby. Opera and concert seasons for 2017 have yet to be announced, but we hope to attend a performance at the Royal Opera House of Wallonia or the Philharmonic Orchestra of Liège, and at the famed opera house, La Monnaie in Brussels. -

Heritage Days 15 & 16 Sept
HERITAGE DAYS 15 & 16 SEPT. 2018 HERITAGE IS US! The book market! Halles Saint-Géry will be the venue for a book market organised by the Department of Monuments and Sites of Brussels-Capital Region. On 15 and 16 September, from 10h00 to 19h00, you’ll be able to stock up your library and take advantage of some special “Heritage Days” promotions on many titles! Info Featured pictograms DISCOVER Organisation of Heritage Days in Brussels-Capital Region: Regional Public Service of Brussels/Brussels Urbanism and Heritage Opening hours and dates Department of Monuments and Sites a THE HERITAGE OF BRUSSELS CCN – Rue du Progrès/Vooruitgangsstraat 80 – 1035 Brussels c Place of activity Telephone helpline open on 15 and 16 September from 10h00 to 17h00: Launched in 2011, Bruxelles Patrimoines or starting point 02/204.17.69 – Fax: 02/204.15.22 – www.heritagedays.brussels [email protected] – #jdpomd – Bruxelles Patrimoines – Erfgoed Brussel magazine is aimed at all heritage fans, M Metro lines and stops The times given for buildings are opening and closing times. The organisers whether or not from Brussels, and reserve the right to close doors earlier in case of large crowds in order to finish at the planned time. Specific measures may be taken by those in charge of the sites. T Trams endeavours to showcase the various Smoking is prohibited during tours and the managers of certain sites may also prohibit the taking of photographs. To facilitate entry, you are asked to not B Busses aspects of the monuments and sites in bring rucksacks or large bags. -

Victor Horta Et Les Débuts De L'art Nouveau À Bruxelles
Victor Horta et les débuts de l’Art Nouveau à Bruxelles Françoise Aubry Le 11 mai 1881, Victor Horta1 s’installe à Bruxelles. Il boulevards à la parisienne doivent remplacer le lacis de quitte Gand, sa ville natale, pour des raisons person- ruelles anciennes) et apte à absorber la croissance de la nelles: il a séduit une jeune fille qui est enceinte de ses population. (Fig. 1) œuvres. Il se marie avec elle dans la capitale et décide de s’inscrire à l’Académie Royale des Beaux-Arts pour poursuivre des études d’architecture entamées à Gand. La Belgique, puissance coloniale Il cherche à gagner sa vie et entre dans le bureau d’Alphonse Balat, architecte favori de Léopold II pour Dès son avènement, Léopold II veut faire de la Belgique qui il a construit, notamment, les magnifiques serres de la capitale d’un empire immense. En 1891, il écrit à un Laeken2. de ses collaborateurs: « Voyez comment nous pourrions La ville de Bruxelles3 vit alors un profond boule- faire, et encore au XIXe siècle, de Bruxelles, la vraie versement: le collège des bourgmestre et échevins et le capitale de l’Afrique centrale »5. Il souhaite que la ville Roi Léopold II4 ont la volonté de moderniser la ville, de soit embellie à la hauteur de cet ambitieux projet et rêve la rendre plus salubre (notamment en voûtant la Senne, de monuments publics grandioses, de parcs, d’avenues la rivière qui traverse le cœur de la ville et qui était de- arborées, (…) Il n’hésite pas à acquérir lui-même des venue un égout à ciel ouvert), plus aérée (de grands terrains pour favoriser le développement de certains 1 Perspective d’un des nouveaux boulevards centraux (ici le boule- vard Anspach) aména- gés après le voûtement de la Senne et inaugurés le 30 novembre 1871, photo ancienne „Eine Stadt müssen wir erbauen, eine ganze Stadt!“ 235 Françoise Aubry 2 Victor Horta, Façade de l’hôtel Van Eetvelde, 4 avenue Palmerston à Bruxelles, 1895 — 97 (à gauche l’agrandissement de 1899), inscrit au Patrimoine mondial en 2000. -

The Jewellery of Lluís Masriera Modernisme, Que Ha De Ser El Canal Pel Qual La Ruta Europea for More Details)
Ödön Lechner, 1891-1986. Museum of Applied Arts, detail of columns Ödön Lechner, 1891-1986. Museu d’Arts Aplicades, detall de columnes THE ROUTE 3 Budapest: an Art Nouveau Stylistic Inventory János Gerle Architect, Budapest © János Gerle he so-called Bedo-house is alive with activity. The long ago destroyed shop will get back its original portal (reconstructed on the basis of one existing photograph) and the tenant, who happens © János Gerle to be the builder, wants to open the Budapest Art Nouveau Centre – with a café, museum, exhibitions and shop for art objects and books. This private initiative is a fantastic opportunity for Budapest to show Toff its Art Nouveau heritage to tourists. Until now, none of the official projects for such a centre have gotten off the ground. Budapest is unfortunately failing to exploit its rich architectural heritage as it could: programmes, publications, restoration and, above all, the very consciousness of the value of this heritage are all missing. The key feature of Hungarian Art Nouveau was the ambition to create a national language for the new style at the turn of the century. The idea of using architecture as a tool for expressing national identity comes from the first third of the 19th century, but this romantic approach to architecture as a stimulator of cultural independence reached its artistic apogee in the 1890s. This led, at least in the work of Ödön Lechner, to a combination of pioneering structures, materials and new construction methods, which together also bore a concrete national message that was at once modern and traditional. -

Gustave Strauven Connaît Une Carrière Brève Et Fulgurante
Avril 2017 | N° 22 Dossier ARt nouVeAu Varia LA propriété Le FéBuRe Remigio CAntAgallinA Bruxelles Patrimoines Bruxelles 22 N° | 2017 Avril u A nouve Art Dossier Le Fébure Le propriété A L Varia A in all g A nt A C emigio r gustaVe strauVen la jubilation De ossier l’art nouveau D Caroline BERCKMANS et oliVier BerCKMANS Historiens de l’archItecture AssociatIoN PouR l’étude Du BâtI (aPEB) maison de saint Cyr, square ambiorix 11, Bruxelles-extension est (2016 © aPeB). ARChiTECTE D’oRIGINE SCHAERBEEKOISE, GUSTAVE STRAUVEN CONNAÎT UNE CARRIÈRE BRÈVE ET FULGURANTE. TRAVAILLEUR ACHARNÉ, ON LUI CONNAÎT PRÈS DE 70 BÂTIMENTS, SITUÉS POUR LA PLUPART À BRUXELLES PARMI LESQUELS QUATORZE SONT À CE JOUR CLASSÉS. Un moment tombé dans l’oubli, il est aujourd’hui remis à l’honneur notamment par le biais d’un site Internet qui lui est entièrement consacré. Le présent article retrace brièvement la vie de ce concepteur hors norme, de ses influences à ses innovations remplies d’originalité et de hardiesse qui caractérisent mieux qu’aucune signature ses compositions. audacieux, virtuose, et même fan- en 1892, âgé de seulement quatorze tasque dans ses meilleures réa- ans, gustave entame une formation lisations, gustave strauven (fig. 1) d’architecte à l’école saint-luc de appartient à la seconde génération schaerbeek. gratifié d’un premier de l’art nouveau. la carrière par- prix, il en sort diplômé trois ans plus ticulièrement courte de cet archi- tard. en 1896-1897, strauven effec- tecte précoce – 1898 à 1914 – atteint tue un stage dans l’atelier de victor déjà son sommet en 1900, lorsque, Horta. -

Heritage Days Recycling of Styles 17 & 18 Sept
HERITAGE DAYS RECYCLING OF STYLES 17 & 18 SEPT. 2016 Info Featured pictograms Organisation of Heritage Days in Brussels-Capital Region: Regional Public Service of Brussels/Brussels Urban Development Opening hours and dates Department of Monuments and Sites a CCN – Rue du Progrès/Vooruitgangsstraat 80 – 1035 Brussels M Metro lines and stops Telephone helpline open on 17 and 18 September from 10h00 to 17h00: 02/204.17.69 – Fax: 02/204.15.22 – www.heritagedaysbrussels.be T Trams [email protected] – #jdpomd – Bruxelles Patrimoines – Erfgoed Brussel The times given for buildings are opening and closing times. The organisers B Bus reserve the right to close doors earlier in case of large crowds in order to finish at the planned time. Specific measures may be taken by those in charge of the sites. g Walking Tour/Activity Smoking is prohibited during tours and the managers of certain sites may also prohibit the taking of photographs. To facilitate entry, you are asked to not Exhibition/Conference bring rucksacks or large bags. h “Listed” at the end of notices indicates the date on which the property described Bicycle Tour was listed or registered on the list of protected buildings. b The coordinates indicated in bold beside addresses refer to a map of the Region. Bus Tour A free copy of this map can be requested by writing to the Department of f Monuments and Sites. Guided tour only or Please note that advance bookings are essential for certain tours (reservation i bookings are essential number indicated below the notice). This measure has been implemented for the sole purpose of accommodating the public under the best possible conditions and ensuring that there are sufficient guides available. -

SERB02 6002 225X180 Art Nouveau.Indd 1 02/11/2018 23:25 UN PATRIMOINE ERFGOED in MIS EN DANGER
ART ART NOUVEAU NOUVEAU Au-delà de l’image idéelle… Voorbij het ideële beeld… des belles façades aux pierres van fraaie gevels tot tombales, en passant par toute grafstenen, over een weelde la richesse des détails aan details SERB02_6002_225x180_art nouveau.indd 1 02/11/2018 23:25 UN PATRIMOINE ERFGOED IN MIS EN DANGER. GEVAAR. DE L’ART NOUVEAU ART NOUVEAU FAIT FACE AUX WEERSTAAT DE MENACES BEDREIGINGEN 1983 1989 1993 Si elle se fonde sur de véritables désastres, Ondanks ware catastrofes, waaronder telle la démolition d’œuvres majeures de sloop van meesterwerken zoals het comme la Maison du Peuple de Victor Horta Volkshuis van Victor Horta in 1965, is de en 1965, l’histoire de la préservation de geschiedenis van het behoud van de art l’Art nouveau à Bruxelles est aussi celle nouveau in Brussel ook een verhaal van Classement du Bloemenwerf, maison personnelle d’H. van de Velde Classement de l’ancien magasin Old England de P. Saintenoy Nouveau martyr de l’Art nouveau d’une prise de conscience, politique mais bewustwording – bij politici maar vooral ook (av. Vanderaey 102 à Uccle). De 1981 à 1988, le nombre de classements (rue Montagne de la Cour 2 à Bruxelles) ; il abrite aujourd’hui le Musée bruxellois : la façade de l’hôtel Delannoy augmente / Bescherming van Bloemenwerf, de persoonlijke woning des Instruments de Musique / Berscherming van het voormalige de P. Hamesse (av. de Tervueren 120 van H. van de Velde ( Vanderaeylaan 102 te Ukkel). Tussen 1981 en 1988 warenhuis Old England van P. Saintenoy (Hofberg 2 te Brussel), dat à Woluwe-Saint-Pierre) est démolie surtout et avant tout citoyenne, de la valeur bij de burgers – van de identiteitsvormende steeg het aantal beschermingen. -

QUARTIER DES SQUARES La Galerie De L’Art L’Art Nouveau Dans Le Quartier Des Squares Nouveau Bruxellois
03square FR 16/03/07 19:47 Page 90 LE QUARTIER DES SQUARES La galerie de l’Art L’Art Nouveau dans le quartier des Squares Nouveau bruxellois Empruntez la rampe qui longe le Berlaymont pour rejoindre l’entrée principale de ce dernier; Rond-point Traversez le boulevard Charlemagne pour Robert Schuman rejoindre le bâtiment du même nom (p. 242); Wille La rue du Taciturne, qui évoque le grand pour- fendeur de l’Inquisition espagnole, a été ampu- tée de sa partie haute pour accueillir le 4.500 m 1 h 15’ – 30’ Charlemagne. Elle garde, au n° 34, une belle construction de Paul Saintenoy, datée de 1900. Celui-ci vient d’achever l’hôtel Lunden à l’ave- nue Louise et les célèbres magasins Old England dans le haut de la rue Ravenstein. Cette maison i l i h bourgeoise, à la façade exceptionnellement P large, mélange subtilement des éléments néo- renaissance – comme le fronton à volutes ou l’oriel arrondi qui sépare les étages - et Art Nouveau - comme les colonnettes de fonte, la ferronnerie et les pierres sculptées; Rejoignez l’avenue Palmerston par la rue Boduognat. C’est Antoine Pompe qui a réalisé, en 1925, l’extension de l’ancien Institut chirur- gical qui se situe au n° 12. Très expressive et bien intégrée, elle témoigne de l’évolution architecturale de l’après guerre. 90 t n i u Q s e l r a h C n io t a c 91 i t 6 u d o h b n 5 e A p m s a 4 C é n r a rite é V d e é u f n rg o a C e n M n r o e 7 ç h n t a u b L a r e B g An el- h n c i i l M k n a r F 8 Archimède Pavie Schuman La galerie de l’Art Nouveau bruxellois t in Ambiorix u Q s Stévin -

Festival Artonov 2020
FESTIVAL ARTONOV 2020 From the 4th to the 11th of Octobre 2020 6th edition Press release The sixth edition of the ARTONOV Festival will take place in Brussels, in various Art Nouveau, Art Deco and other remarkable architectural venues. This year’s central theme is "what the day owes to the night". With this 6th edition, from the 4th to the 11th of October 2020, the ARTONOV Festival is more committed than ever to surprise the audience with a unique program, thanks to the motivation of the festival team, the artists and the partner venues. We have adapted this year’s program to comply with the current health and safety regulations while maintaining the theme, “what the day owes to the night,” as well as the sense of artistic adventure that is in the festival’s DNA since the very beginning. Uniting East and West, the artists of this edition seize the light and enchant it, revealing a world of multiple transparencies. The lockdown has been a challenge for us all, as individuals, communities, and as a society as a whole. It is time to bring light to this dark period and engage again in cultural events. A new wind blows through this special edition thanks to the presence of the young Belgian and international artistic generation. This year, the organizers are also opting for venues of a more contemporary architectural style, such as COOP in Anderlecht, where director, choreographer and visual artist Isabella Soupart and music director, pianist and Steve Reich specialist Guy Vandromme will present Stretch/Timemonochromes, a continuous 4 hour performance. -
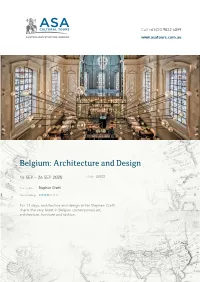
Belgium: Architecture and Design
Belgium: Architecture and Design 16 SEP – 26 SEP 2020 Code: 22033 Tour Leaders Stephen Crafti Physical Ratings For 11 days, architecture and design writer Stephen Crafti charts the very latest in Belgian contemporary art, architecture, furniture and fashion. Overview Tour Highlights With design writer Stephen Crafti, explore, at the time of Design September month, the very best of Belgium’s contemporary art, architecture, furniture and fashion in Brussels, Ghent and Antwerp. Based in the 4-star Hotel Le Dixseptième, begin in Brussels, Art Nouveau capital, with a visit to architect Victor Horta’s private house and studio. By special appointment, visit the interiors of the Art Nouveau Maison Autrique, Hôtel Van Eetvelde, the UNESCO World-Heritage listed Hôtel Max Hallet and Hôtel Solvay, which features a decorated staircase, mosaic floor, painted walls, wrought iron work and custom designed furniture. Tour the fine Art Deco Villa Empain, and the Musée David et Alice van Buuren, a private house containing sublime furnishings, stained glass and fine art. View exceptional 19th-century art in the Musée Fin-de-Siècle and the Belgian surrealist artist, René Magritte’s paintings in the Magritte Museum. Visit ADAM Brussels Design Museum dedicated to 20th-century art and design. By special appointment visit Studio With A View – an innovative artist hub for designers. Accompanied by interior designer Danny Venlet, explore contemporary interiors including Danny’s own private home and studio and architect Ivo Van Hamme’s private house. Discover Ghent’s new Market Hall, an astonishingly reassuring public structure within a delicate urban environment. With architects Dries Vens and Maarten Vanbelle (partners of Atelier Vens Vanbelle) view a number of their projects including a copper-clad extension to a traditional Belgian farmhouse, and their award-winning Gewad apartments. -
2003 Newspaper-English.Pdf
2003 / 15 > 18 Ålesund Helsinki Glasgow Riga Bruxelles-Brussel Nancy Wien Budapest Ljubljana Provincia di Varese Terrassa Barcelona Reus 2 RÉSEAU ART NOUVEAU NETWORK The Réseau Art Nouveau Network 3 ÅLESUND . NORGE At the dawn of the 20th century, a certain cultural phenomenon came into being in several towns and 4 BARCELONA . CATALUNYA cities across Europe: Art Nouveau. This artistic movement which signalled at once an artistic and intellectual break with the past, exploited the innovations of the Industrial Revolution while at the same time keeping a 5 BRUXELLES - BRUSSEL . BELGIQUE - BELGIË place for the refined works of craftsmanship.Throughout Europe Art Nouveau is distinguished by the strength 6 BUDAPEST . MAGYARORSZÀG of its aspiration for modernity, by the wish to make life in the developing great urban centres a thing of beauty, and by the attempt to do away with the distinction between the High and Decorative Arts. The 7 GLASGOW . SCOTLAND UK movement offered a perfect harmony of lifestyle, fusing deftly architectural, interior, and furniture design. 8 HELSINKI . SUOMI In 1999, fourteen European cities joined together as a co-operative network to study, conserve and 9 LJUBLJANA . SLOVENIJA promote their collective Art Nouveau heritage. The network comprises members from various fields, trades and professions: conservators, museum directors, architects, restorers, and art historians.Together they have 10 NANCY . FRANCE produced documents and devised activities for informing professionals and bringing awareness to a wider 11 REUS . CATALUNYA public: a book has been published, an internet site created, a conference and exhibition organised, a 12 RIGA . LATVIJA newspaper for school students has been produced and a magazine for younger children. -

Octokt 2011 2 3
www.voiretdirebruxelles.be oCtoKt 2011 2 3 Biennale 2011 Biënnale 2011 Biennial 2011 Biennale 2011 Biënnale 2011 Biennial 2011 TABLE DES MATIÈRES THEMATISCHE INHOUDSOPGAVE TABLE OF CONTENTS Editorial Présentation Biennale Art Nouveau 2011 p.6 En 2011, la Biennale Art Nouveau et Art Déco ouvrira Visites d’intérieurs p.8 une fois de plus les portes de magnifiques bâtiments Art Parcours guidés p.9 Nouveau et Art Déco à Bruxelles ... Quelques règles à suivre p.14 Cette année nous aurons le plaisir de célébrer les 150 ans Week-end 8 & 9 octobre p.18 Week-end 15 & 16 octobre p.28 de la naissance de l’un des architectes bruxellois les plus Week-end 22 & 23 octobre p.38 célèbres : Victor Horta. Week-end 29 & 30 octobre p.48 Architecte exceptionnel, chef de file du mouvement Art Plan général p.58 Nouveau, concevant non seulement une architecture qui Où loger p.60 change complètement la distribution des espaces intérieurs INFOS PRATIQUES tout en soignant la qualité des matériaux et leurs finitions, Presentatie Art Nouveau Biënnale 2011 p.7 il va mettre son talent au service de multiples program- Interieurbezoeken p.10 mes architecturaux : hôtels particuliers, écoles, grands Rondleidingen p.11 Enkele regels om in acht te nemen p.15 magasins ... Vous aurez le plaisir de découvrir lors de cette Weekend 8 & 9 oktober p.18 Biennale Art Nouveau et Art Déco la majorité de ces im- Weekend 15 & 16 oktober p.28 meubles : l’Hôtel Tassel, l’Hôtel Solvay, l’Hôtel Max Hallet, Weekend 22 & 23 oktober p.38 la Maison Autrique, l’Hôtel Frison, la Maison et atelier de Weekend 29 & 30 oktober p.48 Victor Horta, la Maison Vinck, l’Hôtel Winssinger, l’Hôtel Overzichtsplan p.58 Van Eetvelde, le jardin d’enfants rue Saint Ghislain et les Overnachting p.61 anciens magasins Wolfers (KBC).