Les Calculs Strategiques Derriere Le Canada Bill
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Ralliement National
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL L'INDÉPENDANCE À DROITE L'HISTOIRE POLITIQUE DU REGROUPEMENT NATIONAL ET DU RALLIENIENT NATIONAL ENTRE 1964 ET 1968 MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN HISTOIRE PAR JANIE NORMAND OCTOBRE 2010 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs (SDU-522 - Rév.01-2006). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» REMERCIEMENTS Ce mémoire n'aurait pas pu être mené à telme sans l'aide de nombreuses personnes. J'aimerais adéquatement remercier tous ces gens qui ont contribué de près ou de loin à toutes les étapes de ma recherche et de la rédaction. -
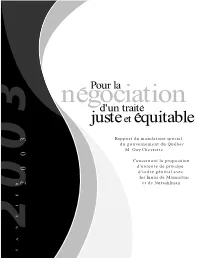
Justeet Equitable
Pour la negociationd'un traite juste et equitable Rapport du mandataire spécial du gouvernement du Québec M. Guy Chevrette Concernant la proposition d'entente de principe d'ordre général avec les Innus de Mamuitun 2003 et de Nutashkuan JANVIER Pour la négociation d'un traité juste et équitable Table des matières 1. PRÉAMBULE. 5 2. LES GRANDS CONSTATS . 7 3. LES TERRITOIRES EN CAUSE ET LES PRINCIPES ET MODALITÉS QUI S’Y APPLIQUERAIENT. 11 3.1 Le Nitassinan. 11 3.1.1 La propriété . 11 3.1.2 L’étendue. 11 3.1.3 Les activités traditionnelles de chasse, de pêche, de trappe et de cueillette (Innu Aitun) . 12 3.1.4 La participation au développement. 14 a) Forêt, mines et pourvoiries. 14 b) Parcs, réserve faunique et aires d’aménagement et de développement. 15 3.1.5 La participation aux processus gouvernementaux de la gestion du territoire . 16 3.1.6 Les redevances. 16 3.2 L’Innu Assi . 16 3.2.1 L’autonomie gouvernementale. 17 3.2.2 L’autonomie financière. 17 3.2.3 Les droits des tiers sur l’Innu Assi . 18 3.2.4 Les cas particuliers de Nutashkuan et d’Essipit . 19 4. LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION ET AUTRES CONSIDÉRATIONS . 21 4.1 La participation au processus de négociation et d’information. 21 4.2 La participation aux processus postnégociation . 22 4.3 Le cas de Sept-Îles et de Uashat-Maliotenam . 22 4.4 La clause concernant la Constitution de 1982 . 22 4.5 Référendum ou consultation . 23 CONCLUSION . 25 RECOMMANDATIONS . 27 ANNEXES A. -

Journal Des Débats
journal des Débats Le mardi 17 novembre 1981 Vol. 26 - No 5 Table des matières Dépôt de documents Rapport annuel du Protecteur du citoyen B-179 Rapport annuel du ministère de la Justice B-179 Liste des commissions sous le grand sceau B-179 Rapport de la Commission québécoise des libérations conditionnelles B-179 Rapport du curateur public B-179 Rapport du Conseil supérieur de l'éducation B-179 Rapport de l'Ordre des ingénieurs du Québec B-179 Rapport de l'Office des personnes handicapées B-179 Rapport de la Société de cartographie du Québec B-179 Rapport de la Société québécoise d'initiatives pétrolières B-179 Pétition pour un service des nouvelles à Radio-Québec B-179 Correspondance sur le problème des concessionaires d'automobiles B-179 Questions orales des députés Les négociations constitutionnelles B-180 Grève à l'hôpital Rivière-des-Prairies B-184 Écoute électronique et autres incidents au Service de la radio-télévision des débats B-185 L'enseignement en anglais aux enfants des personnes en séjour temporaire au Québec B-186 Le dossier de la SHQ et M. Yvan Latouche B-187 Motions non annoncées Nomination des présidents de commissions B-189 Félicitations à M. Jean Pelletier et aux conseillers de la ville de Québec B-189 Démission du député de Saint-Laurent M. Claude Forget B-190 M. Claude Ryan B-192 M. René Lévesque B-193 M. Gérard D. Levesque B-194 M. Claude Charron B-194 M. Yves Bérubé B-195 M. Pierre-Marc Johnson B-195 M. Michel Pagé B-195 M. -

Howard L. Singer Internal Cc}Nflicts Within the Parti Quebecois*
Howard L. Singer Internal Cc}nflicts within the Parti Quebecois* * The author would like to thank William G. Fleming for his comments on an earlifr version fo this article. The Parti Quebecois is not simply a new political party founded in Oc tober 1968, but also the spearhead of a long existing social movement whose raison d 'etre is the independence of Quebec. 1 Social movement organizations are often characterized by serious and frequent internal conflicts which are explained in the social movement literature by several bases of conflict including membership heterogenity and the presence of competing power bases. 2 These two particular explanatory factors correspond to the two major cleavages in the brief history of the PQ: an ideclogical cleavage between radical a nd moderate members and an institutional cleavage between the executive council and the parliamentary wing. This article will trace the development of the PQ's major internal conflicts concentrating upon the conflicts arising from the above two cleavages. Although the Parti Quebecois did not experience any serious conflicts during the first two years of its existence, there were already indications of both an ideological and an institutional cleavage. A hint of the ideological cleavage was the evident anxiety of party president Rene Levesque t~at ideological battles could disrupt the party's second na tional congress in October 1969. Thus in his opening speech, Levesque requested that the delegates hold a disciplined congress with few changes in rhe party programme in order to demonstrate to the voters that the PQ was a serious and responsible force. -

À Mon Drapeau : Je Jure D'être Fidèle » : Le Mouvement Des Sociétés Saint
« À mon drapeau : je jure d’être fidèle » : le mouvement des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, 1947-1984 by Marc-André Gagnon A Thesis presented to The University of Guelph In partial fulfilment of requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History Guelph, Ontario, Canada © Marc-André Gagnon, May, 2017 ABSTRACT « À MON DRAPEAU : JE JURE D’ÊTRE FIDÈLE » : LE MOUVEMENT DES SOCIÉTÉS SAINT-JEAN-BAPTISTE, 1947-1984 Marc-André Gagnon Advisor: University of Guelph, 2017 Professor Matthew Hayday This thesis explores the role played by the Sociétés Saint-Jean-Baptiste (SSJB) in Quebec as a political lobby group between 1947 and 1984. One of the oldest civil society organizations still active in Canada, the SSJB helped build a sense of belonging to the French-Canadian nation by promoting the history, symbols and national myths of French-speaking Canadians. Initially rooted in clerical nationalism and around the pillars of language, traditional institutions and the Catholic faith, the Society went through a period of profound changes starting in the late 1950s. Under the influence of neo-nationalism, it gradually abandoned these references in order to adopt a territorial and secular definition of nationalism. In parallel with these changes, the SSJB in Quebec adopted a political program focused on strengthening the province’s constitutional, linguistic, cultural, and economic sovereignty and autonomy. In addition, the organization’s structures were modified to reflect changes with regard of gender, class, and religion. As consequence, the relationship between the SSJB in Quebec and Ontario deteriorated as the two branches of the Society increasingly promoted different, and divergent, political projects for French-Canadians. -

Analyzing the Parallelism Between the Rise and Fall of Baseball in Quebec and the Quebec Secession Movement Daniel S
Union College Union | Digital Works Honors Theses Student Work 6-2011 Analyzing the Parallelism between the Rise and Fall of Baseball in Quebec and the Quebec Secession Movement Daniel S. Greene Union College - Schenectady, NY Follow this and additional works at: https://digitalworks.union.edu/theses Part of the Canadian History Commons, and the Sports Studies Commons Recommended Citation Greene, Daniel S., "Analyzing the Parallelism between the Rise and Fall of Baseball in Quebec and the Quebec Secession Movement" (2011). Honors Theses. 988. https://digitalworks.union.edu/theses/988 This Open Access is brought to you for free and open access by the Student Work at Union | Digital Works. It has been accepted for inclusion in Honors Theses by an authorized administrator of Union | Digital Works. For more information, please contact [email protected]. Analyzing the Parallelism between the Rise and Fall of Baseball in Quebec and the Quebec Secession Movement By Daniel Greene Senior Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for Graduation Department of History Union College June, 2011 i Greene, Daniel Analyzing the Parallelism between the Rise and Fall of Baseball in Quebec and the Quebec Secession Movement My Senior Project examines the parallelism between the movement to bring baseball to Quebec and the Quebec secession movement in Canada. Through my research I have found that both entities follow a very similar timeline with highs and lows coming around the same time in the same province; although, I have not found any direct linkage between the two. My analysis begins around 1837 and continues through present day, and by analyzing the histories of each movement demonstrates clearly that both movements followed a unique and similar timeline. -

Journal Des Débats
journal des Débats Le jeudi 20 mars 1980 Vol. 21 — No 96 Table des matières Questions orales des députés L'avenir des commissions scolaires 5361 Grève des cols bleus de Montréal 5363 Habitations à loyer modique 5365 Conflit de travail dans les raffineries de l'est de Montréal 5366 Les permis de travail dans la construction 5367 Les centres d'accueil de la région 04 manquent de ressources 5368 Motion non annoncée Membres des commissions scolaires 5369 Question de privilège Article de journal erroné 5369 Mme Jocelyne Ouellette 5369 Recours à l'article 34 M. André Raynauld 5370 Avis à la Chambre 5370 Travaux parlementaires 5371 Motion privilégiée relative à la question devant faire l'objet d'une consultation populaire sur une nouvelle entente avec le Canada Reprise du débat sur la motion principale, les trois motions d'amendement et la motion de sous-amendement 5374 M. Marc-André Bédard 5374 M. Gérard-D. Levesque 5376 M. Rodrigue Biron 5379 M. Patrice Laplante 5380 M. Jean Garon 5380 Mme Solange Chaput-Rolland 5382 M. Guy Chevrette 5383 M. Julien Giasson 5384 Mme Lise Payette 5386 M. John Ciaccia 5387 M. Claude Charron 5388 M. Rodrigue Tremblay 5389 Mme Thérèse Lavoie-Roux 5389 M. Camil Samson 5391 M. Michel Le Moignan 5392 M. Claude Ryan 5395 M. René Lévesque 5398 Mise aux voix de la motion d'amendement de M. Le Moignan 5401 Mise au voix de la motion d'amendement de M. Biron 5402 Mise aux voix de la motion de sous-amendement de M. Tremblay 5402 Mise aux voix de la motion d'amendement de M. -

Journal Des Débats
journal des Débats Commission permanente de l'Assemblée nationale Règlement sur les emplois d'un caractère occasionnel Nominations au conseil d'administration de la Fondation Jean-Charles Bonenfant Le mardi 10 mars 1981 - No 58 Table des matières Réglementation sur les emplois d'un caractère occasionnel à l'Assemblée nationale B-2921 Représentants des partis à la Fondation Jean-Charles Bonenfant B-2924 Intervenants M. Claude Vaillancourt, président M. Claude Charron M. Harry Blank M. Guy Chevrette M. Jean-Pierre Jolivet M. Gérard D. Levesque M. Serge Fontaine B-2921 (Seize heures trente-trois minutes) M. Chevrette: M. le Président, en tant que whip, je suis très heureux de l'appuyer, Le Président (M. Vaillancourt, mais je ne dirai pas pourquoi. Jonquière): À l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare ouverte la séance de la Le Président (M. Vaillancourt, commission permanente de l'Assemblée Jonquière): M. le député de Sainte-Marie est nationale. rapporteur. Les membres de la commission sont: M. Bertrand (Vanier), M. Bisaillon (Sainte-Marie), M. Charron: Ce que j'allais dire, M. le M. Charron (Saint-Jacques), M. Chevrette Président, c'est que la Commission de régie (Joliette-Montcalm), Mme Cuerrier interne de l'Assemblée, sous votre (Vaudreuil-Soulanges), M. Duhaime (Saint- présidence, a récemment adopté un projet de Maurice), M. Dussault (Châteauguay), M. règlement qui améliorerait d'une façon Fontaine (Nicolet-Yamaska), M. Goulet sensible les conditions de travail de ceux qui (Bellechasse), M. Jolivet (Laviolette), M. nous entourent dans la vie quotidienne de Lamontagne (Roberval), M. Lavoie (Laval), M. cette Assemblée. Je voudrais que ce soit de Levesque (Bonaventure).. -

La Réforme Du Mode De Scrutin Au Québec :Une Perspective Néo-Institutionnaliste
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL LA RÉFORME DU MODE DE SCRUTIN AU QUÉBEC :UNE PERSPECTIVE NÉO-INSTITUTIONNALISTE MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE PAR JULIEN YERVILLE JUIN 2018 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs (SDU-522 - Rév.1 0-2015). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» REMERCIEMENTS J'ai entrepris la maîtrise sans me douter de l'expérience que j'allais vivre et de tout le travail qui serait nécessaire pour cheminer jusqu'au dépôt de ce mémoire. Maintenant que je suis à 1'heure des bilans, je veux prendre le temps de remercier ici les principales personnes qui m'ont appuyé à travers ces années. -

Journal Des Débats
journal des Débats Commission permanente des affaires intergouvernementales Etude des crédits du ministère des Affaires intergouvernementales Le 13 juin 1978 — No 131 Table des matières Remarques préliminaires B-5153 Rapport annuel B-5153 Propositions constitutionnelles du gouvernement fédéral B-5155 Etudes Bonin B-5174 Relations internationales B-5182 Coopération interprovinciale B-5196 Ententes fiscales B-5208 Affaires fédérales-provinciales et interprovinciales B-5208 Affaires internationales B-5212 Gestion interne et soutien B-5217 Office franco-Québécois pour la jeunesse B-5219 Intervenants M. Alain Marcoux, président M. Claude Morin M. Gérard D. Levesque M. André Raynauld M. Richard Guay M. Rodrigue Biron M. Jean Alfred M. Claude Charron M. Gérald Godin Mme Denise Leblanc M. Jean-Pierre Charbonneau B-5153 Etude des crédits du ministère qu'ils sont tous les deux heureux de le revoir des Affaires intergouvernementales aujourd'hui, dans des rôles différents. Quant à l'exposé préliminaire, je ne sais pas, (Quinze heures cinq minutes) je peux toujours en faire un, mais cela irait peut- être plus vite si je n'en faisais pas. Je vais Le Président (M. Marcoux): A l'ordre, s'il vous demander le conseil de mes amis de l'Opposition. plaît! S'ils veulent absolument que je fasse un exposé, je La commission des affaires intergouverne- vais en faire un, s'ils veulent aller plus vite, je n'en mentales est réunie pour entreprendre l'étude des ferai pas. crédits budgétaires du ministère des Affaires intergouvernementales. M. Levesque (Bonaventure): Nous n'avons Les membres de la commission sont: M. pas d objection, sûrement, à entendre le ministre. -

Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS I ¿ T O F Pe, P*J P7l 1777- 7^ Gouvernement Du Québec Public Accounts for the Fiscal Year Ended March 31, 1978
Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS I ¿ t o f Pe, P*J P7l 1777- 7^ gouvernement du Québec public accounts for the fiscal year ended March 31, 1978 volume 2 details of expenditure Published in accordance with the provisions of section 71 of the Loi de l’administration financière (Financial Administration Act) (1970 Statutes, Chapter 17) Received MAÏ 2? 1575 RECTOR 4 Gouvernement ELLOR du Québec Ministère des Finances ISSN 0706-2850 ISBN 0-7754-3205-9 Legal deposit, 1s' quarter, 1979 Bibliothèque nationale du Québec UNIVERSITY LIERARY UNIVERSITY OF Al BFRTA TABLE OF CONTENTS SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES 1 LIST OF CAPITAL ASSETS 2 1-1 SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES For each category of expenditure, except for "Transfer expen With regard to the category "Transfer expenses", the list of ses", the list of suppliers or beneficiaries is issued by department beneficiaries is published, in certain cases, grouped by program according to the following publishing limits and criteria: or by element of program and, in other cases, grouped by department, and this, according to the following limits and crite a) Salaries, wages, allowances and other remuneration: ria: — Ministers, Deputy Ministers and Public Officers of equiva — By electoral district: complete listing; lent rank: complete listing; — By electoral district and beneficiary: complete listing; — Managerial Staff (managers, assistant managers and civil servants of equivalent rank): complete listing; — By beneficiary only: $8 000 and over. — Any allowance: $8 000 -

Journal Des Débats
journal des Débats Le lundi 12 juin 1978 Vol. 20 — No 48 Table des matières Rapport de la commission ayant étudié le projet de loi no 7 — Loi modifiant la Loi constituant la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires 2159 Rapport de la commission ayant étudié le projet de loi no 4 — Loi modifiant la Loi sur les biens culturels 2159 Questions orales des députés Demande de retarder l'étude du projet de loi no 44 2159 Modifications à la Loi des caisses d'épargne et de crédit 2161 Entreprises d'Etat et entreprises privées 2163 Construction de logements pour personnes âgées et accessibilité aux soins chiropratiques 2164 Fermeture possible de deux usines à Grand-Mère 2167 Voeux de prompt rétablissement à M. Bellemare 2167 Décès de M. Jean-Maurice Chouinard 2168 Demande de débat d'urgence relatif à la subvention gouvernementale à Tricofil M. Jean-Noël Lavoie 2168 M. Rodrigue Biron 2169 M. Claude Charron 2169 Décision du Président 2170 Travaux parlementaires 2170 Prise en considération du rapport de la commission ayant étudié le projet de loi no 41 — Loi modifiant la Loi d'Hydro-Québec et la Loi du développement de la région de la Baie James Troisième lecture 2171 M. Fabien Roy 2171 M. Guy Joron 2172 Prise en considération du rapport de la commission ayant étudié le projet de loi no 37 — Loi constituant l'Institut national de productivité 2173 Projet de loi no 54— Loi modifiant la loi de la Régie des services publics Deuxième lecture 2173 M. Louis O'Neill 2173 M. John Ciaccia 2175 M.