Revue N°35, 2007
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
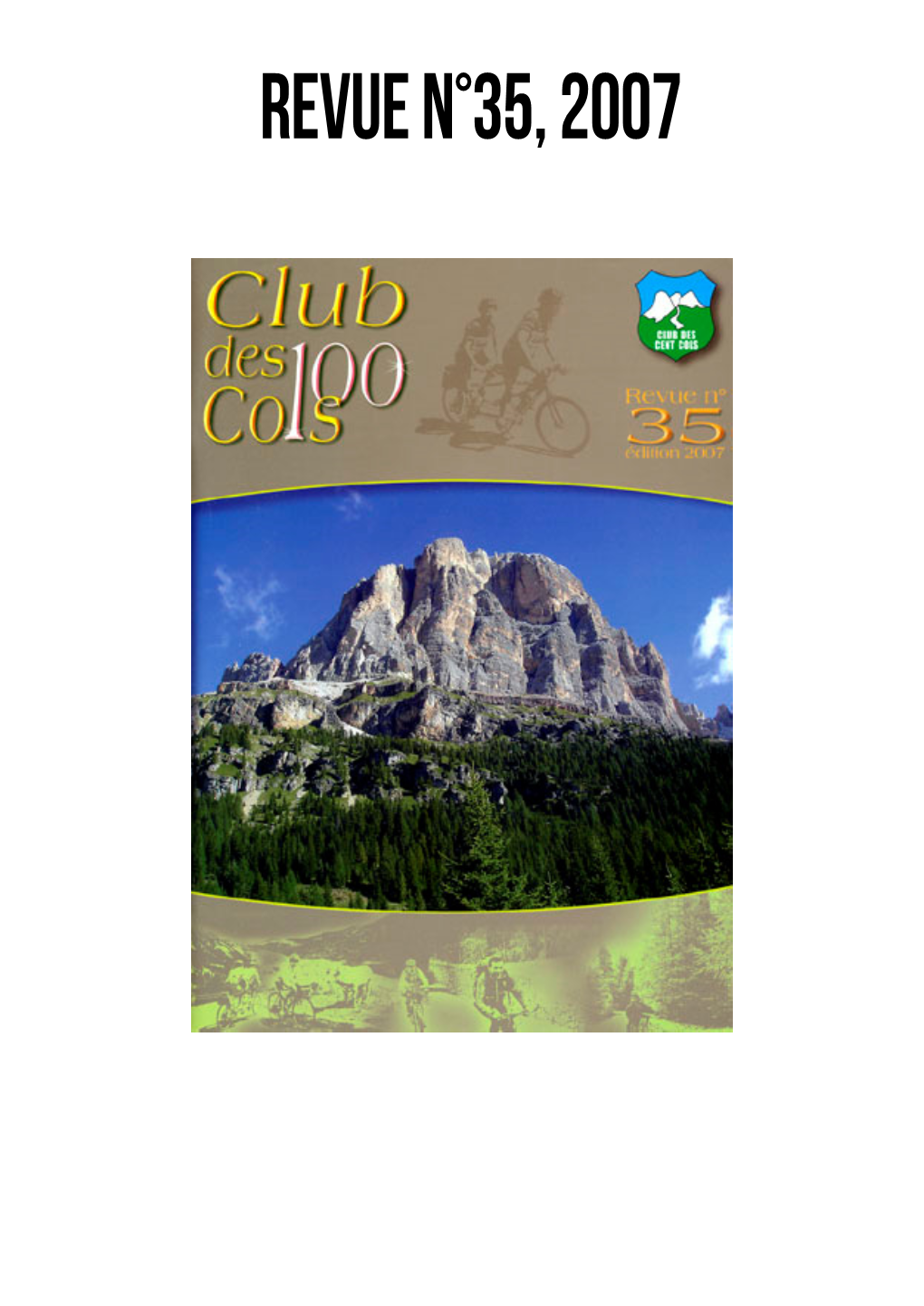
Load more
Recommended publications
-
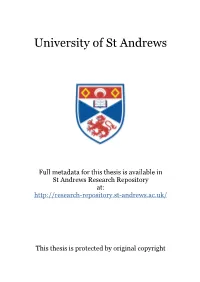
Davidbamfordbphilthesis1973
University of St Andrews Full metadata for this thesis is available in St Andrews Research Repository at: http://research-repository.st-andrews.ac.uk/ This thesis is protected by original copyright EL DIALEGTO ARANES A study of the speech and way of life of the inhabitants of the central reach of the Vald'Aran in the province of Lerida, taking as its limits the towns of Viella and Bosost and incorporating the villages of Casau, Gausach, Vilach, Montj Montcorbau, BetIan, Aubert, Vila, Arros, Vilamos, Arres, Begos, Benos, Arru, Las Bordas arid La Bordeta submitted by David Bamford for the degree of B.Phil, in Hispanic Studies in the University of St. Andrews S t. And rews July 1973 'Tu. % Bm&SXst&L1 I hereby certify that David Bamford 1ms spent 6 terms engaged in part-time research work under my direction and that he has fulfilled the conditions of General Ordinance Ho. 12 (Resolution of the University Court No# 8, 1969)» and that he is qualified to submit the accompanying thesis for the degree of Eaohelor of Philosophy. SupervliSar I hereby declare that the following thesis is based on work carried out by me, that the thesis is my own composition and that no part of it has been presented previously for a higher degree. I was admitted as a research student in April 1969 under General Ordinance No# 12 and enrolled as a candidate for the degree of B.Phil, under this Resolution. The research was conducted in the Val d'Aran during the summer of 1970 and 1971 and in the Department of Spanish, University of St. -

Transpyrenees (France and Spain) September 9-19, 2018 11 Day Trip Itinerary
TransPyrenees (France and Spain) September 9-19, 2018 11 Day Trip Itinerary Day 1 Hondarribia, Spain to St. Jean Pied de Port, France Ride 41 miles/5,100 ft. of climbing Col de St-Ignace (3.5k/560 ft.), Puerto de Otxondo (10k/1,650 ft.) Col d'Ispeguy (11k/1,340 ft.) St. Jean Pied de Port, a town which for centuries has hosted numerous Santiago de Compostela pilgrims as it stands at the foot of the main Pyrenees crossing into Spain. Day 2 St. Jean Pied de Port to Lurbe, France Ride: 55-67 miles/6,600-10,000 ft. Today you’ll ride from the foothills into the mighty Pyrenees. Begin with a climb up the Col de Burdincurucheta (2004 Tour de France), en route to Col de Bagargi and your first hors catégorie climb. Optional Climb: Col de Soudet (21.5k/4,100 ft.) Day 3 Lurbe to Saint-Savin, France Ride: 52 miles/7,600 ft. This morning, ride down the Vallée d’Aspe and cross over to the Vallée d’Ossau as you continue your journey into the Hautes- Pyrenees. You’ll climb through beech forests to Col de Marie-Blanque (9k/2,350 ft.). It is a mere 9km in length but with gradients reaching over 15%. Next you will continue to challenge yourself on the —Col d’Aubisque (18k/3,900 ft.) and Col du Soulor (2k/372 ft.) Finish the day with a long descent to Saint SaVin. Day 4 Saint Savin to Luz St. Sauveur, France Ride: 52 miles/8,299 ft. -

Étude En Traduction
Août 2017 Étude en traduction Traduire un livre sur un événement franco-français tel que le Tour de France en néerlandais Steven van der Haas 5705118 Mémoire de master Université d’Utrecht Rédigé sous la direction de Y.J.C. Vermijn Inhoud Résumé en néerlandais ........................................................................................................................... 2 Chapitre 1 Introduction ........................................................................................................................... 3 Chapitre 2 Analyse de texte .................................................................................................................... 5 Chapitre 3 Analyse des problèmes de traduction généraux ................................................................. 11 3.1 Textes spécifiques à une culture ................................................................................................. 11 3.1.1 Maintien (exotiser) ............................................................................................................... 12 3.1.2 Remplacement (naturaliser) ................................................................................................. 13 3.2 Textes sportifs ............................................................................................................................. 18 3.3 Textes journalistiques .................................................................................................................. 20 Chapitre 4 Traduction annotée ............................................................................................................ -
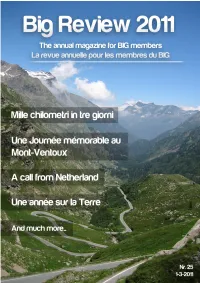
Revue 2011.Pdf
BIG Review 2011 Inhoudsopgave/Table of contents/ La table des matières Author Subject Pages Zone BIG Review Cover Colle del Nivolet Nr. 25 La table des matieres/Table of contents 1 Daniel GOBERT Le mot du president 2 01-03-2011 Dominque JACQUEMIN Carrefour/Crossroad 2011 3 Superliste 4-7 Distribuée à tous les Classement général 8-11 membres en règle. Classement claims 2010 12 Sent to all members regularly Daniel GOBERT Challenges paralleles 13-18 subscribed. Christian le CORRE Balance sheet 19-21 Brevet International du Daniel GOBERT Iron BIG 22-28 Grimpeur Anja von HEYDEBRECK Operation 2525 29 International Axel JANSEN Operation 2525 II 30-32 Cycloclimbing Diploma Daniel GOBERT The 25th birthday of my Baby BIG 33-34 Zwischenstaatliches Gianni CUCCONI La salita ci svela chi siamo 35-36 Kletterer Zeugnis Pete THOMAS Lake District 37-38 2 Internationaal Wim van ELS Engeland 39-40 2 Klimmersbrevet Brevetto Internazional Daniel GOBERT Les plus hautes routes des iles Britanniques 41-45 2 dello Scalatore Various autors UK meeting 46-51 2 Diploma Internacional del Helmuth DEKKERS Italian day in the Netherlands 52-56 3 escalador Gabriele BRUNETTI A call from Netherland 57-58 3 Helmuth DEKKERS Hungarian day in the Netherlands 59-62 3 Association des Monts de Gabor KREISCI September rain 63-64 3 France Super Grimpeur Franco- Roland SCHUYER 20 BIG’s in 4 dagen 65-68 3 Belge Dominique JACQUEMIN Rosier 69 3 Willem VODDE De West Vlaamse heuvels 70-71 3 Editeur/Editor : Daniel GOBERT Central Germany 72 4 Martin Kool Rob BOSDIJK Nebelhorn 73-74 -

The Pyrenees
The Pyrenees A Greentours Holiday for the Alpine Garden Society 10th to 23rd June 2011 Led by Paul Cardy Trip Report and Systematic Lists by Paul Cardy Day 1 Friday 10 th June Arrival and Transfer to Formigueres Having driven from the south western Alps and reached Carcassonne the previous evening, I continued to Toulouse to meet the group at the airport. I was unexpectedly delayed by French customs who stopped me at the toll booth entering the city. There followed a lengthy questioning, as I had to unpack the contents of my suspiciously empty Italian mini-bus and show them my two large boxes of books, suitcase full of clothes, picnic supplies, etc., to convince them my purpose was a botanical tour to the Pyrenees. Now a little late I arrived breathlessly at Toulouse airport and rushed to the gate to meet Margaret, and the New Zealand contingent of Chris, Monica, Archie and Lynsie, hurriedly explaining the delay. Anyway we were soon back on the motorway and heading south towards Foix. White Storks in a field on route was a surprise. We made a picnic stop at a functional aire where there were tables, and a selection of weedy plants. Black Kite soared overhead. Once past Foix and Ax-les- Thermes the scenery became ever more interesting as we wound our way up to a misty Col de Puymorens. There a short stop yielded Pulsatilla vernalis in fruit and Trumpet Gentians. Roadside cliffs had Rock Soapwort, Saxifraga paniculata , and Elder-flowered Orchids became numerous. Now in the Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, a fascinating route down into the valley took us through Saillagouse and Mont-Louis before heading up a minor road to the village of Formigueres, our base for the first three nights. -

Sur La Route Des Quatre Fantastiques
Sur la route des quatre 04 fantastiques Après une baignade dans le plus grand centre de balnéo des Pyrénées, partez à la rencontre de quatre grands sites pyrénéens mondialement connus en suivant la grande route des cols. 4 JOURS /4 NUITS DIStaNCE parCOURUE 209 km J OUR 1 SPOTS photoS LOUDENVIELLE / BALNÉA / SAINT-LARY Géant du Tourmalet - p.80 J OUR 2 La cascade du Cirque SAINT-LARY / PIC DU MIDI / GAVARNIE de Gavarnie - p.82 Le Vignemale se refletant J OUR 3 dans le lac de Gaube - p.84 GAVARNIE / CAUTERETS-PONT d’ESPAGNE paUSES BIEN-ÊTRE J OUR 4 Balnéa - p.79 CAUTERETS/CAUTERETS-PONT Le glacier du Vignemale, avec la Pique Longue à Luzèa - p.81 droite, point culminant des Pyrénées françaises. Vue d’ESPAGNE/LOURDES Les Bains du Rocher - p.85 Détail d’une mosaïque sur la façade de la Basilique depuis le refuge des Oulettes de Gaube à Cauterets- Notre-Dame-du-Rosaire au Sanctuaire de Lourdes. Pont d’Espagne dans le Parc national des Pyrénées. L E JOUR DU DÉpart Tarbes Un berger et son troupeau de moutons dans Aéroport le massif de Gavarnie - Mont Perdu. Tarbes-Lourdes- Pyrénées 19 Montrejeau 18 Lourdes Réserve Naturelle Régionale du massif de Pibeste R A N F C Argelès-Gazost E Col d’Aubisque Col du Val d’Azun Ste-Marie-de-Campan Soulor Saint-Savin Col d’Aspin Pierrette Nestalas Pic du Midi 8 7 6 9 Barèges Cauterets Arreau 15 Col du Tourmalet 16 10 Cauterets Luz- Sers Col du Pont d’Espagne 17 St-Sauveur Réserve Naturelle Pourtalet Nationale du Néouvielle Bagnères- Parc National St-Lary 5 Balnéa des Pyrénées 3 de-Luchon 1 4 2 Col de Gèdre -

Historia Del Deslinde De La Frontera Hispano-Francesa
HISTORIA DEL DESLINDE DE LA Joan Capdevila i Subirana I FRONTERA HISPANO-FRANCESA Del tratado de los Pirineos (1659) a los tratados de Bayona (1856-1868) Edita y Comercializa: Centro Nacional de Información Geográfica Oficina central: General Ibáñez de IberIbero,o, 3 28003 MADRID Comercialización: General Ibáñez de Ibero,Ibero, 3 28003 MADRID Joan Capdevila i Subirana Teléfono:Teléfono: +34 91 597 94 53 Fax: +34 91 553 29 13 e-mail: [email protected] http://www.cnig.es HISTORIA DEL DESLINDE DE LA FRONTERA HISPANO-FRANCESA HISTORIA DEL DESLINDE DE LA FRONTERA 9 7 8 8 4 4 1 6 1 4 8 0 2 HISTORIA DEL DESLINDE DE LA FRONTERA HISPANO-FRANCESA Del tratado de los Pirineos (1659) a los tratados de Bayona (1856-1868) JOAN CAPDEVILA I SUBIRANA GOBIERNO MINISTERIO INSTITUTO DE FOMENTO GEOGRÁFICO DE ESPAÑA NACIONAL Catálogo general de publicaciones oficiales http://www.060.es Venta electrónica: http://www.cnig.es Edita: Centro Nacional de Información Geográfica © Dirección General del Instituto Geográfico Nacional Centro Nacional de Información Geográfica Joan Capdevila i Subirana Estudio realizado por Joan Capdevila i Subirana Fotomecánica y maquetación: Subdirección General de Cartografía Servicio de Edición y Trazado Impreso en la imprenta nacional del BOE ISBN: 978-84-416-1480-2 NIPO: 162-09-013-6 Depósito legal: M-41696-2009 Als meus pares, font de vida. Índice Prólogo ................................................................................................................................................................. 9 Agradecimientos -

RFP-Tripnotes-Apr21-1
Apr 2021 Pyrenean Classic Cols Put on your Polka Dot Jersey and challenge yourself on the legendary climbs of the Pyrenees Summary WHERE: French Pyrenees DISTANCE: To suit you TIME : 6 days PRICE : see website DATES: Jun to Sept Pyrenean Classic Cols This holiday has been carefully crafted to give you the opportunity to cycle the best cols and stage endings that the Pyrenees have to offer. It is a point to point journey, traversing the region from east to west, taking in the infamous climbs (Portet d’Aspet, Col d’Aspin and the mighty Tourmalet, among others) that the professional Tour de France cyclists head up every year. The joy of our Classic Cols itineraries is their flexibility and suitability for mixed ability groups. We have used our in-depth Highlights knowledge of the Pyrenees to devise for you both a Classic Route which warms up gently, getting progressively tougher and a Challenge Route, full of optional extras (cols and TdF stage Flexible itinerary to suit endings) to test even the most experienced of cyclists. Taken at a everyone steady pace the Classic Route is both manageable and enjoyable for healthy cyclists, regardless of experience in the mountains. It is a Infamous TdF Cols route to open up the Pyrenees to you. Whether you opt for the Classic or Challenge Route (or something 2 customised support in between), this week is a holiday and riding on the quiet roads vehicles with through the stunning mountain scenery of the Pyrenees is a real knowledgeable, joy. Our experienced guides will support you from their well- stocked vans and ensure that you have everything you need. -

Cr Haute Route 2017
Haute Route des Pyrénées du 13 au 19 août 2017 Après une première expérience enthousiasmante en 2015, j’ai eu la chance de participer à nouveau à la Haute Route des Pyrénées en bénéficiant d’une des invitations données aux villes étapes par l’organisation. Nous étions 270 au départ venant de plus de 30 pays différents dont seulement une quarantaine de français. Sept étapes nous menaient d’Anglet à Toulouse par un parcours de 900 km et près de 20 000 mètres de dénivelé. Des coureurs de tous niveaux étaient au départ avec des objectifs très variés, certains visant le podium, d’autres comme moi souhaitant simplement faire le maximum pour terminer toutes les étapes dans les délais. 1ère étape : Anglet –Oloron Sainte-Marie (174 km et 3800 m D+) 192 ème en 8h10 – 7émé de la catégorie +60 ans Après un départ très romantique au lever du jour sur la place d’Anglet face à l’Océan, le parcours empruntait la route des Crêtes et ses nombreuses côtes très éprouvantes. Je suis resté dans un groupe d’une vingtaine de coureurs jusqu’à Saint-Jean le Vieux au km 70 où nous avions déjà 1200 mètres de dénivelé au compteur avant d’attaquer le col de Burdincurutcheta (1135 m, 9km à 9% de moyenne) dont les quatre premiers kilomètres à plus de 11% de moyenne sont redoutables. Dès les premiers hectomètres dans une atmosphère chaude et humide, j’ai ressenti un manque de force et des difficultés à respirer, peut-être un début d’hypoglycémie. J’ai été obligé de m’arrêter plusieurs fois, me demandant si j’allais pouvoir continuer. -

Trasa Tour De France 2014 (Rastislav Boris, Cycling-Info.Sk) 17. Etapa
Trasa Tour de France 2014 (Rastislav Boris, Cycling-Info.sk) 17. etapa, streda 23. júl zo SAINT-GAUDENS do SAINT-LARY PLA D’ ADET (124,5 KM) - ak nerátame časovku, tak je to najkratšia etapa tohto ročníka ŠTART: SAINT-GAUDENS • tradičné pyrenejské cyklistické mestečko, ktoré je etapovým mestom TdF štrnásty raz, v minulosti sa tu odohrali viaceré slávne horské etapy, napríklad v roku 1955 si tu obliekol žltý dres legendárny Francúz Louison Bobet, ktorý TdF 1955 napokon vyhral aj celkovo a stal sa prvým cyklistom, ktorý vyhral Tour trikrát po sebe (111 KM) BARBAZAN • zachovalé kúpeľné mestečko, kúpele s rozlohou 4,2 hektára vybudovali v roku 1901 a nachádzajú sa v peknom prostredí prírody, tunajšie vody sú bohaté na vápnik i horčík, používajú sa najmä pri liečení žalúdka alebo čriev (93,5 KM) SAINT-BÉAT, šprintérska prémia • dedinka mramoru a sôch, ktorá je obklopená horami a skalami, už v staroveku bola centrom ťažby mramoru, v stredoveku mali vďaka mramoru kráľovské výsady, no a v súčasnosti sa tu stále nachádza veľa sôch a každoročne sa tu koná tiež festival sôch • v dedinke nájdeme tiež malú zrúcaninu hradu s kaplnkou z 12. storočia, je to jeden z mála zachovalých hradov v Pyrenejách, mierne upraviť ho dal kráľ Henrich IV. (87 KM - 82,5 KM) ŠPANIELSKO • približne v týchto momentoch vstupujú cyklisti do Španielska, i keď iba na úsek niečo cez 20 kilometrov, Španielsko je po Veľkej Británii, Belgicku, a samozrejme Francúzsku, ďalšou tohtoročnou zastávkou pelotónu (75,3 KM - 67 KM) Col du Portillon • stúpanie prvej kategórie • dĺžka stúpania -

Les Plus Beaux Itinéraires Des Pyrénées
ROADTRIP LES PLUS BEAUX ITINÉRAIRES DES PYRÉNÉES PIC DU MIDI • GAVARNIE • CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE • LOURDES • COL DU TOURMALET PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES • RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU NÉOUVIELLE des sites d’exception 6 itinéraires clés en main des expériences uniques ÉDITO Itinéraires mythiques I 2 I 3 e Pyrénées Roadtrip vous transporte entre il y aura ces archipels de lacs, ces torrents, ces France et Espagne, sur des itinéraires aux cascades et ces sources d’eau chaudes si bien mille couleurs et aux multiples saveurs. Au apprivoisés par les gens des Pyrénées. Il sera alors bout de la route, une certitude, vos souvenirs seront temps de vous baigner. Non, ceci n’est pas le pitch frappés du sceau de « grands moments de ma vie ». d’un road movie. Il s’agit simplement d’un avant-goût D’abord, il y aura ces paysages, incroyablement des décors et des aventures qui pourraient être ceux différents et stupéfiants de beauté. Des deux côtés de de vos prochaines vacances, que vous les vouliez en la frontière, vous approcherez des sites uniques au famille, entre amis ou en amoureux. Parcourez ces monde, pour certains classés merveilles naturelles quelques pages et découvrez parmi les plus belles de l’humanité. Parfois, au détour d’un lacet, vous histoires que les Pyrénées vous offrent de vivre cet découvrirez aussi de discrets îlots de nature, très été, et même après. Ces histoires ont été écrites proche d’une certaine idée que l’on se fait du paradis. pour vous, sous forme d’itinéraires à parcourir, C’est à s’y méprendre. -

Ride Pyrenees Tour 10-Day Cycling Tour Itinerary July 12 – 21 Content
2019 TOUR DE FRANCE RIDE PYRENEES TOUR 10-DAY CYCLING TOUR ITINERARY JULY 12 – 21 CONTENT. 4. BONJOUR TOUR DESCRIPTION 5. DAYS 1 – 4 6. DAYS 5 - 8 7. DAYS 9 – 10 PACKAGE INCLUSIONS & PRICE 8. BIKE HIRE 9. OUR ACCOMMODATION BAGNERES-DE-LUCHON 10. OUR ACCOMMODATION LOURDES 11. THE FOOD BREAKFASTS & RESTAURANTS Bonjour. Welcome to the Velo Tours Ride Pyrenees 10-day tour to the 2019 Tour de France. On this fully supported tour with guides and vans, you will enjoy the challenge of riding some of the most famous climbs in world cycling including, Col de Portet d’Aspet, Port de Bales, Col de Peyresourde and the legendary Col du Tourmalet. To top it off we will view 3 key stages of the Tour de France up close, including the Time Trial in Pau. There’s no daily grind of changing hotels and transporting from stage to stage. You unpack for the week and live like a local in an incredible 18th century French chalet right in the heart of Bagneres-de-Luchon. Cafes, restaurants, Billy’s Bar and the best cycling in the world is literally at our front door. This year Le Tour will ride through Luchon during Stage 12 and we’ll stay two nights in Lourdes while viewing stages 13 and 14. And let’s not forget the added pleasure of hanging out with legendary Australian pro cyclist, funny-man and 2- time Tour de France rider, Henk Vogels. We look forward to meeting you and taking care of you in France on this truly memorable cycling experience.