Étude En Traduction
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
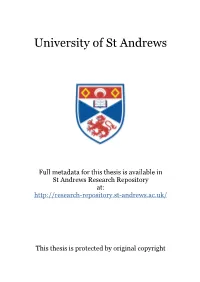
Davidbamfordbphilthesis1973
University of St Andrews Full metadata for this thesis is available in St Andrews Research Repository at: http://research-repository.st-andrews.ac.uk/ This thesis is protected by original copyright EL DIALEGTO ARANES A study of the speech and way of life of the inhabitants of the central reach of the Vald'Aran in the province of Lerida, taking as its limits the towns of Viella and Bosost and incorporating the villages of Casau, Gausach, Vilach, Montj Montcorbau, BetIan, Aubert, Vila, Arros, Vilamos, Arres, Begos, Benos, Arru, Las Bordas arid La Bordeta submitted by David Bamford for the degree of B.Phil, in Hispanic Studies in the University of St. Andrews S t. And rews July 1973 'Tu. % Bm&SXst&L1 I hereby certify that David Bamford 1ms spent 6 terms engaged in part-time research work under my direction and that he has fulfilled the conditions of General Ordinance Ho. 12 (Resolution of the University Court No# 8, 1969)» and that he is qualified to submit the accompanying thesis for the degree of Eaohelor of Philosophy. SupervliSar I hereby declare that the following thesis is based on work carried out by me, that the thesis is my own composition and that no part of it has been presented previously for a higher degree. I was admitted as a research student in April 1969 under General Ordinance No# 12 and enrolled as a candidate for the degree of B.Phil, under this Resolution. The research was conducted in the Val d'Aran during the summer of 1970 and 1971 and in the Department of Spanish, University of St. -

Transpyrenees (France and Spain) September 9-19, 2018 11 Day Trip Itinerary
TransPyrenees (France and Spain) September 9-19, 2018 11 Day Trip Itinerary Day 1 Hondarribia, Spain to St. Jean Pied de Port, France Ride 41 miles/5,100 ft. of climbing Col de St-Ignace (3.5k/560 ft.), Puerto de Otxondo (10k/1,650 ft.) Col d'Ispeguy (11k/1,340 ft.) St. Jean Pied de Port, a town which for centuries has hosted numerous Santiago de Compostela pilgrims as it stands at the foot of the main Pyrenees crossing into Spain. Day 2 St. Jean Pied de Port to Lurbe, France Ride: 55-67 miles/6,600-10,000 ft. Today you’ll ride from the foothills into the mighty Pyrenees. Begin with a climb up the Col de Burdincurucheta (2004 Tour de France), en route to Col de Bagargi and your first hors catégorie climb. Optional Climb: Col de Soudet (21.5k/4,100 ft.) Day 3 Lurbe to Saint-Savin, France Ride: 52 miles/7,600 ft. This morning, ride down the Vallée d’Aspe and cross over to the Vallée d’Ossau as you continue your journey into the Hautes- Pyrenees. You’ll climb through beech forests to Col de Marie-Blanque (9k/2,350 ft.). It is a mere 9km in length but with gradients reaching over 15%. Next you will continue to challenge yourself on the —Col d’Aubisque (18k/3,900 ft.) and Col du Soulor (2k/372 ft.) Finish the day with a long descent to Saint SaVin. Day 4 Saint Savin to Luz St. Sauveur, France Ride: 52 miles/8,299 ft. -

NEW Pyrenees Road Trips - Drive, Mountains and Spas Five New Itineraries for 2017
[Texte] Press Info: July 2017 NEW Pyrenees Road Trips - Drive, Mountains and Spas Five New Itineraries for 2017 New from the Hautes-Pyrenees, France in association with Huesca*, Spain, is a series of 3, 4 or 7 day Road Trip itineraries taking in some of the most iconic landmarks in the Pyrenees as well as routes linking the French and Spanish borders. With these itineraries taking you from France into Spain and back, the Road Trip Pyrenees hopes to evoke the spirit of adventure that other famous routes such as the Route 66, the Silk route, the trans-Amazonian highway have created. The Road Trip offers a super highway to exceptional places of magnificent spectacular scenery, for unique experiences and long lasting memories. Combining some of the key sites of the Pyrenees including: Lourdes, Cirque de Gavarnie, Pic du Midi, Parc National des Pyrénées, Parc National de Ordesa and Monte Perdido, Le Grand Canyon d’Ordesa, Cañon de Añisclo, The Trou du Toro/Forau de Aigualllets and The Aneto - the itineraries covering over 25% of the Pyrenees massif. [Texte] Isabelle Pelieu, Director of HPTE* comments, “Our region is made for ‘Road Trips’! We have launched these five new itineraries three of which include routes crossing the border between France and Spain. We are excited to be working with our partner region Huesca and hope this new ’road trip concept’ will be a popular choice for tourists to the region. They are available to anyone for nine out of twelve months of the year.” www.pyrenees-trip.uk Choose a road trip and experience some of the following: ● 2 COUNTRIES (France and Spain) ● 3 WORLD HERITAGE SITES - Gavarnie & Ordesa - either side of the same mountain ● 4 GRAND SITES MIDI-PYRENEES : Pic du Midi, Gavarnie, Cauterets / Pont d'Espagne, Lourdes.. -
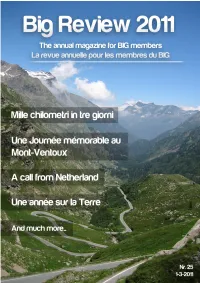
Revue 2011.Pdf
BIG Review 2011 Inhoudsopgave/Table of contents/ La table des matières Author Subject Pages Zone BIG Review Cover Colle del Nivolet Nr. 25 La table des matieres/Table of contents 1 Daniel GOBERT Le mot du president 2 01-03-2011 Dominque JACQUEMIN Carrefour/Crossroad 2011 3 Superliste 4-7 Distribuée à tous les Classement général 8-11 membres en règle. Classement claims 2010 12 Sent to all members regularly Daniel GOBERT Challenges paralleles 13-18 subscribed. Christian le CORRE Balance sheet 19-21 Brevet International du Daniel GOBERT Iron BIG 22-28 Grimpeur Anja von HEYDEBRECK Operation 2525 29 International Axel JANSEN Operation 2525 II 30-32 Cycloclimbing Diploma Daniel GOBERT The 25th birthday of my Baby BIG 33-34 Zwischenstaatliches Gianni CUCCONI La salita ci svela chi siamo 35-36 Kletterer Zeugnis Pete THOMAS Lake District 37-38 2 Internationaal Wim van ELS Engeland 39-40 2 Klimmersbrevet Brevetto Internazional Daniel GOBERT Les plus hautes routes des iles Britanniques 41-45 2 dello Scalatore Various autors UK meeting 46-51 2 Diploma Internacional del Helmuth DEKKERS Italian day in the Netherlands 52-56 3 escalador Gabriele BRUNETTI A call from Netherland 57-58 3 Helmuth DEKKERS Hungarian day in the Netherlands 59-62 3 Association des Monts de Gabor KREISCI September rain 63-64 3 France Super Grimpeur Franco- Roland SCHUYER 20 BIG’s in 4 dagen 65-68 3 Belge Dominique JACQUEMIN Rosier 69 3 Willem VODDE De West Vlaamse heuvels 70-71 3 Editeur/Editor : Daniel GOBERT Central Germany 72 4 Martin Kool Rob BOSDIJK Nebelhorn 73-74 -

Jesper Ralbjerg Tyve Tinder I Tour De France
Jesper Ralbjerg Tyve Tinder i TOUR de FRANCE En kør-selv-guide fra L’Alpe d’Huez til Mont Ventoux Nu med GPS-ruter af forskellig længde og sværhedsgrad for alle de 20 bjerge HHHHH Ekstra Bladet HHHHH Berlingske HHHHH Cykel Magasinet muusmann’ forlag Tyve Tinder i Tour de France Jesper Ralbjerg Tyve Tinder i TOUR de FRANCE En kør-selv-guide fra L’Alpe d’Huez til Mont Ventoux muusmann’ forlag Tyve Tinder i TOUR de FRANCE – En kør-selv-guide fra L’Alpe d’Huez til Mont Ventoux Af Jesper Ralbjerg © 2013 muusmann’forlag, København Omslag og design: ADCO:DESIGN Illustrationer: ADCO:DESIGN 1. udgave, 2013 ISBN: 978-87-92746-41-2 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Det er tilladt at citere med kildeangivelse i anmeldelser. Muusmann’forlag Bredgade 4 1260 København K Tlf. 33 16 16 72 www.muusmann-forlag.dk Indholdsfortegnelse/ Links til bogen Forside 1 Titelblad 3 Kolofon 4 Indholdsfortegnelse 5 Forord 8 Bjergenes fascinationskraft 10 Det skal du have med i rygsækken 15 Forslag til ture 16 Hvor hårdt er det at køre i bjergene? Valg af gearing 20 1. Tourmalet. L’incontournable 22 Federico Bahamontes. Ørnen fra Toledo 35 2. Peyresourde. Det er den store knold på højre hånd! 41 Marco Pantani. Piraten der endte som kokainvrag 49 3. Hourquette d’Ancizan & Aspin. Debutant og veteran 57 Andy Schleck. Dømt til en skyggetilværelse? 66 4. Aubisque & Soulor. Mordere og giftdrik 72 Louison Bobet. -

ID21-A Peyragudes La Chance Vous Sourit
A Peyragudes, la chance vous sourit Séjour proposé par Nathalie 33 (0)5 62 56 70 00 [email protected] Télésièges débrayables à haut débit, forfaits mains libres et réseau ultra-performant de neige de culture, la station la plus high-tech des Pyrénées a aussi été gâtée par la nature. Son domaine orienté est-ouest permet au soleil de vous suivre toute la journée, ses «3000» à portée de vue dessinent un panorama de cinéma. Comble de chance, les hébergements sont en pied de pistes et les prix ont la taille d’un nain de jardin. Chantons ensemble : j’aimerais tant voir Peyraguuuudes ! à partir de 1 semaine en studio dans une résidence de tourisme en pied de pistes • Forfait ski 6 jours à Peyragudes • Accès à l’espace détente de la résidence 240 € / personne avec piscine intérieure chauffée, sauna et bains à remous • Livraison de vos forfaits ski à votre studio Les points forts de votre séjour : Une semaine pour souffler, s’oxygéner, skier, profiter de la montagne Un hébergement en pied de pistes pour chausser ses skis plus vite Une résidence tout confort pour passer d’agréables vacances Au programme : Cette semaine, direction Peyragudes ! Moderne et innovante, la station n'en finit pas de vous surprendre. Adeptes de ski ou de snow, vous serez servis. Pour vous lancer un défi, essayez la luge : snake gliss ou yooner ... vous allez rire ! Votre hébergement : Résidence en pied de pistes Au pied des pistes de la station de Peyragudes, sur la route du col de Peyresourde, cette résidence offre tout le confort et les équipements pour passer d’agréables vacances. -

The Pyrenees
The Pyrenees A Greentours Holiday for the Alpine Garden Society 10th to 23rd June 2011 Led by Paul Cardy Trip Report and Systematic Lists by Paul Cardy Day 1 Friday 10 th June Arrival and Transfer to Formigueres Having driven from the south western Alps and reached Carcassonne the previous evening, I continued to Toulouse to meet the group at the airport. I was unexpectedly delayed by French customs who stopped me at the toll booth entering the city. There followed a lengthy questioning, as I had to unpack the contents of my suspiciously empty Italian mini-bus and show them my two large boxes of books, suitcase full of clothes, picnic supplies, etc., to convince them my purpose was a botanical tour to the Pyrenees. Now a little late I arrived breathlessly at Toulouse airport and rushed to the gate to meet Margaret, and the New Zealand contingent of Chris, Monica, Archie and Lynsie, hurriedly explaining the delay. Anyway we were soon back on the motorway and heading south towards Foix. White Storks in a field on route was a surprise. We made a picnic stop at a functional aire where there were tables, and a selection of weedy plants. Black Kite soared overhead. Once past Foix and Ax-les- Thermes the scenery became ever more interesting as we wound our way up to a misty Col de Puymorens. There a short stop yielded Pulsatilla vernalis in fruit and Trumpet Gentians. Roadside cliffs had Rock Soapwort, Saxifraga paniculata , and Elder-flowered Orchids became numerous. Now in the Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, a fascinating route down into the valley took us through Saillagouse and Mont-Louis before heading up a minor road to the village of Formigueres, our base for the first three nights. -

Grand Tour of the Pyrenees - in 3 Days and 3 Nights
Grand Tour of the Pyrenees - in 3 days and 3 nights Proposed by Nathalie 33 (0)5 62 56 70 00 [email protected] 3 days to see the very best of the Pyrenees : 3 legendary Tour cols, 4 Grand Sites of the Midi Pyrenees, 1 World Heritage site, a National Park, 3 lakes, places famous the world over... All is organised for you, hotels, breakfasts, passes to visit all the best sites, it is all included in the price. The detailed road book will help you make the most of your time with suggestions for places to visit, suggestions for walks, superb viewpoints, the best places to eat, and lovely spots for a relaxing pause. 3 days/3 nights in 4 and 3 star hotels and 3 star Clévacances chambre d’hotes, with breakfast included, staying in Saint-Lary, Gedre-Gavarnie, from Lourdes • 1 ‘Grands Sites’ pass to Pic du Midi (access to summit by cable 260 € /person car) + Cauterets-Pont d’Espagne (parking, cable-car ride from Puntas and Based on 2 persons chairlift to Lac de Gaube) • 1 entry (2h) to Balnéa (Loudenvielle) spa centre with outdoor baths, lagoons, hammam, jacuzzi, bubble beds... An independent driving circuit The strengths: An itinerary set out for you to explore at your own pace Nothing to book No more than 2 hours driving each day A varied programme On the programme: Day 1 : Head to Loudenvielle, in the secret Louron valley, an unspoiled paradise. Relaxation at the Balnea Spa, the first spa in the French Pyrenees. Then cross the Col de Val Louron Azet towards Saint Lary, in its the wide Pyrenean valley which leads to Spain. -

Sur La Route Des Quatre Fantastiques
Sur la route des quatre 04 fantastiques Après une baignade dans le plus grand centre de balnéo des Pyrénées, partez à la rencontre de quatre grands sites pyrénéens mondialement connus en suivant la grande route des cols. 4 JOURS /4 NUITS DIStaNCE parCOURUE 209 km J OUR 1 SPOTS photoS LOUDENVIELLE / BALNÉA / SAINT-LARY Géant du Tourmalet - p.80 J OUR 2 La cascade du Cirque SAINT-LARY / PIC DU MIDI / GAVARNIE de Gavarnie - p.82 Le Vignemale se refletant J OUR 3 dans le lac de Gaube - p.84 GAVARNIE / CAUTERETS-PONT d’ESPAGNE paUSES BIEN-ÊTRE J OUR 4 Balnéa - p.79 CAUTERETS/CAUTERETS-PONT Le glacier du Vignemale, avec la Pique Longue à Luzèa - p.81 droite, point culminant des Pyrénées françaises. Vue d’ESPAGNE/LOURDES Les Bains du Rocher - p.85 Détail d’une mosaïque sur la façade de la Basilique depuis le refuge des Oulettes de Gaube à Cauterets- Notre-Dame-du-Rosaire au Sanctuaire de Lourdes. Pont d’Espagne dans le Parc national des Pyrénées. L E JOUR DU DÉpart Tarbes Un berger et son troupeau de moutons dans Aéroport le massif de Gavarnie - Mont Perdu. Tarbes-Lourdes- Pyrénées 19 Montrejeau 18 Lourdes Réserve Naturelle Régionale du massif de Pibeste R A N F C Argelès-Gazost E Col d’Aubisque Col du Val d’Azun Ste-Marie-de-Campan Soulor Saint-Savin Col d’Aspin Pierrette Nestalas Pic du Midi 8 7 6 9 Barèges Cauterets Arreau 15 Col du Tourmalet 16 10 Cauterets Luz- Sers Col du Pont d’Espagne 17 St-Sauveur Réserve Naturelle Pourtalet Nationale du Néouvielle Bagnères- Parc National St-Lary 5 Balnéa des Pyrénées 3 de-Luchon 1 4 2 Col de Gèdre -

Tour De France Dans Les Hautes-Pyrénées
COMMUNIQUÉ DE PRESSE TOUR DE FRANCE DANS LES HAUTESPYRÉNÉES : COMMENT CIRCULER ET STATIONNER Le Tour de France traversera notre département mercredi 14 et jeudi 15 juillet 2021. À cette occasion, Les Hautes-Pyrénées accueillent les arrivées de la 17e étape Muret > Saint-Lary-Soulan Col de Portet et la 18e étape Pau > Luz Ardiden. Conditions de circulation, stationnement… Voici les infos pratiques. (c) Laurent GAITS - CD65 MERCREDI 14 JUILLET : MURET > SAINTLARYSOULAN COL DE PORTET Lors de cette 17e étape, les coureurs franchiront les portes des Hautes-Pyrénées à Loure- Barousse. Ils graviront le col de Peyresourde, le col d’Azet, pour arriver au sommet du col de Portet. CONDITIONS DE CIRCULATION Sur l’itinéraire de la course, la circulation sera fermée 1h avant le passage de la caravane. La réouverture est prévue 30 min après le ATTENTION : passage des coureurs. La réouverture de la route entre Saint-Lary- Sur les routes de montagne, la fermeture des Soulan et Lannemezan est estimée après 18h30. routes pourra être largement anticipée par POUR INFORMATION : les autorités selon la fréquentation. La caravane du Tour s’arrêtera 8 km avant le col Pour connaître les horaires de passage : de Portet, à Espiaube. www.hautespyrenees.fr rubrique : Actualité Tour de France VENDREDI 9 JUILLET 2021 | DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE (16 km à 8,7%) (7,4 km à 8,3%) (13,2 km à 7%) Col du Portet SAINT-LARY-SOULAN MURET 198 m 2 215 m 2 300 m 226 m BÉRAT 241 m POUY-DE-TOUGES 354 m AURIGNAC 375 m SAINT-GAUDENS 489 m BARBAZAN 465 m SALÉCHAN -

RFP-Tripnotes-Apr21-1
Apr 2021 Pyrenean Classic Cols Put on your Polka Dot Jersey and challenge yourself on the legendary climbs of the Pyrenees Summary WHERE: French Pyrenees DISTANCE: To suit you TIME : 6 days PRICE : see website DATES: Jun to Sept Pyrenean Classic Cols This holiday has been carefully crafted to give you the opportunity to cycle the best cols and stage endings that the Pyrenees have to offer. It is a point to point journey, traversing the region from east to west, taking in the infamous climbs (Portet d’Aspet, Col d’Aspin and the mighty Tourmalet, among others) that the professional Tour de France cyclists head up every year. The joy of our Classic Cols itineraries is their flexibility and suitability for mixed ability groups. We have used our in-depth Highlights knowledge of the Pyrenees to devise for you both a Classic Route which warms up gently, getting progressively tougher and a Challenge Route, full of optional extras (cols and TdF stage Flexible itinerary to suit endings) to test even the most experienced of cyclists. Taken at a everyone steady pace the Classic Route is both manageable and enjoyable for healthy cyclists, regardless of experience in the mountains. It is a Infamous TdF Cols route to open up the Pyrenees to you. Whether you opt for the Classic or Challenge Route (or something 2 customised support in between), this week is a holiday and riding on the quiet roads vehicles with through the stunning mountain scenery of the Pyrenees is a real knowledgeable, joy. Our experienced guides will support you from their well- stocked vans and ensure that you have everything you need. -

Greg Lemond Virage 21
Greg LeMond Virage 21 Greg LEMOND Cols et victoires d’étape Puissance réelle watts/kg Puissance étalon 80 kg temps Cols Etape Tour de France 1984 La Ruchère CLM. Perd 1’54s sur Fignon 407 5,99 425 00:28:19 1 3ème-23 ans Alpe d’Huez X 3 La Plagne. Perd 1mn sur Fignon 384 5,65 398 00:47:08 3 Joux Plane. Mesure sur fin de col. 365 5,37 382 00:18:20 5 Crans Montana. Mesure sur 9 kms. 403 5,93 417 00:25:50 2 moyenne 390 5,7 406 00:29:54 Tour de France 1985 Avoriaz. Montée rapide en poursuivant Hinault 412 6,06 426 00:28:09 3 2ème-24 ans Luz Ardiden. Aurait pu monter plus vite : Hinault leader 365 5,37 378 00:42:40 3 pédales automatiques et cadre carbone à partir de 1986 Tour de France 1986 Marie Blanque. Hinault attaque, Greg, équipier perd 5’. 376 5,53 390 00:21:11 2 1er-25 ans Superbagnères 1er. En solitaire reprend 4’ à Hinault 374 5,5 387 00:28:55 4 Col de Granon. Echappé avec Zimmerman 376 5,53 391 00:41:10 3 Alpe d’Huez 2éme. Laisse gagner Hinault, main dans la main. 336 4,94 354 00:48:00 3 moyenne 366 5,4 381 00:34:49 accident de chasse en 1987 Tour de France 1989 Cauterets. Montée courte non comptabilisée. 416 6,12 431 00:11:38 2 1er-28 ans Superbagnères. Distancé par Fignon dans le dernier km 399 5,87 415 00:29:02 4 Izoard 398 5,85 412 00:24:25 2 Alpe d’Huez.