2021 Etude Floristique Et Nutritive, Spatiotemporelles, Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

RAPPORT DE MISSION Rapport Final
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et de la Pêche Commission européenne PROGRAMME D’ACTIONS PILOTE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL ET L’AGRICULTURE EN ALGÉRIE PAP ENPARD - ALGÉRIE Siège : Direction Générale des Forêts, Chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun Algérie Termes de référence N°15 Appuis/Conseils de producteurs en vue de constituer des groupements dans la wilaya de Laghouat Actions de structuration autour de produits porteurs (29 octobre 2017 – 18 janvier 2018) RAPPORT DE MISSION Rapport Final Consultant-facilitateur : Mohammed TOUNSI EUROCONSULT PAP-ENPARD Rapport TdR 15 Expert : Mohammed TOUNSI Page 1 sur 50 Belgique Belgique Remerciements Nos remerciements à - Mohammed Ben Messaoud, point focal de la conservation des forets pour son dynamisme et sa participation efficace dans l’animation des ateliers ; - Djamal Ben Linani, point focal de la DSA, - Mustapha Bondjemaâ, point focal de la direction du tourisme ; - Omar Rahmani secrétaire général de Chambre d’agriculture ; - Abderrahmane Khirani, directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers Notre respect et notre grande considération à Mr le conservateur des forêts de la wilaya de Laghouat qui nous a mobilisé ses femmes et ses hommes et apporter son aide et son soutien pour le bon déroulement de la mission notamment sa participation aux ateliers des apiculteurs de Bennacer Benchohra et ceux d’Aflou et les réponses, qu’il a apporté, aux préoccupations des apiculteurs. Un grand merci à Sid Ali Taouati et Mohamed Khelaif pour leur assistance à la réussite de la mission. Un grand merci à Ahmed de la conservation des forêts sui m’accompagné dans ma tournée à Aflou et à Tadjrona. -

Journal Officiel Algérie
N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

La Couverture Sanitaire De La Wilaya De Laghouat
La couverture sanitaire de la wilaya de Laghouat Pr. Larbi ABID Située au centre du pays à 400 km au sud d’Alger, la wilaya de Laghouat s'étend sur une superficie de 25 000 km². Région pastorale de l'Algérie, elle possède également le plus grand gisement de gaz naturel situé à Hassi Rmel. De par sa position géographique et ses caractéristiques climatiques, elle fait partie des wilayates pastorales du pays ainsi que des wilayas du Sud. Sa superficie est de 25 052 km² pour une population estimée en 2014 à 603 876 habitants. Cinq communes sont considérées comme urbaines : Laghouat, Aflou, Ain Madhi, Hassi R'Mel et Ksar El Hirane. La wilaya de Laghouat compte 10 daïras : Aflou, Aïn Mahdi, Brida, El Ghicha, Gueltet Sidi Saâd, Laghouat, Oued Morra, Sidi Makhlouf. Située à plus de 750 mètres d'altitude sur les Hauts- Plateaux, la wilaya de Laghouat est traversée par la chaîne de l’Atlas Saharien avec des sommets qui dépassent les 2 000 mètres (Djebel Amour : 2200 mètres). A l'exception de l'important champ gazier de Hassi R'mel, la vocation de la wilaya de Laghouat est à caractère agro-pastorale. Le climat est continental aride avec des moyennes de -5 °C l'hiver et de plus de 40 °C l'été. La situation sanitaire est caractérisée par des pathologies liées a la vocation pastorale de la wilaya (Brucellose avec un taux de prévalence de 95.8 p100.000 habitants et leishmaniose cutanée avec un taux de 78 p 100.000 habitants), à sa situation géographique (wilaya du sud avec un taux assez élevé de piqures scorpionique chaque année, près de 2000/an) mais également aux mauvaises conditions d’hygiène (Maladies à Transmission Hydrique, tuberculose). -

Journal Officiel N°2020-59
N° 59 Dimanche 16 Safar 1442 59ème ANNEE Correspondant au 4 octobre 2020 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: 1 An 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A Tél : 021.54.35..06 à 09 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d'expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 16 Safar 1442 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 4 octobre 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 20-274 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux -

Rapport Sur Les Priorités Et La Planification Année 2021
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Ressources en Eau Rapport sur les priorités et la planification Année 2021 Volume 2 Octobre/ 2020 Table des matières Contenu Section 1. Message du ministre .......................................................................................4 1.1 Message du ministre ...................................................................................................4 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ..............................................................................5 Section 2. Au sujet du portefeuille...................................................................................6 2.1 La mission ...................................................................................................................6 - Production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, de l’eau saumâtre et des eaux usées Épurées ;6 2.2 Le ministère ................................................................................................................7 2.3 Fiche Portefeuille ........................................................................................................9 Gestionnaire responsable : Ministre des Ressources en Eau ...............................................9 2.4 Planification des activités pour l’année 2021 ...........................................................11 Section 3. Planification détaillée du programme 01 ......................................................12 -

L'algérie Legendaire
L’ALGÉRIE LEGENDAIRE EN PÈLERINAGE ÇÀ & LÀ aux Tombeaux des principaux Thaumaturges de l’Islam (Tell et Sahara) PAR LE COLONEL C. TRUMELET COMMANDEUR DE L’ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR OFFICIER DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES DE LA SOCIÉTÉ D’ARCHÉOLOGIE ET DE STATISTIQUE DE LA DRÔME ETC. ETC. Visitez les tombes des saints du dieu puissant : Elles sont parées de vêtements imprégnés de musc, Que sillonnent des éclairs d’or pur. SIDI KHALIL ALGER LIBRAIRIE ADOLPHE JOURDAN IMPRIMEUR-LIBRAIRE-ÉDITEUR 4, PLACE DU GOUVERNEMENT, 4 1892 Augustin CHALLAMEL, ÉDITEUR 17, Rue Jacob, PARIS Livre numérisé en mode texte par : Alain Spenatto. 1, rue du Puy Griou. 15000 AURILLAC. D’autres livres peuvent être consultés ou téléchargés sur le site : http://www.algerie-ancienne.com Ce site est consacré à l’histoire de l’Algérie. Il propose des livres anciens, (du 14e au 20e siècle), à télécharger gratuitement ou à lire sur place. AVANT-PROPOS Nous avons démontré, dans un de nos pré- cédents ouvrages, l’intérêt que pouvait présenter l’étude des mœurs religieuses des groupes musul- mans dont nous avions charge des corps, sinon des âmes, dans les pays de l’Afrique septentrionale que nous avions conquis, et dans ceux où nous pousse- ront encore irrésistiblement les besoins de la politi- que, du commerce et de la civilisation, voire même la curiosité, et cette force d’expansion que nous avons tous au cœur, et qui nous fait affronter tous les dangers avec la foi des premiers martyrs. Or, pour acquérir cette force de pénétration sans laquelle tout nous serait et ferait obstacle, il nous faut d’abord étudier les choses cachées, les mys- térieuses pratiques des groupes que nous sommes exposés à rencontrer sur notre route ténébreuse, si- lencieuse, muette. -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets
No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -

Étude Originale
Étude originale Les jeunes agriculteurs itinérants et le développement de la culture de la pomme de terre en Algérie L'émergence d'une économie réticulaire Alaeddine Derderi1 1,2 Résumé Ali Daoudi ´ ´ 1,3 L’article analyse le fonctionnement en reseau des jeunes agriculteurs itinerants, figure Jean-Philippe Colin e´mergente des filie`res maraıˆche`res en Alge´rie, ne´anmoins tre`s peu connue et encore moins 1 École nationale superieure agronomique reconnue par les de´cideurs politiques. Cette analyse repose sur les donne´es d’une enqueˆte (ENSA) re´alise´e aupre`s de 108 producteurs de pomme de terre dans la re´gion d’Aflou, wilaya de Rue hassen badi Laghouat. Par leur fonctionnement re´ticulaire, ces producteurs interviennent comme Belfort El Harrach « connecteurs » d’individus et de territoires en combinant la maıˆtrise des techniques 1600 Alger culturales et la maıˆtrise des marche´s des facteurs de production et des produits agricoles Algerie <[email protected]> (souvent imparfaits, voire absents localement), mettant ainsi en rapport des marche´s et des <[email protected]> sites de production e´clate´s dans l’espace. Ils e´tablissent ces connexions pour mener a` bien <[email protected]> leur propre production, mais aussi en tant qu’interme´diaires, avec donc un effet 2 d’entraıˆnement sur l’e´conomie agricole locale. CRSTRA El Alia Mots cle´s:Aflou ; Alge´rie ; agriculteurs itine´rants ; capital social ; pomme de terre ; re´seau. Biskra Algerie The`mes : e´conomie et de´veloppement rural ; productions ve´ge´tales. 3 IRD 4911, avenue Agropolis 34394 Montpellier Abstract France Young itinerant farmers and the development of potato farming in Algeria. -

Rapport De Mission
TdR n°026 : Diagnostic wilaya de Laghouat Rapport Final RAPPORT DE MISSION Intitulé de la mission : TdR 026 : Diagnostic et recommandations pour le tourisme rural, dans les wilayas d'Ain-Temouchent, Laghouat, Sétif et Tlemcen Période d'exécution de la mission : Samedi 15 décembre 2018 – jeudi 20 décembre 2018 Durée : 5 jours ouvrables Lieu d'intervention : • Laghouat Établi par : Dr. Cherifa Bensadek Date de soumission du rapport : 1er février 2019 Dr. Cherifa BENSADEK, Samedi 15 décembre 2018 – Jeudi 20 Décembre 2018. 2 TdR n°026 : Diagnostic wilaya de Laghouat Rapport Final Sommaire PRÉAMBULE ....................................................................................................................................................... 4 I- SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'ATELIER PARTICIPATIF FINAL ............... 5 II- FICHES PROJET ............................................................................................................................................ 6 Projet 1 : Création d'un modèle-type de ferme agrotouristique ............................................................... 7 Projet 2 : Destination " Site remarquable du goût à Taouiala" ................................................................... 9 Projet 3 : Filière producteurs et fermes "agroécologiques" pour la valorisation touristique des produits du terroir ...................................................................................................................................... 12 Projet 4 : Artisanat d'art traditionnel -
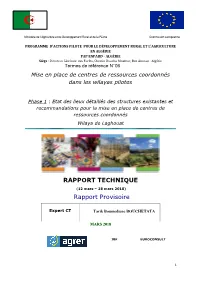
RAPPORT TECHNIQUE Rapport Provisoire
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et de la Pêche Commission européenne PROGRAMME D’ACTIONS PILOTE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL ET L’AGRICULTURE EN ALGÉRIE PAP ENPARD - ALGÉRIE Siège : Direction Générale des Forêts, Chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun Algérie Termes de référence N°06 Mise en place de centres de ressources coordonnés dans les wilayas pilotes Phase 1 : Etat des lieux détaillés des structures existantes et recommandations pour la mise en place de centres de ressources coordonnés Wilaya de Laghouat RAPPORT TECHNIQUE (12 mars – 28 mars 2018) Rapport Provisoire Expert CT Tarik Boumediene BOUCHETATA MARS 2018 IBF EUROCONSULT 1 Remerciements Nos remerciements à - Mohammed Ben Messaoud, point focal de la conservation des forêts - Djamal Ben Linani, point focal de la DSA - Abderrahmane Khirani, directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers -Mustapha Bondjemaâ, point focal de la direction du tourisme ; -Omar Rahmani secrétaire général de Chambre d’agriculture Notre respect et notre grande considération à Mr le conservateur des forêts de la wilaya de Laghouat qui nous a apporté son aide et son soutien pour le bon déroulement de la mission. Un grand merci à Sid Ali Taouati et Mohamed Khelaif pour leur assistance à la réussite de la mission. Tarik BOUCHETATA 2 Table des matière .................................................................................................................................................. 3 Sigle et acronymes ................................................................................................................................................ -

Memoire De Master 2
UNIVERSITE SAAD DAHLEB DE BLIDA 1 INSTITUT D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME Memoire de Master 2 Option : ARCHITECTURE VILLE ET TERRITOIRE Thème Démarche Cognitive pour la Revitalisation du Quartier Zgag El-Hedjadj du Ksar de Laghouat Présenté par : - Mlle ZIREGUE Meriem Encadré par : - Dr. Arch. SAIDI Mohamed Année universitaire 2017/2018 Je remercie dieu le tout puissant qui nous a donné le courage et la volonté de mener à bien notre travail. Ma familles de nous avoir soutenu pendant notre cursus universitaire. Je tiens à remercier mon encadreur Dr SAIDI Mohammed pour le suivi et l’encadrement qui m'a apporté. Sans oublier de remercier mes chers enseignants de l'université de Laghouat qui n'ont cessé de me aider et de m'orienter, Mr Benarfa Kamel grand merci, Mm Bouchareb Zahra, Mr Takhi Belkacem, Mr Korkaz Harzallah, Mr Hadj Kadour. A tout le groupe des enseignants et étudiants de l’option Arviter classique. A toutes personnes qui nous a aidés de près ou de loin. ZIREGUE MERIEM Je dédie ce modeste travaille : A ma très chère mère Affable, honorable, adorable : tu représentes pour moi le symbole de la bonté par excellence, la source de tendresse et l’exemple du dévouement qui n’a pas cessé de m’encourager et de prier pour moi. Ta prière et ta bénédiction m’ont été d’un grand secours pour mener à bien mes études. Aucune dédicace ne saurait être assez éloquente pour exprimer ce que tu mérites pour tous les sacrifices que tu n’as cessé de me donner depuis ma naissance, durant mon enfance et même à l’âge de l’adolescence. -

Aba Nombre Circonscriptions Électoralcs Et Composition En Communes De Siéges & Pourvoir
25ame ANNEE. — N° 44 Mercredi 29 octobre 1986 Ay\j SI AS gal ABAN bic SeMo, ObVel , - TUNIGIE ABONNEMENT ANNUEL ‘ALGERIE MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL Abonnements et publicité : Edition originale .. .. .. .. .. 100 D.A. 150 DA. Edition originale IMPRIMERIE OFFICIELLE et satraduction........ .. 200 D.A. 300 DA. 7 9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER (frais d'expédition | tg}, ; 65-18-15 a 17 — C.C.P. 3200-50 ALGER en sus) Edition originale, le numéro : 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars. — Numéros des années antérleures : suivant baréme. Les tables sont fourntes gratul »ment aux abonnés. Priére dé joindre les derniéres bandes . pour renouveliement et réclamation. Changement d'adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANGAISE) SOMMAIRE DECRETS des ceuvres sociales au ministére de fa protection sociale, p. 1230. Décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux siéges & pourvoir pour l’élection a l’Assemblée fonctions du directeur des constructions au populaire nationale, p. 1217. , ministére de la formation professionnelle et du travail, p. 1230. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général da la planification Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux et de. la gestion industrielle au ministére de fonctions du directeur de la sécurité sociale et lindustrie lourde,.p.