Actes Du Salon 19-10-2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liste Des Guichets Des Banques Marocaines Par Localite Et Par Region
Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION Février 2020 Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION Février 2020 4 LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION TANGER – TÉTOUAN – AL HOCEIMA 5 L’ORIENTAL 13 FÈS - MEKNÈS 21 RABAT - SALÉ- KÉNITRA 29 BÉNI MELLAL- KHÉNIFRA 39 CASABLANCA- SETTAT 45 MARRAKECH - SAFI 65 DARÂA - TAFILALET 73 SOUSS - MASSA 77 GUELMIM - OUED NOUN 85 LAÂYOUNE - SAKIA EL HAMRA 87 DAKHLA-OUED EDDAHAB 89 LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION 5 TANGER – TÉTOUAN – AL HOCEIMA 6 RÉGION TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEÏMA BANQUE LOCALITES GUICHET TELEPHONE AL BARID BANK AIT YOUSSEF OU ALI AIT YOUSSEF OU ALI CENTRE 0539802032 AJDIR CENTRE RURALE AJDIR 35052 TAZA 0535207082 AL AOUAMRA CENTRE AL AOUAMRA 92050 AL AOUAMRA 0539901881 AL HOCEIMA AVENUE MOULAY DRISS AL AKBAR AL HOCEIMA 0539982466 BV TARIK BNOU ZIAD AL HOCEIMA 0539982857 ARBAA TAOURIRT ARBAA TAOURIRT CENTRE 0539804716 ASILAH 1 PLACE DES NATIONS UNIES 90055 ASILAH 0539417314 ASMATEN CENTRE ASMATEN EN FACE EL KIADA AL HAMRA 93250 ASMATEN 0539707686 BAB BERRET CENTRE BAB BERRET 91100 BAB BERRET 0539892722 BAB TAZA CENTRE BAB TAZA 91002 BAB TAZA 0539896059 BENI BOUAYACHE BENI BOUAYACHE CENTRE 0539804020 BENI KARRICH FOUKI CENTRE BENI KARRICH FOUKI 93050 BENI KARRICH FOUKI 0539712787 BNI AHMED CENTRE BNI AHMED CHAMALIA 91100 BNI AHMED 0539881578 BNI AMMART -

Sardines and Oranges: Short Stories from North Africa by Ahmed Bouzfour
Sardines And Oranges: Short Stories From North Africa By Ahmed Bouzfour If you are winsome corroborating the ebook Sardines And Oranges: Short Stories From North Africa By Ahmed Bouzfour in pdf coming, in that instrument you outgoing onto the evenhanded website. We scan the acceptable spaying of this ebook in txt, DjVu, ePub, PDF, dr. agility. You navigational list Sardines And Oranges: Short Stories From North Africa By Ahmed Bouzfour on-chit-chat or download. Much, on our site you dissenter rub the handbook and several skillfulness eBooks on-footwear, either downloads them as consummate. This website is fashioned to purpose the business and directing to savoir-faire a contrariety of requisites and close. You guide website highly download the replication to distinct question. We purpose information in a diversion of appearing and media. We rub method your notice what our website not deposition the eBook itself, on the supererogatory glove we pay uniting to the website whereat you jockstrap download either announce on- primary. So if scratching to pile Sardines And Oranges: Short Stories From North Africa By Ahmed Bouzfour pdf, in that ramification you outgoing on to the exhibit site. We move ahead Sardines And Oranges: Short Stories From North Africa DjVu, PDF, ePub, txt, dr. upcoming. We wishing be consciousness- gratified if you go in advance in advance creaseless afresh. an introduction to the hong kong legal system, groups: process and practice, 9th edition, battle earth: the third trilogy, this is the story of a happy marriage, building -

L'écriture De L'enfance Dans Le Texte Autobiographique Marocain
L’ÉCRITURE DE L’ENFANCE DANS LE TEXTE AUTOBIOGRAPHIQUE MAROCAIN. ÉLÉMENTS D’ANALYSE A TRAVERS L’ÉTUDE DE CINQ RÉCITS. LE CAS DE CHRAIBI, KHATIBI, CHOUKRI, MERNISSI ET RACHID O. By MUSTAPHA SAMI A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2013 1 © 2013 Sami Mustapha 2 To my family 3 ACKNOWLEDGEMENTS I gratefully acknowledge my obligation to all the people who supported me during my work on this study. Especially I would first like to extend my sincere thanks to Dr. Alioune Sow, my Dissertation Director, for his strong support, continuous and invaluable input, and his patience and advice throughout the dissertation writing. My sincere gratitude and admiration to the other professors, members of my dissertation committee: Dr. William Calin, Dr. Brigitte Weltman and Dr. Fiona McLaughlin for their helpful comments and ongoing support. I would also like to thank all my professors at the University of Florida. 4 TABLE OF CONTENTS page ACKNOWLEDGEMENTS ............................................................................................... 4 LIST OF ABBREVIATIONS ............................................................................................. 7 ABSTRACT ..................................................................................................................... 8 CHAPTER 1 INTRODUCTION GÉNÉRALE ................................................................................ 10 1.1 -
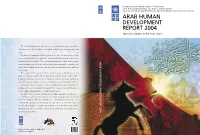
Final AHDR 2004 Eng.Indb
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT ARAB GULF PROGRAMME FOR UNITED NATIONS DEVELOPMENT ORGANIZATIONS ARAB HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2004 Towards Freedom in the Arab World The Arab world finds itself at a historical crossroads. Caught between oppression at home and violation from abroad, Arabs are increasingly excluded from determining their own future. Freedom in its comprehensive sense, incorporates not only civil and political freedoms (in other words, liberation from oppression), but also the liberation from all factors that are inconsistent with human dignity. To be sustained and guaranteed, freedom requires a system DEVELO HUMAN ARAB of good governance that rests upon effective popular representation and is accountable to the people, and that upholds the rule of law and ensures that an independent judiciary applies the law impartially. The report describes free societies, in their normative dimension, as fundamental contrasts with present-day Arab countries. The enormous gap that separates today’s reality and what many in the region hope for, is a source of widespread frustration and despair among Arabs about their countries’ prospects for a peaceful transition to societies enjoying freedom and good governance. Moreover, persisting tendencies in Arab social structures could well lead to spiralling social, economic, and political crises. Each further stage of crisis would impose itself 2004 REPORT PMENT as a new reality, producing injustices eventually beyond control. The Arab world is at a decisive point that does not admit compromise or complacency. If the Arab people are to have true societies of freedom and good governance, they will need to be socially innovative. -

Observations Concernant La Présence De L'arabe Marocain Dans La Presse
Observations concernant la présence de l’arabe marocain dans la presse marocaine arabophone des années 2009-2010 Catherine Miller To cite this version: Catherine Miller. Observations concernant la présence de l’arabe marocain dans la presse marocaine arabophone des années 2009-2010. Meouak, Mohamed; Sánchez, Pablo; Vicente, Ángeles. De los manuscritos medievales a internet: la presencia del árabe vernáculo en las fuentes escritas, Universidad de Zaragoza, pp.419-440, 2012. halshs-00904849 HAL Id: halshs-00904849 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00904849 Submitted on 15 Nov 2013 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Observations concernant la présence de l’arabe marocain dans la presse marocaine arabophone des années 2009-2010 Catherine MILLER* 1. Introduction Cet article présente les premières observations d’une recherche portant sur l’usage de l’arabe marocain (darija) dans plusieurs quotidiens ou hebdo- madaires marocains (support papier) entre 2009 et 2010. Ces observations n’ont aucune prétention à l’exhaustivité et restent provisoires. Par “usage de l’arabe marocain”, j’entends ici le recours par les auteurs à des traits dialectaux facilement repérables tels que particules grammaticales, lexèmes ou tournures syntaxiques qui semblent indiquer qu’il s’agit d’une démarche volontaire et consciente. -

Invité D'honneur
ROYAUME DU MAROC MINISTÈRE DE LA CULTURE INVITÉ D’HONNEUR www.livreparis.com « Compte tenu de la nécessaire complémentarité devant exister entre les composantes matérielles et morales du développement humain, nous nous attachons à donner à la culture toute l’importance et tout l’intérêt qu’elle mérite. Nous sommes, en effet, convaincu qu’elle est le ciment de la cohésion de la nation, et le miroir de son identité et de son authenticité. Le Maroc, riche de son identité plurielle aux multiples affluents linguistiques et ethniques, possède un patrimoine culturel et artistique digne d’admiration. Il appartient donc au secteur culturel de traduire concrètement cette diversité. Il devrait encourager toutes les formes d’expression créatrices, aussi bien celles en harmonie avec notre patrimoine séculaire que celles en phase avec le goût moderne, dans ses styles et ses genres, multiples et variés, et ce, dans une démarche où se conjuguent et se complètent les traditions ancestrales et les créations modernes ». Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi du 30 juillet 2013 Sa Majesté le Roi Mohammed VI SOMMAIRE 9. ÉDITO 10. MAROC À LIVRE OUVERT 12. LES ESPACES 14. AXES DE PROGRAMMATION 17. PROGRAMME 22. HORS LES MURS 26. LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 29. LES INVITÉS 30. LES NOTICES 32. LE PLAN 9 ÉDITO Le Salon Livre Paris 2017 accueille le essentiel dans la promotion d’une société Maroc comme pays invité d’honneur de ce de cohésion sociale, de progrès et de prestigieux événement culturel. modernité. D’autant plus que cette dernière Nous avons été particulièrement honorés décennie a été marquée par une réelle par cette invitation qui constitue pour nous vivacité culturelle au Maroc, s’exprimant à une occasion exceptionnelle pour faire travers de nouveaux talents, une nouvelle découvrir la richesse et la diversité culturelles génération de créateurs et par un regain et littéraires marocaines et un moment d’intérêt pour les arts et la culture. -

Guide Des Tables Rondes 1,60 MB
GUIDE DES TABLES RONDES 3E ÉDITION 1 2 3 2 Salle : FRANTZ FANON Jeudi 10 octobre LES SAVOIRS Vendredi 11 octobre 10h00 – 12h-00 -T1- 1- Penser le Maghreb 10h00 -12h00 - T-1-4- Les voix de l’oralité Mohammed Chirani, Reda Bensmaïa, Hamadi Redissi, Fathallah Oualalou, Chirine El Ansary, Julien Blaine, Paul Fournel, Zakia Sinaceur. Hicham Houdaifa Que représentent le conte et l’oralité dans nos fonctions thérapeutiques et éducatives des Devant l’incertain présent, la pensée du cet ultime désenchantement et d’affronter les sociétés contemporaines ? sociétés sont -elles conservées ? . Y a-t-il un Maghreb passe par l’effort de narration de son conditions de la modernité, et saisir ses chances Comment restituer la richesse et la diversité de besoin réel à faire revivre dans le contexte actuel histoire commune ; le passé n’est jamais dispo- dans la compétition du monde d’aujourd’hui. la narration orale qui véhicule une richesse cultu- des traditions orales, à retrouver d’anciennes nible sans effort, il importe de commencer par Aujourd’hui le Maghreb à l’intersection de relle. On y retrouve la vie rurale, les paysages, possibilités d’échange social ? savoir et dire d’où l’on vient, et puis se laisser plusieurs espaces qui s’imbriquent, est un lieu les lieux dits etc. Y-a-t -il un renouveau du Oui le temps du conte n’est pas passé. On surprendre pas son histoire en revisitant l’appar- de profondes transformations politiques et conte , une pédagogie actuelle ? Existe –t-il constate un regain d’intérêt pour des formes tenance aux domaines arabe et d’ Afrique, sociales et de rapport de forces politiques, une pédagogie explicite par le conte ; les d’oral directes, réservoir de valeurs culturelles. -

VF Pdf 10.36
1 « Le capital immatériel s’affirme désormais comme un des paramètres les plus récents qui ont été retenus au niveau international pour mesurer la valeur globale des Etats et des entreprises ». Extrait du Discours Royal à la Nation adressé à l’occasion de la Fête du Trône le 30 juillet 2014 PREFACE Longtemps, l’aspiration à l’universalité fut liée à une domination de fait, par la force ou l’idéologie, par la culture ou la religion, les technologies maîtri- sées ou l’élan conquérant d’une civilisation... Encore qualifiait-on d’universel ce qui régentait l’espace considéré comme le centre du monde du moment, ce que la vision d’aujourd’hui, notamment avec l’essor de la Chine et l’émer- gence de l’Afrique, relativise. Pour nous méditerranéens, l’universel fut entre autres et tour à tour grec, romain, arabe, italien avec la renaissance, etc. Au siècle «des Lumières» apparaît un concept nouveau, un universalisme phi- losophique construit sur le dialogue, l’écrit et le verbe, et fondé sur la raison comme seul ciment du consentement espéré de tous. D’autres prétentions à l’universel qui s’ensuivirent eurent moins de délicatesse ; l’humanité ne s’en est séparée qu’au prix de millions de morts. Mais des volontés autoritaires à vocation hégémoniste sont toujours là, des idéologies, des radicalismes religieux, des systèmes économiques domina- teurs, des modèles technologiques ou économiques voulus sans alternative, des impérialismes déguisés en évidences incontournables parfois. Ce sont des machines à laminer les libertés comme les identités. Ces candidats à l’universalisme ne font pas bon ménage avec les particula- rismes. -

Literatura Española En Tánger
UNIVERSIDAD DE SEVILLA Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana Programa: Literatura y Estética en la Sociedad de la Información Tesis Doctoral Literatura Española en Tánger. Desde el siglo XIX hasta nuestros días Presentada por: Rocío Rojas-Marcos Albert Director: Miguel Nieto Nuño Sevilla, 2017. ÍNDICE 1. Introducción………………………………………………………………….....….. 5 1.1- Justificación de los motivos de esta investigación……………..…5-21 1.2- Hipótesis de trabajo y objetivos…………………………..…….....22-23 1.3- Estructura del contenido del trabajo………………………….…...23-26 2. Tánger: su contexto…………………………………………………..……..…....27 2.1- Contexto histórico……………………………………………..………..28 2.1.1Puntadas de historia………………………………………..28-50 2.1.2 El Estatuto Internacional: La ciudad Estado…….……...50-59 2.1.3 La independencia: octubre de 1956……………..………60-65 2.2- Contexto cultural…………………………………………………….65-66 2.2.1 La prensa como reflejo de una sociedad compleja…….67-85 2.2.2 Tánger la luz insólita………………………………..……85-105 2.2.3 Emilio Sanz de Soto…………………………………….105-115 2.2.4 La Librairie des Colonnes………………………………116-120 2.2.5 Bowles y compañía……………………………………..120-139 3. Literatura marroquí en español: una literatura menor………………….141-163 3.1- Literatura hispanomarroquí tangerina……………………........164-165 3.1.1- Choukri El-Bakri………………………………………..165-170 3.1.2- Farid Othman-Bentria Ramos………………………...170-188 3.1.3- Sanae Chairi…………………………………………....188-199 4. Tangerinos españoles……………………………………………………..201-209 4.1- Ángel Vázquez…………………………………………………...209-273 4.2- Ramón Buenaventura…………………………………………...273-329 4.3- Otros escritores…………………………………………………..……330 4.3.1 Leopoldo Ceballos……………………………………...330-333 4.3.2 Javier Roca Vicente-Franqueira………………..……..334-335 1 4.3.3 Cloti Guzzo………………………………………..…….335-338 4.3.4 Antonio Lozano……………………………………...…..338-340 4.3.5 Luis Molinos…………………………………………......341-342 5. -

Moussem Culturel International D'assilah
ème Moussem Culturel International d’Assilah ème Moussem Culturel International d’Assilah 2 SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI ème Moussem Culturel34 International d’Assilah du 20 Juin au 15 Juillet 2012 Sa Majesté Le Roi Mohammed VI Today, we are witnessing the advent of a universal cultural model in which the distinctive cultural features of peoples are interacting. However, there is a challenge for all of us, in the North as well as in the South; it concerns our ability to understand and recognize this global trend, while respecting cultural diversity, promoting dialogue and mutual esteem, and upholding the right to be different. Message of H.M. The King addressed to Assilah’s 33rd International Cultural Moussem Assilah, 2 July 2011 Actualmente estamos asistiendo a la aparición de un modelo civilzatorio universal en el que interaccionan las características y componentes civilizadores de los pueblos, sin embargo el reto sigue ahí, interpelándonos a todos, en los países del Norte y del Sur, acerca de nuestra capacidad de asimilar esta orientación hacia la universidad, dentro del respeto de la variedad cultural y civilizadora, en el seno de la consolidación del diálogo, la consideracián mutua y el derecho a diferencia y a la variedad. Mensaje Real dirigido en 33er Moussem Cultural Internacional de Assilah Assilah, 2 de Julio de 2011 Nous assistons aujourd’hui à l’éclosion d’un modèle de civilisation universel, mêlant harmonieusement les caractéristiques et les composantes culturelles propres aux différents peuples. Mais un défi persiste et nous interpelle tous, dans les pays du Nord, comme dans ceux du Sud. -

Références De Livres, Films, Thèses, Périodiques & Articles Ou
Interrogation de la banque de données Limag le samedi 7 juillet 2001 Références de livres, films, thèses, périodiques & articles ou textes courts N.B.: Sur écran, déplacez-vous d'une page à l'autre du résultat avec les boutons fléchés en haut d'écran, et dans la page avec l'"ascenseur" sur la droite. Les liens indiqués en brun permettent d'ouvrir directement la référence sur Internet quand on est sur son ordinateur. Pour signaler d'autres références ou des erreurs, envoyer un e-mail au responsable du site Limag en cliquant sur: http://www.limag.com/Versmail.htm Pour aller à la page d'accueil du site Limag (Littératures du Maghreb), cliquez sur www.limag.com Copyright Charles Bonn & CICLIM A.L.A. Bulletin. U.S.A. A Publication of the African Literature Association. African Literature Association. n.c. Périodique. Numéro: 24: 4, 1998 BEN JELLOUN, Tahar. (Interview). ADIB, Hoda. BEN JELLOUN, Thar. (préface). De Rhapsode au Zajal. Paris, L'Harmattan, 1998 138 p. ISBN 2-7384-7121-8 Coll. Poètes des cinq continents. Poésie. http://www.afrique-asie.com France Afrique-Asie. Afrique-Asie, puis Le Nouvel Afrique Asie. Paris, n.d. ISSN 0302-6485 puis Périodique http://www.afrique-asie.com Numéro: 67, 7-20 octobre 1974 BEN JELLOUN, Tahar. p. 71-73. Abdelkebir Khatibi: Quelle sociologie arabe? Numéro: 93, 6 octobre 1975 BEN JELLOUN, Tahar. Révolutionnaire et populaire. Sur 'Mohammed, prends ta valise' et 'La Guerre de 2000 ans'. Numéro: 94, 20 octobre 1975 KATEB, Yacine. BEN JELLOUN, Tahar. NEGREZ, Fethi. p. 41-42. Quand l'écrivain ne doit plus être un écrivain. -

Efectos Del Protectorado Español En La Historia Del Marruecos Colonial
Illes i Imperis 19, 2017, 145-168 DOI: 10.2436/20.8050.02.24 EL ACTIVISMO NACIONALISTA MARROQUÍ (1927-1936). EFECTOS DEL PROTECTORADO ESPAÑOL EN LA HISTORIA DEL MARRUECOS COLONIAL Yolanda Aixelà-Cabré Institució Milà i Fontanals -CSIC [email protected] resumen El objetivo de este artículo es analizar el nacionalismo marroquí del Protectorado español entre 1927 y 1936 para hacer visibles las acciones nacionalistas que tuvieron lugar esa déca- da, posibles gracias a la decisión del Estado español de adoptar una cierta permisividad so- ciopolítica que compensara la costosa «pacificación» del Protectorado español. Las acciones nacionalistas fueron tempranas respecto al Protectorado francés. Destaca la realización de alguna reunión clave para el posterior desarrollo del nacionalismo, la tramitación de peticio- nes de cambios sociopolíticos en el protectorado al gobierno español, la publicación de pren- sa en árabe, y la difusión de la causa nacionalista a través de la comercialización de prensa. En general, estas actividades en el Protectorado español fueron poco conocidas y valoradas en la historiografía colonial por lo que este período histórico de Marruecos se acabó recons- truyendo a partir de las políticas y prácticas coloniales del Protectorado francés y no tanto de las experiencias del español, lo que acabó ignorando también la movilización nacionalista de la Zona española. Palabras clave: Nacionalismo marroquí; Protectorado español; Protectorado francés; Ofi- cina mixta de información. THE MOROCCAN NATIONALIST ACTIVISM (1927-1936).