Septentrion. Jaargang 3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Piet Wackie Eysten Jubileumboek Van De Stichting Voor Kamermuziek
Jubileumboek van de stichting voor kamermuziek Piet Wackie eysten ‘String quartets trudge onstage hundreds of times a year and play music of the gods for a passionate and intensely involved audience. Not much to write about…’ Arnold Steinhardt, Indivisible by Four Inhoudsopgave 1. Een ‘voorloopige commissie’ 5 2. De Vereeniging voor Kamermuziek te ’s-Gravenhage 13 3. De eerste seizoenen 19 4. Koninklijke belangstelling 25 5. Programmering 29 6. Het 12½-jarig jubileum 35 7. Een nieuwe voorzitter 39 8. Het 25-jarig jubileum 45 9. Oorlogsjaren 51 10. Na de oorlog 57 11. De vijftiger jaren 63 12. Blijvend hoog niveau 67 13. De kosten 73 14. Ledenwerving 79 15. De ‘Vereeniging’ wordt een stichting 83 16. Bestuurswisselingen en stijgende prijzen 87 17. Donkere wolken 93 18. Een website tot slot 101 Inhoudsopgave / 3 Dr. D.F. Scheurleer Daniël François Scheurleer werd op 13 november 1855 geboren in Den Haag, waar zijn vader firmant was van het sinds 1804 in Den Haag gevestigde bankiershuis Scheurleer & Zoonen. De jonge Daniël trad bij zijn vaders firma in dienst, nadat hij in Dresden aan het ‘Handelslehranstalt’ een opleiding had gevolgd en bij de Dresdner Bank een stage had doorlopen. Na het overlijden van zijn vader in 1882 werd hij, nog slechts 26 jaar oud, directeur van het familiebedrijf. De firma hield zich vooral bezig met vermogensbeheer van welgestelde Hagenaars uit de hogere kringen. De schrijver Louis Couperus bankierde zijn leven lang bij Scheurleer & Zoonen. Couperus en zijn vrouw verkeerden op vriendschappelijke voet met de heer en mevrouw Scheurleer. In zijn testament bepaalde Couperus dat het vermogensbeheer van de stichting die hij met dat testament in het leven riep, zou worden gevoerd door ‘de tegenwoordige en toekomstige individueele leden van de firma Scheurleer & Zoonen’. -

Online Bekijken
SIMONIS &BUUNK KUNSTHANDEL Wintersalon 2003 20e eeuw 1 Julius Müller-Massdorf Tearoom Tango Leendert ‘Leo’ Gestel Woerden 1881-1941 Hilversum Bloemstilleven met tijgerlelies, doek 33,3 x 25,3 cm, gesigneerd en te dateren 1912-1913. Herkomst: Douwe Komter, Amsterdam. Wordt opgenomen in de catalogue critique van het werk van de schilder, in voorbereiding door het Leo Gestel Comité. SIMONIS &BUUNK Klassiek-Modernen EEN KEUR AAN KUNST Neo-Impressionisten Bergense School Groninger Ploeg Nieuwe Realisten Wintersalon 2003 Abstracten 20e eeuw donderdag 20 november t/m zaterdag 6 december SIMONIS&BUUNK KUNSTHANDEL BV SIMONIS&BUUNK COLLECTIE BV SIMONIS&BUUNK COLLECTIE DE PLOEG CV RESTAURATIEATELIER J.M. SIMONIS – SINDS 1927 BEËDIGD TAXATEUR SCHILDERIJEN Een collectie schilderijen, aquarellen en tekeningen, voornamelijk uit de eerste helft van de 20e eeuw: klassiek-modernen, waar- onder neo-impressionisten, luministen, en vertegenwoordigers van expressionistische stromingen als Bergense School en Groninger Ploeg, nieuwe realisten en abstracten Voor prijzen: zie www.simonis-buunk.nl Openingstijden expositie: dinsdag t/m zaterdag van 11-17 uur zondag 23 november en zondag 30 november van 12-17 uur Gesloten op maandagen en tevens op 11 en 12, 18 en 19 november Notaris Fischerstraat 19, 6711 BB Ede telefoon: 0318 652888 fax: 0318 611130 Buiten exposities om geopend dinsdag t/m zaterdag van 11-17 uur en op afspraak www.simonis-buunk.nl [email protected] 3 Ter inleiding omgeving en het kantoor en de archiefruimte uit te breiden hebben we in korte tijd en met veel plezier kunnen verwezenlijken. Voor gelijkgestemde zielen is het gemakkelijk samenwerken, en eigenwijs als we zijn waren we bovendien onze eigen binnenhuis- architect. -

Contents Price Code an Introduction to Chandos
CONTENTS AN INTRODUCTION TO CHANDOS RECORDS An Introduction to Chandos Records ... ...2 Harpsichord ... ......................................................... .269 A-Z CD listing by composer ... .5 Guitar ... ..........................................................................271 Chandos Records was founded in 1979 and quickly established itself as one of the world’s leading independent classical labels. The company records all over Collections: Woodwind ... ............................................................ .273 the world and markets its recordings from offices and studios in Colchester, Military ... ...208 Violin ... ...........................................................................277 England. It is distributed worldwide to over forty countries as well as online from Brass ... ..212 Christmas... ........................................................ ..279 its own website and other online suppliers. Concert Band... ..229 Light Music... ..................................................... ...281 Opera in English ... ...231 Various Popular Light... ......................................... ..283 The company has championed rare and neglected repertoire, filling in many Orchestral ... .239 Compilations ... ...................................................... ...287 gaps in the record catalogues. Initially focussing on British composers (Alwyn, Bax, Bliss, Dyson, Moeran, Rubbra et al.), it subsequently embraced a much Chamber ... ...245 Conductor Index ... ............................................... .296 -

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024
Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 7 Samenvatting Hoofdstuk 2 13 Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 Hoofdstuk 3 89 Financiële gegevens: meerjarenbegroting 2021-2024 en balans 2017-2018 Hoofdstuk 4 97 Prestatiegegevens Hoofdstuk 5 101 Collectieplan Bijlagen > Rapportage Erfgoedhuis Zuid-Holland > Statuten > Wijziging statuten als gevolg van naamsverandering > Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Hoofdstuk 1 Samenvatting beleidsplan Naam instelling: Kunstmuseum Den Haag GEM | Museum voor Actuele Kunst Fotomuseum Den Haag Statutaire naam instelling: Stichting Kunstmuseum Den Haag Statutaire doelstelling: Het inrichten, in stand houden en exploiteren van de museumgebouwen en collecties die onder de naam “Kunstmuseum Den Haag” in eigendom toebehoren aan de gemeente Den Haag. Aard van de instelling: Museum Bezoekadres: Stadhouderslaan 41 Postcode en plaats: 2517 HV Den Haag Postadres: Postbus 72 Postcode en plaats: 2517 HV Den Haag Telefoonnummer: 070 3381 111 Email: [email protected] Website: www.kunstmuseum.nl Totalen 2017 2018 2019 2020 Tentoonstellingen (binnenland) 36 33 36 33 Bezoekersaantallen* 502.981 386.819 556.560 400.000 Totalen 2021 2022 2023 2024 Tentoonstellingen (binnenland) 36 30 30 30 Bezoekersaantallen* 400.000 400.000 400.000 400.000 * Bezoekersaantallen exclusief deelnemers basisonderwijs. Kunstmuseum Den Haag Dit museum doet iets met je. Het creëert afstand tot het alledaagse. Biedt troost. Zet je aan het denken. Laat je tot rust komen. Of juist niet. Met museumzalen in menselijke maat, komt Kunstmuseum Den Haag het liefst dichtbij. Zo dichtbij dat kunst intiem wordt. En je niets anders kan dan naar binnen kijken. 8 Kunstmuseum Den Haag vindt dat iedereen dicht bij kunst over wie we zijn. Er zijn maar weinig musea die doorlopend moet kunnen komen. -

BENELUX and SWISS SYMPHONIES from the 19Th Century to the Present
BENELUX AND SWISS SYMPHONIES From the 19th Century to the Present A Discography of CDs And LPs Prepared by Michael Herman JEAN ABSIL (1893-1974) BELGIUM Born in Bonsecours, Hainaut. After organ studies in his home town, he attended classes at the Royal Music Conservatory of Brussels where his orchestration and composition teacher was Paul Gilson. He also took some private lessons from Florent Schmitt. In addition to composing, he had a distinguished academic career with posts at the Royal Music Conservatory of Brussels and at the Queen Elisabeth Music Chapel and as the long-time director of the Music Academy in Etterbeek that was renamed to honor him. He composed an enormous amount of music that encompasses all genres. His orchestral output is centered on his 5 Symphonies, the unrecorded ones are as follows: No. 1 in D minor, Op. 1 (1920), No. 3, Op. 57 (1943), No. 4, Op. 142 (1969) and No. 5, Op. 148 (1970). Among his other numerous orchestral works are 3 Piano Concertos, 2 Violin Concertos, Viola Concerto. "La mort de Tintagiles" and 7 Rhapsodies. Symphony No. 2, Op. 25 (1936) René Defossez/Belgian National Orchestra ( + Piano Concerto No. 1, Andante and Serenade in 5 Movements) CYPRÈS (MUSIQUE EN WALLONIE) CYP 3602 (1996) (original LP release: DECCA 173.290) (1958) RAFFAELE D'ALESSANDRO (1911-1959) SWITZERLAND Born in St. Gallen. After some early musical training, he studied in Paris under the tutelage of Marcel Dupré (organ), Paul Roës (piano) and Nadia Boulanger (counterpoint). He eventually gave up composing in order to earn a living as an organist. -

Download Scans
• zn - .. ^ ^_.^^^ ....} A^^ - ^i"'^r-r - • ^. a- . ^^^ ~ f ^ FéG_ 3^ - T _ _ i ^-Yf_ ..A'__ r - ^ fy n r ^ _ ^. -...1^a^--- -^3 ^ •'f ^J9 ^ O^G•1^_..._ ^-+'^.- -^^^^ : ^. _^` ^1.^`"^:rr' E-' ^^. ?8 r^t ^&. 1.^--^^-^.d, _.^ -'ft.9 a..•^ -.^.^^.-.- ^.-.^^ ^"^----^_. ^.. ... - --^.:.^ c;^,^as^^t^^ dÉc..^^+-e__----•^ àL - ^•^3' :^ f ^..^ ^` ..-.s-^:.^x u. --^/-'#r„' :t^.^.^.. • - • ► PARTICULIERE ARCHIEVEN IN NEDERLAND Omslag: brief van ir. C. Lely aan de voorzitter van de Zuiderzeevereniging waarin hij een deel van het archief van deze vereniging aan hem overdraagt, 1902 (Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland, archief Zuiderzeevereni- ging). OVERZICHTEN VAN DE ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN IN DE OPENBARE ARCHIEFBEWAARPLAATSEN IN NEDERLAND uitgegeven onder auspiciën van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland redactie: L.M.Th.L. Hustinx t F.C.J. Ketelaar H.J.A.H.G. Metselaars J.J. Temminck H. Uil DEEL XIV PARTICULIERE ARCHIEVEN IN NEDERLAND PARTICULIERE ARCHIEVEN IN NEDERLAND onder eindredactie van H.J.A.H.G. Metselaars Bohn Stafleu Van Loghum Houten / Zaventem 1992 Dit overzicht is bijgewerkt tot begin 1991. Copyright 41992 Bohn Stafleu Van Loghum bv, Houten All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of .....Uitgeverij. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna- men, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. -

Bookswallows 36-Pages- Cobra0072 Page01 Bookswallows Cobra0072 Page02 Bookswallows Cobra0072 Page03
BookSwallows 36-pages- Cobra0072 Page01 BookSwallows Cobra0072 Page02 BookSwallows Cobra0072 Page03 From 1. Moderato Rustic Miniatures I Oboe SM (2:22) 2. Roses About Flowers Piano SM (2:46) 3. Andante Rustic Miniatures I Oboe SM (2:16) 4. A group of chickadees in the woods About Birds Piano SM (1:12) 5. Allegretto pastorale Rustic Miniatures I Oboe SM (3:04) 6. Wisteria in the monestary garden About Flowers Piano SM * (3:10) 7. Andante con moto Rustic Miniatures II Oboe SM * (2:48) 8. The water lily About Flowers Piano SM * (2:17) 9. Allegretto giocoso Rustic Miniatures II Oboe SM * (1:56) 10. The tiny fish Children’s book I Piano AV * (1:48) 11. Adagio Rustic Miniatures II Oboe SM * (4:10) 12. Night birds About Birds Piano SM * (5:01) 13. Allegro Rustic Miniatures III Oboe SM * (2:01) 14. The Swan About Birds Piano SM (3:39) 15. Allegretto grazioso Rustic Miniatures III Oboe SM * (1:20) 16. To the ugly duckling Children’s book II Piano AV * (1:40) 17. Lento Rustic Miniatures III Oboe SM * (3:19) 18. The first swallow Children’s book I Piano AV * (1:08) 19. Moderato Sonatina Oboe SM * (3:08) 20. Cornfield in the sun About Flowers Piano SM (1:37) 21. Tranquillo Sonatina Oboe SM * (2:16) 22. The enchanted wood Fairyland Piano SM * (1:26) 23. Ritornello. Allegro Sonatina Oboe SM * (1:38) 24. The wind and the mills Tableaux des Pays-Bas Piano AV * (2:59) 25. Pastorale Oboe & Piano AV (5:47) Total time: 65:00 min. -
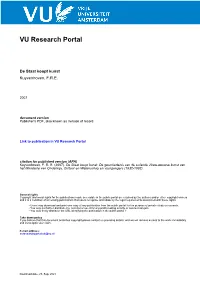
Complete Dissertation
VU Research Portal De Staat koopt kunst Kuyvenhoven, F.R.E. 2007 document version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication in VU Research Portal citation for published version (APA) Kuyvenhoven, F. R. E. (2007). De Staat koopt kunst: De geschiedenis van de collectie 20ste-eeuwse kunst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voorgangers (1932-1992). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. E-mail address: [email protected] Download date: 25. Sep. 2021 VRIJE UNIVERSITEIT De Staat koopt kunst De geschiedenis van de collectie 20ste-eeuwse kunst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voorgangers (1932-1992) ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op gezag van de rector magnificus prof.dr. L.M. Bouter, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de faculteit der Letteren op woensdag 28 november 2007 om 13.45 uur in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105 door Francisca Rosa Elisabeth Kuyvenhoven geboren te Leiden promotoren: prof.dr. -

Fokas Holthuis
antiquariaat FOKAS HOLTHUIS DE SCHOONE JACHT catalogus 50 literatuur ∙ brieven ∙ varia with a section in english antiquariaat FOKAS HOLTHUIS Fokas Holthuis Paul Snijders Nick ter Wal Postbus 18604 NL – 2502 EP Den Haag telefoon 070 – 346 6020 www.fokas.nl [email protected] www.paulbooks.nl [email protected] KvK Haaglanden 10041294 BTW NL 8103.27.910.B01 Illustratie voorzijde: nummer 153 in deze catalogus. Illustratie achterzijde: nummer 97 in deze catalogus. LEVERINGSVOORWAARDEN * Prijzen zijn in euro’s * Verzendkosten zijn voor rekening van de koper * Betaling binnen 14 dagen op één van onze rekeningen * Wij behouden ons het recht voor pas te leveren na betaling Wij versturen wekelijks een nieuwsbrief met aanwinsten of lijstjes rondom een thema of auteur per e-mail. Abonneert u zich (gratis) onder ‘Nieuwsbrieven’ op onze website. 1-132 Nederlandse literatuur in handschriften, foto’s & bijzondere uitgaven 133-151 Eenmanstijdschriften & zeldzame periodieken 152-162 H.N. Werkman 163-170 De Zilverdistel 171-178 Kunera Pers 179-220 Mooi, mal of meesterlijk: boeken, handschriften & efemeer drukwerk 221-263 Treasures and curiosities: books, autographs & ephemera oktober 2010 1 AAFJES, Bertus Handgeschreven brief aan 'Beste Rein [Blijstra]'. 25,4 x 19,2 cm. Gelinieerd blocnotevel. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd 'Bertus Aafjes' en gedateerd 'Den Haag 4 Febr. 46'. 14 regels tekst. Plakbandresten aan bovenzijde (niet storend). € 25 * De schrijver wil zich bij redacteur Blijstra graag abonneren op Critisch Bulletin: 'Ik vind dat 1e nr. het lezenswaardigste wat er tot nu toe aan tijdschrift-nrs verscheen. Het abonnementsgeld laat zich dan wel verrekenen met het honorarium voor de bijdragen'. -

Willem Pijper: an Aper.;Ul
AUGUSTINUS P. DIERICK, UNIVERSITY OF TORONTO Willem Pijper: an aper.;ul "After Sweelinck the Netherlands produced all Mahler. At the same time, Dutch composi practically no composers for three hundred tions were being published by A. A Noske in years. But the 20th century has seen the birth Middelburg. Finally, a new generation of of a flourishing school which, in reacting composers began to make itself heard. against the strong influence of the 19th century, accepted the hegemony of French First and foremost among these was music." Thus the Larousse Encyclopedia of Bernard Zweers. Although trained in Leipzig, Music. 2 Although in its baldness this state Zweers was the first to make a serious bid for ment is correct neither about the lack of an independent nationalistic style, especially composers nor, in this radical form, about the in his Third Symphony, To My Fatherland, of hegemony of French music, it is nevertheless 1890. He was followed closely by Alphons true that the 17th, 18th and 19th centuries Diepenbrock, a composer of large choral and were heavily dominated by foreign compos orchestral works. It was Diepenbrock above ers and performers, with the result that, all who initiated the shift from Germanic to without national content and without inter French influences mentioned above: from national quality, the music of this period is at Wagner to Debussy, and from German Lieder best competent, often only of historical on texts of the Romantics (e.g. Hymnen an die interest. 3 Nacht on texts by Novalis) to vocal works on poems by Baudelaire, Verlaine and Laforgue. -

De Parelduiker. Jaargang 7
De parelduiker. Jaargang 7 bron De parelduiker. Jaargang 7. Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2002 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_par009200201_01/colofon.php © 2014 dbnl i.s.m. 2 [2002/2] Ronald Bos Een oproep van de meester Gisela Dischner over haar geheime liefde met Paul Celan+ ‘Als ik aan Celan denk, denk ik aan hem als nog geen vijftig. Het is voor mij erg vreemd me voor te stellen dat ik hem al twaalf jaar overleefd heb. Ik ben de jongste, ik kan dat eigenlijk helemaal niet denken.’ Dit zegt Gisela Dischner (62), hoogleraar germanistiek in Hannover, als ik in het najaar van 2001 met haar praat over de dichter Paul Celan, met wie zij een tot nu toe geheim gehouden relatie heeft gehad. Een jaar daarvoor heb ik haar leren kennen door de in eigen beheer uitgegeven brieven die zij van augustus 1965 tot begin 1970, een paar maanden voor zijn dood, van Celan ontving. Voor alles wat met Celan samenhangt, interesseer ik me sinds ik begin jaren negentig zijn gedichten leerde kennen. In die tijd bezocht ik, voor een artikel in Het Oog in 't Zeil, zijn geboorteplaats in de Bukowina, op zoek naar het ‘land waarin mensen en boeken wonen’ (Celan). Paul Celan (1920-1970) werd uit joodse ouders geboren in Czernowitz, een Habsburgse stad die nu in de Oekraïne ligt, net over de Roemeense grens. Hij begon als scholier gedichten te schrijven, toen de oorlog zijn leven verwoestte. Terwijl hij in een werkkamp in Roemenië zat, werden zijn ouders door de Duitsers in Transnistrië vermoord. -

Notes Bibliography Index
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/49612 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Teunissen, Petra Title: Voor 't gewone leven ongeschikt. Een biografie van Clare Lennart Issue Date: 2017-06-15 een muur om een uiterst kwetsbaar innerlijk leven. Ze stond vrij weerloos tegenover haar Noten emoties en indrukken, die haar snel overweldigden en tot bijna hysterische uitbarstingen van drift, paniek of verliefdheid konden leiden. Achter de muur van papier en haar INLEIDING EN VERANTWOORDING 1990. De beschreven schrijfsters zijn: Anna pseudoniem waande ze zich echter veilig. In haar werk kon Clare Lennart voldoende 1 Het motto van Weleer, een uitspraak van de Blaman, Jo Boer, Marianne Colijn, Hella S. Tsjechische historicus Frantisek Graus. Haasse, Tonny van der Horst, Dola de Jong, afstand houden. Ze schreef vooral voor zichzelf.109 Om haar verhalen weg te werken uit 2 Telefonische mededeling Aya Zikken, 13 Clare Lennart, Josepha Mendels, Marga Minco, haar hoofd. En om er wat mee te verdienen. Tot haar eigen verrassing hebben veel lezers september 2010. Marie-Sophie Nathusius, Nel Noordzij, Gerdy 3 Jan Romein, De biografie: een inleiding. Pendel, An Rutgers van der Loefff, Annie M.G. zowel haar worsteling met het leven als haar remedie herkend. Tijdens lezingen sprak Amsterdam, 1946. Schmidt, Luisa Treves, Jacoba van Velde, Ellen ze daar opmerkelijk open over en zo versterkte ze haar ‘verbond’ met haar publiek. De 4 Rob Groenewegen, Te leven op duizend Warmond, Sonja Wittstein, Ruth Wolf en Aya plaatsen. Jo Otten 1901-1940. Haarlem, Zikken. Annejet van der Zijl, Anna. Het leven troost van de groene tuin bleek goed overdraagbaar.