Sébastien Goubault Le Chien Dans Les Jeux Vidéo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hansen, Cinema and Experience: Siegfried Kracauer, Walter
Cinema and Experience WEIMAR AND NOW: GERMAN CULTURAL CRITICISM Edward Dimendberg, Martin Jay, and Anton Kaes, General Editors Cinema and Experience Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, and Th eodor W. Adorno Miriam Bratu Hansen UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS Berkeley Los Angeles London University of California Press, one of the most distinguished university presses in the United States, enriches lives around the world by advancing scholarship in the humanities, social sciences, and natural sciences. Its activities are supported by the UC Press Foundation and by philanthropic contributions from individuals and institutions. For more information, visit www.ucpress.edu. University of California Press Berkeley and Los Angeles, California University of California Press, Ltd. London, England © 2012 by Th e Regents of the University of California Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Hansen, Marian Bratu, 1949–2011. Cinema and experience : Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, and Th eodor W. Adorno / Miriam Bratu Hansen. p. cm.—(Weimar and now: German cultural criticism ; 44) Includes bibliographical references and index. isbn 978-0-520-26559-2 (cloth : alk. paper) isbn 978-0-520-26560-8 (pbk. : alk. paper) 1. Motion pictures. 2. Kracauer, Siegfried, 1889–1966—Criticism and interpretation. 3. Benjamin, Walter, 1892–1940—Criticism and interpretation. 4. Adorno, Th eodor W., 1903–1969—Criticism and interpretation. I. Title. PN1994.H265 2012 791.4309—dc23 2011017754 Manufactured in the United States of America 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 In keeping with a commitment to support environmentally responsible and sustainable printing practices, UC Press has printed this book on Rolland Enviro100, a 100 percent postconsumer fi ber paper that is FSC certifi ed, deinked, processed chlorine-free, and manufactured with renewable biogas energy. -

An Exploration of Comics and Architecture in Post-War Germany and the United States
An Exploration of Comics and Architecture in Post-War Germany and the United States A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA BY Ryan G. O’Neill IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY Dr. Rembert Hueser, Adviser October 2016 © Ryan Gene O’Neill 2016 Table of Contents List of Figures……………………………………………………………………………………...……….i Prologue……………………………………………………………………………………….....…1 Introduction………………………………………………………………………………………...8 Chapter 1: The Comic Laboratory…………………………………………………...…………………………………….31 Chapter 2: Comics and Visible Time…………………………………………………………………………...…………………..52 Chapter 3: Comic Cities and Comic Empires………………………………...……………………………...……..…………………….80 Chapter 4: In the Shadow of No Archive…………………………………………………………………………..…….…………114 Epilogue: The Painting that Ate Paris………………………………………………………………………………...…………….139 Works Cited…..……………………………………………………………………………..……152 i Figures Prologue Figure 1: Kaczynski, Tom (w)(a). “Skyway Sleepless.” Twin Cities Noir: The Expanded Edition. Ed. Julie Schaper, Steven Horwitz. New York: Akashic Books, 2013. Print. Figure 2: Kaczynski, Tom (w)(a). “Skyway Sleepless.” Twin Cities Noir: The Expanded Edition. Ed. Julie Schaper, Steven Horwitz. New York: Akashic Books, 2013. Print. Figure 3: Image of Vitra Feuerwehrhaus Uncredited. https://www.vitra.com/de-de/campus/architecture/architecture-fire-station Figure 4: Kaczynski, Tom (w)(a). “Skyway Sleepless.” Twin Cities Noir: The Expanded Edition. Ed. Julie Schaper, Steven Horwitz. New York: Akashic Books, 2013. Print. Introduction Figure 1: Goscinny, René (w), Alberto Uderzo (i). Die Trabantenstadt. trans. Gudrun Penndorf. Stuttgart: Ehapa Verlag GmbH, 1974. Pp.28-29. Print. Figure 2: Forum at Pompeii, Vitruvius Vitrubius. The Ten Books on Architecture. trans. Morris Hicky Morgan, Ph.D., LL.D. Illustrations under the direction of Herbert Langford Warren, A.M. pp. 132. Print. Figure 3: Töpffer, Rodolphe. -

Videogames and Isolation the Galapagos Effect on the Videogame Market
Single Cycle Degree programme in Lingue culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea (LICAAM) ordinamento ex DM 270/2004 Final Thesis Videogames and isolation The Galapagos effect on the videogame market Supervisor Ch. Prof. Patrick Heinrich Assistant supervisor Ch. Prof. Pierantonio Zanotti Graduand Luca D’Angelo Matriculation Number 855677 Academic Year 2017 / 2018 Index Index..................................................................................................................................................... 3 要旨 ...................................................................................................................................................... 4 Introduction .......................................................................................................................................... 6 CHAPTER 1: The world of gaming..................................................................................................... 8 1.1 Origin ......................................................................................................................................... 8 1.2 Golden Age of West and East ................................................................................................... 11 1.3 Old “console wars” ................................................................................................................. 17 1.4 The 1990s ................................................................................................................................. 20 -

Narrative Inheritance: the Facts and Fictions That Shape Our Lives
NARRATIVE INHERITANCE: THE FACTS AND FICTIONS THAT SHAPE OUR LIVES A Thesis submitted to the Faculty of The School of Continuing Studies and of The Graduate School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Liberal Studies By Caroline Jennifer Comport, B.A. Georgetown University Washington, D.C. April 2, 2012 Copyright 2012 by Caroline Jennifer Comport All Rights Reserved ii NARRATIVE INHERITANCE: THE FACTS AND FICTIONS THAT SHAPE OUR LIVES Caroline Jennifer Comport, B.A. Mentor: William J. O’Brien, Ph.D. ABSTRACT The purpose of this thesis is to explore the powerful impulse that drives people of all backgrounds to research their family of origin. In addition to understanding the motivating forces behind genealogical pursuits, this thesis will attempt to answer the following questions: How does who we think we are impact who we become? How is our life story shaped by the stories we believe about our family of origin? How do myth, reality, perception, and meaning influence the way we consciously and unconsciously frame and enact our life story? Does understanding our past give meaning to our present? This research endeavor employs a phenomenological approach to analyze data for meaning and themes. To mine and study this data, the author intentionally embarks on her own genealogical quest and describes the journey from a first-person point of view. The author uses the Comport family as a case study—drawing extensively on the life events of her paternal grandfather, Lionel Frederick Comport. The author chronicles the family’s transformation from 19th century English farmers to 20th century film pioneers. -

Onkel Dagobert“-Zeichners Don Rosa Ist Da!
PRESSEMITTEILUNG Sein Leben, seine Comics: Die lang ersehnte Gesamtausgabe des legendären „Onkel Dagobert“-Zeichners Don Rosa ist da! Berlin, 26.05.2020 – Don Rosa gehört zu den berühmtesten Zeichnern Entenhausens. Die Ducks in der Tradition seines Kindheitshelden Carl Barks zu zeichnen, so sagt er, wäre seit jeher seine Bestimmung gewesen. Seine Comics beweisen dies: schon längst gelten die Abenteuer Don Rosas rund um Onkel Dagobert als Klassiker. Jetzt endlich finden sich alle seine Geschichten mit den Ducks in einer Hardcover-Edition! In dieser neuen, chronologischen Gesamtausgabe sind sämtliche Don Rosa- Geschichten in der vom Künstler bevorzugten Kolorierung und Aufmachung enthalten. Abgerundet wird die Edition durch spannende Hintergrundinformationen, Biografien, Skizzen und Kommentaren des Comic-Zeichners selbst. Dieses auf 10 Bände ausgelegte Gesamtwerk darf in keiner Sammlung fehlen! „Dem Ingenieur ist nichts zu schwör“: Getreu dem Daniel Düsentrieb-Motto begann 1987 die Zeichnerkarriere des gelernten Ingenieurs Don Rosa aus Kentucky, als er erstmals die Gelegenheit bekam, eine Geschichte mit den legendären Ducks von Carl Barks zu zeichnen. Seitdem hat Don Rosa längst selbst den Titel eines legendären Entenzeichner erlangt: Sein schräger Witz, die detailreichen und mit Gags gefüllten Zeichnungen und vor allem seine mit historischen Fakten angereicherten Abenteuergeschichten haben ihm weltweit Fans beschert und machen ihn zu dem beliebtesten lebenden Zeichner Entenhausens. Der erste Band „Der Sohne der Sonne“ erscheint am 04. Juni bei der Egmont Comic Collection (30,00€, ISBN 978-3-7704-4052-8). Band 2 „Zurück ins Land der viereckigen Eier“ folgt am 03. September (30,00€, ISBN 978-3-7704-4053-5). Zusätzlich erscheint ebenfalls am 04. Juni eine gebündelte Schuberausgabe mit den ersten beiden Bänden der „Onkel Dagobert und Donald Duck – Don Rosa Library“ (70,00€, 978-3-7704-4113-6) in begrenzter Stückzahl. -
![[Author's Name]](https://docslib.b-cdn.net/cover/7385/authors-name-1747385.webp)
[Author's Name]
Journal of Social Science Education © JSSE 2008/2009 Volume 7/8, Number 2/1, 2008/09, pp. 119-131 ISSN 1618-5293 Nina Mahrt A Comic Approach to Politics? Political Education via Comics Abstract This article examines juvenile comics that deal with politics as a main topic. These comics introduce and develop politicised themes and topics in varying ways and their individual approaches to politics will be discussed and analysed. The first example, the German Micky Maus-Magazin series, occasionally uses political matters to create new comical stories. In the issues discussed here, democratic processes in the fictional city of Duckburg are described. The second example, Andi, published by the Interior Ministry of the State of North Rhine- Westphalia, aims at civic education. This comic explores the very real issues of rightwing extremism and rightwing propaganda within a fictional framework. The third example, Persepolis treats political issues in a serious, but not primarily pedagogical, way. It offers a personal viewpoint on the Iranian revolution in 1979. By reflecting on Iranian society, the Iranian author puts forward new perspectives on the country which are quite opposite to those that are typically represented in Western countries’ daily news. All three comics provide varying degrees of understanding on politics and political processes. Since each example combines elements of entertainment with political information, they will be analysed within the theoretical framework of what Dörner defines as politainment. Contents 1. Introduction 2. Comic series and politics 2.1 Mayoral elections in Duckburg 2.2 Politics as a topic for young people 3. Political comics aiming at civic education 3.1 Rightwing propaganda at schools 3.2 Comics as reliable sources of information 4. -

1973 Patsy Awards
A HI^L l^k /I A SEPTEMBER/OCTOBER 1973 WNhmDEVOTED TO PET CARE AND WELL-BEING NATIONAL DOG WEEK . - -*»«*> •% * 197 * - t i '£- y PATSY i AWARDS- fcS." I ! 8 • WITH HOWARD A, WEYKER DVM EDITOR'S NOTEBOOK THE AKC TODAY Guest Editorial by John Lafore, Jr. John Lafore, Jr., Philadelphia, is president of the American Kennel Club, regulating agency of the dog fancy in the United States. Following are excerpts from a speech he pre fflffifeiDE sented at a Dog Health Seminar spon sored by the Denver-based Morris Ani Official Journal of the Animal Health Foundation on animal care and health. mal Foundation February 4, 1973, in King of Prussia, Pennsylvania. SEPTEMBER/OCTOBER Volume 4 Number 5 We have recently made some changes in the American Kennel Club. A few have been executed, some are in ARTICLES the stages of execution, and others are still on the drawing board. Animals in Verse Cars ten Ahrens 6 One of the innovations, a new con Deserve To Be Your Dog's Best Friend 10 cept of enforcement and education in New AVMA President 11 the field, may solve some of the Bighorn Sheep in California Charles W. Jenner, D. V.M. 12 problems that worry dog breeders of An Emergency Hospital for Pets Jane H. Bailey 14 America. Canine Stamp Collection Olga Phillips 15 We have established a resident agent On African Safari with Howard A. Weyker, D.V.M. 16 in Iowa, the state which is the second Children's Page 20 largest breeder of commercial puppies Children's Picture Poem Mary B. -

Micky Maus & Donald Duck
SO FINDEN SIE ZU UNS DAS BEGLEITPROGRAMM Tauberbischofsheim Residenzschloss Mergentheim Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten Bad Mergentheim Bf Badweg Unterer Graben selbstständig zu erkunden. asse uerg Mün a zgass e M e er nt MICKY MAUS & FÜHRUNGEN U T örkelgasse Sybille Beyer, Dr. Nicole Scheuerbrandt, Christine Wahl 0 50 100 m Nonnengasse Holzapfelgasse RESIDENZSCHLOSS MERGENTHEIM SCHLOSSPARK DONALD DUCK TERMINE: Eingang Samstag, 5. Juni 14.30 Uhr Sonntag, 8. Aug. 14.30 Uhr Mühlwehrstraße GEZEICHNET VON BARKS, GOTTFREDSON, TALIAFERRO Burgstraße r. Sonntag, 20. Juni 14.30 Uhr Samstag, 21. Aug. 14.30 Uhr r St ime K he a rs p ge u I z in Sonntag, 4. Juli 14.30 Uhr Samstag, 4. Sep. 14.30 Uhr Wettga e sse r st ra Marktplatz ß e Samstag, 24. Juli 14.30 Uhr Sonntag, 19. Sep. 14.30 Uhr se as ng e rk Tü HINWEIS: Für Gruppen nach Vereinbarung buchbar. 22. MAI BIS Diese Führungen können auch für Gruppen von Kindern und Jugend- WEGBESCHREIBUNG 19. SEPT. 2021 lichen gebucht werden und werden von den Referent*innen der Das Schloss ist über die Autobahnen A 3, A 6, A 7 und A 81 sowie die Bundes- Altersgruppe entsprechend angepasst. straßen B 19 und B 290 erreichbar, kostenpflichtige Parkplätze sind in fuß- läufiger Reichweite vorhanden. Fußweg vom Bahnhof zum Schloss ca. 5 bis 7 Die Führungen können stattfinden, sobald die Situation es erlaubt. Minuten. Der Eingang zum Residenzschloss liegt im Inneren Schlosshof. Weitere Informationen unter www.schloss-mergentheim.de ÖFFNUNGSZEITEN KONTAKT UND INFORMATION ANMELDUNG: Telefonisch unter +49(0)79 31. 5 22 12 1. -

COMIC COLLECTION Tel: 030-24008-0 Fax: 030-24008-130
EGMONT Verlagsgesellschaften mbH · Alte Jakobstraße 83 · 10179 Berlin Tel: +49 (0) 30-24008-0 (-DW) · Fax: +49 (0) 30-24008-130 [email protected] | www.egmont.de EGMONT FRÜHJAHR 2020 Ihre Ansprechpartner im Verlag APRIL 2020 BIS SEPTEMBER 2020 VORSCHAU UND GESAMTVERZEICHNIS Regional Sales & Marketing Director, GSA & Denmark Stefan Krogh-Hansen [email protected] COMIC COLLECTION Tel: 030-24008-0 Fax: 030-24008-130 Verkaufsleitung Vertrieb Kundenservice Marketing Comic und Manga Peter Kaboth [email protected] Markus Iking [email protected] [email protected] Tel: 030-24008-133 Tel: 030-24008-142 Fax: 030-24008-130 Fax: 030-24008-130 Verkaufsleitung Schneiderbuch Vertrieb Kundenservice Product Manager & Black Library Olaf Gabriel Rita Koch Ute Plaßmann [email protected] [email protected] [email protected] Tel: 030-24008-132 Tel: 030-24008-426 Tel: 030-24008-136 Fax: 030-24008-130 Fax: 030-24008-130 Außendienst Auslieferungen Außendienst Buchhandel, Schreib- Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Auslieferungen Im Buchhandel vertreten durch: und Spielwaren, Warenhaus (D) Hamburg, Bremen Auslieferung Deutschland Österreich West Günther Pölking-Henkel VVA - arvato Edwin Mayr Bayern, Südtirol, Sachsen, Leher Heerstraße 231 Abt. D6F5 Kreuzweg 24, A-4600 Wels Sachsen-Anhalt, Thüringen 28357 Bremen An der Autobahn 100, Tel: 0664-3912833 Patricia Fuß-Beschta Tel: 0421-4170819 33333 Gütersloh Fax: 07242-910408 Fuß Beschta Verlagsvertretungen Fax: 0421-4170804 Tel: 05241-80-88280 [email protected] Handelsvertretungen CDH [email protected] -

Comics Und Alte Geschichte. Versuch Einer
Historische Sozialkunde Geschichte – Fachdidaktik – Politische Bildung 2/2016 Comics und Alte Geschichte Versuch einer Kontextualisierung Verein für Geschichte und Sozialkunde 46. Jg./Nr. 2 April–Juni 2016 AU ISSN 004-1618 Historische Sozialkunde. Geschichte – Fachdidaktik – Politische Bildung. Zeitschrift für Lehrerfortbildung. Inhaber, Herausgeber, Redaktion: Verein für Geschichte und Sozialkunde (VGS) in Kooperation mit dem Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien. Chefredaktion: Eduard Fuchs/Andrea Schnöller (Wien) Fachdidaktik: Zentrale Arbeitsstelle für Geschichtsdidaktik und Politische Bildung, FB Geschichte/ Universität Salzburg, Rudolfskai 42, 5020 Salzburg ([email protected]) Preise Jahresabonnement o 17,– (Studenten o 12,50), Einzelheft o 6,–, Sondernummer o 7,– zuzügl. Porto. Bankverbindungen: Raiffeisenbank Oberes Waldviertel eGen IBAN AT21 3241 5000 02424570, BIC RLNWATWWOWS Herausgeber (Bestelladresse): Verein für Geschichte und Sozialkunde, c/o Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien, Universitätsring 1, A-1010 Wien Tel.: +43-1-4277/41330 (41301), Fax: +43-1-4277/9413 Aboverwaltung: +43-1-4277/41330 (Marianne Oppel) E-mail: [email protected] http://vgs.univie.ac.at Trotz intensiver Bemühungen konnten nicht alle Inhaber von Text- und Bildrechten ausfindig gemacht werden. Für entsprechende Hinweise ist der Verein für Geschichte und Sozialkunde dankbar. Sollten Urheberrechte verletzt worden sein, werden wir diese nach Anmeldung berechtigter Ansprüche abgelten. Titelbild: Wandbild des Malers der Grabkammer des Ramose, Theben (ca. 1411–1375 v. Chr.). Bildquelle: https://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/8/89/Maler_der_Grabkammer_des Ramose_001.jpg (bearbeiteter Ausschnitt) Heftredaktion: Wolfgang Hameter Layout/Satz: Marianne Oppel AutorInnen: Stefan Brenne, Dr., Promotion in Alter Geschichte in Tübingen, seit 2005 Leitung der medienpädagogischen Arbeitsstelle, FB 04 der Justus-Liebig-Universität Gießen. -

Entenhausen›››› Oberhausen››››
LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen Konrad-Adenauer-Allee 46 ∙ 46049 Oberhausen ENTENHAUSEN›››› Info-Line und Buchungen: 0208 41249 28 Fax: 0208 41249 13 OBERHAUSEN›››› [email protected] Öffnungszeiten: Di–So 11–18 Uhr, Mo geschlossen, 3. Okt. geöffnet, 24., 25., 31. Dez. und 1. Jan. geschlossen Eintritt: 8 €, ermäßigt 4 €, Familien 12 € Kombiticket mit dem Gasometer Oberhausen 13 € Öffentliche Führungen: Sonn- und feiertags 11.30 Uhr Kostenlos in Verbindung mit dem Museumseintritt Führungen: 45 € in Verbindung mit dem ermäßigten Eintritt für Gruppen von 4 € pro Person Schulführungen: 20 € plus 1 € je SchülerIn Anfahrt: Mit dem Niederflurbus ab Hbf Oberhausen Linie 956, Richtung Oberhausen Goerdelerstraße oder Linie 966, Richtung OB Sterkrade Bf, Ausstieg Schloss Oberhausen Mit dem Auto über die A 42, Ausfahrt Oberhausen Zentrum, nach 200 m rechts oder über die A 40, Ausfahrt Mülheim Styrum, Titel: Sonntagsseite, (Detail)©Al 9.6.1946 Taliaferro/Courtesy Sammlung Reichelt und Brockmann Mannheim B 223 bis Schloss Oberhausen; Nähe CentrO und Gasometer Zur Ausstellung erscheint ein Booklet mit einem Text von Christine Vogt, 16 Seiten, 4 €. Donald, 1960er Jahre © Carl Barks/Courtesy Sammlung Reichelt und Brockmann Mannheim www.ludwiggalerie.de Mittwoch, 19. Oktober 2016, 15 bis 18 Uhr ▶ Don Rosa Signierstunde mit dem amerikanischen Dagobert Duck-Zeichner Die Veranstaltung ist kostenlos in Verbindung mit dem Museumseintritt. Sonntag, 27. November 2016 um 14 Uhr donald, Micky and friends gezeichnet in der disney factory von Wir schaffen das ! ▶ Ulrich Schröder carl Barks, floyd Gottfredson und al Taliaferro sowie Der deutsche Zeichner führt zu seiner Micky Maus! Politische Karikaturen von Waldemar Mandzel, Mit anschließender Signiermöglichkeit Thomas Plaßmann und Heiko Sakurai Jan Gulbransson, don rosa und Ulrich schröder Die Veranstaltung ist kostenlos in Verbindung mit dem Museumseintritt. -
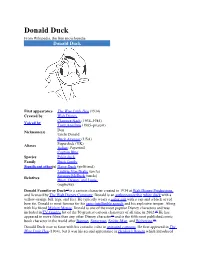
Donald Duck from Wikipedia, the Free Encyclopedia Donald Duck
Donald Duck From Wikipedia, the free encyclopedia Donald Duck First appearance The Wise Little Hen (1934) Created by Walt Disney Clarence Nash (1934–1985) Voiced by Tony Anselmo (1985–present) Don Nickname(s) Uncle Donald Duck Avenger (USA) Superduck (UK) Aliases Italian: Paperinik Captain Blue Species Pekin duck Family Duck family Significant other(s) Daisy Duck (girlfriend) Ludwig Von Drake (uncle) Scrooge McDuck (uncle) Relatives Huey, Dewey, and Louie (nephews) Donald Fauntleroy Duck[1] is a cartoon character created in 1934 at Walt Disney Productions and licensed by The Walt Disney Company. Donald is an anthropomorphic white duck with a yellow-orange bill, legs, and feet. He typically wears a sailor suit with a cap and a black or red bow tie. Donald is most famous for his semi-intelligible speech and his explosive temper. Along with his friend Mickey Mouse, Donald is one of the most popular Disney characters and was included in TV Guide's list of the 50 greatest cartoon characters of all time in 2002.[2] He has appeared in more films than any other Disney character[3] and is the fifth most published comic book character in the world after Batman, Superman, Spider-Man, and Wolverine.[4] Donald Duck rose to fame with his comedic roles in animated cartoons. He first appeared in The Wise Little Hen (1934), but it was his second appearance in Orphan's Benefit which introduced him as a temperamental comic foil to Mickey Mouse. Throughout the 1930s, '40s and '50s he appeared in over 150 theatrical films, several of which were recognized at the Academy Awards.