Rapport Pdl Moidja Hamamet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Centre Souscentreserie Numéro Nom Et Prenom
Centre SousCentreSerie Numéro Nom et Prenom MORONI Chezani A1 2292 SAID SAMIR BEN YOUSSOUF MORONI Chezani A1 2293 ADJIDINE ALI ABDOU MORONI Chezani A1 2297 FAHADI RADJABOU MORONI Chezani A4 2321 AMINA ASSOUMANI MORONI Chezani A4 2333 BAHADJATI MAOULIDA MORONI Chezani A4 2334 BAIHAKIYI ALI ACHIRAFI MORONI Chezani A4 2349 EL-ANZIZE BACAR MORONI Chezani A4 2352 FAOUDIA ALI MORONI Chezani A4 2358 FATOUMA MAOULIDA MORONI Chezani A4 2415 NAIMA SOILIHI HAMADI MORONI Chezani A4 2445 ABDALLAH SAID MMADINA NABHANI MORONI Chezani A4 2449 ABOUHARIA AHAMADA MORONI Chezani A4 2450 ABOURATA ABDEREMANE MORONI Chezani A4 2451 AHAMADA BACAR MOUKLATI MORONI Chezani A4 2457 ANRAFA ISSIHAKA MORONI Chezani A4 2458 ANSOIR SAID AHAMADA MORONI Chezani A4 2459 ANTOISSI AHAMADA SOILIHI MORONI Chezani D 2509 NADJATE HACHIM MORONI Chezani D 2513 BABY BEN ALI MSA MORONI Dembeni A1 427 FAZLAT IBRAHIM MORONI Dembeni A1 464 KASSIM YOUSSOUF MORONI Dembeni A1 471 MOZDATI MMADI ADAM MORONI Dembeni A1 475 SALAMA MMADI ALI MORONI Dembeni A4 559 FOUAD BACAR SOILIHI ABDOU MORONI Dembeni A4 561 HAMIDA IBRAHIM MORONI Dembeni A4 562 HAMIDOU BACAR MORONI Dembeni D 588 ABDOURAHAMANE YOUSSOUF MORONI Dembeni D 605 SOIDROUDINE IBRAHIMA MORONI FoumboudzivouniA1 640 ABDOU YOUSSOUF MORONI FoumboudzivouniA1 642 ACHRAFI MMADI DJAE MORONI FoumboudzivouniA1 643 AHAMADA MOUIGNI MORONI FoumboudzivouniA1 654 FAIDATIE ABDALLAH MHADJOU MORONI FoumbouniA4 766 ABDOUCHAKOUR ZAINOUDINE MORONI FoumbouniA4 771 ALI KARIHILA RABOUANTI MORONI FoumbouniA4 800 KARI BEN CHAFION BENJI MORONI FoumbouniA4 840 -

Les Grands Comoriens a Tananarive Et La Divination : Cas Etudie : Les Devins D’Ambodin’Isotry
1 Université d’Antananarivo Faculté de droit, d’économie, de gestion et de sociologie Départem ent :Sociologie Année universitaire : 2002-2003 LES GRANDS COMORIENS A TANANARIVE ET LA DIVINATION : CAS ETUDIE : LES DEVINS D’AMBODIN’ISOTRY Mémoire de maîtrise Présenté et soutenu par : Monsieur HASSANI Karani Président : Monsieur RAMANDIMBIARISON Jean Claude Juges : Madame ANDRIANAIVO Victorine et Monsieur RATSIMBAZAFY Bède Rapporteur : Monsieur RATSIMBAZAFIMAHEFA Patrice Date de soutenance : 10 Mai 2003 2 REMERCIEMENTS Au terme de ce mémoire, nous voudrions remercier Allah de nous avoir donné l'audace, le courage et la santé d'entreprendre cette étude dans les meilleures conditions. Cependant, j'adresse mes vifs remerciements : - A Monsieur le Doyen de la faculté de droit, d'économie, de gestion et de sociologie d'avoir accepté et toléré les étudiants comoriens dont je fais parti d'être membre intégrant de cette faculté ; - Au chef du Département Sociologie qui m'a traité avec bienveillance en m'offrant la chance d'aborder ce travail ingénieux ; - Aux corps enseignants d'avoir assuré régulièrement nos cours jusqu'à faire ce que je suis aujourd'hui ; - A mon professeur encadreur en l'occurrence de Monsieur RATSIMBAZAFIMAHEFA Patrice. Mes remerciements vont également aux personnels de notre départements sociologie ayant la sympathie de nous traiter avec sagesse, avec générosité et avec indulgence et qui a été fertile et féconde. Enfin, nos remerciements vont : - Aux devins en général ayant accepté de nous confier leurs secrets et contribué massivement à la réalisation de ce travail ; - A mes parents ayants souffert pendant des longues années pour m'éduquer et faire de moi un érudit ; - A mes frères qui ont contribué et investi durant mes études universitaires ; - A mes amis qui m'ont encouragé pendant les moments les plus compliqués de ma vie universitaire ; - A ma femme Fanja qui m'a aidé et soutenu pendant mes études. -

Arret N°16-016 Primaire Ngazidja
H h ~I'-I courcon5t~liorwr~ UNION DES COMORES Olll\;I\IHliWif,!' Unité - Solidarité - Développement ARRET N° 16-016/E/P/CC PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DE L'ELECTION PRIMAIRE DE L'ILE DE NGAZIDJA La Cour constitutionnelle, VU la Constitution du 23 décembre 200 l, telle que révisée; VU la loi organique n° 04-001/ AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour constitutionnelle; VU la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique n° 14-016/AU du 26juin 2014; VU la loi organique n° 05-009/AU du 04 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du Président de l'Union et les modalités d'application de l'article 13 de la Constitution, modifiée par la loi organ ique n? 10-019/ AU du 06 septembre 2010 ; VU la loi n° 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral; VU le décret n° 15- 184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles autonomes; VU l'arrêt n? 16-001 /E/CC du 02 janvier 2016 portant liste définitive des candidats à l'élection du Président de l'Union de 2016; VU l'arrêté n° 15- 130/MIIDIICAB du 01 décembre 2015 relatif aux horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles Autonomes; VU le circulaire n? 16-037/MIIDIICAB du 19 février 2016 relatifau vote par procuration; VU la note circulaire n° 16-038/MIIDIICAB du 19 février -

Remerciements
SOWO LA MKOßE signifie « voie publique » en shikomor ancien. YA MKOßE est le nom du premier fe (doyen d’un clan et magistrat d’une chefferie) à avoir aménagé et entretenu des chemins pour relier les villages de la côte Est de Ngazidja entre Malé et Hantsindzi. Damir BEN ALI REMERCIEMENTS Ce numéro de ya mkoþe est le fruit d'un partenariat modèle développé entre deux institutions scientifiques, le CNDRS (Centre National de Docu- mentation et de Recherche Scientifique, Moroni) et le LACITO du CNRS (UMR 7107 “Langues et Civilisations à Tradition Orale”), Paris. L’appui financier du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l’Ambassade de France à Moroni a permis la formation d'une secrétaire d'édition, sous la direction de Madame Françoise LE GUENNEC-COPPENS et l’encadrement technique de Madame Françoise PEETERS, respectivement chercheur et ingénieur au LACITO, ainsi que l'acquisition d'un équipement informatique en vue de l’édition de nos prochains numéros. Par l'intérêt qu'il a toujours témoigné à l'égard de la recherche et du développement, Monsieur Gérard SOURNIA, chef de Service de Coopération, a joué un rôle clef dans l’octroi des subventions nécessaires à la réalisation de ce projet. Je lui adresse mes plus chaleureux remerciements. Nous remercions également KomEdit pour son travail de promotion et de diffusion de la revue. Enfin que Mohamed AHMED-CHAMANGA accepte notre reconnaissance pour son aide bienveillante et désintéressée. ya mkoþe est publié par le Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique des Comores (CNDRS), sous la direction du Directeur Général de l’Institution. -

La Commune Inaugurée Avec Succès
« Aime la vérité, mais pardonne à l’erreur » Voltaire La lecture pour les conscients futurs. Première année N°2- du Mercredi 16 Juillet 2014 Prix : 500fc . L’Enfant du Kalam, l’enfant mal aimé NYUMAMDRO HAMAHAMET, Comment redonner ou donner un éclat à ce journal ? La commune inaugurée avec succès. Des réflexions et des réunions se succèdent du levé au couché du soleil d’un jour à l’autre pour réfléchir à des actions visant à donner une bonne image à ce journal et à faire impliquer tout le monde à se sentir responsable. Certaines ont suggéré la publication du journal tous les mois, les trois mois, chaque semaine alors on se met d’accord à la publication dès que possible. Oui nous sommes ôtés de moyens appropriés. Le journal est délaissé du grand public, peu sont ceux qui nous encourage et qui apprécie une telle initiative. Beaucoup des personnes compétentes qui ont l’art d’écrire et qui pourront faire mieux que nous ne s’intéressent pas de ce journal et refusent à nous rejoindre. C’est le 2 constant fait dès l’apparition de notre première édition le mois de Mai. On risque à des publications irrégulières, SPORT : manque de moyens et de ressources humaines à nous soutenir, le journal est pour certains une bonne idée, mais beaucoup sont ceux qui nous critiquent. ère A un mois de la 1 publication la liste des problèmes est longue : manque des rédacteurs intéressés, pas d’ordinateur ni appareil photo, pas des abonnés… tous ces problèmes sont au cœur de nos débats et de nos discussions. -

Communauté De Simboussa Badjini
UNION DES COMORES __________ ILE AUTONOME DE LA GRANDE - COMORE ___________ CREDIT / IDA 3868 - COM Fonds d'Appui au Développement Communautaire (FADC) Secrétariat Exécutif Régional BP 2494 – Moroni – Quartier Mahandi - Bd Karthala Tél. : (269) 73 28 89/73 28 78 - Fax : 73 28 89 Email : [email protected] ______________________________________________________ Communauté de Simboussa Badjini P LAN DE D EVELOPPEMENT L OCAL 2010 – 2015 1 Sommaire Chapitre I : Introduction : Chapitre II : Résumé du rapport Chapitre III : Analyse des données socio - économiques 1. Localisation 2. Aperçu historique 3. Situation Administrative 4. Situation Démographique 5. Organisations Sociales 6. Les Organisations extérieures opérantes dans le village 7. Environnement 8. La situation des services sociaux et des infrastructures de base 9. Activités économiques Chapitre IV : Plan d’investissement du village 10. Le plan quinquennal d’investissement du village ANNEXES Annexe 1 : Fiches de collecte de données socio - économiques Annexe 2 Les abré viations Annexe 3 : Adresses des partenaires au développement 2 I NTRODUCTION 1 - C ONTEXTE GENERAL Ce document est le rapport sur le Plan de Développement Local (PDL) de la communauté de Simboussa. C’est un village situé dans la région de Badjini dans la préfecture du Sud Est de l’île Autonome de la Grande - Comore. Ce document est le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données socio - économiques du village qui a réuni toutes les différentes couches sociales : jeunes, femmes, homme s, notables et personnes vulnérables. Le travail a été fait 3 mois durant et consist ait à identifier et analyser secteur par secteur les potentialités, les contraintes et à dégager les solutions pour relever le défi en matière de développement communautair e. -

World Bank Document
Document of The World Bank Public Disclosure Authorized Report No. 20990 - COM PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ONA PROPOSED CREDIT Public Disclosure Authorized IN THE AMOUNT OF SDR8.8. MILLION (US$11.4 MILLION EQUIVALENT) TO THE ISLAMIC FEDERAL REPUBLIC OF THE COMOROS FOR AN INFRASTRUCTURE, WATER AND ENVIRONMENT PROJECT FEBRUARY 2,2001 Public Disclosure Authorized AFTTR AFC08 AfricaRegional Office Public Disclosure Authorized CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective 12/31/00) SDR 1.00 = US$1.3047 Currency Unit = Comorian franc (KMF) US$1.00 = KMF 550 KMF 1.00 = US$0.001818 FISCAL YEAR January 1-December 31 SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES 1 meter (m) = 3.28 feet I hectare (ha) 2.47 acres 1 kilometer (km) = 0.625 miles I liter 0.220 imperial gallons 1 cubic meter = 220 imperial gallons Vice President: Callisto Madavo Country Director: Hafez M. H. Ghanem Sector Manager: Maryvonne Plessis-Fraissard Team Leader: Abdelmoula Ghzala ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AFD Agence Fran9aise de Developpement CAS country assistance strategy CEE Comorienne de l'Eau et de l'Electricite DERM Direction de l'Energie et de Ressources Min6rales (Directorate of Energy and Mining) DGI Direction Generale des Infrastructures (General Directorate of Infrastructure) DGTP Direction Generale des Travaux Publics (Directorate General of Public Works) DRTP Direction Regionale des Travaux Publics (Regional Directorate of Public Works) DRI Direction Regionale des Infrastructures (Regional Directorate of Infrastructure) DU Direction de l'Urbanisme (Directorate of Urban Affairs) -

Plan National De Developpement Sanitaire 2010-2014
UNION DES COMORES ور ا ر ادة Unité – Solidarité – Développement ودة - ن - -------------- -------------- Ministère de la Santé, de la Solidarité وزارة ا وا ن ور ارأة et de la Promotion du Genre PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 2010-2014 Avril 2010 0 Abréviations et Acronymes ACT Combinaison thérapeutique à base d’artémisinine AFD Agence française de développement ASCOBEF Association comorienne du bien être familial BCG Bacile de Calmette-Guérin BID Banque islamique de développement CA Conseil d’administration CARITAS Réseau Caritatif de France -Secours catholique CCC Communication pour le changement de comportement CDAG Centre de dépistage volontaire CHN Centre hospitalier national CHR Centre hospitalier régional CIM Classification International des Maladies CNS Comité national de santé COI Commission de l’océan indien CPN Consultation pré -natale CSD Centre de santé de district CMC Centre médico-chirurgical CSM Centre de santé militaire CTNS Comité technique national de santé DAF Directeur administratif et financier DEPSS Directeur des études, de la planification et des statistiques sanitaires DGS Direction générale de la santé DNS Direction nationale de la santé DTC Diphtérie-tétanos-coqueluche DTC HépB Diphtérie-tétanos-coqueluche-hépatite B EDS Enquête démographique et de santé EVF Education à la Vie Familiale FEMES Traitement de masse à base d’artémisine FM Fonds mondial GATPA Gestion active de travail et preparation à l’accouchement GAVI Global alliance for vaccines and immunization - GPS Geographical Positioning System -

COMOROS Swashbuckling Adventure You’Ve Beencraving
© Lonely Planet Publications 234 lonelyplanet.com GRANDE COMORE •• History 235 Aside from being the largest island at GRANDE COMORE 60km by 20km, Grande Comore is also the Comoros most economically developed of the three pop 360,000 independent islands that make up the Union The biggest (and most politically bullying) des Comores. Grande Comore (known as of the three islands, Grande Comore is also Ngazidja by the Comorians) wields the most dominated by the largest active volcano in political power of the three islands from the the world, Mt Karthala (2360m) – over the seat of its handsome main town, Moroni. The Haphazardly scattered across the Indian Ocean, the mysterious, outrageous and enchanting last 200 years it has consistently erupted once island is fringed by solidified lava and sandy Comoros islands are the kind of place you go to just drop off the planet for a while. Far every 11 years on average. The last eruption beaches of various hues, where brilliant white removed from the clutter that comes with conventional paradises – sprawling hotels, neon spewed lava for a full 14 days in December meets dark volcanic grey and molten black. discos – the Comoros are so remote even an international fugitive could hide out here. 2005. It flattened villages, contaminated What little agricultural land is still available drinking water and killed at least one child. is found in the south, where there are ba- COMOROS Rich in Swahili culture, and devoutly Muslim, the charming inhabitants come from a This came on the heels of the tourism crisis of nana, breadfruit, cassava, vanilla, ylang-ylang legendary stock of Arab traders, Persian sultans, African slaves and Portuguese pirates. -

Rapport Pdl Moidja Mboudé
UNION DES COMORES __________ ILE AUTONOME DE LA GRANDE-COMORE ___________ CREDIT / IDA 3868-COM Fonds d'Appui au Développement Communautaire (FADC) Secrétariat Exécutif Régional BP 2494 Moroni/Magoudjou - Bd Said Mohamed Cheikh Tél. : (269) 73 28 89/73 28 78 - Fax : 73 28 89 Email : [email protected] ______________________________________________________ Communauté de MOIDJA/MBOUDE PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL 2006 – 2010 Résumé du rapport Ce document est le rapport sur le Plan de Développement Local (PDL) de la communauté de Moidja. C’est un village situé dans la région de Mboudé et qui appartient à la préfecture de Mboudé/Mitsamiouli dans l’île Autonome de la Grande-Comore. Ce document est le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données socio-économiques du village qui a réuni toutes les différentes couches sociales : jeunes, femmes, hommes, notables et personnes vulnérables. Le travail a été fait 7 jours durant et consiste à identifier et analyser secteur par secteur les potentialités, les contraintes et à dégager les solutions pour relever le défi en matière de développement communautaire. Il comporte quatre grande parties : une première partie porte sur la justification, la méthodologie du PDL. La deuxième partie porte sur la présentation du village et l’organisation socioculturelle. La troisième partie est consacrée à l’analyse des potentialités, des problèmes et des solutions ainsi qu’à l’établissement d’un plan d’investissement du village et la quatrième partie contient les fiches d’analyse réalisées par les groupes sociaux qui ont participé à l’élaboration du présent document. Ce plan de développement local est conçu pour servir de document de référence pour toute action de développement à entreprendre au village. -
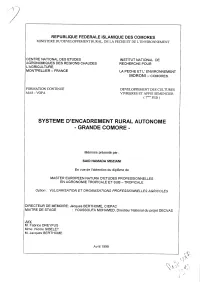
Systeme D'encadrement Rural Autonome - Grande Comore
REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL, DE LA PECHE ET DE L'ENVIRONNEMENT CENTRE NATIONAL DES ETUDES INSTITUT NATIONAL DE AGRONOMIQUES DES REGIONS CHAUDES RECHERCHE POUR L'AG RI CUL TURE, MONTPELLIER - FRANCE LA PECHE ET L'ENVIRONNEMENT MORONI - COMORES. FORMATION CONTINUE DEVELOPPEMENT DES CULTURES MAS - VOPA VIVRIERES ET APPUI SEMENCIER (7°1110 FED) SYSTEME D'ENCADREMENT RURAL AUTONOME - GRANDE COMORE - Mémoire présenté par: SAlO HAMADA MDZIANI En vue de l'obtention du diplôme de MASTER EUROPEEN NATURA D'ETUDES PROFESSIONNELLES EN AGRONOMIE TROPICALE ET SUB - TROPICALE Option: VULGARISA TlON ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES DIRECTEUR DE MEMOIRE: Jacques BERTHOME, CIEPAC MAITRE DE STAGE : YOUSSOUFA MOHAMED, Directeur National du projet DECVAS ~ M. Fabrice DREYFUS Mme. Nicole SIBELET M. Jacques BERTHOME Avril 1999 / REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL, DE LA PECHE ET DE L'ENVIRONNEMENT CENTRE NATIONAL DES ETUDES INSTITUT NATIONAL DE AGRONOMIQUES DES REGIONS CHAUDES RECHERCHE POUR L'AG RI CUL TURE, MONTPELLIER - FRANCE LA PECHE ET L'ENVIRONNEMENT MORONI- COMORES. FORMATION CONTINUE DEVELOPPEMENT DES CULTURES MAS - VOPA VIVRIERES ET APPUI SEMENCIER (7eme FED) SYSTEME D'ENCADREMENT RURAL AUTONOME - GRANDE COMORE - Mémoire présenté par: SAlO HAMADA MDZIANI En vue de l'obtention du diplôme de MASTER EUROPEEN NATURA D'ETUDES PROFESSIONNELLES EN AGRONOMIE TROPICALE ET SUB - TROPICALE Option: VULGARISATION ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES DIRECTEUR DE MEMOIRE: Jacques BERTHOME, CIEPAC MAITRE DE STAGE : YOUSSOUFA MOHAMED, Directeur National du projet DECVAS ~ M. Fabrice DREYFUS Mme. Nicole SIBELET M. Jacques BERTHOME Avril 1999 RESUME Notre étude a été réalisée dans le cadre du projet de Développement des Cultures Vivrières et d'Appui Semencier (DECVAS), du Ministère de Développement Rural de la Pêche et de l'Environnement, sur l'île de la Grande Comore, plus grande île de l'archipel des Comores. -

Ministère Du Plan, De L'aménagement Du Territoire
UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement ----------------------------- MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PLAN ----------------------------- COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN Direction Nationale du Recensement ------------------------------ pauvreté aux comores « Analyse des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2003 » Rédigé par : NAILANE MHADJI Statisticien Moroni, juin 2007…….. Sommaire INTRODUCTION ..................................................................................................................... 4 I.1 Objectifs de l’étude ............................................................................................................ 6 I.2 Contexte national et importance du sujet .......................................................................... 7 II. Méthodologie et Concepts .................................................................................................. 7 II.1 Définitions ........................................................................................................................ 7 II.2 Méthodologie d’analyse ................................................................................................... 8 II.2.1 Construction de l’indice composite de la pauvreté ....................................................... 8 III. Caractéristiques des principales variables ....................................................................... 9 III.1 éducation ........................................................................................................................