Préalpes Vision 2030 Rapport Final
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fribourg Region the Leisure Activities and Discoveries Guide Welcoming Delicious Unexpected 2019
FRIBOURG REGION THE LEISURE ACTIVITIES AND DISCOVERIES GUIDE WELCOMING DELICIOUS UNEXPECTED 2019 THE UNEXPECTED THE NOCTURNAL ADVENTURES OF BEAVERS EXPERIENCE i'VE EXPERIENCED: AN EXTRAORDINARY ADVENTURE PASSION KEEPING WALKERS ON THE RIGHT TRACK... ALONG 1800 KM OF PATHWAYS! www.fribourgregion.ch 2 FRIBOURG REGION IT'S DZ¡N ! Discover unique activities and inspiring encounters with local MEADOWS: people. Create memories NATURE’S as a group or individual, TREASURES for children and adults alike. www.dzin.ch PAGE 4 CONTENTS Meadows: nature’s treasures ........................ 4 Hiking in Fribourg Region, Aline Hayoz-Andrey accompanies amateur botanists the joy factor! ................................................ 20 I've experienced: an extraordinary Life is a beautiful walk ...................................22 adventure ....................................................... 8 The Trans Swiss Trail, a shared long-distance project Jean-Claude Pesse perpetuates an ancestral tradition Keeping walkers on the right track... “The philosophical sweeper” .......................10 along 1800 km of pathways! ...................... 26 Interview with Michel Simonet on the streets of Fribourg The diligent professionals who maintain the waymarks The nocturnal adventures Valuable advice from Bruno Jelk ................ 28 of beavers ....................................................... 14 A leading expert on safety in the mountains Nature and people get along together in the Grande Cariçaie A visit to Romont that’s full of surprises ....................................................32 -

Le Creux Des Tables Facile MATÉRIEL CONSEILLÉ BUTS DES TOURING TRACKS IMPORTANT Le Bivouacmoyen
TOURING TRACKS powered by BUTS DES TOURING TRACKS 1 Le Creux des Tables facile Durée: 2h ● Permettre la pratique de la randonnée à skis DEGRÉS DE DANGER D’AVALANCHE 1600 Montée totale: 435m Le Pralet ● Offrir un terrain d’entraînement à tous les skieurs, 1500 Descente totale: 434m du débutant à l’alpiniste chevronné ainsi qu’aux 1400 Point le plus bas: 1130m En général, conditions sûres. randonneurs adeptes de la compétition. 1 1300 Point le plus haut: 1559m 1200 ● Proposer une expérience sportive dans le respect 1100 de l’environnement 2 Conditions favorables dans la plupart des cas. La prudence est 6.41 km ● Faciliter la cohabitation entre le ski alpin et le ski de randonnée surtout conseillée lors de passages sur des pentes raides aux expositions et altitudes indiquées dans les bulletins. IMPORTANT 3 Conditions partiellement défavorables. L'appréciation du danger 2 Le Bivouac moyen Durée: 5h52 ● Itinéraires non-sécurisés et non-surveillés d'avalanche demande de l'expérience. Il faut éviter autant que 1600 Montée totale: 1171 m possible les pentes raides aux expositions et altitudes indiquées Le Pralet ● L’Office du Tourisme des Paccots et la Région et Movement Skis 1500 Descente totale: 1165 m dans les bulletins. 1400 Point le plus bas: 912 m déclinent toutes responsabilités en cas d’accident. Merci de respecter 1300 Point le plus haut: 1551 m les consignes de sécurité. 4 Conditions défavorables. L'appréciation du danger d'avalanche 1200 demande beaucoup d'expérience. Il faut se limiter aux terrains 1100 MATÉRIEL CONSEILLÉ peu raides et prendre en considération les zones de dépôt 1000 d'avalanches. -
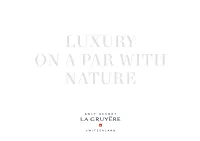
S W I T Z E R L A
LUXURY ON A PAR WITH NATURE SWITZERLAND LUXURY REAL ESTATE PRIVATE RESIDENCES SWITZERLAND GERMANY BASEL ZÜRICH AUSTRIA BIEL FRANCE LUZERN NEUCHÂTEL BERN CHUR FRIBOURG DAVOS INTERLAKEN PONT-LA-VILLE LAUSANNE GRUYÈRES GSTAAD ST. MORITZ MONTREUX SION GENEVA ASCONA VERBIER LUGANO MARTIGNY ZERMATT ITALY NATURE NATURE IN ITS PUREST FORM In the immediate vicinity of the famous village of Gruyères, as well as being close to Gstaad, Charmey, and les Diablerets, the new Golf Resort La Gruyère is blessed with endless charm. The surrounding scenery is truly exceptional. Nature has generously adorned it with all the splendours of its setting. Set between Lake Gruyère and the hilly landscape, this authentic countryside proudly preserves its ancestral village culture. Pastures and woodlands follow one another as far as the eye can see, crowned on the horizon by the peaks of the Fribourg Pre-Alps. A UNIQUE RESORT IN FRENCH-SPEAKING SWITZERLAND AT THE GOLF RESORT LA GRUYÈRE, A PRESTIGIOUS PROJECT OF LUXURY RESIDENCES IS BEING CREATED, HARMONIOUSLY INTEGRATED INTO A REMARKABLY WELL-PRESERVED NATURAL ENVIRONMENT: - sumptuous apartments from 2.5 to 5.5 rooms, and penthouses with vast terraces, all perfect as main or secondary residences - a 5-star hotel featuring hotel residences - a 2000 m2 wellness spa, with unique treatment programmes - a full array of culinary delights in three restaurants with menus offering great variety; a gourmet restaurant, a hotel brasserie, and La Ferme offering Gruyerian specialities - a private beach club by the lake - state-of-the-art infrastructure for organising seminars - a concierge service located at the entrance of the Resort, offering first class security and surveillance 24/7 - a world-class 18-hole golf course, redesigned by Robert Trent Jones Jr. -

Niremont, HB/FR-033
Niremont, HB/FR-033 January 8, 2014 Paul, HB9DST Summary: An easy hike in any snow conditions, but today with a special guest. Today was a very special SOTA activation for me. Toni, for the first time on snowshoes, accompanied me up to Niremont (HB/FR-033). And who knows if we'll ever be able to do something like this again together? Conditions were great: warm temperatures about 5 C, sunny and a well-packed snowshoe trail the entire way up to the summit. Perfect for a beginner. The hike up the 400 meters of elevation along a distance of 5.5 km took a tad over 2 hours. It's an easy hike with no dangerous grades anywhere on the trail, no matter how much snow. Because it has been so warm recently, I was at first worried we wouldn't have any snow at all -- but we did have more than enough to make things interesting. Toni mastered the snowshoes quickly, had a great time and particularly enjoyed the scenery. On the way home, we stopped and bought some local cheese named after the summit (Niremont); the special thing about it is that the wheel of cheese is bound in spruce bark. Finding that cheese was a special end to a wonderful day. I spent time on 40 and 30 meters, made roughly 30 contacts, one S2S (to DM/TH-003). Following the well-packed snowshoe trail. The snowshoe trail is well marked throughout. There is a parking lot near Moillertson for those who drive. Father/daughter SOTA team (only he has a license, though). -

Hotels Which Have Asked to Be Souhaité Y Figurer Et Les Informations Qu’Il Contient Sont Haben
www.fribourgregion.ch 9 0 HOTELS 0 Guide / Führer / Guide 2 online booking • www.fribourgregion.ch La région des Lacs Die Seenregion The Lakes Region Localité Page Ortschaft Seite Place Page Neuchâtel Mont Vully Avry-devant-Pont 4 Kerzers Bösingen 13 Sugiez Bern Broc 4 Lugnorre Praz Bulle 5 Laupen Bern Charmey 6 Portalban Cousset 18 Murten Crésuz 6 Düdingen 13 Bösingen Estavayer-le-Lac – Lully 18 Münchenwiler Fribourg 14 Avenches Ueberstorf Granges-Paccot 16 Düdingen Gruyères 7 Lugnorre – Vully 19 Granges-Paccot Estavayer-le-Lac Givisiez Schwarzenburg Marly 16 Moléson-s/Gruyères 8 Cousset Tafers Montbovon 8 Lully Fribourg et le centre Morlon 9 Payerne FRIBOURG Freiburg und das Zentrum Münchenwiler 19 Yverdon Marly Fribourg and the Centre Murten 20 Lausanne Neyruz 16 Neyruz Plaffeien Paccots (Les) 9 Rossens Pâquier (Le) 10 Plaffeien 10 Romont Pont-la-Ville 10 Portalban 19 Avry-devant-Pont Pont-la-Ville Praz – Vully 21 Romont 16 Schwarzsee Rossens 10 Schwarzsee 11 Morlon Spiez Siviriez 17 Siviriez Crésuz Sugiez – Vully 22 Bulle Tafers 17 Vaulruz Jaun Vuadens Broc Charmey Ueberstorf 17 Le Pâquier Vaulruz 11 Gruyères Vuadens 12 Lausanne Moléson-s/Gruyères Les Préalpes Die Voralpen Lausanne Les Paccots Genève Châtel-St-Denis The Pre-Alps Montbovon Château d'Oex Gstaad Vevey Gd St-Bernard 10 km Simplon Conditions générales Allgemeine Bedingungen General conditions Le présent guide ne répertorie que les établissements ayant Dieser Führer erfasst nur Hotelbetriebe, die dies gewünscht This guide contains only hotels which have asked to be souhaité y figurer et les informations qu’il contient sont haben. Die Informationen, die der vorliegende Führer ent- included. -

Fribourg Region the Leisure Activities and Discoveries Guide Welcoming Delicious Unexpected 2018
FRIBOURG REGION THE LEISURE ACTIVITIES AND DISCOVERIES GUIDE WELCOMING DELICIOUS UNEXPECTED 2018 FULFILMENT WALKING MAKES YOU SMILE ! IT HAS BEEN SCIENTIFICALLY PROVEN ADRENALINE MOUNTAIN BIKING, A STATE OF MIND! SLOW FOOD IN SEARCH OF AUTHENTIC FLAVOUR www.fribourgregion.ch 2 FRIBOURG REGION CONTENTS THE STREET WITH A CLICK, YOUR WHERE FRIBOURG ADVENTURE BEGINS! REINVENTS ITSELF PAGE 20 PAGE 16 An original blend : Walking makes cyclist and wine grower 4 you smile! 22 A keen sportsman at the Domaine Scenery as important as the du Vieux Moulin effort involved In search of Three little turns authentic flavour 8 and then take flight 24 The traditional delights of the Four de Your mind and body have never l'Adde bakery in Cerniat felt so light Mountain biking, The secret blast of a state of mind ! 10 the Alpine horn 26 Pedal your way to nature Samuel Descloux reveals the mysteries of the Alpine horn Mustards of the abbey 13 Island charm at the lakeside 28 A place of peace and innovation Drop anchor at Estavayer-le-Lac, The street where as though at sea Fribourg reinvents itself 16 A roof made entirely The trendy district for designers of wood 32 and foodies Léon Doutaz keeps a traditional craft alive What is Dzin? 20 Online 35 A truly unique experience FRIBOURG REGION 3 IN SEARCH OF AUTHENTIC ISLAND CHARM FLAVOUR AT THE LAKESIDE PAGE 8 PAGE 28 EDITORIAL Publisher THE LOCALS FRIBOURG REGION OF FRIBOURG INVITE Layout YOU TO JOIN THEM So Graphic Studio, Bulle Editorial Mélanie Rouiller, Susi Schildknecht The region of Fribourg is teaming with experiences to enjoy in good company. -

Fribourg Region the Leisure Activities and Discoveries Guide Welcoming Delicious Unexpected
FRIBOURG REGION THE LEISURE ACTIVITIES AND DISCOVERIES GUIDE WELCOMING DELICIOUS UNEXPECTED Fine food FINGERS IN THE CHOCOLATE GÉRALDINE MARAS, THE BEST WOMAN CHOCOLATE-MAKER IN THE WORLD Experience PASSIONATE ABOUT GOATS Sensory THE WHOLE WORLD IN A GARDEN www.fribourgregion.ch 2 FRIBOURG REGION CONTENTS “IF I WAS A WINE, I WOULD BE A FREIBURGER” PAGE 15 Cherry jam and Aperitif and Gruyère d’Alpage 4 sculpture 20 In the cool of the Marc Bucher’s family Murith’s chalet creative aperitifs Sharing his love The Chalet du Soldat 24 for the mountains 8 A view over the Gastlosen, Raoul Colliard in his Alpine a climbers’ paradise restaurant, La Saletta The tightrope walker Passionate who loves to be free 26 about goats 10 Hugo Minnig defies the Ursula Raemy’s laws of gravity 120 adorable goats The whole world The dawn in a garden 28 fisherman 12 Go barefoot with Fréderic Perritaz A boat trip with on a sensory journey Claude Delley Online 31 “If I was a wine I would be a Freiburger” 15 Fabrice Simonet, oenologist for the Petit Château family business Fingers in the chocolate 18 Géraldine Maras, the best woman chocolate-maker in the world FRIBOURG REGION 3 THE TIGHTROPE WALKER WHO LOVES TO BE FREE PAGE 26 APERITIF AND 12 La désalpe SCULPTURE en Gruyère PAGE 20 Editorial Publisher PEAKS OF FRIBOURG REGION Layout ADVENTURE AND Agence Symbol, Châtel-St-Denis Editorial A SIESTA BENEATH Mélanie Rouiller, Susi Schildknecht THE TREES Pictures Pascal Gertschen, Mélanie Rouiller, Nicolas Geinoz, Eric Fookes, Aurélie Felli, Free4style, Anthony Demierre, Marc-André Marmillod, In a world where everything keeps getting faster, Claude-Olivier Marti, Elise Heuberger, rediscover the joy of the moment, with your feet Nicolas Repond, Agence Symbol, Switzerland Tourism, Tourist Offices in a stream or your head in the clouds at the top of FRIBOURG REGION, of a mountain. -

Fribourg Region the Leisure Activities and Discoveries Guide Welcoming Delicious Unexpected 2019
FRIBOURG REGION THE LEISURE ACTIVITIES AND DISCOVERIES GUIDE WELCOMING DELICIOUS UNEXPECTED 2019 THE UNEXPECTED THE NOCTURNAL ADVENTURES OF BEAVERS EXPERIENCE i'VE EXPERIENCED: AN EXTRAORDINARY ADVENTURE PASSION KEEPING WALKERS ON THE RIGHT TRACK... ALONG 1800 KM OF PATHWAYS! www.fribourgregion.ch 2 FRIBOURG REGION FRIBOURG REGION 3 LIFE IS A BEAUTIFUL WALK PAGE 22 IT'S KEEPING WALKERS DZ¡N ! ON THE RIGHT Discover unique activities and inspiring encounters with local MEADOWS: TRACK... ALONG people. Create memories NATURE’S 1800 KM OF as a group or individual, TREASURES PATHWAYS! for children and adults alike. www.dzin.ch PAGE 4 PAGE 26 TONE Publisher FRIBOURG REGION Layout CONTENTS A WALKER’S So Graphic Studio, Bulle DELIGHT Editorial Mélanie Rouiller, Susi Schildknecht Meadows: nature’s treasures ........................ 4 Hiking in Fribourg Region, Take a walk in the Fribourg Region’s countryside, Pictures Aline Hayoz-Andrey accompanies amateur botanists the joy factor! ................................................ 20 where thrilling discoveries and delicious delicacies Pascal Gertschen, André Meier/ Suisse Tourisme, Carim Jost, await. Whether they are walking the shores of Mélanie Rouiller, Marc-André Marmillod, Life is a beautiful walk ...................................22 I've experienced: an extraordinary Eric Fookes, Elise Heuberger, Pierre Cuony, adventure ....................................................... 8 The Trans Swiss Trail, a shared long-distance project a lake, under the cover of a forest or along a mountain Stemutz, Jorgenn, Maxime Schmid, Jean-Claude Pesse perpetuates an ancestral tradition ridge, hikers will always find the path that’s right for Aurélie Felli, Restaurant du Port, Keeping walkers on the right track... rawkingphoto.ch, Gruyère Escapade, them. Walkers and sports lovers will be delighted outsideisfree.ch, Fabrice Savary. -

Randonnées Goldenpass Panoramic Montreux Vevey
GoldenPass Panoramic Montreux - Gstaad - Zweisimmen 1 | MT-PÈLERIN – PLEIN CIEL – MT-PÈLERIN 2 | VEVEY – CHÂTEL-ST-DENIS 3 | LES PLÉIADES – LES TENASSES – LALLY 4 | SONLOUP – LES AVANTS 9.5 km 2:50 05 – 10 10.6 km 4:00 04 – 10 4.8 km 1:45 05 – 10 4.3 km 1:35 04 – 10 A 1’080 m, le Mont-Pèlerin est Auf einer Höhe von 1’080 m, At an altitude of 1’080 m, Cette promenade le long de la Der Spaziergang entlang der This walk through the Veveyse Promenade en altitude avec Schöne Wanderung, die sich im Nice hike loop in the Pléiades re- Une fois hissé par la mécanique Nachdem man dank der mehr Once you have been hauled un superbe belvédère qui offre un bietet der Mont-Pèlerin eine her- Mont-Pèlerin mountain is a great Veveyse est un dépaysement Veveyse ist eine lohnende Ab- district involves a complete découverte du marais « Les Te- Kreis schliesst, in der Höhe der gion. Discovery of Les Tenasses plus que centenaire du funiculaire als hundertjährigen Mechanik up by the over one-hundred- panorama époustouflant sur l’en- vorragende Sicht und einen spek- panoramic viewpoint overlooking total. En partant du centre ville wechslung. Vom Stadtzentrum change of countryside. Leaving nasses » et de ses plantes carni- Region „Les Pléiades“. Ent- swamp and its carnivorous plants. Les Avants-Sonloup, le sentier der Seilbahn Les Avants-Son- years-old mechanism of the Les semble du bassin lémanique. takulären Blick auf den Genfersee. Lake Geneva region. de Vevey, le tracé conduit à Châ- Vevey aus geht es nach Châ- the centre of Vevey, the route vores grâce à un sentier didactique. -

Randonnées 1 | Chexbres – Tour Plein Ciel – MT-Pèlerin 3
Les Pléiades 1 | CHEXBRES – TOUR PLEIN CIEL – MT-PÈLERIN 2 | MT-PÈLERIN – PLEIN CIEL – MT-PÈLERIN 3 | VEVEY – CHÂTEL-ST-DENIS Très belle randonnée cham- Sehr schöne Wanderung, auf Very nice walk in the countryside, A 1’080 m, le Mont-Pèlerin est Auf einer Höhe von 1’080 m, At an altitude of 1’080 m, Mont- Cette promenade le long de la Der Spaziergang entlang der This walk through the Veveyse pêtre, durant laquelle ren- welcher Sie die Narzissen in ihrer where you may discover some un superbe belvédère qui offre bietet der Mont-Pèlerin eine Pèlerin mountain is a great Veveyse est un dépaysement Veveyse ist eine lohnende Ab- district involves a complete contres avec narcisses (mai), ganzen Schönheit bewundern narcissus (mai), typical cha- un panorama époustouflant sur hervorragende Sicht und einen panoramic viewpoint overlooking total. En partant du centre ville wechslung. Vom Stadtzentrum change of countryside. Leaving petits chalets typiques et ani- können (Mai). Kleine typische lets and forest animals. A 360° l’ensemble du bassin lémanique. spektakulären Blick auf den Gen- Lake Geneva region. de Vevey, le tracé conduit à Vevey aus geht es nach Châtel- the centre of Vevey, the route maux des bois sont fréquentes. Chalets und Waldtiere sind häufig unrestricted view of the area fersee. Châtel-St-Denis à travers une St-Denis durch eine idyllische leads to Châtel-St-Denis through Vue panoramique imprenable de zu sehen. Auf dem Turm „Plein from the top of the “Plein Ciel” nature des plus bucoliques, Landschaft, über römische some natural scenery at its most 360° au sommet de la tour Plein Ciel“ haben Sie einen 360° atem- tower (opening hours: April-Oc- traversant pont, passerelles et Brücken und durch zauberhafte bucolic, crossing Roman bridges Ciel (ouverture : avril-octobre). -

Rathvel Les Paccots
Tarifs 2014/2015 Rathvel Tarifs 2014/2015 Les Paccots Etudiant/ Etudiant/ Enfant Enfant www.les-paccots.ch Abonnements Adulte Apprenti/ Ecoles Abonnements Adulte Apprenti/ Ecoles (-> 16 ans) (->16 ans) AVS AVS ½ jour (9 h15-13 h ou dès 11 h 30) CHF 20.– CHF 15.– CHF 15.– CHF 6.– ½ jour (9 h-13 h ou dès 11 h 30) CHF 25.– CHF 21.– CHF 17.– CHF 7.– 1 jour CHF 25.– CHF 18.– CHF 18.– CHF 8.– 1 jour CHF 32.– CHF 26.– CHF 22.– CHF 9.– (dès 3 jours: 20% de réduction) PLAN DES PISTES 2 jours consécutifs CHF 56.– CHF 45.– CHF 38.– 1 soirée CHF 10.– CHF 6.– CHF 6.– Pistenkarte / Piste map 3 jours consécutifs CHF 78.– CHF 63.– CHF 53.– Saison CHF 280.– CHF 180.– CHF 180.– 4 jours consécutifs CHF 99.– CHF 80.– CHF 67.– Carte à 25 cases * CHF 25.– CHF 18.– CHF 18.– 5 jours consécutifs CHF 119.– CHF 96.– CHF 80.– Les Paccots Rathvel Carte à 45 cases * CHF 44.– CHF 26.– CHF 26.– 6 jours consécutifs CHF 138.– CHF 111.– CHF 93.– * Valable 3 ans dès la date d’achat Gros-Niremont = 3 cases; Rathvel = 2 cases; Rathvel-junior = 1 case. Prix «famille» dès 2 enfants: 10% sur les cartes journalières Office du tourisme Châtel-St-Denis/Les Paccots Saison CHF 380.– CHF 280.– CHF 220.– et la Région Etudiant/ Enfant Abonnements Adulte AVS Apprenti/ (-> 16 ans) Saison indigène CHF 342.– CHF 252.– CHF 198.– Place d’Armes 15 1618 Châtel-St-Denis Saison Alpes fribourgeoises CHF 500.– CHF 400.– CHF 300.– CHF 440.– Carte de 15 cases CHF 26.– CHF 21.– CHF 16.– Tél. -

Liste Des Chalets D'alpage Fribourgeois
Liste des chalets d'alpage du canton de Fribourg Classé par commune; état septembre 2008 N° N° Propriétaire Teneur Année du Alpage Commune Localité Localité Zone rap. Nom, prénom Nom, prénom rapport MM. Raphaël et Jean- 987 31 Beaucu Albeuve Grandvillard MM. Raphaël et Jean-Luc Delabays Grandvillard 2003 6 Luc Delabays Copropriété G. et N. 988 32 Biron Albeuve Albeuve M. Max Pythoud Albeuve 2003 6 Tena M. et Mme Bruno et 989 44 Cerniaulaz Albeuve Albeuve M. et Mme Bruno et Michèle Pythoud Albeuve 2003 6 Michèle Pythoud 990 18 Chalet Neuf ou Ermitage Albeuve Commune Albeuve M. et Mme Bruno et Michèle Pythoud Albeuve 2003 6 991 27 Champ-Derrey Albeuve Commune Albeuve M. Jean-Louis Roch Le Châtelard 2003 6 992 45 Combaz à la Loge Albeuve Commune Albeuve M. Philippe Roch Les Sciernes-d'Albeuve 2003 6 17 Cuvigné Albeuve Commune Albeuve Communauté Combaz/Pythoud p.a. M. N. Pythoud Les Sciernes-d'Albeuve 2003 6 993 24 Féguire Albeuve Commune Albeuve Ass. Pythoud-Comba Les Sciernes-d'Albeuve 2003 6 994 46 Gîte des Prés Albeuve M. Jean Moret M. Jacques Moret Bulle 2003 6 995 42 La Belle Gîte Albeuve M. Bernard Roch M. Jean-Louis Roch Le Châtelard 2003 6 996 40 La Chenalettaz Albeuve Copropriété M. François Pasquier Maules 2003 6 997 2 La Cuvignetta Albeuve Commune Albeuve M. Louis Castella Albeuve 2003 6 MM. Gaby et Nicolas 998 33 La Gîte Albeuve Albeuve M. Max Pythoud Albeuve 2003 6 Tena Copropriété Beaud- 999 34 La Grosse Côte Albeuve Albeuve M.