Les Variae Lectiones De Marc-Antoine Muret: L'esprit D'un Homme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Spoken Latin in the Late Middle Ages and Renaissance Revisited
The Journal of Classics Teaching (2020), 21, 66–71 doi:10.1017/S2058631020000446 Forum Spoken Latin in the Late Middle Ages and Renaissance Revisited Terence Tunberg Key words: Latin, immersion, communicative, Renaissance, speaking, conversational An article by Jerome Moran entitled ‘Spoken Latin in the Late tained its role as the primary language by which the liberal arts and Middle Ages and Renaissance’ was published in the Journal of sciences were communicated throughout the Middle Ages and Classics Teaching in the autumn of 2019 (Moran, 2019). The author Renaissance. Latin was the language of teaching and disputation in of the article contends that ‘actual real-life conversations in Latin the schools and universities founded during the medieval centuries. about everyday matters’ never, or almost never took place among Throughout this immensely long period of time, the literate and educated people in the late Middle Ages and Renaissance. A long- educated were, of course, always a small percentage of the total standing familiarity with quite a few primary sources for the Latin population. But for virtually all of the educated class Latin was an culture of Renaissance and early modern period leads us to a rather absolute necessity; and for nearly all of them Latin had to be learned different conclusion. The present essay, therefore, revisits the main in schools. Their goal was not merely to be able to read the works of topics treated by Moran. Latin authors, the Latin sources of the liberal arts and theology, but We must differentiate Latin communication from vernacular also to be able to use Latin themselves as a language of communica- communication (as Moran rightly does), and keep in mind that the tion in writing and sometimes in speaking. -

Salve Deus Rex Iudæorum. Æmilia Lanyer
Topic: Confrontations Workshop title: “Gender and Intellectual Boundaries in 16th Century English and Continental Literature” Short description: Our proposed workshop considers how Renaissance female authors contested the male dominance of authorial traditions that center on male authorship, friendship, and patronage through collaborative stances. Focusing on Tullia d’Aragona and Aemilia Lanyer as test cases for our exploration, we ask: how do women “collaborate” with male writers, and with their audience and patrons to carve a space in philosophical and theological prose and poetry? Organizers: Person of contact: Astrid Adele Giugni, Duke University, English department, email: [email protected]; home address: 1727 Tisdale Street, Durham, NC 27705; institutional address: 114 South Buchanan Boulevard, Bay 9, Room A289, Durham, NC 27708 phone number: 919-638-3283 Co-organizer: Hannah VanderHart, Duke University, English department, email: [email protected] Description Our workshop is interested in collaborations as confrontations and contestations. We focus on female writers’ strategies to contest philosophical, theological, and generic traditions that center on male authorship, friendship, and patronage. We ask: How do women’s awareness and conceptualization of their audience affect their understanding and presentation of collaboration? How do women “collaborate” with male writers by responding to philosophical and theological traditions? How does attending to female author’s national and religious background change our perception of their engagement with literary and philosophical traditions? As early modern literature scholars we are interested in exploring the role of women in the Italian and English Renaissance. We consider Tullia d’Aragona and Aemilia Lanyer as test cases for this exploration. Tullia d’Aragona’s Della infinità d’amore dialogo (1547) comments upon and challenges works that center and debate male love, Plato’s Symposium, and its influence on Ficino’s, Bembo’s, and Castiglione’s writings. -

Adam Smith's Library”
Discuss this article at Journaltalk: https://journaltalk.net/articles/5990/ ECON JOURNAL WATCH 16(2) September 2019: 374–474 Foreword and Supplement to “Adam Smith’s Library: General Check-List and Index” Daniel B. Klein1 and Andrew G. Humphries2 LINK TO ABSTRACT To dwell in Adam Smith’s thought one places him in history and streams of discourse. We learn a bit about his personage from contemporary memoirs and accounts, his personal communications from his correspondence, and his influences from the allusions and references in his work. Also useful is the catalogue of his personal library. He did not much write inside the books he owned (Phillipson et al. 2019; Simpson 1979, 191), but Smith scholars use the listing of his personal library in interpreting his thought. The cataloguing of books belonging to Adam Smith has been the work of numerous scholars, the two chief figures being James Bonar (1852–1941) and Hiroshi Mizuta, who in September 2019 reached the age of 100 years. To aid scholarship, we here reproduce the checklist created by Mizuta (1967). We gratefully acknowledge the permission of both Professor Mizuta and the Royal Economic Society, which holds copyright. The 1967 checklist has been bettered, notably by Mizuta’s own complete account represented by Mizuta (2000). That work, however, does not lend itself to a handy checklist to be reproduced online. When Mizuta made the 1967 checklist, those of Smith’s books held by the University of Edinburgh had not all been recognized as such. When a librarian has a volume in hand, nearly the only way to determine that it had been in Smith’s library is by the presence of his bookplate, shown below. -

Elenco Bibliografico Alfabetico Per Autori E Titoli Degli Incunaboli E Delle Cinquecentine Della Biblioteca Arcivescovile Cardinale Pietro Maffi
1 Elenco bibliografico alfabetico per autori e titoli degli incunaboli e delle cinquecentine della Biblioteca arcivescovile cardinale Pietro Maffi All’interno di ogni voce per autore o titolo la successione è quella degli anni di edizione (Le schede elaborate per il catalogo a stampa sono consultabili in biblioteca nel data base) 34.6.33 ACCADEMIA DELLA CRUSCA Degli accademici della Crusca Difesa dell’Orlando furioso dell’Ariosto. Contra’l Dialogo dell’epica poesia di Cammillo Pellegrino. Stacciata prima. - In Firenze : per Domenico Manzani stampator della Crusca, 1584 (In Firenze : nella Stamperia di Giorgio Marescotti, 1584). - [4], 53, [1]c. ; 8° - Contenuto: dedicatoria di Bastiano de’ Rossi a Orazio Rucellai datata Firenze, 16-2-1584; avvertenza del segretario dell’Accademia della Crusca ai lettori; testo; colophon; errata corrige. - - Esempl. leg. con Il Lasca: dialogo / di Ormannozzo Rigogoli - Firenze: Domenico Manzani, 1584. * PSN: Firenze, Manzani. Domenico, 1584, Firenze. Marescotti. Giorgio. 1584. 32.6.38 ACCOLTI, Benedetto, 1415-1464 La guerra fatta da christiani contra barbari per la ricuperatione del sepolcro di Christo et della Giudea / di Benedetto Accolti aretino ; tradotta per Francesco Baldelli da Cortona. - In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1549 (In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1549). - 127, [1] c. : ill. ; 8° IS: Baldelli, Francesco * PSN: Venezia, Giolito De Ferrari. Gabriele, 1549. (MLO) 50.2.40 ACETI DE’ PORTI, Serafino Opere spirituali, alla christiana perfettione, utiliss. necessarie. Del r. p. don Serafino da Fermo... Nuovamente con somma diligentia riviste, da infiniti errori purgate... - In Piacenza : appresso Francesco Conti, 1570. - 574, [50]c. ; 8° * PSN: Piacenza, Conti. Francesco, 1570. -

Renaissance Receptions of Ovid's Tristia Dissertation
RENAISSANCE RECEPTIONS OF OVID’S TRISTIA DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Gabriel Fuchs, M.A. Graduate Program in Greek and Latin The Ohio State University 2013 Dissertation Committee: Frank T. Coulson, Advisor Benjamin Acosta-Hughes Tom Hawkins Copyright by Gabriel Fuchs 2013 ABSTRACT This study examines two facets of the reception of Ovid’s Tristia in the 16th century: its commentary tradition and its adaptation by Latin poets. It lays the groundwork for a more comprehensive study of the Renaissance reception of the Tristia by providing a scholarly platform where there was none before (particularly with regard to the unedited, unpublished commentary tradition), and offers literary case studies of poetic postscripts to Ovid’s Tristia in order to explore the wider impact of Ovid’s exilic imaginary in 16th-century Europe. After a brief introduction, the second chapter introduces the three major commentaries on the Tristia printed in the Renaissance: those of Bartolomaeus Merula (published 1499, Venice), Veit Amerbach (1549, Basel), and Hecules Ciofanus (1581, Antwerp) and analyzes their various contexts, styles, and approaches to the text. The third chapter shows the commentators at work, presenting a more focused look at how these commentators apply their differing methods to the same selection of the Tristia, namely Book 2. These two chapters combine to demonstrate how commentary on the Tristia developed over the course of the 16th century: it begins from an encyclopedic approach, becomes focused on rhetoric, and is later aimed at textual criticism, presenting a trajectory that ii becomes increasingly focused and philological. -

I. BIOGRAPHICAL NOTE the Manuscript of Jan Strzembosz and His Book Collection Have Not Been Deprived of the Attention of Polish Scholaraship
ORGANON 26-27:1997-1998 AUTEURS ET PROBLEMES Tomasz Strzembosz (Poland) JAN STRZEMBOSZ (1545-1606) HIS MANUSCRIPT AND COLLECTION OF BOOKS I. BIOGRAPHICAL NOTE The manuscript of Jan Strzembosz and his book collection have not been deprived of the attention of Polish scholaraship. The manuscript has been studied by Witold Rubczynski (1922), who, as Aleksander Birken- majer observed, "knew very little about its author". In fact his knowledge was "less than very little". The book collection has received the scholarly regard of many others, writing at diverse times. But none of it has amounted to more than just brief notes, not providing much information about the library collection and its history, and next to none about its original owner. Today, in an age marked by a heightened interest in the Renaissance, Strzem bosz’ valuable bibliophile bequest is a worthy subject for academic attention, while the life and achievements of the enlightened and public-spirited col lector who endowed us with it merit a few moments of notice. A compilation of the facts published earlier and more recently with the material preserved in the archives and collected still before the Second World War, which has fortunately managed to survive that War, will help to give us a fuller picture of the figure of Jan Strzembosz. In 1538 at Opoczno (now Central Poland), on a date recorded as "f. 5 post Conductum Paschae" the Strzembosz brothers, Mikołaj, the Reverend Andrzej, Derstaw, and Ambroży, sons of Jan Strzembosz of Jablonica and Wieniawa, and later of Dunajewice and Skrzyńsko, Justice of the Borough of Radom1, and Owka (Eufemia), daughter of Dersław Dunin of Smogorze- wo, Lord Crown Treasurer, and Małgorzata of Przysucha, concluded an act for the distribution of the patrimonial and maternal property left to them. -

1948 the Witness, Vol. 31, No. 13
MAY 6, 1948 BISHOP KARL BLOCK OF CALIFORNIA FROM A PO R TR A IT............... The Church and Social Service Copyright 2020. Archives of the Episcopal Church / DFMS. Permission required for reuse and publication. SERVICES In Leading Churches In Leading Churches T he Cathedral of S t . J ohn For Christ and His Church Christ Church Cathedral the Divine Main and Church Sts., Hartford, Conn. N ew York City E d ito ria l B oard: Roscoe T. Foust, E d ito r; Sunday Services: 8, 9:30, 10:05, 11 A.M., Sundays: 8, 9, 11, Holy Communion; 10, William B.- Spofford, Managing Editor; H ugh 8 P.M . Morning Prayer; 4, Evening Prayer; Ser D. McCandless, John M. Mulligan, William B. W eekdays: Holy Communion — Monday mons 11 and 4. I __ , _ Spofford Jr., Sydney A. Temple Jr., Joseph H. and Thursday, 9 A.M.; Tuesday. Friday and Weekdays: 7:30, 8 (also 9:15 Holy Days Titus, Andrew M. Van Dyke, William M. Saturday, 8 A.M. ; Wednesday, 7 :00 and and 10, W ednesdays). Holy-Com m union; 9, Weber, Hal M. Wells, Walter N. Welsh. 11-00 A.M. Noonday Service, daily 12:15 Morning Prayer; 5, Evening Prayer. Open P.M . daily 7 A.M. to'6 P.M._________ Grace Church, New York Christ Church Cambridge Broadway at 10th St. C ontributing E d it o r s: Frederick C. Grant, Rev. Louis W. Pitt, D.D., Rector Book Editor. F. O. Ayres Jr., L. W. Barton, Rev. Gardiner M. Day, Rector Daily: 12:30 except Mondays and Satur- D H Brown Jr., Adelaide Case, Angus Dun, R ev. -
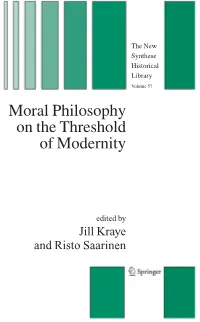
Moral Philosophy on the Threshold of Modernity
The New Synthese Historical Library Volume 57 Moral Philosophy on the Threshold of Modernity edited by Jill Kraye and Risto Saarinen 302 LORENZO CASINI although Vives considered himself to be the first to deal with the investigation of the emotions in an adequate manner, a closer inspection reveals that he pays considerable attention to earlier thinkers and that his account relies heavily on information from a variety of sources. Although they are not introduced as opposing views, the positions of Aristotle and of the Stoics are mentioned as examples of the insufficient care with which the ancient studied the emotions. The Stoics are said to have corrupted the whole subject with their quibbling, and Aristotle is blamed for having dealt with the emotions in his Rhetoric only from an exclusively forensic point of view. Most of Vives’s definitions of the single emotions, however, are drawn from Aristotle’s Rhetoric and Cicero’s Tusculanae disputationes. The fact that Cicero is associated with the Stoics also suggests that the latter work is one of Vives’s principal sources for the Stoic theory of the passions. Moreover, his rejection of Aristotle’s contribution to the subject of the emotions clearly indicates that he based his assessment principally on the Rhetoric. The Peripatetic tradition nonetheless constitutes one of the most important sources of inspiration for Vives’s conception of the emotions. Plutarch’s De virtute morali, which is one of the best formulations of the Peripatetic ideal of a moderate degree of passion, together with his distinction between êthos and pathos, which Vives might also have encountered in Quintilian’s Institutio oratoria, influenced him, not least in his crucial distinction between passions and emotions. -

Okorcik Wvhanas* J a Biography
OKORCIK WVHANAS* J A BIOGRAPHY BY D. MACMILLAN, M.A., D.D. MINISTER OF KELVINHAUGII FAKLSH, GLASGOW AUTHOR OF "JOHN KNOX, A BIOGRAPHY" IMPRESSION EDINBURGH GEORGE A, MORTON, 42 GEOROK STKERT LONDON : SIMPKIN, MARSHALL, St CO. LTD. 1906 ROBERT FLINT D.D,, LL.I>,, F.R.S.R. EMERITUS I'ROFBSSOR 01'" DIVINITY IN TUB UNIVERSITY QV EDINBURGH CORRESPONDING MRMI1EK OF TUB INSTITOTB OF FKANCE AND IJONORAKY MWMiJBR OF THE WOYAt SOCIETY Olf I'AI.BRMO REPRESENTATIVE IN THE TWENTIETH CENTURY AS GEORGE BUCHANAN WAS* IN THE SIXTEENTH OF SCOTTISH LEARNING AND SCHOLARSHIP PREFACE T Y AD Mr. Robert Wallace, M.F. for East ** Edinburgh, lived to finish bis biography of George Buchanan, this work would probably have never been written. But all that he left was a frag- ment in the form of "characteristics,"" rich and suggestive so far as it goes ; the life proper abruptly stops in its opening chapter. Apart from that there is no other biography of Buchanan which attempts to give, within a brief compass, the story of his chequered and remarkable career. It accordingly occurred to me that a# the country- men of Buchanan had resolved to commemorate the quater-century of his birth, which falls this year, they would not take it amiss if I attempted to write his Life after the game manner an I did that of his vii viii PREFACE great contemporary, John Knox, last year. The generous reception given to that work inspired me with a hope that the same favour might be extended to a companion volume. There are, of course, two well-known biographies of Buchanan in existence the one by Dr. -

A French Miscellany
FRENCH MISCELLANY · 1 MAGGS BROS. LTD · 48 BEDFORD SQUARE · LONDON · WC1B 3DR 1. DE GARATIS (Martinus) Clarissimi iurisconsulti domini Martini de Caraziis Laudensis solenes et quottidiani ac practicabiles tractati sequuntur. Paris: Thomas Kees and Jean Lambert for A Poncet Le Preux, 22 October, 1513. (With:) JOHANNES (Monarchius Cisterciensis). Defensorium FRENCH Iuris. Rouen: Michael Angier and Jean Mace, 1518. £2500 I. Title printed in red and black, with criblé metalcut device of publisher MISCELLANY Poncet le Preux on title page with his monogram and name, criblé initials throughout, one with guide letter. Gothic letter. PART I. THE SIXTEENTH CENTURY II. Title printed in red and black, woodcut initials throughout, some historiated, one woodcut shield ornament (fol. f2(r)), text in columns. TEL. NO. +44 (0)20 7493 7160 Gothic letter. EMAIL: [email protected] 4to (200 x 140mm). 96ff; 88ff (of 96, lacking final quire ‘M’, final tract by Peter of Ancarano). Contemporary limp calf, upper cover panelled with hunting roll border (EBDB r000644) and lattice pattern at centre (EBDB r000519), lower with floral roll (EBDB r000646) and simple blind-fillet pattern at centre, executed in Bavaria, Germany; with stamped monogram ’PAZL’ ( Placidus Hieber Abt Zu Lambach) and date, 1659, spine with three raised bands, painted, with manuscript title at head (calf worn, corners and headcaps chipped, worming to upper cover and spine, remnants of ties). A handsomely-bound volume from the library of the Abbot of Lambach comprising two rare works on jurisprudence: the first, a collection of tracts on Roman and canon law by fifteenth-century jurist and economist Martinus de Garatis (Martino Garatti da Lodi, d.1453); the second, a compilation of legal tracts by medieval and early modern jurists. -

Gabriel Harvey's <I>Ciceronianus</I>
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Papers from the University Studies series (The University of Nebraska) University Studies of the University of Nebraska 11-1945 Gabriel Harvey's Ciceronianus Harold S. Wilson Clarence A. Forbes Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/univstudiespapers Part of the Arts and Humanities Commons This Article is brought to you for free and open access by the University Studies of the University of Nebraska at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Papers from the University Studies series (The University of Nebraska) by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Gabriel Harvey's Ciceronian us * * * * * H A R O L D S. W I L S O N and C L A R E N C E A. F O R B E S UNIVERSITY OF NEBRASKA STUDIES November 1945 STUDIES IN THE HUMANITIES NO. 4 GABRIEL HARVEY'S GIGERONIAJVUS University of Nebraska Studies November 1945 Gabriel Har,vey's Ciceronianus * * * With an Introduction and Notes by HAROLD S. WILSON And an English Translation by CLARENCE A. FORBES * * * STUDIES IN THE HUMANITIES NO. 4 PUBLISHED BY THE UNIVERSITY AT LINCOIN, NEBRASKA Copyright 1945 by THE UNIVERSITY OF NEBRASKA SENATE COMMITTEE ON PUBLICATION OF UNIVERSITY STUDIES R. W. Goss, Chairman PAUL jANNKE A. S. ] ENNESS C. E. GEORGI L. W. LANCASTER F. A. LUNDY M. s. PETERSON J. L. SELLERS BOARD OF UNIVERSITY PUBLICATIONS K. 0. BROADY, Chairman F. C. BLOOD H.P. DAVIS F. A. LUNDY G. S. RouND G. w. -
Neo-Latin News
84 SEVENTEENTH-CENTURY NEWS NEO-LATIN NEWS Vol. 62, Nos. 1 & 2. Jointly with SCN. NLN is the official publica- tion of the American Association for Neo-Latin Studies. Edited by Craig Kallendorf, Texas A&M University; Western European Editor: Gilbert Tournoy, Leuven; Eastern European Editors: Jerzy Axer, Barbara Milewska-Wazbinska, and Katarzyna To- maszuk, Centre for Studies in the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe, University of Warsaw. Founding Editors: James R. Naiden, Southern Oregon University, and J. Max Patrick, University of Wisconsin-Milwaukee and Graduate School, New York University. ♦ Hofkritik im Licht humanistischer Lebens- und Bildungsideale. De miseris curialium (1444), Über das Elend der Hofleute.By Enea Silvio Piccolomini. Equitis Germani aula dialogus (1518), Aula, eines deutschen Ritters Dialog über den Hof. By Ulrich von Hutten. Edited and translated by Klaus Schreiner and Ernst Wenzel. Mittellateinische Studien und Texte, 44. Leiden: Brill, 2012. 241 pp. $144. The scope of this dual-language (Latin-German) edition of two works from the early modern period is valuable for the ease of comparison of original to translation and for the insights the texts provide into the socio- logical, literary, humanistic, and educational ideals of a time when the court, secular or ecclesiastical, defined standards of behavior for a particular class. Underlying both works is Lucan’s warning that he who wishes to lead a righteous or virtuous life should avoid the court. The controversial nature of Lucan’s words finds full expression in these works and others, and the excellent bibliography of secondary studies of critiques of court manners and this way of life preceding and fol- lowing the early modern period shows that the controversy extended well into the eighteenth century.