Karsztfejlődés Xiii
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Natural Beauty Spots Paradises to Be Discovered
The Active OUTDOORS Natural Beauty Spots Paradises to be discovered Walking and biking in Basque Country Surfing the waves Basque Coast Geopark Publication date: April 2012 Published by: Basquetour. Basque Tourism Agency for the Basque Department of Industry, Innovation, Commerce and Tourism Produced by: Bell Communication Photographs and texts: Various authors Printed by: MCC Graphics L.D.: VI 000-2011 The partial or total reproduction of the texts, maps and images contained in this publication without the San Sebastián express prior permission of the publisher and the Bilbao authors is strictly prohibited. Vitoria-Gasteiz All of the TOP experiences detailed in TOP in this catalogue are subject to change and EXPE RIEN may be updated. Therefore, we advise you CE to check the website for the most up to date prices before you book your trip. www.basquecountrytourism.net The 24 Active OUT- DOORS 20 28LOCAL NATURE SITES 6 Protected Nature Reserves Your gateway to Paradise 20 Basque Country birding Bird watching with over 300 species 24 Basque Coast Geopark Explore what the world way 6 34 like 60 million years ago ACTIVITIES IN THE BASQUE COUNTRY 28 Surfing Surfing the Basque Country amongst the waves and mountains 34 Walking Walking the Basque Country Cultural Landscape Legacy 42 42 Biking Enjoy the Basque Country's beautiful bike-rides 48 Unmissable experiences 51 Practical information Gorliz Plentzia Laredo Sopelana THE BASQUE Castro Urdiales Kobaron Getxo ATXURI Pobeña ITSASLUR Muskiz GREENWAY GREENWAY Portugalete ARMAÑÓN Sondika COUNTRY'S MONTES DE HIERRO Gallarta Sestao NATURAL PARK GREENWAY Ranero BILBAO La Aceña-Atxuriaga PROTECTED Traslaviña Balmaseda PARKS AND AP-68 Laudio-Llodio RESERVES Amurrio GORBEIA NATURAL PARK Almost 25% of Basque Country Orduña territory comprises of protected nature areas: VALDEREJO A Biosphere Reserve, nine AP-68 NATURAL PARK Natural Parks, the Basque Lalastra Coast Geopark, more than Angosto three hundred bird species, splendid waves for surfing and Zuñiga Antoñana numerous routes for walking or biking. -

VIA DE BAYONA O Del Tunel De San Adrian E Cammino Vasco Del Interior
VIA DE BAYONA o del Tunel de san Adrian e cammino vasco del interior (note della Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Miranda del Ebro e di Gisella Parente “Gix”). 298 km separano Bayona (Francia) da Burgos (dove si unisce al camino francés o a santo Domingo de la calzada) dice la guida in vendita all'OT di Miranda del Ebro, e come segnala Andrés Terrazas, presidente degli amici del cammino della zona. Il Cammino comincia in Bayona-Bayonne o da Irun. Da Bayona si va verso Anglet, un pittoresco villaggio, Bidart e altri villaggi, passando per San Jean de Luz fino a Irún (42,1 km) in due tappe. Il tracciato prosegue tra Irún e Hernani su 24.1 km e conta su due albergues in Irún più quelli di Astiagarra e di Hernani. Visita all'ermita di Santiagomendi (monte di Santiago), cosa che attesta il passaggio di pellegrini per questa zona in epoca antica. Le tappe 4 (21,8 km) e 5 (31 km) vanno da Hernani a Tolosa attraversando i ponti di Villabona, Tolosa e Alegría ed offrendo al peregrino alloggi in Urnieta, Tolosa, Segura (casa rural) e Zegama. Si deve poi attraversare il túnel de San Adrián, crocevia commerciale ai tempi in cui il nodo viario tra Guipúzcoa e Castilla passava per Zegama, la pittoresca ermita Sancti Spíritu, ed i santuari di Nuestra Señora de Ayala e di Nuestra Señora de Estíbaliz, che formano parte delle tappe 6 (23,3 km) e 7 (29 km) del cammino a Vitoria, dove si trova un albergue de peregrinos. -

THE BASQUE COUNTRY a Varied and San Sebastián Seductive Region
1 Bilbao San Sebastián Vitoria-Gasteiz All of the TOP experiences detailed in TOP in this catalogue are subject to change and EXPE may be updated. Therefore, we advise you RIEN to check the website for the most up to date CE prices before you book your trip. www.basquecountrytourism.net 22 14 32 40 City break getaways 6 6 Bilbao 14 San Sebastián 22 Vitoria-Gasteiz 32 Gastronomy 40 Wine Tourism 44 50 44 The Basque Coast 50 Active Nature 56 Culture 60 Unmissable experiences 56 62 Practical information Bilbao San Sebastián Vitoria- Gasteiz 4 THE BASQUE COUNTRY a varied and San Sebastián seductive region You are about to embark on an adventure If you explore the history of the figures with many attractions: a varied landscape, who have marked the personality of these a mild climate, ancient culture, renowned communities, you will discover how their gastronomy... These are the nuances maritime, industrial and agricultural that make the Basque Country a tourist character, always diverse and enterprising, destination you will be delighted to has been bred. discover. And if you find the coastal and inland Two colours will accompany you on your villages interesting, you will be fascinated journey through the Basque Country: the by the three capitals. Bilbao will surprise green of the mountains and valleys, and you with its transformation from the blue of the sea. an industrial city to an avant garde metropolis, that brings together the You will discover that the Basque people world's best architects. San Sebastián, maintain strong links with the natural exquisite and unique, will seduce you with resources of the land and the sea. -

Way of St. James Chemin De Compostelle
This is the stage where you leave the province of Gipuzkoa and cross over into The Way of St. James in the Basque Country Alava. There are few border crossings as intriguing as the Tunnel of San Adrián, Section a cave carved into the rock by the action of water and the passing of time. After Le Chemin de Compostelle au Pays Basque climbing up and over the medieval road, the landscape takes on a different feel. You’re now in the Llanada Alavesa, the drier plains of Alava, which stand in sharp Zegama > WAY OF ST. JAMES contrast to the lush green valleys of Gipuzkoa. Here, the landscape is dominated Donostia Portuzarra / Alto de la Horca San Sebastián by rain-fed crops and lazy, sun-basked villages dotted with impressive baroque and CHEMIN DE COMPOSTELLE renaissance mansions. Bilbao Au revoir Guipúzcoa, bienvenue en Álava : les deux territoires revêtent ici leurs habits km 0 ZEGAMA. Starting at Zegama town centre, make your way to the Gurutze de cérémonie. Il existe peu de frontières aussi belles que le tunnel de San Adrián, Santua chapel and follow the path that goes along the river Oria. After une grotte creusée dans la roche par l‘action de l’eau et le passage du temps. Après passing several farmhouses and an old hydroelectric plant, cross the main The Inland Route Le Chemin de l’Intérieur ZEGAMA le tunnel, la chaussée médiévale nous ouvre d’autres horizons. La Plaine d’Álava a road and continue uphill along a smaller, local road. As you’re heading up the 4 peu de points communs avec les vallées voluptueuses de Guipúzcoa. -

The Basques by Julio Caro Baroja
Center for Basque Studies Basque Classics Series, No. 5 The Basques by Julio Caro Baroja Translated by Kristin Addis Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada This book was published with generous financial support obtained by the Association of Friends of the Center for Basque Studies from the Provincial Government of Bizkaia. Basque Classics Series, No. 5 Series Editors: William A. Douglass, Gregorio Monreal, and Pello Salaburu Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada 89557 http://basque.unr.edu Copyright © 2009 by the Center for Basque Studies All rights reserved. Printed in the United States of America. Cover and series design © 2009 by Jose Luis Agote. Cover illustration: Fue painting by Julio Caro Baroja Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Caro Baroja, Julio. [Vascos. English] The Basques / by Julio Caro Baroja ; translated by Kristin Addis. p. cm. -- (Basque classics series ; no. 5) Includes bibliographical references and index. Summary: “The first English edition of the author’s 1949 classic on the Basque people, customs, and culture. Translation of the 1971 edition”-- Provided by publisher. *4#/ QCL ISBN 978-1-877802-92-8 (hardcover) 1. Basques--History. 2. Basques--Social life and customs. i. Title. ii. Series. GN549.B3C3713 2009 305.89’992--dc22 2009045828 Table of Contents Note on Basque Orthography.................................... vii Introduction to the First English Edition by William A. Douglass....................................... ix Preface .......................................................... 5 Introduction..................................................... 7 Part I 1. Types of Town Typical of the Basque Country: Structure of the Settlements of the Basque-Speaking Region and of the Central and Southern Areas of Araba and Navarre....... -

Secundaria Castellano
NECESIDADES DE PROFESORADO CURSO:2019/2020 CUERPO: 590 CÓDIGO: 001 ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA (CASTELLANO) CENTRO VACANTES HORAS OBSERVACIONES I.E.S.O. DE BERRIOZAR- BERRIOZAR 1 0 I.E.S. IBAIALDE- BURLADA 0 12 I.E.S.O. VALLE DEL ARAGON- CARCASTILLO 0 12 01 [12 horas] Con Ámbito Socio-Lingüístico en Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento I.E.S.O. LA PAZ- CINTRUENIGO 1 0 01 PRC-PRL (extraescolar) 4 sesiones, 3 sesiones(Convivencia.) ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE 0 15 CORELLA- CORELLA I.E.S. TIERRA ESTELLA- ESTELLA 0 9 I.E.S. PABLO SARASATE- LODOSA 1 0 02 (Programa PROEDUCAR), Proyecto de Inclusión I.E.S. MARQUÉS DE VILLENA- MARCILLA 3 0 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE 0 15 PAMPLONA- PAMPLONA I.E.S. BASOKO- PAMPLONA 1 12 03 [12 horas] Proyecto de Inclusión I.E.S. JULIO CARO BAROJA- PAMPLONA 1 0 I.E.S. MENDILLORRI- PAMPLONA 1 17 I.E.S. NAVARRO VILLOSLADA- PAMPLONA 2 24 05 Perfil Inglés C1//06 [10 horas] Para Nocturno 10 sesiones//07 [14 horas] I.E.S. PADRE MORET- PAMPLONA 1 12 I.E.S. PLAZA DE LA CRUZ- PAMPLONA 2 9 I.E.S.O IÑAKI OCHOA DE OLZA- PAMPLONA 1 0 01 Proyecto de Inclusión I.E.S. RIBERA DEL ARGA- PERALTA 1 0 03 Perfil Inglés C1 Con PROA I.E.S. EGA- SAN ADRIAN 1 0 miércoles, 14 de agosto de 2019 Página 1 de 106 NECESIDADES DE PROFESORADO CURSO:2019/2020 CUERPO: 590 CÓDIGO: 001 ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA (CASTELLANO) I.E.S. -
Guiacaminosantiagoaragones
he best-known trail of the Santiago Route in Aragon is the one which follows the course of the Aragon River in a north-south direc- tion from its source in Somport through the accidental landscapes of the high Pyre- nees, crossing forests and meadows, waterfalls and gorges until it veers suddenly in a right angle as it pas- ses Jaca. From there onwards, the river meanders in a wes- terly direction towards the Canal de Berdun valley be- fore reaching the Yesa re- servoir. At this point, the route is obliged to nego- ciate another section of rough, verdant terrain. The river and the trail now enter Navarre, where the former joins the Ebro River and the latter continues towards Puente la Reina (Nava- rre), where it joins up with the other four main trails of the French Santia- go Route. These beautiful landscapes are dotted with architectural gems. In the past, the Santiago Route was one of the first gateways for the introduction of romanesque architecture. Jaca Cathe- dral became the model which was emulated along the length and influence of the route. In addition to this singular monu- ment, there are other examples of this fascinating style on or near the main trail, such as San Adrian de Sasabe and Santa Maria de Iguacel, San Vicente de Aruej and San Andres de Abay, San Juan de la Peña and Santa Cruz de la Seros, San Juan de Maltray and San Jacobo de Ruesta. Witness to other ages are the prehistoric dolmens, the vestiges of Roman times, the large Gothic and Renaissance houses and the baroque and neoclassical churches. -

Accesos Teléfonos De Interés Zegama
CAMINO DE SANTIAGO El Camino del interior en Álava ´ ZEGAMA - AGURAIN/SALVATIERRA ZEGAMA PARQUE NATURAL AIZKORRI-ARATZ Calzada de San Adrián Portuzarra San Adrián GORDOA Calzada Udala Calzada de de Aldakio Aratz Berokia GALARRETA ZUHATZU LUZURIAGA DONEMILIAGA/ ZUAZO DE SAN MILLÁN Marutegi ZALDUONDO ERDOÑANA/ ORDOÑANA ROBLEDALES-ISLA ARAIA DE LA LLANADA ALAVESA MEZKIA AMETZAGA ALBEIZ/ EGILATZ/ AGURAIN/ ALBÉNIZ SALVATIERRA EGUILAZ Dolmen de Aizkomendi ILARDUIA Descarga de información y tracks : www.araba.eus ACCESOS i TELÉFONOS DE INTERÉS Parketxe de Aizkorri-Aratz (Araia): 688 629 932 Museo Etnográfico (Zalduondo): BERGARA 945 30 43 93 Oficina de Turismo de Salvatierra: 945 30 29 31 ARRASATE/ GI-632 MONDRAGÓN BEASAIN N-240 A-627 AP-1 Zegama GI-2637 N-1 N-622 Agurain/ Salvatierra VITORIA- N-1 ALTSASU GASTEIZ CAMINO DE SANTIAGO El Camino del interior en Álava ´ ZEGAMA - AGURAIN/SALVATIERRA Km 0 ZEGAMA. Partimos del casco urbano de Zegama adentrándonos en el Parque Natural de Aizkorri- Aratz. Los viajeros de épocas pasadas citaban esta etapa en sus crónicas como un paso complicado y peligroso en una zona plagada de bandidos. Para los peregrinos de hoy en día es bastante más accesible aunque tendrán que estar preparados para el desnivel de esta bonita etapa. Km 7,8 SAN ADRIAN. Una vez pasada la ermita del Sancti Espiritu, que fue antiguo hospital de peregrinos, la antigua calzada se adentra en el mítico túnel de San Adrián, habitado desde la prehistoria y en el que durante la Edad Media se localizó un castillo del reino de Navarra. La ermita que actualmente encontramos Poco antes de alcanzar Zalduondo, queda a nuestra en su interior es de reciente construcción y sustituyó a izquierda la ermita románica de San Julian y Santa otra de origen medieval. -

WAY of ST. JAMES in the BASQUE COUNTRY This Is the Stage Where You Leave the Province of Gipuzkoa and Cross Over Into LE CHEMIN DE COMPOSTELLE AU PAYS BASQUE Alava
THE WAY OF ST. JAMES IN THE BASQUE COUNTRY This is the stage where you leave the province of Gipuzkoa and cross over into LE CHEMIN DE COMPOSTELLE AU PAYS BASQUE Alava. There are few border crossings as intriguing as the Tunnel of San Adrián, Section a cave carved into the rock by the action of water and the passing of time. After WAY OF Donostia climbing up and over the medieval road, the landscape takes on a different feel. ZEGAMA > San Sebastián You’re now in the Llanada Alavesa, the drier plains of Alava, which stand in sharp PORTUZARRA / ST. JAMES contrast to the lush green valleys of Gipuzkoa. Here, the landscape is dominated Bilbao by rain-fed crops and lazy, sun-basked villages dotted with impressive baroque and ALTO DE LA HORCA renaissance mansions. CHEMIN DE Au revoir Guipúzcoa, bienvenue en Álava : les deux territoires revêtent ici leurs habits COMPOSTELLE ZEGAMA km 0 ZEGAMA. Starting at Zegama town centre, make your way to the Gurutze de cérémonie. Il existe peu de frontières aussi belles que le tunnel de San Adrián, Santua chapel and follow the path that goes along the river Oria. After Vitoria-Gasteiz une grotte creusée dans la roche par l‘action de l’eau et le passage du temps. Après AGURAIN / passing several farmhouses and an old hydroelectric plant, cross the main SALVATIERRA le tunnel, la chaussée médiévale nous ouvre d’autres horizons. La Plaine d’Álava a road and continue uphill along a smaller, local road. As you’re heading up the peu de points communs avec les vallées voluptueuses de Guipúzcoa. -
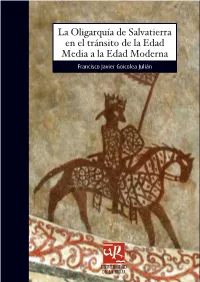
Texto Completo Libro (Pdf)
Este libro, centrado cronológicamente en el trán- Biblioteca sito de la Edad Media a la Edad Moderna, pretende dar a conocer algunos de los aspectos de Investigación característicos de la elite dirigente de un núcleo La Oligarquía de Salvatierra urbano del cuadrante nororiental de la Corona 36 El juego intelectual. Ironía y textualidad en de Castilla. Se trata de la villa alavesa de las narraciones breves de Vladimir Nabokov en el tránsito de la Edad Salvatierra, localidad que cuenta con unos fon- Asunción Barreras Gómez dos documentales privilegiados procedentes de 37 Aproximación semiótica a los rasgos generales Media a la Edad Moderna diversos archivos. La transcripción y estudio de la escritura autobiográfica de estos documentos han permitido culminar Francisco Ernesto Puertas Moya una investigación en la que se analizan los patrimonios, actividades económicas, modos de 38 Estrategias didácticas Francisco Javier Goicolea Julián vida, mentalidades y participación política de en el aula universitaria Francisco Javier Goicolea Julián Fermín Navaridas Nalda algunas de las familias que tuvieron una par- ticipación más activa en los pequeños y grandes 39 Monodía litúrgica en La Rioja: Catedral de acontecimientos históricos que afectaron a esta Calahorra, Santo Domingo de la Calzada villa de la Llanada alavesa a lo largo del siglo y Seminario Diocesano de Logrono XV y primeras décadas del XVI. Las Actas de (Siglos XII – XIX) Petra Extremiana Navarro las Juntas Generales de Álava ponen de mani- fiesto el activo papel desempeñado por miembros 4o Envejecimiento y sociedad. de las familias Santa Cruz, Zuazo, Oquerruri, Una perspectiva pluridisciplinar Luzuriaga, Paternina o Vicuña en la política Joaquín Giró Miranda (coord.) provincial; si bien, la máxima preocupación de 41 El estudio de los relatos de Vladimir Nabokov. -

Goierri Tolosaldea
Goierri Tolosaldea HEART OF THE BASQUE COUNTRY RURAL PARADISE CŒUR DE L’EUSKADI PARADISE RURAL A-1 GI-3210 Andoain Greenways Markets Donostia Voies vertes Marchés San Sebastián Bike lanes Tunnel Aduna Piste cyclable Tunnel GI-631 Zizurkil Information office Agritourism Andatzarrate GI-3282 GI-3210 Bureau d’information Agritourisme Asteasu A-15 GI-3174 Historic Quarter or Historic Buildings Rural Stays Iturriotz GI-2631 M GI-3841 Centre historique ou Ensemble monumental Maison de tourisme rural Azpeitia Villabona Larraul Amasa GI-3173 MuseumsAzkoitia and Interpretation Centres Youth hostel GI-3630 Musées et Centres d’interprétation GI-2634 Auberge de Jeunesse The Camino to Santiago Hotel A-1 Loiola Alkiza Oria Chemin de Saint Jacques Hôtel GI-2635 GI-2634 M Irura BTT centre Bed & Breakfast GI-3630 Hernio Centre BTT Pension 1.075 HERNIO Anoeta Basque Country Trail Station Tourist apartment GATZUME Station de Trail du Pays Basque Appartement touristique GI-3740 Special Area of Uzturre Conservation (SAC) Hernialde 730 Parking camping-car GI-3182 Tourist hostel Zone spéciale de Beotibar Parking for motorhomes Auberge touristique conservation (ZSC) Izaskun GI-3720 M GI-2130 Nuarbe Tolosa Bidania-Goiatz Urkizu Belauntza Albiztur M Aratz Erreka GI-3714 Ibarra GI-3212 Goierri GI-2634 GI-3720 GI-3881 N-130 GI-3803 Aldaba Txiki Leaburu GI-631 GI-3042 Intxurre Tolosaldea 743 Aldaba Oria GI-3620 Matxinbenta Santa Marina GI-3712 GI-631 Altzo Lizartza Ikaztegieta Aldaola Araxes Urretxu GI-3541 Alegia Zumarraga GI-3670 Mandubia A-1 Otsabio GI-632 GI-2630 -

Nuevas Cavidades En El Karst De Aizkorri-Aratz (Sector Sur Del Túnel De San Adrián, Gipuzkoa)
NUEVAS CAVIDADES EN EL KARST DE AIZKORRI -ARATZ (SECTOR SUR DEL TÚNEL DE SAN ADRIÁN , GIPUZKOA ) New cavities in Aizkorri-Aratz karst (Southern sector of San Adrian tunnel, Gipuzkoa) Carlos GALÁ N; Jose RIVAS; Marian NIETO; Daniel ARRIETA & Iñigo HE RRAIZ. Laboratorio de Bioespeleología. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Febrero 2013. NUEVAS CAVIDADES EN EL KARST DE AIZKORRI -ARATZ (SECTOR SUR DEL TÚNEL DE SAN ADRIÁN , GIPUZKOA ) New cavities in Aizkorri-Aratz karst (Southern sector of San Adrian tunnel, Gipuzkoa) Carlos GALÁN; Jose RIVAS; Marian NIETO; Daniel ARRIETA & Iñigo HERRAIZ. Laboratorio de Bioespeleología. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Alto de Zorroaga. E-20014 San Sebastián - Spain. E-mail: [email protected] Febrero 2013. RESUMEN Al Sur del túnel-cueva de San Adrián (karst de Aizkorri-Aratz) las calizas de edad Cretácico temprano forman una serie de abruptos paredones verticales. La caliza está compartimentada en bloques, cuyo drenaje subterráneo es independiente del de otros sectores de Aizkorri. Sobre las paredes se puede observar desde lejos varias bocas de cuevas, colgadas a distintas alturas. El sector, dado su difícil acceso, permanecía inexplorado. En salidas sucesivas exploramos sobre el bloque Sur, donde se localiza la Cueva de San Adrián (que es parte del mismo bloque), un conjunto de diez cavidades, que describimos en esta nota. Se presenta también información sobre fauna cavernícola de estas cavidades y se comentan sus características hidrogeológicas. Palabras clave: Karst, espeleología física, hidrogeología, bioespeleología, fauna cavernícola. ABSTRACT Southern of San Adrian tunnel-cave (Aizkorri-Aratz karst), the early Cretaceous limestones form a series of steep vertical walls. The limestone is compartmentalized into blocks, which underground drainage is independent of from other sectors of Aizkorri.