Le Nouvel Esprit De L'université
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Feuillet Charleroi 2020
Bulletin trimestriel, 31ème année, 1er trimestre, février 2005 Editeur responsable : Jean-Marie Duvosquel 3, rue du Château - B-6032 Charleroi - Wallonie www.wallonie-en-ligne.net HPôle Prospective Programme The Futures of Europeans Tuesday April 12, 2005 in the Global Knowledge 20.00 Welcoming Evening Reception , Mercure Hotel, Louvain-la-Neuve Society Wednesday April 13, 2005 A Meeting Place for Europeans 8.30 Morning coffee creating Futures 9.00 Opening plenary session :The Futures of Europe Chair : Philippe Destatte, director of The Destree Institute (Wallonia), hat unique challenges does the Knowledge Society pre- Brussels-Area Millennium Project Node Chair, Scientific Director sent to Europe? How can futures studies help create of the European College of Regional Foresight - DATAR (Paris) W effective strategies to meet those challenges? How can Welcome address : futures studies contribute to strategies for success for European Bernard Coulie, Rector of the Catholic University of Louvain- companies and private sector organizations? How can futures la-Neuve studies assist Europeans in clarifying their change issues with Louis Michel, Member of the European Commission regard to the key challenges facing the world as a whole? 10.00 Keynote speakers : Addressing these critical questions is the main objective of this Jerome C. Glenn, Director of the Millennium Project conference. (Washington), The Futures of Europe Maria João Rodrigues, President of the European Advisory So, the Conference "The Futures of the European in a Global Group for Social Sciences, Professor at ISCTE University Knowledge Society" will focus on the following actions : Institute (Lisbon) – identify common emerging challenges for Europe and deve- 10.45 Break lop actions to meet these challenges. -
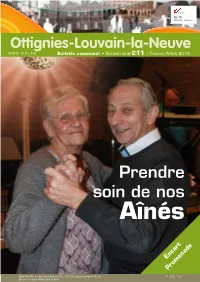
Prendre Soin De Nos Aînés :Annie Galban-Leclef, Rue De Spangen, 44 À 1341 Mousty Editeur Responsable Encart
PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Ottignies-Louvain-la-Neuve www.olln.be Bulletin communal • Bimestriel n°211 – Février/Mars 2018 Prendre soin de nos Aînés :Annie Galban-Leclef, rue de Spangen, 44 à 1341 Mousty Editeur responsable Encart Promenade Hôtel de Ville, av. des Combattants, 35 - 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve P 3 0 2 1 6 3 Bureau de dépôt Mont-Saint-Guibert Ottignies-Louvain-la-Neuve Le nouveau T-Roc. DÉCOUVREZ LE NOUVEAU T-ROC AU GARAGE HERMAND À CÔTÉ DE LA GARE Et toute la gamme VW et VW Utilitaires Pionnière du secteur, La Biosphère a accompagné activement l’évolution du bio depuis ses débuts. wavre Elle offre une gamme unique de produits… Et du frais, plus frais que frais ! 100% bio - 100% respect - 100% engagé La Biosphère privilégie la filière courte ou directe quand les produits viennent de l’étranger. Elle s’implique dans les relations avec ses producteurs comme avec ses clients. Elle prend en compte les réalités de terrain et s’adapte en fonction des possibilités de chacun - à l’exact opposé de la grande distribution ottignies qui impose à tous ses conditions. LLN Acheter du bio en filière courte, c’est construire DEMAIN ! Ouvert 7 jours sur 7 Bld du Centenaire 8 1325 Chaumont-Gistoux tél 010 24 34 41 www.labiosphere.be Encart ottignies LLN.indd 1 23/09/16 17:16 Ottignies-Louvain-la-Neuve Madame, Monsieur, C'est avec grand plaisir que je vous invite à découvrir ce premier Bulletin de 2018, dont le dossier est consacré aux séniors. Prendre soin des aînés, voilà bien un enjeu de plus en plus important dans notre société actuelle. -

LE JOUR ET LA NUIT Idées Reçues Sur Le Folklore Et L’Animation Néo-Louvanistes
LE JOUR ET LA NUIT Idées reçues sur le folklore et l’animation néo-louvanistes À l’attention toute particulière des habitants de Louvain-la-Neuve et des nouveaux étudiants de l’Université catholique de Louvain. Where will your next step take you? The next step in your career is the big one. Are you looking for lots of options? Do you want to develop valuable skills? Make time for life outside work? Be part of a team culture that brings out the best in you? It’s your future. How far will you take it? Make the leap at www.careers.deloitte.com Une production ASBO Avec le soutient du GCL, de la Fédé, de l’AGL et de l’UCL © 2009 Deloitte Belgium Cette brochure est la réalisation d’un projet vieux de plusieurs années, ayant germé après de longs débats passionnés jalonnant nos vies d’étudiants impliqués dans le monde de l’animation néo-louvaniste, notam- ment au contact de Xavier Renders et de son cabinet du Vice-Rectorat aux Affaires étudiantes de l’UCL. Il aura finalement fallu 3 ans de recul pour relancer et concrétiser ce projet, basé entre autres sur le travail préliminaire de Christophe Petre et Nicolas Pitance. Mais ce projet n’aurait pas vu le jour si nous n’avions pas reçu un soutien massif de toutes parts. Remercions d’abord les personnes qui ont soutenu moralement cette initiative : l’Ordre Académique de Sainte Barbe, le GCL, la Fédé, l’AGL, l’Organe, le Vice-Rectorat aux Affaires étudiantes de l’UCL, et princi- palement Xavier Renders et Anne Van Laethem. -

United States of America
Belgian Economic Mission to the UNITED STATES OF AMERICA 22-30 June 2011 Belgian Economic Mission to the UNITED STATES OF AMERICA Organised by the regional institutions for Foreign Trade (Brussels Export – Invest in Brussels, Flanders Investment & Trade – FIT, the Wallonia Foreign Trade and Investment Agency – AWEX), FPS Foreign Affairs and the Belgian Foreign Trade Agency. 22 - 30 June 2011 1 2 3 BELGIAN ECONOMIC MISSIONS CALENDAR 2011-2012 2011 RUSSIA April 3 - 8 UNITED STATES OF AMERICA June 22 - 30 CHINA October 19 - 29 CHILE & PERU November 19 - 25 2012 VIETNAM March 10 - 16 JAPAN June 2 - 8 TURKEY October 14 - 19 AUSTRALIA & NEW ZEALAND November 18 - 28 (The dates are subject to change) 2 3 HRH PRINCE PHILIPPE OF BELGIUM 4 5 HRH Prince Philippe was born on April 15, The Prince holds an Honorary Doctorate from The Prince is keenly interested in the situation 1960, in Brussels, Belgium, as the first child the Katholieke Universiteit Leuven (2002). of young people and their integration in the of HM King Albert II and HM Queen Paola. society of tomorrow. He regularly visits schools He is first in line for succession to the throne As a result of his increasing number of com- and universities, but also closely follows such of Belgium and, as such, bears the title of mitments, the “Household of Prince Philippe” important social issues as unemployment and Duke of Brabant. was created in 1992. the struggle against poverty and exclusion. On December 4, 1999, the Prince married On August 6, 1993, by government decree, In May 1997, Prince Philippe was appointed Miss Mathilde d’Udekem d’Acoz. -

Projets De Recherche 2008
PROJETS DE RECHERCHE 2008 DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE ÉCONOMIE, EMPLOI ET RECHERCHE DÉPARTEMENT DES PROGRAMMES DE RECHERCHE PROJETS DE RECHERCHE 2008 DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE ÉCONOMIE, EMPLOI ET RECHERCHE DÉPARTEMENT DES PROGRAMMES DE RECHERCHE TABLE DES MATIÈRES Préface 7 Introduction 9 Les programmes mobilisateurs 13 Le programme Winnomat 2 17 Le programme Waleo 3 21 AMOVIM 24 ANTIBODY 26 BIOSE 28 CARDIOSAVE 30 GPCRLIKE 32 HYDRASANTE 34 HYPRO2COM 36 NEUROS 38 ORTHOGEN 40 RAIDGBS 42 RAPPARAY 44 SENSENDO 46 Le programme EnergyWall 49 COGETHER 52 EMETSURF 54 EVERFIRE 56 THERM+ 58 Les programmes FIRST 61 Le programme FIRST Spin-off 65 ADAPT 66 AMPACIMON 68 APTAVISION 70 BIOXODES 72 ERGOFACE 74 FERUZYME 76 INFOSURF 78 KIT 80 NODUS 82 PRISM 84 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES PROTEC 86 PROTIT 88 REMED 90 SCALAB 92 SCIP 94 THYMUP 96 VITALITY 98 Le programme FIRST Post-Doc 101 BIOVAG 102 CHICOPAT 104 CYCLOCUR 106 DIAGPORI 108 GASIR-AT 110 GETALLH5 112 MIFORVEG 114 MUNA 116 NIRINTOL 118 RPQFLAT 120 SIMUCAL 122 SOUBIRO 124 TABLOID 126 TOXIC 128 Le programme FIRST Hautes Ecoles 131 ENZYGOX 132 FRUITAOX 134 HIPOPCOM 136 ICARE 138 IMAGINE 140 MICOS 142 MPLPLUS 144 PHOEBUS 146 REDBOUES 148 THERALEV 150 VEGELED 152 Le programme FIRST DOCA 155 2 Table des matières TABLE DES MATIÈRES INTERMES 156 MEREHO 158 PLACAREF 160 Les centres de recherche agréés 163 Les recherches collectives 167 BCC-BAT 170 BESLAG 172 CO2FLEX 174 PREDICOR 176 RETERMAT 178 SIMSEMSO 180 SIPRIMER 182 TICOPIM2 184 TRAINEAU 186 VTGHT 188 YUMABS 190 Les guidances -

Armenian Philology in the Modern Era Handbook of Oriental Studies Handbuch Der Orientalistik
Armenian Philology in the Modern Era Handbook of Oriental Studies Handbuch der Orientalistik section eight Uralic and Central Asian Studies Edited by Nicola Di Cosmo VOLUME 23/1 The titles published in this series are listed at brill.com/ho8 Armenian Philology in the Modern Era From Manuscript to Digital Text Edited by Valentina Calzolari With the Collaboration of Michael E. Stone LEIDEN | BOSTON Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Armenian philology in the modern era : from manuscript to digital text / edited by Valentina Calzolari ; with the collaboration of Michael E. Stone. pages cm — (Handbook of Oriental studies = Handbuch der Orientalistik. Section eight, Uralic & Central Asia ; volume 23/1) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-25994-2 (hardback : alk. paper) — ISBN 978-90-04-27096-1 (e-book) 1. Armenian philology. I. Calzolari, Valentina, editor of compilation. II. Stone, Michael E., 1938– PK8002.A75 2015 491’.992—dc23 2014009260 This publication has been typeset in the multilingual ‘Brill’ typeface. With over 5,100 characters covering Latin, ipa, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see brill.com/brill-typeface. issn 0169-8524 isbn 978-90-04-25994-2 (hardback) isbn 978-90-04-27096-1 (e-book) Copyright 2014 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill nv incorporates the imprints Brill, Brill Nijhoff, Global Oriental and Hotei Publishing. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. -

Qui Est Le Plus Grand Scientifique Belge?
À VOUS DE CHOISIR! QUI EST LE PLUS GRAND SCIENTIFIQUE BELGE? Qui mérite, d’après vous, le titre du plus grand scientifique belge? Eos Sciences part à sa recherche, mais c’est vous qui décidez, en votant sur notre site web. Dans ce numéro, nous vous présentons déjà la "longlist", composée par les universités belges et la rédaction. A partir de celle-ci ,un jury indépendant sélectionnera une "shortlist" de dix finalistes. Et c’est à partir de cette liste-là que vous élirez le gag- nant en septembre. Leo Apostel (1925-1995) Bakelite Company, il est devenu l’un des anticorps. Le complément – "substance" que était philosophe et à la fois grand défenseur multimillionnaires américains de l’époque. Bordet appelait à l’origine alexine – est déjà de la recherche interdisciplinaire entre les Baekeland a passé ses dernières années en présent dans le corps avant qu’il n’y ait de sciences exactes et humaines. Au centre de sa solitaire dans sa maison en Floride. D’après contact avec le microbe, alors que les anti- philosophie se trouvait souvent sa conviction le magazine Time, il compte parmi l’un des corps ne sont créés qu’après un contact entre de franc-maçon, une identité sur laquelle il cent esprits les plus influents du 20e siècle. le germe pathogène et le corps, suite à une in- fondait également ses conceptions de spiritu- fection involontaire ou à une vaccination. A alité athéistes. Il a donné son nom au centre André Berger (1942-) base du système du complément, Jules Bordet de recherche interdisciplinaire CLEA (Center a acquis une grande reconnaissance par sa a développé un test sérologique utilisé jusqu’à Leo Apostel) de la Vrije Universiteit Brussel, recherche concernant les paléoclimats, les aujourd’hui pour le diagnostic d’un grand au sein duquel philosophes, physiciens et ma- climats à l’époque préhistorique. -

Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis
NIEUWSBRIEF UNIVERSITEITSGESCHIEDENIS . LETTRE D'INFORMATION SUR L'HISTOIRE DES UNIVERSITÉS Werkgroep Universiteitsgeschiedenis Studium• generale Contactgroep Universiteitsgeschiedenis Groupe de contact pour l'histoire des universités Halfjaarlijks bulletin Deux fois par an 7de jaargang 2001 I 1 7e année Colofon Redactie: Ad Tervoort en Marc Nelissen Franck Smit, Brigitte Van Tiggelen Tekstverwerking: Els Scheers Kopij richten aan de redactieadressen in Nederland of België. Werkgroep Universiteitsgeschiedenis Redactieadres: Ad Tervoort, Vrije Universiteit, afd. VEB, De Boelelaan 1107, 1081 HV Amsterdam, tel: +31(0)20.444.56.43, fax: +31(0)20.444.56.55, e-mail: al. tervoort@dienst . vu. nI/al . tervoort@let . vu. nl; Secretariaat Werkgroep: Franck R.H. Smit, Universiteitsmuseum Groningen, Zwanestraat 33, NL-9712 CK Groningen, tel: +31(0)50.363.55.63, fax: +31(0)50.363.49.96, e-mail: [email protected] Het lidmaatschap geeft recht op de Nieuwsbrief, korting op publicaties van de Werkgroep en voor rechten bij de overige activiteiten van de Werkgroep. Contributie binnenland: flAO (€ 18,15); stu denten fl .20 (€ 9,07) . Betalingen van Nederlandse leden dienen te geschieden op gironummer 6845444 ten name van de Stichting Batavia Academica. Betalingen vanuit het buitenland mogen geen kosten voor de Werkgroep met zich meebrengen. Nederl,mdse leden die ook wensen te worden uitgenodigd voor de vergaderingen van het Belgische Studium generale, dienen dit kenbaar te maken aan het Belgische secretariaat. Studium generale Contactgroep Universiteitsgeschiedenis Groupe de contact pour l'histoire des universités Redactieadreslsecretariaat Contactgroep - Rédactionlsecrétariat du Groupe: Marc Nelissen, Universiteitsarchief K.U.Leuven, Mgr. Ladeuzeplein 21, B-3000 Leuven, tel: + 32(0) 16.32.46.32, fax: + 32(0) 16.32.47.09, marc. -

1433 LV 156 Cover 1-3.Qxd
UCL L’UCL se mobilise en faveur d’Aung San Suu Kyi Docteurs honoris causa Il y a trois mois, un groupe Cette opération comportait deux volets. Le de chercheurs et de professeurs premier s’adressait aux 54 docteurs honoris invitait l’UCL à « concrétiser causa de l’UCL encore en vie : le recteur leur a [son] soutien à [ses] docteurs envoyé un courrier leur proposant de signer la honoris causa » en lançant un tribune que nous publions ci-dessous et les invi- appel à la libération d’Aung San tant à faire publier ce texte dans la presse de leur Suu Kyi. Un appel qui coïncide- pays 1. De son côté, l’université a fait paraître rait avec le soixantième anni- dans la presse belge le texte muni de la signatu- versaire de l’opposante birma- re de ses docteurs honoris causa2. ne – célébré le 19 juin – et qui Le second volet concernait la communauté uni- interviendrait alors qu’Aung San versitaire: le 17 juin, deux jours avant l’anniversaire Suu Kyi vit sa dixième année de d’Aung San Suu Kyi, elle a été invitée à participer détention. à un rassemblement organisé dans les Halles uni- Le recteur Bernard Coulie a versitaires. Outre les autorités de l’université, un choisi de répondre positivement représentant du peuple birman et des représen- à cette demande: il a engagé la tants de l’association Actions Birmanie y assis- communauté universitaire dans taient. La communauté universitaire a également une grande action de soutien à la été invitée à signer la carte postale éditée par l’as- fondatrice et leader du mouve- sociation Actions Birmanie, reproduite ci-dessous. -

Océans: Aux Extrêmes De La Vie
LOUVAIN Mensuel p402035 Belgique – Belgïe P.P. - P.B. Bruxelles X BC9442 148 LOUVAINUCL Université catholique de Louvain – Alumni et Amis de l’UCL Juin 2004 Océans: aux extrêmes de la vie UCL ALUMNI Une nouvelle équipe rectorale L’UCL diplôme ses premiers en septembre licenciés en informatique Revue mensuelle - Ne paraît pas en janvier-février et juillet-août. Adresse d’expédition: Place de l’Université 1, 1348 Louvain-la-Neuve. Bureau de dépôt: Bruxelles X. DEL Diffusion présente CRÉATION NOUVELLE EN FRANÇAIS OPÉRA-ROCK D’ANDREW LLOYD WEBBER ET TIM RICE - ADAPTATION FRANÇAISE DE PIERRE DELANOË UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL MARIANT LA FORCE DU THÈME À CELLE DES CHANSONS, BASÉ SUR UNE MISE EN SCÈNE ORIGINALE, UNE MUSIQUE PUISSANTE ET DES INTERPRÉTATIONS POIGNANTES. Mise en scène: JEAN MARK FAVORIN Direction musicale: PASCAL CHARPENTIER Avec PEHUEN DIAZ BRUNO VINCENT HEDEN DELPHINE GARDIN PIERRE BODSON JACKY DRUAUX PATRICK RINGAL DIETER VERHAEGEN VINCENT DUJARDIN FABRICE PILLET MICHEL DESAUBIES MOÏSE FUSSEN et VINCENT BOUTRY STEVEN COLOMBEEN STÉPHANE METRO BORIS MOTTE MARIELLA ARNONE SÉVERINE DELFORGE NICOLINE HUMMEL KRISTEL LAMERICHS NATHALIE STAS… et un orchestre de 11 musiciens. Ass. à la mise en scène: MARIE-PAULE CHARLIER Ass. à la direction musicale: HÉLÈNE CATSARAS Scénographie: PATRICK de LONGRÉE Costumes: MICHAËL TREVISANATO Maquillages: JEAN-PIERRE FINOTTO Chorégraphie: JOËLLE MORANE Eclairages: CHRISTIAN STENUIT Son: MARCO GUDANSKI Produit par PATRICK de LONGRÉE et RINUS VANELSLANDER ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE DU 7 JUILLET AU 14 AOÛT 2004 | RÉSERVATIONS: 070/224.304 L Une production DEL Diffusion avec l’aide du Ministère de la Culture de la Communauté Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et de la Province du Brabant wallon, avec l’appui de BACARDI-MARTINI, HECHT, RENTPLAN RENT A CAR et ERMENEGILDO ZEGNA. -

Univ.-Prof. Mag. Dr. Tara L Andrews Institut Für Geschichte Universität Wien Universitätsring 1 A-1010 Wien +43 1 4277 40864 [email protected]
Univ.-Prof. Mag. Dr. Tara L Andrews Institut für Geschichte Universität Wien Universitätsring 1 A-1010 Wien +43 1 4277 40864 [email protected] " ACADEMIC POSTS Sep 2016– — University Professor of Digital Humanities Institut für Geschichte, Universität Wien Aug 2013–Aug 2016 — Assistant Professor of Digital Humanities Phil.-Hist. Fakultät, Universität Bern Oct 2010–Jun 2013 — Post-doctoral researcher in Greek Studies Faculteit Letteren, KU Leuven Oct 2009–Sep 2010 — Departmental Lecturer in Byzantine History History Faculty, University of Oxford Oct 2008–Sept 2009 — Tutor in introductory Classical Armenian Oriental Institute, University of Oxford EDUCATION D.Phil. in Oriental Studies, Linacre College, University of Oxford — 2009 Supervisor: Professor Theo M. van Lint Examiners: Dr Catherine Holmes (Oxford) and Prof. Bernard Coulie (UCLouvain) Thesis: Prolegomena to the Critical Edition of the Chronicle of Matthew of Edessa, with a Discussion of Computer-Assisted Methods Used to Edit the Text (available at: http://ora.ouls.ox.ac.uk/objects/uuid:67ea947c-e3fc-4363-a289-c345e61eb2eb) M.Phil. in Byzantine Studies, University College, University of Oxford — 2005 Supervisors: Dr Timothy Greenwood and Prof. Elizabeth Jeffreys Dissertation: An Investigation of the Chronology and Sources in Book 1 of the Chronicle of Matthew of Edessa B.Sc. in Humanities and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA — 1999 Concentrations: History; electrical engineering and computer science FUNDING AWARDED swissuniversities CUS-P2 Project funding, SCALE-UP, 2015 (as work package leader). SFr111,300. SNF Project funding (Div I) grant 162736 “Das Kloster-Tagebuch des Einsiedler Paters Joseph Dietrich, 1670-1704. Kommentierte Online-Edition", 2015 (as co-applicant). -
Research at the De Duve Institute and Brussels Branch of the Ludwig Institute for Cancer Research
Research at the de Duve Institute and Brussels Branch of the Ludwig Institute for Cancer Research August 2008 Introduction 3 Miikka Vikkula 8 Frédéric Lemaigre 15 Annabelle Decottignies 20 Charles de Smet 25 Emile Vanschaftingen 28 Françoise Bontemps 35 Jean-François Collet 40 Louis Hue 45 Fred Opperdoes 52 Pierre Courtoy 60 Etienne Marbaix 68 Jean-Baptiste Demoulin 73 Jean-Paul Coutelier 77 Thomas Michiels 81 Pierre Coulie 86 LICR Benoît Van den Eynde 96 Etienne De Plaen 103 Pierre van der Bruggen 105 Nicolas Van Baren 115 Jean-Christophe Renauld 120 Stefan Constantinescu 126 The de Duve Institute 1 2 THE DE DUVE INSTITUTE: AN INTERNATIONAL BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE In 1974, when Christian de Duve founded the Institute of Cellular Pathology (ICP), now renamed the de Duve Institute, he was acutely aware of the constrast between the enormous progress in biological sciences that had occur- red in the 20 preceding years and the modesty of the medical advances that had followed. He therefore created a research institution based on the principle that basic research in biology would be pursued by the investigators with complete freedom, but that special attention would be paid to the exploitation of basic ad- vances for medical progress. It was therefore hi- ghly appropriate for the Institute to be located on the campus of the Faculty of Medicine of Emile Van Schaftingen the University of Louvain (UCL). This campus is located in Brussels. The University hospital (Clinique St Luc) is located within walking dis- The main commitment of the members of tance of the Institute.