Justice, Vengeance, Trahison Dans La Légende D'ogier Le Danois
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tradition Et Renouvellement Dans La Chanson De Geste Tardive: Doon De Mayence Et Gaufrey
Tradition et renouvellement dans la chanson de geste tardive: Doon de Mayence et Gaufrey by MARINA LUSHCHENKO B.A., Simon Fraser University, 2004 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (French) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA April 2006 © Marina Lushchenko, 2006 11 ABSTRACT Written towards the close of the Middle Ages (late 13th - early 14th centuries) and rather neglected until now, the epic songs of Doon de Mayence and Gaufrey deserve nonetheless a study, because, in addition to their considerable literary value, they make it possible for us to understand the evolution of French medieval epic poetry. The object of the research is to evaluate the importance of tradition in these comparatively late works and, at the same time, to examine the innovations, laying particular emphasis on the authors' originality. To study intertextual references to other epic songs and Arthurian romances, to analyze versification and composition of the given songs, to take a look at epic rhetoric and the system of characters, - such are the stages of the present study. First conclusion : Doon de Mayence and Gaufrey are both at the junction of epic and romance traditions. Second conclusion : the epic songs in question borrow differently from these two genres. Third conclusion : realistic features add to the narration, making it, consequently, less archaistic. iii TABLE DES MATIERES Abstract • ii Table des matieres iii Remerciements -v CHAPITRE I Introduction ..: 1 CHAPITREII Genese de Doon de Mayence et de Gaufrey 5 2.1 Chansons de geste: formation de cycles 5 2.2 Emprunt d'episodes aux chansons de geste 14 2.3 Sources arthuriennes .". -
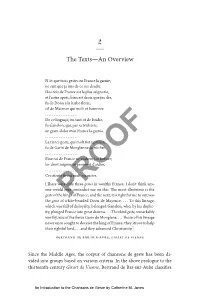
Jonesexcerpt.Pdf
2 The Texts—An Overview N’ot que trois gestes en France la garnie; ne cuit que ja nus de ce me desdie. Des rois de France est la plus seignorie, et l’autre aprés, bien est droiz que jeu die, fu de Doon a la barbe florie, cil de Maience qui molt ot baronnie. De ce lingnaje, ou tant ot de boidie, fu Ganelon, qui, par sa tricherie, en grant dolor mist France la garnie. La tierce geste, qui molt fist a prisier, fu de Garin de Monglenne au vis fier. Einz roi de France ne vodrent jor boisier; lor droit seignor se penerent d’aidier, . Crestïenté firent molt essaucier. [There were only threegestes in wealthy France; I don’t think any- one would ever contradict me on this. The most illustrious is the geste of the kings of France; and the next, it is right for me to say, was the geste of white-beardedPROOF Doon de Mayence. To this lineage, which was full of disloyalty, belonged Ganelon, who, by his duplic- ity, plunged France into great distress. The thirdgeste , remarkably worthy, was of the fierce Garin de Monglane. Those of his lineage never once sought to deceive the king of France; they strove to help their rightful lord, . and they advanced Christianity.] Bertrand de Bar-sur-Aube, Girart de Vienne Since the Middle Ages, the corpus of chansons de geste has been di- vided into groups based on various criteria. In the above prologue to the thirteenth-century Girart de Vienne, Bertrand de Bar-sur-Aube classifies An Introduction to the Chansons de Geste by Catherine M. -

Société Rencesvals
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE de la SOCIÉTÉ RENCESVALS (pour l’étude des épopées romanes) Fascicule n° 37 2005-2006 Université de Liège BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE de la SOCIÉTÉ RENCESVALS (pour l’étude des épopées romanes) Fascicule n° 37 2005-2006 Université de Liège INFORMATIONS DIVERSES MEMBRES FONDATEURS Belgique : Mme Lejeune, MM. Jodogne (†) et Horrent (†). Espagne : MM. Menéndez Pidal (†), Lacarra (†) et de Riquer. France : MM. Frappier (†), Le Gentil (†) et Louis (†). Grande-Bretagne : M. McMillan (†). Italie : MM. Monteverdi (†), Roncaglia (†) et Ruggieri (†). Suisse : M. Burger (†). BUREAU INTERNATIONAL Le Bureau international est composé des membres du bureau en exercice. Tous les présidents d’honneur en font partie de droit. Présidents d’honneur : 1955-1973 : M. Pierre Le Gentil (†), France. 1973-1978 : M. Maurice Delbouille (†), Belgique. 1978-1982 : M. Martín de Riquer, Espagne. 1982-1985 : M. Gerard J. Brault, États-Unis. 1985-1988 : M. Cesare Segre, Italie. 1988-1991 : Mlle Madeleine Tyssens, Belgique. — 3 — 1991-1994 : M. François Suard, France. 1994-1997 : M. Wolfgang van Emden (†), Grande-Bretagne. 1997-2000 : M. Bernard Guidot, France. 2000-2003 : M. Alberto Varvaro, Italie. Bureau 2003-2006 Président : M. Philip Bennett, professeur à l’Université d’Édimbourg. Vice-présidents : Mme Catherine M. Jones, professeur à l’Université de Géor- gie, USA. M. Claude Roussel, professeur à l’Université de Clermont- Ferrand. Secrétaire : Mme Nadine Henrard, chargée de cours à l’Université de Liège, rue de Wandre, 2, B-4610 Bellaire. COMITÉ DE DIRECTION Les membres fondateurs et les membres du Bureau Internatio- nal en font partie de droit. Chacune des Sections nationales y est représentée par deux des membres de son bureau. -

DE HITON DE BORDEAUX a Thesis Presented to the French
ANALYSE ET ETUDE LITTERAIRES DE HITON DE BORDEAUX A Thesis Presented to the French Department of Mc Gill U:hive:rsi ty In Partial Fulfilment of the Requirements of the Degree of H.a.ster of Arts by J ean-M8.rcel Paquette August 1964 lNTRODUCTIOff •••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••~~ P~ 1 PREMIERE PARTIE: MATIERE CHAPITRE PREMIER: De l'histoire A la légende •••••••••••••••••• CF..APITRE DEUXIEMEt Autour de Charlemagne ...... ~~~ .......... ~~. p~ tb DEUXIEME PART!Et CON JOINTURE CHAPITRE TROISIENE: Les éléments romanesques ••••••••••••• ••... P• a.~ CHAPITRE QUATR~Œ: Les éléments féeriques ••••••••••••••••••~• p~~ TROISmŒ PARTIE: SENEFIANCE" CHAPITRE Cn:IQ~Œ: L'aventure et ses symlx>les •••••••••••• ••.. P• 5 s- CHAPITRE SIXIEME: Colœlusion: La conta:mihation des genres • • • • • p~ ~ 1- NOTES" ••••••••••••••••••••••••• ·-· •••••••••••••••• ·-······........ p. q 1- BIBLIOGRAPHIE •·• •. • • .... •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •. •. • •. •. • • • •• • • • • P•' \ 0 ' INTRODUCTION n semblera- d 1abord paradoxal que les trois mots de MATIERE, de CONJOTh"TURE et de SIDTEFIANCE, appartenant au vocabulaire du roman cour tois, servent, chacun, de titre aux trois parties de cette étude eon sacrée à une chanson de geste du cycle carolingien~ Cela est d'O., en partie, A ce que, Huon de Bordeaux constituant une oeuvre complexe, l'objet de la présente th~se sera d'établir jus- qu•·~. quel point l'oeuvre, d'apparence épique, a subi la contaminatfon du genre romanesque. Les médiévistes désignent par le mot de MATIERE, 11 ensemble des sources, historiques ou littéraires, dont ont pu s'inspirer les po~tes et les romanciers du Moyen Age. Ainsi parle-t-on de "mati~re bretonne" pour les romans arthuriens, et de "mati~re antiquen pour les romans, tel que le Roman d'Alexandre, inspirés des oeuvres et des th~es de r•·antiqufté. -

Para Estudiar La Imagen Épica De Francia En La Literatura Caste
PERSONAJES DE LA ÉPICA FRANCESA EN LA LITERATURA CASTELLANA MEDIEVAL ANA M.A MUSSONS Para estudiar la imagen épica de Francia en la literatura caste- llana medieval hemos de ir a parar forzosamente al Romancero, las crónicas o a relatos como La Gran conquista de Ultramar. Induda- blemente el trabajo sería mucho más fácil si lo que nos planteára- mos aquí fuera la imagen de España en la épica francesa, porque la mayoría de los cantares de gesta franceses narran historias que transcurren en España: Barcelona, Gerona, Balaguer, Barbastro, Gandía, Toledo, Córdoba ...por citar sólo algunos de los topónimos que podemos encontrar. Es evidente que, como zona fronteriza, la marca hispánica se ofrecía como algo enormemente atractivo para desarrollar el germen de las leyendas guerreras de Carlomagno o de otros héroes de gran talla como Roldán, Renaut de Montauban, Girart de Roussillon, Guillermo... y que la Reconquista española pre- sentaba la posibilidad de aproximación de las cruzadas de Oriente, tan alejadas. Por este motivo, quizás, reciben el mismo tratamiento y, en los cantares de gesta, turcos, eslavos, árabes o bretones son catalogados indistintamente como enemigos de Francia sin más par- ticularizaciones. Grisward, en su obra Archéologie de l'épopée médiévale/ afirma que España representa, dentro de la épica francesa, la guerra, mien- tras que Italia es la riqueza y Francia la soberanía, de esta manera se reparten imaginariamente las tres funciones con que se caracte- riza la ordenación de las civilizaciones indoeuropeas. La geografía española que puede recorrerse en los cantares de gesta franceses puede ser fantástica e interpretable en sentidos muy diversos, entre 1. -

La Chanson De Roland
Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lachansonderolOOgaut Ef LA CHANSON DE ROLAND TEXTE CRITIQUE TRADUCTION ET COMMENTAIRE LÉON GAUTIER PEOFESSEOE A L'ÉCOLE DES CHABTBS OUVRAGE COURONNE PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE ET PAR l'aCADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES -LETTRES CINQUIÈME ÉDITION /v'^—0$ TOURS ALFRED MAME ET FILS, ÉDITEURS M DCCC LXXV INTRODUCTION I. — AVANT-PROPOS ET DEDICACE A tous ceux qui ignorent notre vieille poésie nationale, à tous ceux qui ont souci de la connaître, nous dédions «es quelques pages. La France, qui est la plus épique de toutes les na- tions modernes, a jadis possédé deux cents Poëmes populaires consacrés à des héros chrétiens , à des héros français. Ces poëmes étaient chantés, et se rattachaient par leur sujet à certaines familles héroïques, à certaines gestes.. De là leur nom de « Chansons de geste ». Imaginez de longs récits poétiques où plusieurs mil- liers de vers sont inégalement distribués en un certain nombre de tirades ou laisses. Et figurez -vous, dans chacun de ces couplets, tous les vers terminés à l'ori- gine par les mêmes assonances, et, plus tard, par les mêmes rimes. Telles sont les Chansons de geste; tels sont ces chants épiques de la France que toute l'Europe a connus, imités et traduits, et qui ont fait le tour du monde avec nos traditions et notre gloire. Or, la plus antique, la plus célèbre, la plus belle de toutes les Chansons de geste, c'est la Chanson de Roland. vj INTRODUCTION Nous allons parler de la Chanson de Roland. -

Rediscovering Cumulative Creativity from the Oral Formulaic Tradition to Digital Remix: Can I Get a Witness?
THE JOHN MARSHALL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW REDISCOVERING CUMULATIVE CREATIVITY FROM THE ORAL FORMULAIC TRADITION TO DIGITAL REMIX: CAN I GET A WITNESS? GIANCARLO F. FROSIO ABSTRACT For most of human history, the essential nature of creativity was understood to be cumulative and collective. This notion has been largely forgotten by modern policies that regulate creativity and speech. As hard as it may be to believe, the most valuable components of our immortal culture were created under a fully open regime with regard to access to pre-existing expressions and re-use. From the Platonic mimesis to Shakespeare’s “borrowed feathers,” the largest part of our culture has been produced under a paradigm in which imitation—even plagiarism—and social authorship formed constitutive elements of the creative moment. Pre-modern creativity spread from a continuous line of re-use and juxtaposition of pre-existing expressive content, transitioning from orality to textuality and then melding the two traditions. The cumulative and collaborative character of the oral- formulaic tradition dominated the development of epic literature. The literary pillars of Western culture, the Iliad and the Odyssey, were fully forged in the furnace of that tradition. Later, under the aegis of Macrobius’ art of rewriting and the Latin principles of imitatio, medieval epics grew out of similar dynamics of sharing and recombination of formulas and traditional patterns. Continuations, free re-use, and the re-modeling of iconic figures and characters, such as King Arthur and Roland, made chansons de geste and romance literature powerful vehicles in propelling cross- country circulation of culture. -

Société Rencesvals
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE de la SOCIÉTÉ RENCESVALS (pour l'étude des épopées romanes) Fascicule n° 18 1986-1987 A.-G. NIZET, ÉDITEUR, PARIS BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE de la SOCIÉTÉ RENCESVALS (pour l'étude des épopées romanes) Fascicule n° 18 1986-1987 A.-G. NIZET, ÉDITEUR PARIS INFORMATIONS DIVERSES BUREAU INTERNATIONAL Présidents d'honneur : M. Pierre Le Gentil, professeur honoraire de la Sorbonne, 133, boulevard du Montparnasse, Paris VIe. M. Martin de Riquer, professeur à la Faculté des Lettres de Barcelone, Rosario, 22-24, Barcelone, Espagne. M. Cesare Segre, professeur à l'Université de Pavie, via Pietro Panzeri, 10, I-20123 Milano. Président : M. Gerard J. Brault, professeur au Department of Romance Languages, Pennsylvania State University, Univer- sity Park, Pennsylvania 16802, USA. Vice-Présidents : M. Alberto Limentani, professeur à l'Université de Padoue(†). M. François Suard, professeur à l'Université de Lille, rue de Fleurus, 40, F - 59000 Lille. Secrétaire : Mlle Madeleine Tyssens, professeur à la Faculté de Philosophie et Lettres de Liège, boulevard Frère-Orban, 43/071, B - 4000 Liège. — 3 — MEMBRES FONDATEURS Belgique : Mme Lejeune; MM. Jodogne et Horrent (†). Espagne : MM. Menéndez Pidal (†) et Lacarra. France : MM. Frappier (†) et Louis. Grande-Bretagne : M. McMillan. Italie : MM. Monteverdi (†), Roncaglia et Ruggieri. Suisse : M. Burger (†). COMITÉ DE DIRECTION Les membres fondateurs et les membres du Bureau International en font partie de droit. Chacune des Sections nationales y est représentée par deux des membres de son bureau. BUREAUX DES SECTIONS NATIONALES Allemagne Fédérale : M. U. Mölk, professeur à l'Université de Göttingen, président. MM. G. Holtus, professeur à l'Université de Mayence et P. -

Jean-Louis G. Picherit L'evolution De Quelques Thèmes Épiques: La
Jean-Louis G. Picherit L'Evolution de quelques thèmes épiques: la dépossession, l'exhérédation, et la reconquête du fief Les thèmes de la dépossession du fief et de l'exhérédation sont très courants dans la chanson de geste, en particulier dans celles qui appartiennent à la geste des barons révoltés. Ce sont là en effet des injustices dont peuvent être victimes les vassaux qui, le plus souvent dans de tels cas, sont amenés à se soulever pour recouvrer leurs biens. Aussi la reconquête du fief est-elle le thème complémentaire, quasi obligatoire des deux premiers. Le bannissement ou l'exil du héros accompagne souvent la dépossession et l'exhérédation de la victime, mais pas forcément, comme nous le montrent, par exemple, le cas de Floovant, proscrit pendant sept ans par son père Clovis sans perdre ses droits, ou celui de Doon de Mayence, qui est déshérité avant d'être la victime d'une tentative d'assassinat.1 Les trois thèmes que nous nous proposons d'étudier apparaissent très tôt dans le domaine épique, puisque nous les trouvons au centre d'une de nos toutes premières chansons, celle de Gormont et Isembart. Ils continuent à se répandre par la suite jusque dans les épopées les plus tardives, celles du quatorzième siècle. C'est surtout sur deux d'entre elles que nous porterons notre attention, afin de faire ressortir les transformations profondes subies par les thèmes qui nous intéressent Dans la chanson de Gormont et Isembart, d'après ce que l'on peut reconstituer à partir du fragment que nous possédons et des œuvres françaises et étrangères qui en suivent le récit, il est clair que la dépossession et l'exil d'Isembart par le roi Louis de France constituent le tournant du poème, le thème sur lequel repose toute 1 Henri Victor Michelant et François Guessard, éds., Floovant, chanson de geste, Les anciens poëtes de la France, no. -

1 Division of Administration Quarterly Litigation Report March 2021
Division of Administration Quarterly Litigation Report March 2021 – May 2021 Docket Court Plaintiffs Defendants Cause of Action Relief Sought Current Status Counsel Number (At Any (At Any Time) Information Time) 658310 19th DOA, FP&C Lincoln Builders of Ruston, et al Breach of construction Damages, Petition for Damages filed by In house- Sec. 21 JDC contract related to leaks in interests, costs and the State on 5/30/2017; parties Bridget Denicola roof fees are working on remediation Matthew Darouse plan; remediation plan received on 1/29/2018 and Lincoln Builders working on lining up subcontractors to complete the remediation work; although it was agreed by all parties that remediation work should commence and be completed during summer break (between Memorial Day and Labor Day, 2019), the recent tornados in that area impacted the construction schedule; Settlement agreement was signed on January 22, 2020. Dismissal was signed June 11, 2020. 671,252, 19th DOA, LPAA Brown’s Auction Co., LLC & Jacob Conversion $175,342.67 Petition filed on July 6, 2018; In house-Carlos Sec. 24 JDC Brown Jacob Brown was personally Romanach served on 6-21-2019;order of preliminary default signed by the Court on July 9, 2020. 647,500 19th DOA, FP&C The Migues Deloach Company, Breach of construction Damages, Petition for Damages filed by In house- Sec. 27 JDC LLC and Hartford Fire Insurance Co contract related to corrosion in interests, costs and the State on 4/12/16; Consent Bridget Denicola Hallmark Specialty Ins. Co (third- sprinkler system piping fees Judgment -

Observations on the Grouping of Epics of Revolt in Manuscripts and Compilations
Observations on the grouping of epics of revolt in manuscripts and compilations Article Published Version Ailes, M. J. (1984) Observations on the grouping of epics of revolt in manuscripts and compilations. Reading Medieval Studies, X. pp. 3-19. ISSN 0950-3129 Available at http://centaur.reading.ac.uk/85093/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . Publisher: University of Reading All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online READING MEDIEVAL STUDIES Observations on the Grouping of Epics of Revolt in Monuscripts and Compilations * The final stages of the development of a cycle of poems are the formotion of cyclical manuscripts, and of compilations. Thus, the majority of the poems of the Guillaume cycle, the most developed of the epic cycles, have come down to us only in cyclical manuscripts. On the other hand, although poems of the cycle du roi are grouped together in some monuscripts, there is, as fur as I know, no extant manuscript which attempts to connect the poems; this reflects the relative lack of cohesion of the cycle du roi. Similarly, we can expect the grouping of epics of revolt to reflect the degree to which the cycle developed. The factors that determined the grouping of texts in a m,.:muscript indicate what were seen to be the most importont ele ments connecting the vorious poems. -

Bulfinch's Mythology the Age of Fable by Thomas Bulfinch
1 BULFINCH'S MYTHOLOGY THE AGE OF FABLE BY THOMAS BULFINCH Table of Contents PUBLISHERS' PREFACE ........................................................................................................................... 3 AUTHOR'S PREFACE ................................................................................................................................. 4 INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 7 ROMAN DIVINITIES ............................................................................................................................ 16 PROMETHEUS AND PANDORA ............................................................................................................ 18 APOLLO AND DAPHNE--PYRAMUS AND THISBE CEPHALUS AND PROCRIS ............................ 24 JUNO AND HER RIVALS, IO AND CALLISTO--DIANA AND ACTAEON--LATONA AND THE RUSTICS .................................................................................................................................................... 32 PHAETON .................................................................................................................................................. 41 MIDAS--BAUCIS AND PHILEMON ....................................................................................................... 48 PROSERPINE--GLAUCUS AND SCYLLA ............................................................................................. 53 PYGMALION--DRYOPE-VENUS