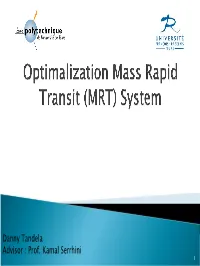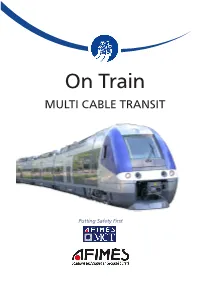Contenus
Articles
Transport
1
- 1
- Grand Paris Express
- Société du Grand Paris
- 16
22 31 41
Syndicat des transports d'Île-de-France Arc Express Réseau de transport public du Grand Paris
Urbanisme
54
54 59 63 64 65 69
Politique de la ville Agence nationale pour la rénovation urbaine Établissement public d'aménagement Opération d'intérêt national Établissement public foncier Schéma directeur de la région Île-de-France
EPCI
74
74 78 81 84
Communauté d'agglomération Liste des intercommunalités du Val-de-Marne Communauté d'agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne Communauté d'agglomération Seine Amont
Références
Sources et contributeurs de l’article
87
- 88
- Source des images, licences et contributeurs
Licence des articles
- Licence
- 90
1
Transport
Grand Paris Express
Cet article ou cette section contient des informations sur un projet de transport en Île-de-France.
Il se peut que ces informations soient de nature spéculative et que leur teneur change considérablement alors que les événements approchent.
Grand Paris Express
Situation Type
Île-de-France Métro automatique
Entrée en service
Longueur du réseau 200 km
Lignes Gares
472
Lignes du réseau Réseaux connexes TC en Île-de-France :
Métro de Paris RER d'Île-de-France Transilien Tramway d'Île-de-France
Autobus d'Île-de-France
modifier [2]
Le Grand Paris Express est un projet de réseau composé de quatre lignes de métro automatique autour de Paris, et de l'extension de deux lignes existantes. D'une longueur totale de 200 kilomètres[], il doit être réalisé par la Société du Grand Paris (SGP) dans le cadre d'un accord avec le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF).
Inscrit dans le cadre du Grand Paris, Grand Paris Express est issu de l'accord intervenu le 26 janvier 2011 entre le Conseil régional d'Île-de-France et l'État, à la suite des débats publics portant sur leurs deux projets de métro en
rocade, le Réseau de transport public du Grand Paris et Arc Express[3],[4]. Cet accord a été amendé en mars 2013
par le gouvernement Ayrault pour aboutir au projet actuel.
Histoire
Prémices
Dès le XIXe siècle, Paris disposait de deux lignes de chemin de fer en rocade : la Petite Ceinture (bouclée en 1869), faisant le tour de Paris à l'intérieur des boulevards des Maréchaux et la Grande Ceinture (terminée en 1886), formant une boucle autour de Paris à une distance de 5 à 20 km du boulevard périphérique. Ces deux lignes en rocade, qui préexistent au métro de Paris, transportaient à la fois des voyageurs et des marchandises. À ces rocades s'ajoutent plusieurs lignes de tramway, également en rocade.
Grand Paris Express
2
Le développement du métro, essentiellement radial (sauf la ligne 2 et la ligne 6, originellement appelée 2 Nord et 2 Sud), et du trafic automobile fait sensiblement chuter le nombre de voyageurs sur la Grande et la Petite Ceinture, ainsi que sur le tramway, qui est progressivement abandonné dans l'entre-deux-guerres puis après la guerre. Le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Région de Paris (SDAURP), en 1965, puis le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France (SDAURIF) en 1976, prévoient néanmoins la création d'une rocade en proche banlieue permettant de mailler le réseau radial, ainsi que plusieurs liaisons en rocade prévues en tramway, dont Saint-Denis – Bobigny. Ces projets ne voient jamais le jour, la priorité étant donnée au développement des radiales (notamment les RER) pour permettre la desserte des zones nouvellement urbanisées, dont les villes nouvelles.
Certains de ces projets seront à nouveau inscrits dans les contrats de plan État-Région ultérieurs, notamment le tramway Saint-Denis – Bobigny, le Trans-Val-de-Marne ou encore la réouverture partielle de la Grande Ceinture. Ils ne sont néanmoins pas réalisés, au profit d'Éole (RER E) ou de Meteor (ligne 14 du métro), qui mobilisent l'essentiel des crédits.
Orbitale
Lors de la révision du Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) par l'État, au début des années 1990, plusieurs projets de métro en rocade en Île-de-France sont à nouveau évoqués. Ainsi, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France (IAURIF) propose de créer deux rocades : une ligne de métro en proche couronne, proposant des stations rapprochées (un kilomètre) et maillant les liaisons radiales et une ligne plus extérieure, proche de la Route nationale 186, incluant notamment la ligne de tramway T1 et le Trans-Val-de-Marne ; la Direction régionale de l'Équipement de l'Île-de-France (DREIF) propose, elle, un réseau rapide structurant (le Ring ou Interpôles), complétant les lignes RER, et reliant les pôles de développement (Marne-la-Vallée, Créteil, Bobigny…) avec des distances plus élevées entre les stations (trois kilomètres) et une vitesse plus élevée. Ces projets répondent à deux ambitions différentes : tandis que le premier vise à structurer le cœur de l'agglomération, le second vise à favoriser le développement de pôles (polycentrisme) et à les relier entre eux[5].
C'est finalement le premier projet, nommé Orbitale, qui est inscrit au SDRIF de 1994. Néanmoins, il n'est pas engagé dans le cadre du Contrat de plan État-Région 1994-1998, en raison de son coût, les grands projets EOLE et METEOR ayant mobilisé, comme pour le contrat de plan précédent, une large part des financements publics[6]. Si plusieurs des lignes de tramway prévues par Orbitale sont réalisées dans le cadre des contrats de plan État-Région 2000-2006 puis 2007-2013, la ligne de métro en proche couronne n'est pas réalisée.
Orbitale peut être considéré comme l'ancêtre des projets Orbival, Métrophérique et Arc Express, qui ont tous repris les éléments de base de ce projet[7].
Orbival
Le 10 juillet 2006, le Conseil général du Val-de-Marne présente Orbival (contraction d'Orbitale et de Val-de-Marne), une déclinaison locale et détaillée d'Orbitale[8]. Le projet consiste à relier Val-de-Fontenay (RER A et E) à Arcueil-Cachan (RER B) en reliant l'ensemble des lignes radiales traversant le département. Selon le Conseil général, ce projet permettrait un report modal de 20 %, soit de l'ordre de 40 000 voitures de moins dans le département, ce qui désengorgerait l'A86 ; il transporterait de 250 000 à 300 000 passagers par jour.
Orbival a été porté par un consensus entre élus et collectivités de toute tendance politique du département (notamment Christian Favier, président communiste du Conseil général, et Jacques J. P. Martin, chef de l'opposition UMP du département et maire de Nogent-sur-Marne), au sein de l'association Orbival. Cette dernière regroupe de nombreuses villes du département, mais aussi la Ville de Paris, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis ou des villes des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis[9]. Dominique Bussereau, secrétaire d'État aux transports, s'est également dit « très intéressé » par le projet le 28 août 2008[10].
Grand Paris Express
3
Le projet Orbival a été intégralement repris dans Arc Express, au sein de son arc Sud, puis à son tour dans le projet de Grand Paris Express[11].
Projets initiateurs
Métrophérique
À l'occasion de la révision du Schéma directeur de la région Île-de-France, la RATP a présenté début octobre 2006 un nouveau projet de métro de rocade, appelé Métrophérique[12], inspiré du projet Orbitale.
Ce projet était constitué d'une boucle de 50 kilomètres, située à une distance de deux à sept kilomètres du périphérique (contournant le bois de Vincennes), avec 50 stations, une vitesse commerciale de 40 km/h (comparable à la ligne 14) et une fréquence inférieure à deux minutes en heure de pointe. La RATP estimait le nombre de voyageurs par jour à un million, permettant un report modal de 20 %[13]. Son coût était estimé à environ 100 millions d'euros par kilomètre, soit entre quatre et six milliards d'euros[14].
La RATP estime que Métrophérique est similaire à Arc Express, porté par le Conseil régional d'Île-de-France et inscrit dans son Schéma directeur et dans le Contrat de projets État-région 2007-2013.
Arc Express
Article détaillé : Arc Express. Arc Express était un projet de métro automatique de « rocade », autour de Paris, situé en proche couronne, d'une longueur totale de 60 kilomètres. Officiellement engagé par Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France et Pierre Mutz, préfet de la région le 5 décembre 2007, ce projet devait favoriser les liaisons de banlieue à banlieue et améliorer la desserte en transports collectifs, grâce aux correspondances proposées avec les lignes de transport en commun existantes ou en projet (métros, RER, Transiliens, tramways). Il devait également constituer un projet d’aménagement du territoire puisqu’il était prévu qu’il desserve les grands pôles économiques et d’habitat existants ou en développement de la petite couronne[]. Le projet de SDRIF adopté par le Conseil régional le 25 septembre 2008 proposait d'étudier la réalisation de quatre arcs :
• une liaison sud-est entre Val-de-Fontenay ou Noisy-le-Grand et Arcueil ou Bourg-la-Reine, pour une mise en service à l'horizon 2020 (phase 2 du SDRIF) ;
• une liaison nord-ouest entre La Défense et Saint-Denis, pour une mise en service à l'horizon 2020 (phase 2 du
SDRIF) ;
• une liaison nord-est entre Val-de-Fontenay ou Noisy-le-Grand et Saint-Denis, pour une mise en service à l'horizon
2025-2030 (phase 3 du SDRIF) ;
• une liaison sud-ouest entre Arcueil ou Bourg-la-Reine et La Défense en passant par Saint-Cloud et Suresnes ou
Rueil-Malmaison, pour une mise en service à l'horizon 2025-2030 (phase 3 du SDRIF).
De ces quatre arcs, deux étaient jugées prioritaires, au regard des besoins de déplacements, de l’offre de transport proposée et des enjeux du territoire qu'ils devaient traverser : • l'arc sud, entre Issy-les-Moulineaux et Noisy-le-Grand ou Val-de-Fontenay, tracé vraisemblablement proche du projet Orbival ;
• l'arc nord entre La Défense et Bobigny ou Pantin.
Arc Express était prévu pour l'essentiel en souterrain, avec quelques tronçons en aérien (notamment le long de l'autoroute A4). Sa vitesse commerciale devait être de 40 km/h, comme la ligne 14. La longueur des quais prévue était de 55 mètres, avec un matériel roulant de 2,80 mètres de large (contre 2,40 mètres pour le métro parisien), en roulement fer[15], en automatisme intégral sans conducteur. Il devait desservir une quarantaine de stations, distantes entre elles de 1 à 1,5 kilomètres. Le temps d'attente entre deux trains en heure de pointe pouvait descendre à 1 minute 30. Il aurait été soumis à la tarification également valable sur les autres lignes du réseau ferroviaire francilien. À
Grand Paris Express
4
terme, l’ensemble de la rocade devait accueillir 1 million de voyageurs. Le coût de la réalisation des arcs Sud et Nord d'Arc Express était estimé entre 4,8 milliards et 5,4 milliards, selon les tracés retenus (l'arc Sud varie entre 2,8 et 3,1 milliards et l'arc Nord de 2 à 2,3 milliards). Ces coûts incluaient les travaux, l'aménagement des gares et le matériel roulant[16]. Un de ces deux arcs aurait pu être mise en service à l’horizon 2017.
Réseau de transport public du Grand Paris