Cahiers D'ethnomusicologie, 6
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ethnomusicologie Et Anthropologie De La Musique: Une Question De Perspective » Anthropologie Et Sociétés, Vol
Cahiers d’ethnomusicologie Anciennement Cahiers de musiques traditionnelles 28 | 2015 Le goût musical Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/ethnomusicologie/2484 ISSN : 2235-7688 Éditeur ADEM - Ateliers d’ethnomusicologie Édition imprimée Date de publication : 15 novembre 2015 ISBN : 978-2-88474-373-0 ISSN : 1662-372X Référence électronique Cahiers d’ethnomusicologie, 28 | 2015, « Le goût musical » [En ligne], mis en ligne le 15 novembre 2017, consulté le 06 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/ethnomusicologie/2484 Ce document a été généré automatiquement le 6 mai 2019. Article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle. 1 L’étude du goût musical a rarement été appliquée aux musiques de tradition orale. Ce numéro aborde cette question non pas sous l’angle philosophique ou sociologique, mais d’un point de vue spécifiquement ethnomusicologique. Il s’agit de montrer comment des musiciens de sociétés variées, expriment et manifestent leurs goûts sur la musique qu’ils pratiquent, en fonction de leurs champs d’expérience. À partir de l’hypothèse qu’il existe partout une conception du « bien chanter » et du « bien jouer » qui sous-tend les divers savoir-faire musicaux, ce volume aborde les critères du goût musical selon plusieurs méthodes, notamment par l’analyse du vocabulaire des jugements de goût et celle des modalités d’exécution, le tout en relation aux contextes et aux systèmes de pensée locaux. Ce dossier s’attache ainsi à décrire les conceptions vernaculaires du goût musical afin d’explorer le champ -

Leydi Supporti Sonori 101001
Centro di dialettologia e di etnografia - Bellinzona Elenco dei compact-disc in ordine alfabetico (versione 06.11.2010) Titolo ‘A cantata di li pasturi Titolo A travers le grillage Il Natale nella tradizione musicale della provincia di Canti e complaintes delle Valli Valdesi Messina (Sicilia) Interprete Les Musiciens Interprete Interpreti vari Autore Autori Vari Curatore Mario Sarica ; Nuccio lo Castro Curatore Riccardo Bertalmio ; Marco Chiappero EdizioneSudnord nr.SN 0038/TA anno 1993 EdizioneStradivarius nr.20007 anno 1999 Nr. inv. BEL-2004.0002.0316 Nr. inv. BEL-2004.0002.0415 Titolo A capella Titolo Aadat Chants polyphoniques corses profanes et sacrés Tambours du Maroc Interprete Tavagna Interprete Dqa Marrakchya ; Heddawa Aissawa ; Haouariyat Edizione Silex nr.Y225201 anno 1993 Curatore Antonio Baldassarre Nr. inv. BEL-2004.0002.0104 EdizioneAl sur nr.AL CD 121 anno 1994 Nr. inv. BEL-2004.0002.0194 Titolo A dr Aelplerchilbi Interprete Chaschbi Gander ; Ländlertrio Burch-Enz ; Ruedi Titolo Ab eternu Rymann Interprete A filetta Autore Autori vari Edizione Adda nr.591061 AD anno 1992 Edizione Corema nr.0149-2 anno 1995 Nr. inv. BEL-2004.0002.0110 Nr. inv. BEL-2004.0002.0265 Titolo Achtung s’geit los! Titolo A fishermen’s festival for the Madonna del Lume Interprete Ländlertrio Hans Hänni Dottorato presso la University of California, Los Autore Hans Hänni ; Arthur Rubin Angeles Edizione Corema nr.393 125 anno 1993 Autore Giuseppina Colicci Nr. inv. BEL-2004.0002.0116 Edizione autoprodotta anno 1996 Nr. inv. BEL-2004.0002.0730 Titolo Ae Gruess zum Abschied Urchige, rassige, Ländlermusik im beliebten, Titolo A History of the Portuguese Fado altbewährten Kinzig-Stil Interprete Interpreti Vari Interprete Kapelle Echo vom Kinzig ; Kapelle Gisler Schuler ; Kapelle Gebrüder Imholz ; Trio Imholz- Edizione Ashgate anno 1998 Nr. -

MUS 360 Music in the Global Environment Instructor: Dr. Aaron I
MUS 360 Music in the Global Environment Instructor: Dr. Aaron I. Hilbun Office Location: 223 Keene Hall Office Hours: by appointment only Office Phone: (407) 691 1126 Email: [email protected] Course Objectives: Be able to identify cultures and countries from around the world. Be able to identify and classify musical instruments and genres. Be able to identify how music is used in different societies. Have a basic understanding of the development of music in different cultures. Be able to recognize and identify the cultural values of diverse musical traditions. Understand how music is linked to spirituality, politics, class and identity in other cultures. Learn appropriate ethnomusicological terminology for analyzing and describing music within social and cultural contexts. Understand how globalization affects music. Required Materials: Terry E. Miller and Andrew Shahriari, World Music: A Global Journey Reserve Readings: Catherine Ellis, Aboriginal Music: Education for Living Helen Myers, Ethnomusicology: Historical and Regional Studies Bruno Nettl, Excursions in World Music Michael Tenzer, Balinese Music Traditional Korean Music Chris McGowan and Ricardo Pessanha, The Brazilian Sound Articles from scholarly journals and newspapers as assigned Grading: Midterm Exam 20% Research project and presentation 25% Concert reports (2 at 10% each) 20% Participation in class discussion 10% Final Exam 25% Exams: A midterm exam will be given approximately halfway through the semester. The midterm will assess both your written and aural work, and will consist of multiple choice, matching and true or false questions. The final exam will be similar in nature to the midterm, except that it is comprehensive and will include material from the entire semester. -

Fondo Leydi CD 20170330
Centro di dialettologia e di etnografia - Bellinzona Fondo Roberto Leydi Elenco dei CD in ordine alfabetico di edizione (versione 30.3.2017) Titolo Anthologie de la musique arabe volume 2 Titolo The Greek tradition of Thrace Oum Kaltsoum Interprete Hronis Aidonidis Interprete Oum Kaltsoum Edizione AEM nr. 004 Edizione AAA nr.AAA 024 anno 1990 Nr. inv. BEL-2004.0002.0751 supporto CD Nr. inv. BEL-2004.0002.0180 supporto CD Titolo Traditional songs of Western Thessaly Titolo Canti popolari di Faedo (Vicenza) Interprete Hrisostomos Mitropanos Curatore Claudio Preato Edizione AEM nr. 005 EdizioneACB nr.ACB 0102 anno 2001 Nr. inv. BEL-2004.0002.0752 supporto CD Nr. inv. BEL-2004.0002.0306 supporto CD Titolo Canzoni dalla tradizione di Messolog Titolo Organetto e fisarmonica in provincia di Vicenza Edizione AEM nr. 006 Interprete Interpreti vari Nr. inv. BEL-2004.0002.0753 supporto CD Curatore Modesto Brian EdizioneACB nr.ACB 9801 anno 1998 Titolo Traditional carols of the Greeks Nr. inv. supporto BEL-2004.0002.0301 CD Edizione AEM nr. 007 Nr. inv. BEL-2004.0002.0754 supporto CD Titolo Brüzè Carvè Canti e danze tradizionali delle Langhe e del Titolo Traditional music of Crete Monferrato Edizione AEM nr. 013 Interprete Tre Martelli Nr. inv. BEL-2004.0002.0755 supporto CD Edizione ACTB nr.TM 005 anno [1991] Nr. inv. BEL-2004.0002.0250 supporto CD Titolo Traditional ballads of Epirus Titolo Ab eternu Interprete S. Siatras Curatore George Constantzos Interprete A filetta EdizioneAEM nr. AEM 008 Edizione Adda nr.591061 AD 184 anno 1992 Nr. inv. BEL-2004.0002.0089 supporto CD Nr. -

BORN, Western Music
Western Music and Its Others Western Music and Its Others Difference, Representation, and Appropriation in Music EDITED BY Georgina Born and David Hesmondhalgh UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS Berkeley Los Angeles London All musical examples in this book are transcriptions by the authors of the individual chapters, unless otherwise stated in the chapters. University of California Press Berkeley and Los Angeles, California University of California Press, Ltd. London, England © 2000 by the Regents of the University of California Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Western music and its others : difference, representation, and appropriation in music / edited by Georgina Born and David Hesmondhalgh. p. cm. Includes bibliographical references and index. isbn 0-520-22083-8 (cloth : alk. paper)—isbn 0-520--22084-6 (pbk. : alk. paper) 1. Music—20th century—Social aspects. I. Born, Georgina. II. Hesmondhalgh, David. ml3795.w45 2000 781.6—dc21 00-029871 Manufactured in the United States of America 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 10987654321 The paper used in this publication meets the minimum requirements of ANSI/NISO Z39.48-1992 (R 1997) (Permanence of Paper). 8 For Clara and Theo (GB) and Rosa and Joe (DH) And in loving memory of George Mully (1925–1999) CONTENTS acknowledgments /ix Introduction: On Difference, Representation, and Appropriation in Music /1 I. Postcolonial Analysis and Music Studies David Hesmondhalgh and Georgina Born / 3 II. Musical Modernism, Postmodernism, and Others Georgina Born / 12 III. Othering, Hybridity, and Fusion in Transnational Popular Musics David Hesmondhalgh and Georgina Born / 21 IV. Music and the Representation/Articulation of Sociocultural Identities Georgina Born / 31 V. -

Musical Practices in the Balkans: Ethnomusicological Perspectives
MUSICAL PRACTICES IN THE BALKANS: ETHNOMUSICOLOGICAL PERSPECTIVES МУЗИЧКЕ ПРАКСЕ БАЛКАНА: ЕТНОМУЗИКОЛОШКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ НАУЧНИ СКУПОВИ Књига CXLII ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ Књига 8 МУЗИЧКЕ ПРАКСЕ БАЛКАНА: ЕТНОМУЗИКОЛОШКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНОГ СКУПА ОДРЖАНОГ ОД 23. ДО 25. НОВЕМБРА 2011. Примљено на X скупу Одељења ликовне и музичке уметности од 14. 12. 2012, на основу реферата академикâ Дејана Деспића и Александра Ломе У р е д н и ц и Академик ДЕЈАН ДЕСПИЋ др ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ др ДАНКА ЛАЈИЋ-МИХАЈЛОВИЋ БЕОГРАД 2012 МУЗИКОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS ACADEMIC CONFERENCES Volume CXLII DEPARTMENT OF FINE ARTS AND MUSIC Book 8 MUSICAL PRACTICES IN THE BALKANS: ETHNOMUSICOLOGICAL PERSPECTIVES PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE HELD FROM NOVEMBER 23 TO 25, 2011 Accepted at the X meeting of the Department of Fine Arts and Music of 14.12.2012., on the basis of the review presented by Academicians Dejan Despić and Aleksandar Loma E d i t o r s Academician DEJAN DESPIĆ JELENA JOVANOVIĆ, PhD DANKA LAJIĆ-MIHAJLOVIĆ, PhD BELGRADE 2012 INSTITUTE OF MUSICOLOGY Издају Published by Српска академија наука и уметности Serbian Academy of Sciences and Arts и and Музиколошки институт САНУ Institute of Musicology SASA Лектор за енглески језик Proof-reader for English Јелена Симоновић-Шиф Jelena Simonović-Schiff Припрема аудио прилога Audio examples prepared by Зоран Јерковић Zoran Jerković Припрема видео прилога Video examples prepared by Милош Рашић Милош Рашић Технички -

Afro No-Clash Composing Syncretic African/Western Music
Afro No-Clash Composing syncretic African/Western music: eleven compositions and the frameworks for their systematic analysis by Jim Chapman BA (Dip Psych), B Mus Volume 1 Music Creative Industries Faculty Submitted for the degree of PhD at the Queensland University of Technology 2007 Keywords African musics, analysis, appropriation, aesthetics, blending, composition, cross-cultural, culture, difference, embodiment, ethnomusicology, expectancy, identity, metatheory, multivalence, participation, performance, polyrhythm, postcolonialism, repetition, simultaneity, syncretism, transformation, ubuntu, variation, Western music Abstract Afro No-Clash - Composing syncretic African/Western music: eleven compositions and the frameworks for their systematic analysis. This PhD consists of an artistic work (an album of music) and an exegesis. The album contains eleven works for a variety of ensembles, including an eight-piece pop fusion group, a string quartet, an eleven-piece a cappella ensemble, a five-piece contemporary classical ensemble and a six-piece percussion ensemble. Each of these works embraces a blend of African and Western techniques and aesthetics. These works are the result of a compositional praxis which is closely integrated with a theoretical framework that I develop in the exegesis. The purpose of the exegesis is to provide a framework from which to understand the compositions. Perspectives such as postcolonialism are immediately engaged because of the fact that two distinct world cultures are referenced by these compositions. Similarly, the musical aesthetics of the two source cultures are examined because I need to understand the ways that the value systems are expressed in musical terms, and how they might interact in cross-cultural composition. Examination of the literature reveals that there has been a trend in recent decades towards cultural analysis of cross-cultural music but very little work has been done on the technical analysis of such works (Utz 2003). -

Vom Reichtum Kalabriens
SWR2 MusikGlobal Vom Reichtum Kalabriens Von Cristiana Coletti und Wolfgang Hamm Sendung: Dienstag, 25. Juni 2019 Redaktion: Anette Sidhu-Ingenhoff Produktion: SWR 2019 SWR2 MusikGlobal können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf Mobilgeräten in der SWR2 App hören Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de Die neue SWR2 App für Android und iOS Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, online oder offline. Alle Sendung stehen sieben Tage lang zum Nachhören bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app SWR 2 MusikGlobal 25. Juni 2019, 23.03 - 24.00 Uhr Vom Reichtum Kalabriens Eine Sendung von Cristiana Coletti und Wolfgang Hamm Musik: Serenade (Stimme, surdulina) (Folk Music of Calabria, tr. 1) (3:35) Autor/in: Vom Reichtum Kalabriens - Eine Sendung von Cristiana Coletti und Wolfgang Hamm Autor/in: Kalabrien an der Südspitze des italienischen Stiefels ist reich an vielfältigen Landschaften, Gebirgszügen und Flusstälern. Ein Paradies für viele Italiener, die im Sommer dort Urlaub machen. An drei Seiten vom Meer umgeben, grenzt es im Westen an das thyrrenische, im Süden und Osten an das ionische Meer. -

16 Lewis Final Proof
Empirical Musicology Review Vol. 7, No. 1-2, 2012 Response to Richard Widdess: Music, Meaning and Culture JEROME LEWIS [1] University College London ABSTRACT: This commentary discusses the anthropological implications of Richard Widess’ paper by summarizing some anthropological approaches to music, especially focusing on the way musical participation inculcates and transmits an aesthetic orientation that guides action across cultural domains such as politics, economics and religion. The paper ends by suggesting that the heart of human culture is more likely to be an aesthetic orientation than a script or set of rules, and traces out some reasons why music does this so well. Submitted 2012 January 6; accepted 2012 July 13 KEYWORDS: BaYaka Pygmy, identity, cultural transmission, aesthetics and culture RICHARD Widdess’ excellent article makes an important contribution to understanding the locus of meaning in music, to bridging the gap between ethnomusicology and anthropology, and by emphasizing the way that music generates meaning for participants both contextually and structurally. By situating musical meaning in the diverse cultural domains that its performance and experience elicit for participants, ethnomusicological analysis can offer deep insight into the way that culture is likely to be organized in the minds, bodies and production of members of a particular society. I think that Widdess is right to argue that music embodies in its structure and in its performance a wide range of cultural schema that make it a privileged window onto -
A Basic World Music Library
The Scoville Series: Part III Reprinted from Impressions, CDEA Fall 2006, pgs 18-19 $%DVLF:RUOG0XVLF/LEUDU\ By Jon Scoville One of the singular joys of living on a newly music, Lou Harrison with Indonesian and Korean forms, digital planet is how much access we now have to a and of course the Beatles encounter with the music of remarkable treasury of world music. Of course it wasn’t ,QGLD1RZHYHU\RQHLQHYHU\JHQUHLVEHLQJLQÀXHQFHG always that way. I remember vividly seeing Indian by everyone else. It’s a yeasty brew and it’s growing. PXVLFLDQ5DYL6KDQNDUIRUWKH¿UVWWLPHLQWKHODWH¶V Similarly, in the dance world, the explorations on the tv program Omnibus. It was like nothing I’d ever LQLWLDWHGE\5XWK6W'HQLV0DUWKD*UDKDP.DWKHULQH KHDUGEHIRUHJURZLQJXSLQDKRXVH¿OOHGZLWKFODVVLFDO 'XQKDPDQGRWKHUVLVFRQWLQXLQJ0DQ\FRQWHPSRUDU\ PXVLF DQG P\ RZQ OLWWOH FROOHFWLRQ RI &KXFN %HUU\ FKRUHRJUDSKHUVIURP0DUN0RUULVWR$NUDP.KDQWR DQG /RXLV$UPVWURQJ 1RZ LQ D VHFRQG RU WZR \RX *UXSR&RUSRDUHDYDLOLQJWKHPVHOYHVRIWKHUHVRXUFHV can download Ravi’s daughter Anoushka on iTunes, of world dance and world music, not in an attempt to DQGVKH¶VWKHUHUHDG\WRSOD\IRU\RX0\VHFRQG recreate dances of those cultures but to ask the audience world music revelation came around 10 years later to bring fresh ears to new movement. when I heard a collection of Bantu musicians recorded With that in mind, I have assembled a basic E\ +XJK 7UDFH\ ,PSUHVVLRQV¶ 3DXO 7UDFH\¶V IDWKHU survey of some of what’s available, much of which has IRU &ROXPELD 5HFRUGV 7KH OLIH IRUFH DQG UK\WKPLF particular dance forms associated with the music. Along invention woven into the music left an indelible mark ZLWKWKLVOLVWRIVW\OHV ZKLFKLVLQQRSDUWLFXODURUGHU on me as a musician. -
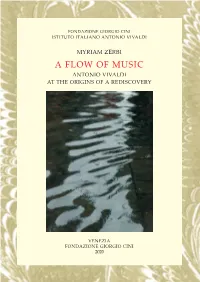
Download Myriam Zerbi – a Flow of Music
FONDAZIONE GIORGIO CINI ISTITUTO ITALIANO ANTONIO VIVALDI MYRIAM ZERBI A FLOW OF MUSIC ANTONIO VIVALDI AT THE ORIGINS OF A REDISCOVERY VENEZIA FONDAZIONE GIORGIO CINI 2020 This book recounts the circumstances leading up to the foundation of the Istituto Italiano Antonio Vivaldi, established by Antonio Fanna and Angelo Ephrikian on 23 January 1947. It retraces the sometimes surprising adventures in postwar Italy that took the two protagonists from the dream of reviving the Red Priest’s music to the publication of his complete instrumental works. Using the le琀ers of the leading players, contemporary press reports and the personal memories of one of the founders, the author reconstructs the Istituto’s vicissitudes focusing especially on its first years, full of high emotions, enterprise and tenacity, in a war-torn country where a desire for renewal was everywhere palpable, through to 1978 when it was donated by Antonio Fanna to become part of the Fondazione Giorgio Cini in Venice. The story, which is enlivened with a copious apparatus of images and documents, unfolds through the personal testimonies of those involved: Angelo Ephrikian, who dreamed the original dream, Antonio Fanna, who laid the practical foundations of the Istituto and ran it for 昀fty years, Alfredo Gallinari the enabling benefactor, who until now has remained, by his own wish, anonymous, Francesco Continetto, the copyist, who transcribed over 昀ve hundred of Vivaldi’s manuscripts, Gian Francesco Malipiero, the Istituto’s artistic director and editor of the greater part of the Venetian composer’s music, and Eugenio Clause琀i the enlightened head of the music publisher Casa Ricordi. -

Table of Contents Volume 18, Number 1 (2012)
Table of Contents Volume 18, Number 1 (2012) Articles Gayathri Khemadasa and the Phoolan Devi Opera Project .................................................. Jeff Hush...................................1 Images of Landscape in the Music of Anne Boyd ............................................................... Sally Macarthur ........................7 Changing Women: Performers, Patrons and Composers in Renaissance Europe ................. Nancy Hadden ........................14 In Search of the White Raven: Ruth Shaw Wylie and Her Music ........................................ Deborah Hayes .......................20 Envisioning Life Beyond the Academy: Building Community ............................................ Madeline Williamson .............25 Meet Five New IAWM Members A Woman on the Bench .................................................................................................. Gail Archer .............................29 Sound as a Generative Force .......................................................................................... Somna M. Bulist .....................30 Music in Migration ......................................................................................................... Tonia Ko .................................31 A Soprano on the Move .................................................................................................. Jessica McCormack ................31 The Patch-Work Musical Life .......................................................................................