Télécharger Au Format .Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
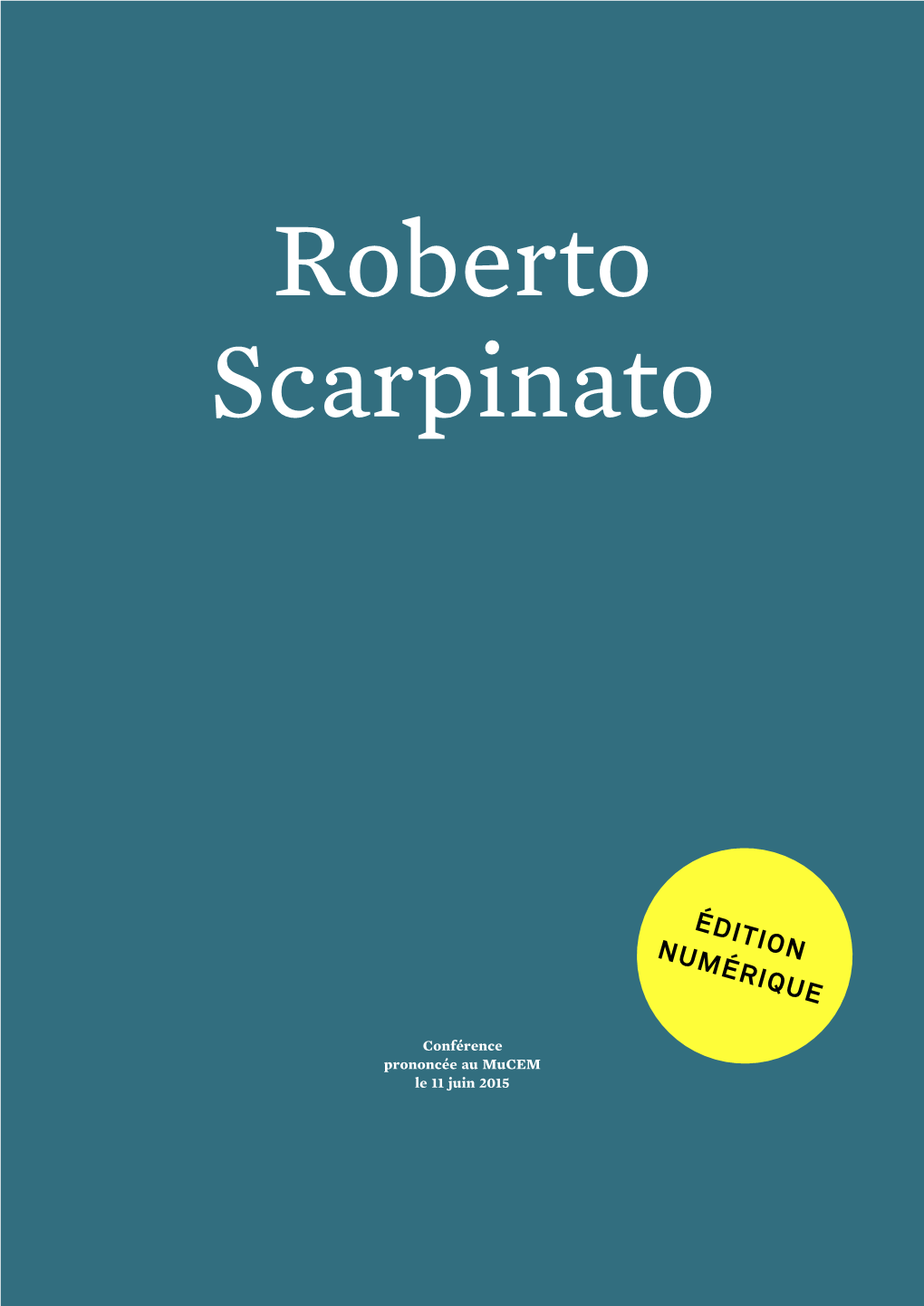
Load more
Recommended publications
-

Mafia Linguaggio Identità.Pdf
EDIZIONI MAFIA LINGUAGGIO IDENTITÁ di Salvatore Di Piazza Di Piazza, Salvatore <1977-> Mafia, linguaggio, identità / Salvatore Di Piazza – Palermo : Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre, 2010. (Collana studio e ricerca) 1. Mafia - Linguaggio. 364.10609458 CDD-21 SBN Pal0224463 CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 5 Nota editoriale di Vito Lo Monaco, Presidente Centro Pio La Torre 7 Prefazione di Alessandra Dino, sociologa 13 Introduzione Parte Prima 15 Il linguaggio dei mafiosi 15 Un linguaggio o tanti linguaggi? Problemi metodologici 17 Critica al linguaggio-strumento 18 Critica al modello del codice 19 Critica alla specificità tipologica del linguaggio dei mafiosi 19 Mafia e linguaggio 20 La riforma linguistica 21 Le regole linguistiche: omertà o verità 22 La nascita linguistica: performatività del giuramento 23 Caratteristiche del linguaggio dei mafiosi 23 Un gergo mafioso? 26 Un denominatore comune: l’“obliquità semantica” 30 Impliciti, non detti, espressioni metaforiche 36 Un problema concreto: l’esplicitazione dell’implicito Parte Seconda 41 Linguaggio e identità mafiosa 41 Sulla nozione di identità 42 Linguaggio e identità mafiosa tra forma e contenuto 43 Prove tecniche di appartenenza: così parla un mafioso 44 La comunicazione interna 45 La comunicazione esterna 49 La rappresentazione linguistica: un movimento duplice 49 Dall’interno verso l’esterno 51 Dall’esterno verso l’interno 52 Un caso emblematico: i soprannomi 54 Conclusioni 57 Bibliografia di Vito Lo Monaco Il presente lavoro di Salvatore Di Piazza fa parte delle ricerche promosse dal Centro Studi La Torre grazie alla collaborazione volontaria di autorevoli comitati scientifici e al contributo finanziario della Regione Sicilia. -

Mafia E Mancato Sviluppo, Studi Psicologico- Clinici”
C.S.R. C.O.I.R.A.G. Centro Studi e Ricerche “Ermete Ronchi” LA MAFIA, LA MENTE, LA RELAZIONE Atti del Convegno “Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico- clinici” Palermo, 20-23 maggio 2010 a cura di Serena Giunta e Girolamo Lo Verso QUADERNO REPORT N. 15 Copyright CSR 2011 1 INDICE Nota Editoriale, di Bianca Gallo Presentazione, di Claudio Merlo Introduzione, di Serena Giunta e Girolamo Lo Verso Cap. 1 - Ricerche psicologico-cliniche sul fenomeno mafioso • Presentazione, di Santo Di Nuovo Contributi di • Cecilia Giordano • Serena Giunta • Marie Di Blasi, Paola Cavani e Laura Pavia • Francesca Giannone, Anna Maria Ferraro e Francesca Pruiti Ciarello ◦ APPENDICE • Box Approfondimento ◦ Giovanni Pampillonia ◦ Ivan Formica Cap. 2 - Beni relazionali e sviluppo • Presentazione, di Aurelia Galletti Contributi di • Luisa Brunori e Chiara Bleve • Antonino Giorgi • Antonio Caleca • Antonio La Spina • Box Approfondimento ◦ Raffaele Barone, Sheila Sherba e Simone Bruschetta ◦ Salvatore Cernigliano 2 Cap. 3 - Un confronto tra le cinque mafie • Presentazione, di Gianluca Lo Coco Contributi di • Emanuela Coppola • Emanuela Coppola, Serena Giunta e Girolamo Lo Verso • Rosa Pinto e Ignazio Grattagliano • Box Approfondimento ◦ Paolo Praticò Cap. 4 - Psicoterapia e mafia • Presentazione, di Giuseppina Ustica Contributi di • Graziella Zizzo • Girolamo Lo Verso • Lorenzo Messina • Maurizio Gasseau Cap. 5 - Oltre il pensiero mafioso • Presentazione, di Antonio Caleca Contributi di • Leoluca Orlando • Maurizio De Lucia • Alfredo Galasso Conclusioni, di Girolamo Lo Verso e Serena Giunta Bibliografia Note 3 Nota editoriale di Bianca Gallo Questo Quaderno CSR, il n° 15, riporta le riflessioni sviluppate attraverso i diversi interventi durante il Convegno Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico- clinici, che si è tenuto a Palermo il 20-23 maggio 2010. -

Relazione Al Parlamento Sull’Attività Delle Forze Di Polizia E Sullo Stato Dell’Ordine E Della Sicurezza Pubblica Nel Territorio Nazionale (Art
Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Relazione al Parlamento sull’attività delle Forze di Polizia e sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale (Art. 113 legge 1° Aprile 1981, n. 121) Anno 2002 ________________________________________________ Premessa La Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell’ordine e sicurezza pubblica, costituisce ormai non solo l’adempimento del precetto contenuto nell’art. 113 della legge 1° aprile 1981, ma si propone anche come tradizionale appuntamento per divulgare - nella maniera più ampia e compiuta sul piano della comunicazione - i progetti e le strategie di intervento attuate, nel campo della sicurezza, per la prevenzione e la repressione dei reati e, più in generale, sulle predisposizioni organizzative intese a raccordare sistematicamente l’apparato sicurezza alle istanze del Paese. Istanze che nel 2002, ed in particolare dopo i noti attentati terroristici dell’11 settembre negli Stati Uniti d’America, hanno profondamente improntato lo scenario complessivo, già ampiamente segnato - nel recente passato - dalla crescita della percezione dell’insicurezza, connotandolo di nuove apprensioni per le minacce che insidiano il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali. Ed è in tale contesto che si rende indispensabile, da parte di coloro che sono deputati istituzionalmente a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, un ulteriore impegno, mirato e costante, in termini di risorse umane, mezzi e qualificazione professionale, finalizzato a consolidare la trasparenza del rapporto fra Stato e cittadini, migliorare la circolazione delle informazioni sul territorio, utilizzando al meglio gli strumenti informatici di cui dispone la Pubblica Amministrazione ed infine, rafforzare la fiducia del cittadino nei confronti delle forze dell’ordine. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

Mafia Carini Capaci Isola Delle Femmine E Dintorni
Mafia Carini Capaci Isola delle Femmine e dintorni Comuni sciolti per mafia 25 09 09 Uploaded by isolapulita . - News videos from around the world. Figura 1 Cipriano Santo Inzerillo Gianni SIINO dichiara: DI MAGGIO Salvatore Emanuele Io l’ho conosciuto all’interno della fattoria di Bellolampo intorno alla fine degli anni ’70. I DI MAGGIO hanno avuto varie vicissitudini in negativo all’interno dell’organizzazione mafiosa, perché messi da parte. L’ho rivisto insieme ad un DI MAGGIO detto “u’ figghiu da za’ lena” che mi venne indicato come capo della famiglia di Torretta. I due vennero a raccomandare un imprenditore di Torretta al quale ho fatto aggiudicare, perché loro me lo avevano chiesto, la scuola media di Isola delle Femmine. (Ordinanza di Custodia cautelare Operazione Oldbridge N. 11059/06 R. mod. 21 D.D.A.) Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. 1 Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. …… Ed è un dato ormai processualmente acquisito che, fino a quando il suo capo indiscusso, Gaetano BADALAMENTI, non fu espulso da Cosa Nostra, la famiglia di Cinisi costituiva uno dei più importanti mandamenti della provincia di Palermo, ricomprendendo, oltre al circondario di Cinisi e Terrasini , anche i territori di Balestrate, Carini, Capaci e Isola delle Femmine (cfr. BUSCETTA, MARINO MANNOIA e MUTOLO, nonché DI MATTEO Mario Santo). Successivamente, il mandamento venne sciolto e la famiglia aggregata al mandamento di Partinico, mentre i territori che ne avevano fatto parte furono divisi tra lo stesso mandamento di Partinico e (dopo il 1982) il neo- mandamento di San Lorenzo , dopo la ristrutturazione seguita alla conclusione della sanguinosa guerra di mafia dei primi anni ’80. -

Ius Novum 3-08.Indd
Ius Novum 3 2008 ISSN 1897-5577 WARSZAWA 2008 KOLEGIUM REDAKCYJNE Marek Chmaj, Teresa Gardocka (przewodnicząca), Bogudar Kordasiewicz, Maria Kruk-Jarosz, Franciszek Longchamps de Bérier, Andrzej Marek, Jerzy Menkes, Henryk Olszewski, Jacek Sobczak (zastępca przewodniczącego) REDAKCJA Ryszard A. Stefański (redaktor naczelny), Andrzej Szlęzak (zastępca redaktora naczelnego), Jacek Kosonoga (sekretarz redakcji) Copyright © by Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Warszawa 2008 ISSN 1897-5577 Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 tel. 0-22 54 35 450, 0-22 54 35 410 www.lazarski.pl [email protected] Opracowanie komputerowe, druk i oprawa: Dom Wydawniczy ELIPSA ul. Infl ancka 15/198, 00-189 Warszawa tel./fax 0-22 635 03 01, 0-22 635 17 85, e-mail: [email protected], www.elipsa.pl SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y Dr Zbigniew Ję drzejewski, UW System i topika w nauce o przestępstwie . 5 Dr Ryszard Szał owski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zakres przedmiotowy tajemnicy państwowej . 22 Mgr Adrianna Mię kina, Zabójstwo w środowisku mafijnym . 38 Dr hab. R yszard Stefań s k i, prof. WSHiP Zasady bezpieczeństwa w ruchu w doktrynie i orzecznictwie. Część II. 53 Dr Maria Sobczak, UAM Wolność sumienia i wyznania, jej gwarancje w systemie prawnym Rady Europy oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu . 87 Mgr Aleksandra Gliszczyń s k a, Instytut Nauk Prawnych PAN Zalecenia Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji w zakresie walki z antysemityzmem oraz ich realizacja przez Polskę . 117 Dr Przemysł aw Szustakiewicz, adiunkt WSHiP Najwyższa Izba Kontroli – czwarta władza czy organ Sejmu . -

Società E Cultura 65
Società e Cultura Collana promossa dalla Fondazione di studi storici “Filippo Turati” diretta da Maurizio Degl’Innocenti 65 1 Manica.indd 1 19-11-2010 12:16:48 2 Manica.indd 2 19-11-2010 12:16:48 Giustina Manica 3 Manica.indd 3 19-11-2010 12:16:53 Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo di fondi di ricerca del Dipartimento di studi sullo stato dell’Università de- gli Studi di Firenze. © Piero Lacaita Editore - Manduria-Bari-Roma - 2010 Sede legale: Manduria - Vico degli Albanesi, 4 - Tel.-Fax 099/9711124 www.lacaita.com - [email protected] 4 Manica.indd 4 19-11-2010 12:16:54 La mafia non è affatto invincibile; è un fatto uma- no e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fe- nomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze mi- gliori delle istituzioni. Giovanni Falcone La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un mo- vimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità… Paolo Borsellino 5 Manica.indd 5 19-11-2010 12:16:54 6 Manica.indd 6 19-11-2010 12:16:54 Alla mia famiglia 7 Manica.indd 7 19-11-2010 12:16:54 Leggenda Archivio centrale dello stato: Acs Archivio di stato di Palermo: Asp Public record office, Foreign office: Pro, Fo Gabinetto prefettura: Gab. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -
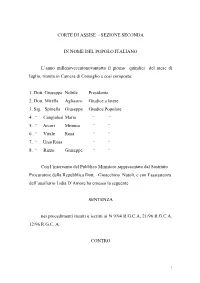
Processo Lima
CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

Brief History of Sicilian Mafia
For centuries, there had been banditry in southern Italy. It is not surprising when we consider that the area south of Rome was ruled for hundreds of years by foreign powers and the land was generally (mis)managed by absentee landlords. In their absence, the bandits stepped in to enforce the payment of dues or meagre profits from the peasants to the landowners, creaming a lot off the top. Stealing from the rich to give to the poor was no part of their raison d’etre. Over time, they became the landowners’ enforcers and then began to take over large tracts but it was the unification of Italy, following Garibaldi’s march through Sicily and up through southern Italy defeating and forcing the capitulation of the Spanish Bourbons, rulers of the Kingdom of the Two Sicilies, which gave them their greatest opportunity . If you have read “The Leopard” by Giuseppe di Lampedusa or seen the film, you will have recognised that the Mafia were gaining an important role in the running of Sicilian cities, towns and regions; they were gaining election as mayors and they were marrying into families of the nobility of the island. The Risorgimento whilst unifying the country also exaggerated the division between the north and the south. Sicilians often used to dispute (at least publicly) the existence of the Mafia or La Cosa Nostra (Our Thing) as the organisation names itself. They claimed that it was a northern construct. However, there is an excellent book by Gianni Riotta, “Prince of the Clouds”, which describes how the mafia, acting as a private army on behalf of the landowner against her peasants, uses force and murder to keep the poor of Sicily under control. -

Magisterarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES Magisterarbeit Titel der Magisterarbeit La Cosa Nostra – Struktur, Funktionen und mediale Berichterstattung im Zuge des Maxiprozesses von Palermo (10.2.1986 – 17.12.1987) Verfasser Fabio Arienti BA angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 236 349 Studienrichtung lt. Studienblatt: Italienisch Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Robert Tanzmeister Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis S.1 1. Fragestellung S.3 2. Methode S.6 3. Aktueller Forschungsstand S.9 4. Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte S.12 4.1. Etymologie S.13 4.2. Glossar S.13 4.3. Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert S.16 4.3.1. Die Einigung Italiens S.17 4.3.2. Implementierung einer lokalen Verwaltung S.19 4.3.3. Der Erste Weltkrieg S.22 4.3.4. Faschismus S.22 4.3.5. Die Nachkriegsjahre S.23 4.3.6. Wirtschaftlicher Aufschwung S.26 4.3.7. Der Drogenhandel S.27 4.3.8. Änderungen in der öffentlichen Wahrnehmung S.29 4.3.9. Wiederbelebung und zweite Phase des Drogenhandels S.31 4.3.10. Die Machtergreifung der Mafia aus Corleone S.33 4.3.11. Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino und der Antimafia Pool S.34 4.3.12. Revolutionierung der politischen Landschaft Italiens S.36 5. Struktur und soziale Funktionen S.38 5.1. Ihre Struktur nach Giovanni Falcone S.38 5.2. Ihre Funktionen nach Raimondo Catanzaro S.46 5.2.1. Die Mafia als Vermittler zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen S.48 1 5.2.2. -
![Il Dizionario Della Mafia [Archivioantimafia]](https://docslib.b-cdn.net/cover/1755/il-dizionario-della-mafia-archivioantimafia-1511755.webp)
Il Dizionario Della Mafia [Archivioantimafia]
27 MARTEDÌ 1DICEMBRE 2009 IL DIZIONARIO DELLA MAFIA CORAGGIO/1 Falcone e Borsellino Due giudici contro Amici d’infanzia, coetanei e colleghi Foto Ansa AMANINUDE CONTRO LA VIOLENZA IL COLPO PIÙ DURO ACOSANOSTRA Nicola Tranfaglia STORICO oraggio è una parola che non è faci- le usare quando si scrive di mafia. Il C mondo mafioso, infatti, per rag- giungere i suoi obiettivi, piuttosto che il coraggio utilizza l’astuzia e, contro chi non si adegua, la violenza. Una violenza im- provvisa e oscura. Ma di coraggio bisogna parlare quando raccontiamo la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che hanno perduto la vita perché hanno combattuto fino all’ultimo la mafia siciliana. Erano coscienti di quello che li aspettava. Sapevano per l’esperienza accumulata nella loro breve vita che non c’era da farsi illusio- ni. Cosa Nostra, questo è il nome che in Sici- lia è stato assunto dalla mafia, aveva identifi- cato in quei due giudici i nemici principali dell’organizzazione. Questo perché negli an- ni Ottanta il cosiddetto «maxi-processo» - che da Falcone e Borsellino era stato istruito -avevasferratoaCosaNostrauncolpodeci- sivo: decine di capi e sottocapi erano stati condannati come agenti di un potere che comminava pene anche mortali, senza ap- pello, a chi provava a opporsi. Anche a don- ne e bambini se si ribellavano o, semplice- mente, avevano avuto la sfortuna di vedere qualcosa che non avrebbero dovuto vedere. Falcone e Borsellino lottarono fino all’ulti- mo, in un certo senso attesero la morte, con- tro un’organizzazione che ormai era diventa- ta parte dello Stato e delle istituzioni pubbli- che.