Fernandez Rodriguez Laura
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

JEUDI 13 DECEMBRE 2018 Sur Interencheres-Live.Com 10 H : TIMBRES-POSTE France, Colonies Françaises, Monde, À L’Unité Et En Lots
JEUDI 13 DECEMBRE 2018 sur interencheres-live.com 10 H : TIMBRES-POSTE France, Colonies françaises, Monde, à l’unité et en lots 14 H : LIVRES ET DOCUMENTATION BIBLIOTHEQUE THEMATIQUE SPECIALISEE + 1 000 ouvrages sur l'art (tableaux, dessins, artistes, céramiques, tapisseries, habillement, sculptures, bronzes etc..) Régionalistes (France, étrangers, colonies), Techniques (aviation, précurseurs), sur les collections et objets divers (timbres, monnaies, cartes postales, jouets, parfums, pipes etc...) Histoire (guerres, civilisations à travers les âges, modes de vie) etc... EXPOSITIONS à la salle des ventes de CHERRE (LA FERTE-BERNARD) le 13 DECEMBRE 2018 matin de la vente de 9h à 10 h Photos et lots sur www.interencheres-live.com , www.balsanencheres.com EXPERT : Pour tous renseignements : Jean Paul PINON Ŕ 64 rue Michelet Ŕ 37000 TOURS Tel : 02 47 05 72 39 Ŕ Email : [email protected] Ŕ Site Web : www.pinoncollections.com Rejoignez-nous sur Facebook : « Timbres Monnaies Minéraux « Prix départ Accumulation de 35 (trente-cinq) carnets de circulation…oubliés par le collectionneur décédé depuis les années 60. Principalement France toutes périodes (1850 aux années 1 60) neufs et oblitérés mais aussi quelques carnets avec bons timbres pays divers : Egypte, 200 Etats Unies, Allemagne, Grande Bretagne, Belgique, Autriche, Norvège etc... également quelques lettres anciennes de France - Forte valeur à sortir. archives d'un capitaine du 3e Hussard - 32 documents philatéliques, encarts & enveloppes souvenir, avec CACHETS POSTAUX MILITAIRES SECTEURS POSTAUX (forces 2 françaises d'occupation en Allemagne, forces aux Liban en 1978, Opération 20 Daguet/Koweït). doubles d'un collectionneur, TIMBRES DU MONDE. Boîte contenant environ 5 000 (cinq mille) timbres à trier, complètement en VRAC et 3 mélangés. -
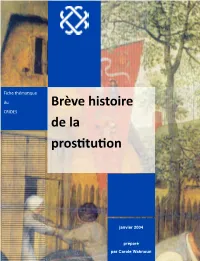
Brève Histoire De La Pros Tu On
Fiche théma+que du Brève histoire CRIDES de la pros0tuon janvier 2004 préparé par Carole Wahnoun COURTISANE ET SON CLIENT, PÉLIKÉ ATTIQUE À FIGURES ROUGES DE POLYGNOTE, V. 430 AV. J.-C., MUSÉE NATIONAL ARCHÉOLOGIQUE D'ATHÈNES 1 LES DÉBUTS : L'HOSPITALITÉ SEXUELLE ET LA PROSTITUTION SACRÉE Il n'est pas certain que la prostitution soit "le plus vieux métier du monde" ; durant la colonisation, les Européens la feront admettre. Il existait toutefois, dans certaines sociétés primitives européennes, une prostitution liée à la notion d'hospitalité : les différentes femmes de la maison sont offertes aux hô- tes de passage. Cette coutume existait en Chaldée, en Inde, en Egypte et dans tout l'Orient. Parfois même, l'hospitalité sexuelle implique un aspect religieux que les prêtres de certaines divinités organi- sent et dont ils bénéficient. Les prostituées sacrées n'étaient pas toutes considérées de la même fa- çon et certaines spécialisaient leurs tâches en fonction de ce qui était décidé chez les grands prê- tres. Pourtant la prostitution s'est bientôt réduite à un rituel sexuel prenant son vrai visage durant les Saturnales et autres orgies à caractère religieux. Aussi, bien que le rite demeure, la prostitution de- vient un phénomène social et commence à se désacraliser. En plus de la prostitution sacrée, les grandes courtisanes existèrent en Orient, non seulement en Inde, mais aussi en Birmanie et en Corée et surtout au Japon. En Chine si, au départ, les prostituées ressemblaient aux hétaïres grecques, la prostitution s'y organise très vite commercialement. Chez les Hébreux et les Musulmans, elle fut toujours considérée avec répulsion et n'était pratiquée que par les étrangères ou les esclaves. -

The French Law of April 13 2016 Aimed at Strengthening the Fight Against the Prostitutional System and Providing Support For
The French law of April 13 2016 aimed at strengthening the fight against the prostitutional system and providing support for prostituted persons Principles, goals, measures and adoption of a historic law. 1 CAP international, March 2017 www.cap-international.org Authors: Grégoire Théry, Executive director of CAP international Claudine Legardinier, Journalist Graphic design: micheletmichel.com Translation: Caroline Degorce Contents Presentation of the law of April 13, 2016 > Introduction ................................................................................................................................................p.5 > Content of the law ....................................................................................................................................p.5 French law following the adoption of the new Act > The fight against procuring and pimping .......................................................................................p.8 > Prohibition of the purchase of sex acts .......................................................................................... p.9 > Protection, access to rights and exit policy for victims of prostitution, pimping and trafficking .......................................................................................................................p.10 The spirit of the law > Philosophical foundation ....................................................................................................................p.13 > Adoption of the parliamentary resolution of December -

Mapping Prostitution: Sex, Space, Taxonomy in the Fin- De-Siècle French Novel
Mapping Prostitution: Sex, Space, Taxonomy in the Fin- de-Siècle French Novel The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Tanner, Jessica Leigh. 2013. Mapping Prostitution: Sex, Space, Taxonomy in the Fin-de-Siècle French Novel. Doctoral dissertation, Harvard University. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:10947429 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, WARNING: This file should NOT have been available for downloading from Harvard University’s DASH repository. Mapping Prostitution: Sex, Space, Taxonomy in the Fin-de-siècle French Novel A dissertation presented by Jessica Leigh Tanner to The Department of Romance Languages and Literatures in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of Romance Languages and Literatures Harvard University Cambridge, Massachusetts May 2013 © 2013 – Jessica Leigh Tanner All rights reserved. Dissertation Advisor: Professor Janet Beizer Jessica Leigh Tanner Mapping Prostitution: Sex, Space, Taxonomy in the Fin-de-siècle French Novel Abstract This dissertation examines representations of prostitution in male-authored French novels from the later nineteenth century. It proposes that prostitution has a map, and that realist and naturalist authors appropriate this cartography in the Second Empire and early Third Republic to make sense of a shifting and overhauled Paris perceived to resist mimetic literary inscription. Though always significant in realist and naturalist narrative, space is uniquely complicit in the novel of prostitution due to the contemporary policy of reglementarism, whose primary instrument was the mise en carte: an official registration that subjected prostitutes to moral and hygienic surveillance, but also “put them on the map,” classifying them according to their space of practice (such as the brothel or the boulevard). -

Monde.20011122.Pdf
EN ÎLE-DE-FRANCE a Dans « aden » : tout le cinéma et une sélection de sorties Demandez notre supplément www.lemonde.fr 57e ANNÉE – Nº 17674 – 7,90 F - 1,20 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE -- JEUDI 22 NOVEMBRE 2001 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Afghanistan : les débats de l’après-guerre b Quels étaient les buts de la guerre, quel rôle pour les humanitaires ? b « Le Monde » donne la parole à des intellectuels et à des ONG b Conférence à Berlin sur l’avenir de l’Afghanistan, sous l’égide de l’ONU b Le reportage de notre envoyée spéciale en territoire taliban SOMMAIRE formation d’un gouvernement pluriethnique. Les islamistes étran- BRUNO BOUDJELAL/VU b Guerre éclair, doute persistant : gers de Kunduz encerclée risquent Dans un cahier spécial de huit d’être massacrés. Kaboul retrouve a REPORTAGE pages, Le Monde donne la parole à le goût des petites libertés, mais un spécialiste du droit d’ingéren- une manifestation de femmes a ce, Mario Bettati, et à deux person- été interdite. Notre envoyée spé- Une petite ville nalités de l’humanitaire, Rony ciale en territoire taliban, Françoi- Brauman et Sylvie Brunel. Ils disent se Chipaux, a rencontré des popula- leur gêne ou leur inquiétude tions déplacées qui redoutent l’Al- POINTS DE VUE en Algérie devant le rôle que les Etats-Unis liance du Nord. p. 2 et 3 font jouer aux ONG. Des intellec- L’ÉCRIVAIN François Maspero tuels français, Robert Redeker, b La coalition et l’humanitaire : Le Cahier a passé le mois d’août dans une Jean Clair, Daniel Bensaïd et Willy Pentagone compte sur l’Alliance petite ville de la côte algéroise. -

4. Prostitution
0 1 Archives municipales Histoires de femmes Cavaillonnaises au miroir des archives (XVIe s.-XXIe s.) Exposition Archives municipales Place du Cloître – Cavaillon 16 septembre-23 décembre 2016 2 3 Introduction A Cavaillon comme ailleurs, les femmes ont toujours été les « oubliées de l’histoire ». D’une part parce que les archives ont longtemps été faites par des hommes – administrateurs ou politiques - et donc, que les traces des femmes y sont discrètes, d’autre part parce que l’histoire elle-même fut longtemps écrite par des hommes. Pourtant, les sources cavaillonnaises bruissent d’histoires de femmes pour peu que l’on y prête attention, et elles révèlent une richesse et une réalité complexes. C’est donc pour combler un vide, couvrir une zone d’ombre, que les Archives ont entrepris ce vaste chantier au féminin mais aussi pour donner envie aux historien(ne)s de demain de poursuivre dans cette voie encore en friche. Cette exposition regroupe les aspects les plus marquants de l’histoire des femmes à Cavaillon sous quatre thèmes : - Le Corps des femmes : entre l’intime et le politique, il présente la place qui leur fut assignée dans la société : mariage, maternité, « Idéal féminin », mais aussi, la grande précarité qui fut souvent leur lot aux siècles passés. - Le Travail des femmes : des agricultrices aux incontournables « emballeuses », des ouvrières en soie aux « chardonneuses », et à travers les métiers dits « de femmes » : un panorama des Cavaillonnaises au travail à travers les siècles. - Femmes dans la cité : des exemples d’engagement intellectuel ou économique au féminin mais aussi d’engagement civique et politique, en suivant le long chemin des femmes vers l’émancipation et la citoyenneté. -
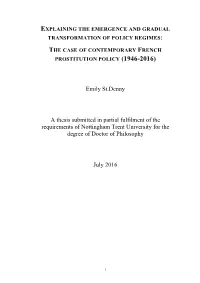
Emily St.Denny a Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements of Nottingham Trent University for the Degree Of
EXPLAINING THE EMERGENCE AND GRADUAL TRANSFORMATION OF POLICY REGIMES: THE CASE OF CONTEMPORARY FRENCH PROSTITUTION POLICY (1946-2016) Emily St.Denny A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of Nottingham Trent University for the degree of Doctor of Philosophy July 2016 1 This work is the intellectual property of the author. You may copy up to 5% of this work for private study, or personal, non-commercial research. Any re-use of the information contained within this document should be fully referenced, quoting the author, title, university, degree level and pagination. Queries or requests for any other use, or if a more substantial copy is required, should be directed to the owner of the Intellectual Property Rights. 2 Abstract Immediately after the Second World War, France began to abolish the regulation of prostitution, first by outlawing brothels in 1946, then by dismantling all remaining medical and police registers in 1960. In doing so, it adopted an ‘abolitionist’ approach to prostitution. This stance, which distinguishes itself from both regulation and prohibition, is based on criminalising the exploitation of prostitution, and providing social support to individuals involved in prostitution, who are perceived to be inherently ‘victims’. However, since then, the policies and programmes enacted in the name of ‘abolitionism’ have varied considerably: policies based on supporting ‘victims’ have been succeeded by some that seek to criminalise individuals in prostitution by outlawing soliciting. More recently, in April 2016, the country adopted a policy of client criminalisation which is intended to ‘abolish’ prostitution entirely. Thus, on the one hand, France has remained steadfastly committed to abolitionism throughout the period. -

Nancy Huston in Self-Translation an Aesthetics of Redoublement
Corso di Dottorato in Studi Umanistici Curriculum: Studi Linguistici e Letterari XXIX ciclo Nancy Huston in Self-translation An Aesthetics of Redoublement Relatore Dottoranda Prof. Andrea Binelli Dott.ssa Giorgia Falceri A.A. 2015-2016 1 2 TABLE OF CONTENTS PART I ............................................................................................... 7 I. AN INTRODUCTION TO LITERARY SELF-TRANSLATION .............. 7 1.1 FRAMING SELF-TRANSLATION STUDIES ................................................... 7 1.2 SELF-TRANSLATION IN THEORY ............................................................. 15 1.2.1 AUTHOR, TRANSLATOR AND TEXT .....................................................................18 1.2.2 RECONSIDERING TRADITIONAL CATEGORIES AND BINARY OPPOSITIONS .......... 23 1.3 SELF-TRANSLATION IN PRACTICE ........................................................... 26 1.3.1 SELF-TRANSLATORS, THESE STRANGERS. .......................................................... 26 1.3.2 TYPOLOGIES OF SELF-TRANSLATED TEXTS ........................................................ 31 1.3.3 TOWARDS A HISTORY OF SELF-TRANSLATION? ................................................. 35 1.3.4 SELF-TRANSLATION IN A SOCIOLINGUISTIC PERSPECTIVE ................................. 40 1.4 AGAINST SELF-TRANSLATION ................................................................ 46 1.5 INNOVATIVE THEORETICAL MODELS TO APPROACH THE SELF-TRANSLATED TEXT ............................................................................................................ -
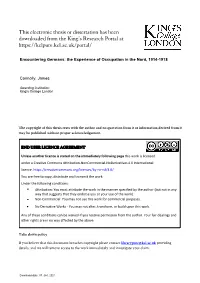
The Experience of Occupation in the Nord, 1914-1918
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Encountering Germans: the Experience of Occupation in the Nord, 1914-1918 Connolly, James Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 07. Oct. 2021 This electronic theses or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Encountering Germans: the Experience of Occupation in the Nord, 1914-1918 Title: Author: James Connolly The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. -

Petite Histoire Des Maisons Closes
Paris mon Village PETITE HISTOIRE DES MAISONS CLOSES par Romi n peut affirmer que la prostitution est aussi vieille que notre vieux monde: plus de vingt siècles avant l’ère chrétienne, au temps aima- Oble des prophètes et des patriarches, les filles se fai- saient déjà payer pour «passer un moment» - Dans la Genèse, (XXXVIII. 15) nous rencontrons le galant Juda qui n’hésite pas à offrir un chevreau à une jolie personne « qui se fait payer d’avance » : « Juda l’ayant vue, s’imagine que c’était une prostituée car elle s’était couvert le visage afin de n’être pas reconnue - s’avançant vers elle, il lui dit : Permettez que j’approche de vous (car il ne savait pas que ce fut sa belle-fille.) Elle lui répondit : Que me donnerez vous pour jouir de moi ? - Je vous enverrai, dit-il, un chevreau de mes trou- peaux. Elle répartit : j’accorderai ce que vous vou- lez, si vous me donnez un gage de ce que vous me promettez de m’envoyer. – - Quel gage exigez-vous ? lui dit Juda. Elle Tamar et Juda répondit : Votre anneau, votre bracelet et le bâton que vous tenez à la main. Ce marché conclu, il la connut une fois, et elle conçut. » Tite-Live nous donne une version nouvelle de l’allaitement de Romulus et Remus par une Louve. «Quelques-uns prétendent que Laurentia était une prostituée à qui les bergers avaient donné le nom de Louve». Sur le même sujet voici quelques lignes (August. De Civit. Dei lib. XVIII, cap. 21) édifiantes: « On rapporte qu’ils (Romulus et Remus) furent abandonnés et expo- sés et qu’une prostituée inconnue, attirée par leurs vagissements) les recueillit et les allaita. -

Prostitution, Proxénétisme Et Droit Pénal
BANQUE DES MEMOIRES Master de droit pénal et sciences pénales Dirigé par Yves Mayaud 2010 Prostitution, proxénétisme et droit pénal Aubéri Salecroix Sous la direction d’Agathe Lepage INTRODUCTION Il est un principe cher aux juristes énoncé en latin par l'adage « nullum crimen nulla poena sine lege » qui, appliqué à notre sujet, ne permet d’admettre la répression de la prostitution ou du proxénétisme que si les faits ou actes concernés correspondent exactement à ceux que la loi incrimine. La prostitution et le proxénétisme sont, en effet, inextricablement liés au droit pénal depuis l’Antiquité, ce dernier oscillant inlassablement entre tolérance et répression (I). Il faut admettre que la précision des textes juridiques ne puisse que se ressentir de la difficulté attachée à l’étude des relations unissant les différents protagonistes du système prostitutionnel (II). Section 1 Prostitution et proxénétisme de l’Antiquité à nos jours : entre tolérance et répression Chercher les origines historiques de la prostitution est une opération quasiment impossible car, bien qu’il ne soit pas certain qu’il s’agisse du plus vieux métier du monde, on la signale dans tous les peuples d'Orient, déjà trois mille ans avant notre ère. Il existait, dans certaines sociétés primitives européennes, une prostitution liée à la notion d'hospitalité : les femmes de la maison étaient offertes aux hôtes de passage. Très vite, la famille ou le clan trouva un intérêt dans cette pratique, au point que, dans la société étrusque, la prostitution représentait pour les femmes de condition libre une source de revenus pour se constituer une dot et accéder au statut recherché du mariage. -

UNSTITCHING the 1950S FILM Á COSTUMES: HIDDEN
1 UNSTITCHING THE 1950s FILM Á COSTUMES: HIDDEN DESIGNERS, HIDDEN MEANINGS Volume I of II Submitted by Jennie Cousins, to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Film Studies, October 2008. This thesis is available for library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. …………………………………. 2 Abstract This thesis showcases the work of four costume designers working within the genre of costume drama during the 1950s in France, namely Georges Annenkov, Rosine Delamare, Marcel Escoffier, and Antoine Mayo. In unstitching the cinematic wardrobes of these four designers, the ideological impact of the costumes that underpin this prolific yet undervalued genre are explored. Each designer’s costume is undressed through the identification of and subsequent methodological focus on their signature garment and/or design trademark. Thus the sartorial and cinematic significance of the corset, the crinoline, and accessories, is explored in order to determine an ideological pattern (based in each costumier’s individual design methodology) from which the fabric of this thesis may then be cut. In so doing, the way in which film costume speaks as an independent producer of cinematic meaning may then be uncovered. By viewing costume design as an autonomous ideological system, rather than a part of mise-en- scène subordinate to narrative, this fabric-centric enquiry consolidates Stella Bruzzi’s insightful exploration of film costume in Undressing Cinema, Clothing and Identity in the Movies (1997).