Petite Histoire Des Maisons Closes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
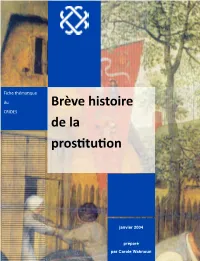
Brève Histoire De La Pros Tu On
Fiche théma+que du Brève histoire CRIDES de la pros0tuon janvier 2004 préparé par Carole Wahnoun COURTISANE ET SON CLIENT, PÉLIKÉ ATTIQUE À FIGURES ROUGES DE POLYGNOTE, V. 430 AV. J.-C., MUSÉE NATIONAL ARCHÉOLOGIQUE D'ATHÈNES 1 LES DÉBUTS : L'HOSPITALITÉ SEXUELLE ET LA PROSTITUTION SACRÉE Il n'est pas certain que la prostitution soit "le plus vieux métier du monde" ; durant la colonisation, les Européens la feront admettre. Il existait toutefois, dans certaines sociétés primitives européennes, une prostitution liée à la notion d'hospitalité : les différentes femmes de la maison sont offertes aux hô- tes de passage. Cette coutume existait en Chaldée, en Inde, en Egypte et dans tout l'Orient. Parfois même, l'hospitalité sexuelle implique un aspect religieux que les prêtres de certaines divinités organi- sent et dont ils bénéficient. Les prostituées sacrées n'étaient pas toutes considérées de la même fa- çon et certaines spécialisaient leurs tâches en fonction de ce qui était décidé chez les grands prê- tres. Pourtant la prostitution s'est bientôt réduite à un rituel sexuel prenant son vrai visage durant les Saturnales et autres orgies à caractère religieux. Aussi, bien que le rite demeure, la prostitution de- vient un phénomène social et commence à se désacraliser. En plus de la prostitution sacrée, les grandes courtisanes existèrent en Orient, non seulement en Inde, mais aussi en Birmanie et en Corée et surtout au Japon. En Chine si, au départ, les prostituées ressemblaient aux hétaïres grecques, la prostitution s'y organise très vite commercialement. Chez les Hébreux et les Musulmans, elle fut toujours considérée avec répulsion et n'était pratiquée que par les étrangères ou les esclaves. -

The French Law of April 13 2016 Aimed at Strengthening the Fight Against the Prostitutional System and Providing Support For
The French law of April 13 2016 aimed at strengthening the fight against the prostitutional system and providing support for prostituted persons Principles, goals, measures and adoption of a historic law. 1 CAP international, March 2017 www.cap-international.org Authors: Grégoire Théry, Executive director of CAP international Claudine Legardinier, Journalist Graphic design: micheletmichel.com Translation: Caroline Degorce Contents Presentation of the law of April 13, 2016 > Introduction ................................................................................................................................................p.5 > Content of the law ....................................................................................................................................p.5 French law following the adoption of the new Act > The fight against procuring and pimping .......................................................................................p.8 > Prohibition of the purchase of sex acts .......................................................................................... p.9 > Protection, access to rights and exit policy for victims of prostitution, pimping and trafficking .......................................................................................................................p.10 The spirit of the law > Philosophical foundation ....................................................................................................................p.13 > Adoption of the parliamentary resolution of December -

Mapping Prostitution: Sex, Space, Taxonomy in the Fin- De-Siècle French Novel
Mapping Prostitution: Sex, Space, Taxonomy in the Fin- de-Siècle French Novel The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Tanner, Jessica Leigh. 2013. Mapping Prostitution: Sex, Space, Taxonomy in the Fin-de-Siècle French Novel. Doctoral dissertation, Harvard University. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:10947429 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, WARNING: This file should NOT have been available for downloading from Harvard University’s DASH repository. Mapping Prostitution: Sex, Space, Taxonomy in the Fin-de-siècle French Novel A dissertation presented by Jessica Leigh Tanner to The Department of Romance Languages and Literatures in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of Romance Languages and Literatures Harvard University Cambridge, Massachusetts May 2013 © 2013 – Jessica Leigh Tanner All rights reserved. Dissertation Advisor: Professor Janet Beizer Jessica Leigh Tanner Mapping Prostitution: Sex, Space, Taxonomy in the Fin-de-siècle French Novel Abstract This dissertation examines representations of prostitution in male-authored French novels from the later nineteenth century. It proposes that prostitution has a map, and that realist and naturalist authors appropriate this cartography in the Second Empire and early Third Republic to make sense of a shifting and overhauled Paris perceived to resist mimetic literary inscription. Though always significant in realist and naturalist narrative, space is uniquely complicit in the novel of prostitution due to the contemporary policy of reglementarism, whose primary instrument was the mise en carte: an official registration that subjected prostitutes to moral and hygienic surveillance, but also “put them on the map,” classifying them according to their space of practice (such as the brothel or the boulevard). -

Monde.20011122.Pdf
EN ÎLE-DE-FRANCE a Dans « aden » : tout le cinéma et une sélection de sorties Demandez notre supplément www.lemonde.fr 57e ANNÉE – Nº 17674 – 7,90 F - 1,20 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE -- JEUDI 22 NOVEMBRE 2001 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Afghanistan : les débats de l’après-guerre b Quels étaient les buts de la guerre, quel rôle pour les humanitaires ? b « Le Monde » donne la parole à des intellectuels et à des ONG b Conférence à Berlin sur l’avenir de l’Afghanistan, sous l’égide de l’ONU b Le reportage de notre envoyée spéciale en territoire taliban SOMMAIRE formation d’un gouvernement pluriethnique. Les islamistes étran- BRUNO BOUDJELAL/VU b Guerre éclair, doute persistant : gers de Kunduz encerclée risquent Dans un cahier spécial de huit d’être massacrés. Kaboul retrouve a REPORTAGE pages, Le Monde donne la parole à le goût des petites libertés, mais un spécialiste du droit d’ingéren- une manifestation de femmes a ce, Mario Bettati, et à deux person- été interdite. Notre envoyée spé- Une petite ville nalités de l’humanitaire, Rony ciale en territoire taliban, Françoi- Brauman et Sylvie Brunel. Ils disent se Chipaux, a rencontré des popula- leur gêne ou leur inquiétude tions déplacées qui redoutent l’Al- POINTS DE VUE en Algérie devant le rôle que les Etats-Unis liance du Nord. p. 2 et 3 font jouer aux ONG. Des intellec- L’ÉCRIVAIN François Maspero tuels français, Robert Redeker, b La coalition et l’humanitaire : Le Cahier a passé le mois d’août dans une Jean Clair, Daniel Bensaïd et Willy Pentagone compte sur l’Alliance petite ville de la côte algéroise. -
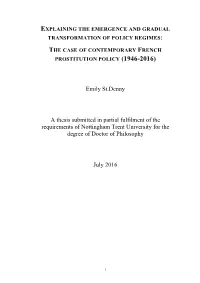
Emily St.Denny a Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements of Nottingham Trent University for the Degree Of
EXPLAINING THE EMERGENCE AND GRADUAL TRANSFORMATION OF POLICY REGIMES: THE CASE OF CONTEMPORARY FRENCH PROSTITUTION POLICY (1946-2016) Emily St.Denny A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of Nottingham Trent University for the degree of Doctor of Philosophy July 2016 1 This work is the intellectual property of the author. You may copy up to 5% of this work for private study, or personal, non-commercial research. Any re-use of the information contained within this document should be fully referenced, quoting the author, title, university, degree level and pagination. Queries or requests for any other use, or if a more substantial copy is required, should be directed to the owner of the Intellectual Property Rights. 2 Abstract Immediately after the Second World War, France began to abolish the regulation of prostitution, first by outlawing brothels in 1946, then by dismantling all remaining medical and police registers in 1960. In doing so, it adopted an ‘abolitionist’ approach to prostitution. This stance, which distinguishes itself from both regulation and prohibition, is based on criminalising the exploitation of prostitution, and providing social support to individuals involved in prostitution, who are perceived to be inherently ‘victims’. However, since then, the policies and programmes enacted in the name of ‘abolitionism’ have varied considerably: policies based on supporting ‘victims’ have been succeeded by some that seek to criminalise individuals in prostitution by outlawing soliciting. More recently, in April 2016, the country adopted a policy of client criminalisation which is intended to ‘abolish’ prostitution entirely. Thus, on the one hand, France has remained steadfastly committed to abolitionism throughout the period. -
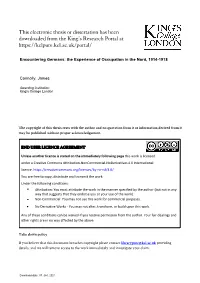
The Experience of Occupation in the Nord, 1914-1918
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Encountering Germans: the Experience of Occupation in the Nord, 1914-1918 Connolly, James Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 07. Oct. 2021 This electronic theses or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Encountering Germans: the Experience of Occupation in the Nord, 1914-1918 Title: Author: James Connolly The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. -

Le Système Prostitueur
“Il n’est nullement question de faire gouverner la société par les femmes mais bien de savoir si elle ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et par les femmes.” John STUART MILL Une association pour ré-agir au féminin Le système prostitueur : violence machiste archaïque Quinzaine Egalité femmes-hommes de la région Rhône-Alpes 8 octobre 2012 – Villeurbanne, Palais du travail, 9 place Lazare Goujon 9h30-18h00 Conclusion Le système prostitueur : un enjeu social et politique, Gérard Biard En guise de préambule, j’aimerais citer quelques courts passages d’un livre, qui n’a pas été écrit par un fervent militant de l’abolitionnisme. Il s’agit de « La Fermeture », d’Alphonse Boudard, qui retrace les conditions dans lesquelles fut adoptée la loi Marthe Richard. Il a interrogé nombre de proxénètes, qu’il connaissait personnellement : je rappelle qu’avant de devenir un écrivain de talent, Boudard était cambrioleur professionnel — de talent aussi, à ce qu’il paraît — et appartenait au milieu. Quelques passages, donc, tiré du chapitre intitulé « Histoire succincte de la galanterie et de ses maisons d’accueil depuis l’âge de pierre jusqu’à l’ère de la bourgeoisie absolue ». Dans cette brève histoire de la prostitution documentée à la source, Boudard évoque la « grande époque » de la prostitution moderne, celle qui va de la fin du XVIIIè siècle à la loi Marthe Richard, celle qui fait rêver les esthètes qui signent des tribunes dans le Nouvel Observateur, puisque les grands artistes, peintres, écrivains, poètes, fréquentaient et chantaient les louanges du bordel. Voilà ce que Boudard en écrit : « […] sur les boulevards, dans les allées du bois de Boulogne ou de Vincennes, dans les ruelles sordides aussi bien que bouclées en maison, les filles seront toutes maquées. -

If I Say If: the Poems and Short Stories of Boris Vian
Welcome to the electronic edition of If I Say If: The Poems and Short Stories of Boris Vian. The book opens with the bookmark panel and you will see the contents page. Click on this anytime to return to the contents. You can also add your own bookmarks. Each chapter heading in the contents table is clickable and will take you direct to the chapter. Return using the contents link in the bookmarks. The whole document is fully searchable. Enjoy. If I Say If The high-quality paperback edition is available for purchase online: https://shop.adelaide.edu.au/ CONTENTS Foreword ix Marc Lapprand Boris Vian: A Life in Paradox 1 Alistair Rolls, John West-Sooby and Jean Fornasiero Note on the Texts 13 Part I: The Poetry of Boris Vian 15 Translated by Maria Freij I wouldn’t wanna die 17 Why do I live 20 Life is like a tooth 21 There was a brass lamp 22 When the wind’s blowing through my skull 23 I’m no longer at ease 24 If I were a poet-o 25 I bought some bread, stale and all 26 There is sunshine in the street 27 A stark naked man was walking 28 My rapier hurts 29 They are breaking the world 30 Yet another 32 I should like 34 If I say if 35 If I Say If A poet 36 If poets weren’t such fools 37 It would be there, so heavy 39 There are those who have dear little trumpets 41 I want a life shaped like a fishbone 42 One day 43 Everything has been said a hundred times 44 I shall die of a cancer of the spine 45 Rereading Vian: A Poetics of Partial Disclosure 47 Alistair Rolls Part II: The Short Stories of Boris Vian 63 Translated by Peter Hodges Martin called… -

The Paradoxes and Contradictions of Prostitution in Paris
chapter 7 The Paradoxes and Contradictions of Prostitution in Paris Susan P. Conner Overview and Sources Paris, France changed dramatically between the seventeenth century and the beginning of the twenty-first century. As the population of Paris increased from nearly 250,000 residents in 1600 to a current population of approximately 2.2 million in the city centre,1 the city was redefined by its revolutions, sub- sequent industrialization and immigration, and wars. During those centuries, prostitution was redefined as well. Originally prostitution was a moral offense and an issue of public order. Individual prostitutes, who were defined collec- tively under the law, were typically poor, young women from the provinces.2 They were dealt with in three ways: the judicial system if they committed other more serious infractions, prison hospitals if they were diseased, or the police in an effort to enforce order. * I would like to thank Central Michigan University for several Research and Creative En- deavors Grants in support of this project, the neh for a Travel to Collections Grant, and col- leagues who have given critiques on aspects of this research including Dena Goodman, Isser Wolloch, Alan Williams, Linda Merians, Tim Shaffer, and Rosamond Hooper-Hamersley. Por- tions of this research have been published as “The Pox in Eighteenth-Century France”, in Linda Merians (ed.), The Secret Malady: Venereal Disease in Eighteenth-Century England and France (Lexington, ky, 1996), pp. 15–33; “Public Women and Public Virtue: Prostitution in Revolutionary Paris”, Eighteenth Century Studies, 28 (1994–1995), pp. 221–240; “Politics, Pros- titution and the Pox in Revolutionary Paris, 1789–1799”, Journal of Social History, 22 (1989), pp. -

City Research Online
City Research Online City, University of London Institutional Repository Citation: Wheelwright, J. ORCID: 0000-0002-6982-4476 (2019). Poisoned Honey: The Myth of Women in Espionage. Queen’s Quarterly, 100(2), pp. 3-17. This is the published version of the paper. This version of the publication may differ from the final published version. Permanent repository link: https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/23204/ Link to published version: Copyright: City Research Online aims to make research outputs of City, University of London available to a wider audience. Copyright and Moral Rights remain with the author(s) and/or copyright holders. URLs from City Research Online may be freely distributed and linked to. Reuse: Copies of full items can be used for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge. Provided that the authors, title and full bibliographic details are credited, a hyperlink and/or URL is given for the original metadata page and the content is not changed in any way. City Research Online: http://openaccess.city.ac.uk/ [email protected] Margaretha Zelle MacLeod, a.k.a. Mata Hari,on the day French authorities arrested her as a spy, February 13, 1917. JULIE WHEELWRIGHT Poisoned Honey The Myth of Women in Espionage Our century’s fascination with the spy has produced at least as much mythology as recorded fact, and the romanticized picture of international espionage is never complete without the alluring and dangerous femme fatale. But this misconception about the role of women in intelligence is not confined to spy novels and James Bond films; in many cases it has been nurtured at the very highest levels of the intelligence community. -

Table of Contents
TABLE OF CONTENTS NON-FICTION.................................................................................. 3 HIGHLIGHT.................................................................................................3 SOCIETY, POLITICS, ECONOMY ...........................................................3 HISTORY ......................................................................................................9 BIOGRAPHY ..............................................................................................19 MEMOIRS & TRUE STORIES.................................................................27 SCIENCES...................................................................................................33 CULTURAL ESSAYS.................................................................................36 PHILOSOPHY & RELIGION & SPIRITUAL LIFE...............................40 PSYCHOLOGY & MEDECINE & SELF-HELP.....................................44 TRAVEL GUIDES & GASTRONOMY ....................................................51 REFERENCE BOOKS ...............................................................................55 ILLUSTRATED BOOKS ...........................................................................55 ATLAS .........................................................................................................56 ALL TITLES .................................................................................... 59 Contact: Mrs Anastasia Lester ; Email: [email protected] 1 NON-FICTION NON-FICTION HIGHLIGHT -

Sex, AIDS, Migration, and Prostitution: Human Trafficking in the Caribbean Catherine Benoît
Connecticut College Digital Commons @ Connecticut College Anthropology Faculty Publications Anthropology Department 1-1-1999 Sex, AIDS, Migration, and Prostitution: Human Trafficking in the Caribbean Catherine Benoît Follow this and additional works at: https://digitalcommons.conncoll.edu/anthrofacpub Part of the Anthropology Commons, and the Caribbean Languages and Societies Commons This Article is brought to you for free and open access by the Anthropology Department at Digital Commons @ Connecticut College. It has been accepted for inclusion in Anthropology Faculty Publications by an authorized administrator of Digital Commons @ Connecticut College. For more information, please contact [email protected]. The views expressed in this paper are solely those of the author. C. Benoît Sex, AIDS, migration, and prostitution : human trafficking in the Caribbean Study of sexual tourism in Saint Martin/Sint Maarten, where prostitution is a widespread reality. Author argues that on this island where rapid economic development is based on the tourist industry and on offshore financial services, sexual relationships are determined by geopolitical and financial (neoliberal) interests that go beyond sexuality per se. She focuses on the precarious situation of the foreign prostitutes who have no working papers. In: New West Indian Guide/ Nieuwe West-Indische Gids 73 (1999), no: 3/4, Leiden, 27-42 This PDF-file was downloaded from http://www.kitlv-journals.nl Downloaded from Brill.com02/28/2019 07:29:22PM via Connecticut College CATHERINE BENOIT SEX, AIDS, MIGRATION, AND PROSTITUTION: HUMAN TRAFFICKING IN THE CARIBBEAN In every society, sexuality is set in the service of several realities - economic, political, etc. - which have nothing to do directly with sexuality or with the sexes (Godelier 1995:117).