Geometre Intervention Du Mise En Oeuvre De La De L
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SERIE A1 Centre: ANTANANARIVO I Mention:Très Bien
SERIE A1 1010134 FANORENANA NOMENA JOHNSON SERIE A1 1030005 RANDRIAMANANA MIORA HENINT 1030220 RASOAMANANTENA DAMY ANITA 1050039 RASOLONIAINA ANGELINE Centre: 1010136 ANDRIAMIALISOA NIRINA CLAR Centre: 1030015 RAHARIMINO MURIELLE CHRIST 1030221 RAKOTOARISOA FANILO SIMONE 1050040 RANJAMALALA ROJONIAINA JEN ANTANANARIVO I 1010138 RANDRIANAIVOSOA ZAFINDRAVA ANTANANARIVO II 1030017 RANDRIANOMENA NJAKANIAINA 1030226 RAOBINOMENJANAHARY VOLA LA 1050041 RANDRIAMIHAMINA LOVA DIAMO Mention:Très Bien 1010139 RANDRIAMANANA TIANA HENINT Mention:Très Bien 1030021 RASOANINDRINA LINA 1030230 GILBERTO CLAUDIO SITRAKINI 1050044 RATOVOSON ANDRIANINA Néant 1010140 RAOBIJAONA MIROJOTIANA VAN Néant 1030023 WOEL-LALA RAMIHARISOA SAHO 1030234 RABEMANANJARA ANDY SITRAKA 1050045 DANITSAIKA MIREILLE CHANTA Mention: Bien 1010142 ANDRIANIAINA RATSIMBAZAFY Mention: Bien 1030025 RAHARIMANANIRINA SEHENOMAL 1030237 RAKOTOARIBOANA ANDRIANANTE 1050048 RAZAFINDRAININOEL ANDO NAN 1010034 RAMAROSON DINA FITIAVANA E 1010143 RASOAVOLOLONA SOAVA KOLOIN 1020045 ANDRIANARISOA KOJAMIJORO V 1030028 RASENDRANORO HAINGOALINASY 1030239 RASOLONDRAIBE HANITRINIAIN 1050061 ANDRIANANDRIANINA MIORAMAN Mention: Assez Bien 1010145 RAZAFIARIVELO ANJARISOA JE 1020048 RAFARAMALALA SAHONDRA NIRI 1030029 RANDRIAMANANJARA SOPHIE MI 1030240 RAKOTOMAMONJY FENONTSOA MI 1050065 RASOATIANA LINDA PASCALINE 1010004 RAFETIARISON HASINA ANDRIA 1010146 RANIVOARIVELO DIMBINIAINA Mention: Assez Bien 1030035 RAJAOARIVONY LAZANIAINA 1030243 RAZAFINDRATAFIKA HENINTSOA 1050078 MIHAJA NANTENAINA IDEAL IS 1010012 -

RALAMBOZANANY Reine Dokia ECO N°
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO A/U : 2004/05 Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie ---------------------- Département ECONOMIE ---------------------- Deuxième Cycle – Promotion Sortante ---------------------- Mémoire de Maîtrise ès Science Economique : LA FILIERE FRUITS ET LEGUMES DANS LA REGION DU VAKINANKARATRA Directeur de mémoire : RANDRETSA Maminavalona Professeur titulaire à l’Université d’Antananarivo Présenté par : RALAMBOZANANY Reine Dolcia Date de Soutenance 20 Décembre 2005 REMERCIEMENT : Ce travail a été le fruit d’une longue réflexion et d’une rude recherche. Ceci ne peut être accompli sans la grande aide de ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa réalisation. Un remerciement à Monsieur RANDRETSA Maminavalona qui a bien voulu m’encadrer dans la réalisation de ce mémoire. Je dédie aussi un vif remerciement à tous nos professeurs pour leurs enseignements et conseils. J’adresse un profond remerciement à tous les organismes qui ont contribué à la conception de ce mémoire : - à Monsieur Rakotoralahy J. Baptiste, Chef de Service du DRDR du Vakinankaratra - à Madame Ratsimbazafy Modestine, Responsable de la promotion de la filière fruits et légumes dans la Région (DRDR) - aux responsables de la documentation du MAEP - à tous les personnels du CTHA - à Monsieur Nary, ingénieur agronome de la CTHA qui m’a beaucoup aidé lors de ma descente dans la commune d’Ambano. Nous espérons que ce modeste travail, contribuera à la prise de décision non seulement sur les politiques de développement local mais aussi celles du développement rural de Madagascar. TABLE DES MATIERES - 2 - REMERCIEMENT INTRODUCTION……………………………………………………………………….. 05 Partie I : Etat des lieux….…………………………………………………………… 06 Chap I : Contexte socio-économique de la région du Vakinankaratra…………… 06 1. -

Résultats Détaillés Antananarivo
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 1 ANTANANARIVO BV reçus: 313 sur 313 GASIKA MARINA HVM MAPAR MMM NY AREMA ASSOCI TIM RA MANGA ATION MAINTS RANO MALAG N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E O MALAZA ASY SAMBA REGION 11 ANALAMANGA BV reçus 140 sur 140 DISTRICT: 1101 AMBOHIDRATRIMO BV reçus24 sur 24 01 AMBATO 0 0 8 7 0 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 02 AMBATOLAMPY 0 0 8 8 0 8 0 1 4 1 0 0 0 0 2 03 AMBOHIDRATRIMO 0 0 10 10 0 10 0 1 8 0 0 0 0 0 1 04 AMBOHIMANJAKA 0 0 6 6 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 05 AMBOHIMPIHAONANA 0 0 6 6 0 6 0 0 3 0 0 0 0 1 2 06 AMBOHITRIMANJAKA 0 0 8 8 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 2 07 AMPANGABE 0 0 8 7 0 7 0 1 6 0 0 0 0 0 0 08 AMPANOTOKANA 0 0 8 8 0 8 0 4 2 0 1 0 0 0 1 09 ANJANADORIA 0 0 6 6 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 1 10 ANOSIALA 0 0 8 8 0 8 0 2 2 1 0 0 0 0 3 11 ANTANETIBE MAHAZA 0 0 8 8 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 2 12 ANTEHIROKA 0 0 8 6 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 1 13 ANTSAHAFILO 0 0 6 6 0 6 0 3 2 0 0 0 0 0 1 14 AVARATSENA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 FIADANANA 0 0 6 6 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 16 IARINARIVO 0 0 6 6 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 1 17 IVATO 0 0 8 8 0 8 0 1 4 2 0 0 0 0 1 18 MAHABO 0 0 6 6 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 2 19 MAHEREZA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 MAHITSY 0 0 8 8 0 8 0 4 3 0 0 0 0 0 1 21 MANANJARA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 22 MANJAKAVARADRAN 0 0 6 6 0 6 0 1 2 1 0 0 0 1 1 23 MERIMANDROSO 0 0 8 8 0 8 0 2 5 0 1 0 0 0 0 24 TALATAMATY 0 0 8 8 0 8 0 0 3 2 0 0 0 0 3 TOTAL DISTRICT 0 0 172 165 0 165 0 28 98 7 2 0 0 2 28 DISTRICT: 1102 ANDRAMASINA BV reçus14 sur 14 01 ALAROBIA VATOSOLA 0 0 8 8 0 8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 02 ALATSINAINY -
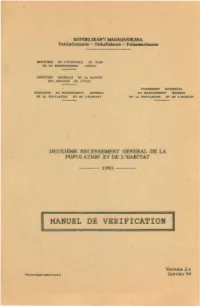
[ Manuel De Verification'i
~POBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahanâ - Fahamarinana YIN1ST~RB DE L' ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRBSSBMENT SOCIAL DIRBCTION' GBNERALE DE LA BANQUE DES DON NEES DE L'BTAT COMMISSION N'ATIONALE DIRECTION DV RECENSEMBNT GENERAL- DU iECBNSENENT ~ENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DB LA 1'OPULATION ST J)E L'HABITAT ,. DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 1993 --- 1 / [ MANUEL DE VERIFICATION ' I Version 2.s . fO\<l.ocrsph\lIIanveT2.8 Janvier 94 REPOBLlKAN'I MADAGASlKARA 'farundrazalla - Fahafahana - Fahamarinana UINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRESSEMENT SOCIAL DIRECTIO:-: GENERALE DE LA BANQUE DES DONNEES DE L'ETAT COMMISSION NATIONALE DIREC1ION Dl! RECENSEMENT GENERAL DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POP U LATIO:i ET DE l' HABITAT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DEUXIEME RECENSEMEl\rrr GEN]~RAL DE LA POPULATION Err DE L ~HA,BI'TAT 1993 MANUEL DE VERIFICATION 1 Il Version 2.s fb\docrBPh\manver2.s Janvier 94 SOI\.iMA1RE INTRODUCTIO~~ . 2 l - GENERALITES SUR LA VERIFICATION 1.1 - LA SECTION V"ERIFICATION ..•.........' , . ,........... 2 1.2 - LE TR~ VAIL DU \lt:RlFICATEUR ..................... 2 1.3 - L'IDEN1IFICATION DES QUESTIONNAIRES .. ,.... ~, ...... 3 1.4- LES QUESTIOl'.~.AIRES-SUITE ...................... 5 ,2 '- METIIODE DE'VERIFICATION o - MILIEU ..............................••........ 5 l - 'FARITA.N1" 2 - F IVONDRONA1\fPOK0l'41 Al"\""l , 3 - FIRAISM1POKONTMry· ..............•...•..........• 5 4 -. N°DE LA ZONE 5 - N e DU S EGME?\l . ~ . .. .... 6 6 "- FOKONTAl~l'· 7 - LOCALITE .... ' .....•..............•..... la ••' • • • • • • 8 8 - N ~ 'DU B.ATIMEr1T .•..-. _ .....•.. ~ ..••.•' .•••.•..•• · • 8 . 9 - TI'1>E' D'UTILISATION . '........................ · . 8 , <> DU ,..,.-c.... TAGE .. 9 ,~ 10. ~ _N Ir}...!::..l'" .• • . -

Universite D'antananarivo Faculte Des Sciences
UNIVERSITE D'ANTANANARIVO FACULTE DES SCIENCES DEPARTEMENT DE PHYSIQUE MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE MAITRISE EN SCIENCES ET TECHNIQUES EN GEOPHYSIQUE APPLIQUEE Intitulé ETUDE ET EVALUATION DE LA PRODUCTION AURIFERE PROVENANT DES ORPAILLEURS PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES DE MADAGASCAR Présenté par RANDRIANARIJAONA Herivonjy Guy Nicolas Membres de Jury : Président Monsieur RAMBOLAMANANA Gérard, Professeur Rapporteur Monsieur RASOLOMANANA Eddy, Professeur Examinateurs Monsieur PUVILLAND Pascal, Docteur Madame RAKOTONOMENJANAHARY Vololona, Docteur Soutenu le 16 Janvier 2007 UNIVERSITE D'ANTANANARIVO FACULTE DES SCIENCES DEPARTEMENT DE PHYSIQUE MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE MAITRISE EN SCIENCES ET TECHNIQUES EN GEOPHYSIQUE APPLIQUEE Intitulé ETUDE ET EVALUATION DE LA PRODUCTION AURIFERE PROVENANT DES ORPAILLEURS PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES DE MADAGASCAR Présenté par RANDRIANARIJAONA Herivonjy Guy Nicolas Membres de Jury : Président : Monsieur RAMBOLAMANANA Gérard, Professeur Rapporteur : Monsieur RASOLOMANANA Eddy, Professeur Examinateurs : Monsieur PUVILLAND Pascal, Docteur Madame RAKOTONOMENJANAHARY Vololona, Docteur Soutenu le 16 Janvier 2007 Remerciements Avant de passer au développement de cet ouvrage, il m’est particulièrement agréable d’adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui ont bien voulu, contribuer à sa bonne réalisation, et exprimer ma gratitude notamment à : - Madame RANDRIAMANANTANY Zely Arivelo, Chef de département de la physique à l’Université d’Antananarivo -

EITI Madagascar Rapport De Réconciliation Exercice 2011 Rapport De Réconciliation EITI Exercice 2011 Résumé Exécutif
EITI Madagascar Rapport de réconciliation Exercice 2011 Rapport de réconciliation EITI Exercice 2011 Résumé exécutif Contexte et objectifs du rapport Le présent document, intitulé « Rapport EITI Madagascar – Exercice 2011 », constitue le troisième rapport officiel de réconciliation de Madagascar, commandé par le Comité National de l’EITI. Son premier objectif est la réconciliation des flux financiers entre l’État et les principales industries extractives (compagnies minières et pétrolières amont) à Madagascar pour l’année fiscale 2011. Le rapport reflète également les recommandations préconisées par le Board of Directors international de l’EITI, notamment : ► L’état des dons remis par les entreprises extractives à la collectivité ; ► La mise en exergue des informations concernant les collectivités décentralisées (régions et communes) ; ► L’utilisation des fonds reçus des entreprises extractives par les communes pratiquant le budget participatif ; ► La divulgation de la production exportée au cours de l’année considérée ; ► La contribution fiscale et économique du secteur extractif dans l’économie malgache ; ► L’état des procédures d’octroi de permis en 2011 ; ► L’état de la transparence des titres extractifs disponible dans le domaine public. Etendue et approche La mission du Réconciliateur est régie par la norme internationale ISRS 4400 relative aux « Missions de procédure convenue relatives à des informations financières ». L’approche adoptée suit les étapes principales suivantes : ► La réalisation de l’étude de matérialité incluant -

Version Finale
PROJET D’URGENCE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA PROTECTION Public Disclosure Authorized SOCIALE (PURSAPS) Crédit N° 5374-MG Public Disclosure Authorized VERSION FINALE AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET D’URGENCE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA PROTECTION SOCIALE (PURSAPS) Exercice 2015 Agence d’Exécution « Programme National Bassins Versants Public Disclosure Authorized Périmètres Irrigués (PNBVPI)» AVRIL 2016 Public Disclosure Authorized Cabinet Audit Conseil Service (ACS) Lot VF 62 Mahamasina Nord (1er étage) ANTANANARIVO - 101 Tél : 020 22 240 22 E. mail : [email protected] PURSAPS PN-BVPI COMPOSANTE A TABLEAU A ETATS DES RESSOURCES ET EMPLOIS (par Catégories) (Montants exprimés en Ariary) Désignation Année Cumulatif RESSOURCES Fonds de dotation reçus 16 070 994 608,03 29 005 063 502,60 Fonds de dotation reçu IDA 16 017 996 709,94 28 952 065 604,51 Fonds de dotation reçu Autres 52 997 898,09 52 997 898,09 Fonds de contribution reçus (7 195 359,61) (7 205 659,61) Fonds de contribution accordés IDA Fonds de contribution accordés AUTRES Compte de liaison/Paiement directe Compte d'attente à régulariser (7 195 359,61) (7 205 659,61) Sous-Total RESSOURCES 16 063 799 248,42 28 997 857 842,99 Financement Total 16 063 799 248,42 28 997 857 842,99 EMPLOIS PAR CATEGORIE 2a – Dépenses liées aux composantes A1(b), A1(c), A2(c), A2( 11 899 141 432,82 13 049 840 813,50 2b – Argent contre travail de la composante A2(b) 543 877 249,67 577 975 749,67 2c - Subvention aux sous-projets A1(a) 2 233 729 355,68 2 395 161 608,68 3 – Dépenses -

Projet D'amelioration De La Delimitation Administrative, Outil De La Gestion Fonciere Decentralisee
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana -Ecole Nationale d’Administration de Madagascar- PROJET DE FIN D’ETUDES POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION DE MADAGASCAR SECTION: Ingénieur des Services Topographiques PROJET D’AMELIORATION DE LA DELIMITATION ADMINISTRATIVE, OUTIL DE LA GESTION FONCIERE DECENTRALISEE CAS : REGION VAKINANKARATRA Présenté par RAOELIARIMANANA Tsiry Aina Nomenjanahary PROMOTION ILAINA : 2014-2016 PRESUDENT DU JURY : Monsieur RAOELSON Harilanto Enseignant permanent à l’ENAM EXAMINATEUR : Monsieur RAZAFINDRAKOTOHARY Tiana GEOMETRE EXPERT RAPPORTEUR : Monsieur RMAROJOHN Landry Juriste, membre du comité de révision des textes fonciers Janvier 2016 Androhibe Ecole Nationale d’Administration de Madagascar Site web : www.enam.mg Antananarivo 101 Etablissement Public à caractère Administratif e-mail : [email protected] BP 1163 Placé sous tutelle du Ministère de la Fonction Publique [email protected] 020 24 553 79 Du Travail et des Lois Sociales et du Ministère des Finances et du Budget tél: 020 24 553 86 REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana -Ecole Nationale d’Administration de Madagascar- PROJET DE FIN D’ETUDES POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION DE MADAGASCAR SECTION: Ingénieur des Services Topographiques PROJET D’AMELIORATION DE LA DELIMITATION ADMINISTRATIVE, OUTIL DE LA GESTION FONCIERE DECENTRALISEE CAS : REGION VAKINANKARATRA Présenté par RAOELIARIMANANA Tsiry Aina Nomenjanahary PROMOTION ILAINA : 2014-2016 PRESUDENT -

Citizen Involvement in Municipal Service Improvement (Cimsi) : Etude De Reference (Baseline)
EVALUATION DES EFFETS ET IMPACTS DU PROJET CITIZEN INVOLVEMENT IN MUNICIPAL SERVICE IMPROVEMENT (CIMSI) : ETUDE DE REFERENCE (BASELINE) RAPPORT FINAL Etude de référence du projet « Citizen Involvement in Municipal Service Improvement (CIMSI) » Version finale GROUPEMENT A2DM Association d’Appui au Développement de Madagascar Siège sociale : Lot III O 50 Mananjara BP 8336 - Antananarivo 101 Téléphone : +261 33 15 00 495 / +261 34 20 104 95 Email : [email protected] CONFORME Conseil Formation Etudes Lot II M 45 DF Andrianalefy Androhibe 101 Antananarivo Téléphone : +261 33 72 596 13 Email : [email protected] Juillet 2018 p. 1 EVALUATION DES EFFETS ET IMPACTS DU PROJET CITIZEN INVOLVEMENT IN MUNICIPAL SERVICE IMPROVEMENT (CIMSI) : ETUDE DE REFERENCE (BASELINE) Table des matières Table des matières..........................................................................................................................2 Résumé exécutif ..............................................................................................................................6 1. Introduction générale ........................................................................................................... 11 1.1. Contexte du projet .......................................................................................................... 11 1.2. Le projet CIMSI ................................................................................................................ 11 1.3. Localisation des zones d’intervention du projet ............................................................ -
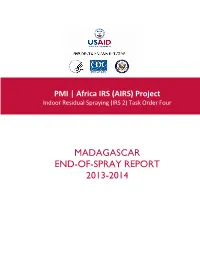
IRS Technical Report Template
PMI | Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT 2013-2014 Recommended Citation: PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four. May 2014. Madagascar End-of-Spray Report 2013-2014. Bethesda, MD. PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four, Abt Associates Inc. Contract No.: GHN-I-00-09-00013-00 Task Order: AID-OAA-TO-11-00039 Submitted to: United States Agency for International Development/PMI Abt Associates Inc. 1 4550 Montgomery Avenue 1 Suite 800 North 1 Bethesda, Maryland 20814 1 T. 301.347.5000 1 F. 301.913.9061 1 www.abtassociates.com 2013-2014 MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT CONTENTS Contents….. .................................................................................................................................. iii Acronyms… ..................................................................................................................................vii Executive Summary ..................................................................................................................... ix 1. Introduction ............................................................................................................................ 1 1.1 Background of IRS in Madagascar ................................................................................................................... 1 1.2 Objectives for AIRS Madagascar During the 2013-2014 IRS Campaigns ............................................. -

(Malagasy Miara
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS AMBATOLAMPY AMBATOLAMPY 1 MMM (Malagasy Miara - Miainga) RAJOELINA Harisson INDEPENDANT SOA IOMBONANA (Indépendant AMBATOLAMPY AMBATOLAMPY 1 FOLOMANANANDRO Marius Soa Iombonana) INDEPENDANT RAHARIVOLOLONA MONIQUE AMBATOLAMPY AMBATOLAMPY 1 RAHARIVOLOLONA Monique (Indépendant Raharivololona Monique) GROUPEMENT DE P.P IRD (Isika Rehetra AMBATOLAMPY AMBATOLAMPY 1 RAKOTOMALALA Dimbiniavo Mika Rasoanaivo Miaraka @ Andry Rajoelina) AMBATOLAMPY AMBATOLAMPY 1 TIM (Tiako I Madagasikara) VONINAHITRINIAINA Harilanto Randrianasolo INDEPENDANT RA DODA (Indépendant Ra AMBATOLAMPY AMBATOLAMPY 1 RAMANOELINA Rivoniaina Jodia Doda) INDEPENDANT RA OLIVIER (Indépendant Ra AMBATOLAMPY AMBATOLAMPY 1 RANDRIANARISON José Olivier Olivier) INDEPENDANT RAZAFY HARIMALALA AMBATOLAMPY AMBATONDRAKALAVAO 1 RAZAFY Harimalala Norosoa NOROSOA (Razafy Harimalala Norosoa) INDEPENDANT MITSANGANA MIHAZAVA AMBATOLAMPY AMBATONDRAKALAVAO 1 RAKOTOSAONA Patrick Nomenjanahary (Mitsangana Mihazava) AMBATOLAMPY AMBATONDRAKALAVAO 1 MMM (Malagasy Miara - Miainga) RANDRIAMADY Hoby Andréas Toussin GROUPEMENT DE P.P IRD (Isika Rehetra AMBATOLAMPY AMBATONDRAKALAVAO 1 RAMANAMISATA Miaraka @ Andry Rajoelina) AMBATOLAMPY AMBATONDRAKALAVAO 1 INDEPENDANT RAZILY (Indépendant Razily) RAKOTONDRAMANANA Gilbert INDEPENDANT RAKOTOARISOA JONAH PIERRE AMBATOLAMPY AMBATONDRAKALAVAO 1 RAKOTOARISOA Jonah Pierre (Indépendant Rakotoarisoa Jonah Pierre) INDEPENDANT RABENJAMIN (Indépendant Ra AMBATOLAMPY AMBODIFARIHY 1 RAKOTONDRAMANANA Benjamin -

Promouvoir Les Organisations De Producteurs Et Les Accompagner Vers Leur Viabilité
Promouvoir les organisations de producteurs et les accompagner vers leur viabilité Rapport d’activités 2017 et perspectives 2018-2019 SOMMAIRE A. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES ACTIVITÉS DE FERT À MADAGASCAR........................................... 4 1. HISTOIRE ET DÉMARCHE ................................................................................................................ 4 2. PRINCIPES D’INTERVENTION DE FERT ................................................................................................. 4 3. FERT À MADAGASCAR ................................................................................................................... 5 3.1. DOMAINES D’INTERVENTION ............................................................................................................. 5 3.2. ZONES D’INTERVENTION ................................................................................................................... 6 3.3. CONTEXTE D’INTERVENTION DE FERT À MADAGASCAR ........................................................................... 7 3.4. FAITS MARQUANTS 2017 ................................................................................................................. 7 3.5. SYNTHÈSE DES ACTIONS DE FERT À MADAGASCAR ............................................................................... 11 3.6. PERSPECTIVES 2018 ...................................................................................................................... 17 B. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES PROJETS ET ACTIVITÉS .........................................................