RALAMBOZANANY Reine Dokia ECO N°
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Infected Areas As on 26 January 1989 — Zones Infectées an 26 Janvier 1989 for Criteria Used in Compiling This List, See No
Wkty Epidem Rec No 4 - 27 January 1989 - 26 - Relevé éptdém hebd . N°4 - 27 janvier 1989 (Continued from page 23) (Suite de la page 23) YELLOW FEVER FIÈVRE JAUNE T r in id a d a n d T o b a g o (18 janvier 1989). — Further to the T r i n i t é - e t -T o b a g o (18 janvier 1989). — A la suite du rapport report of yellow fever virus isolation from mosquitos,* 1 the Min concernant l’isolement du virus de la fièvre jaune sur des moustiques,1 le istry of Health advises that there are no human cases and that the Ministère de la Santé fait connaître qu’il n’y a pas de cas humains et que risk to persons in urban areas is epidemiologically minimal at this le risque couru par des personnes habitant en zone urbaine est actuel time. lement minime. Vaccination Vaccination A valid certificate of yellow fever vaccination is N O T required Il n’est PAS exigé de certificat de vaccination anuamarile pour l’en for entry into Trinidad and Tobago except for persons arriving trée à la Trinité-et-Tobago, sauf lorsque le voyageur vient d’une zone from infected areas. (This is a standing position which has infectée. (C’est là une politique permanente qui n ’a pas varié depuis remained unchanged over the last S years.) Sans.) On the other hand, vaccination against yellow fever is recom D’autre part, la vaccination antiamarile est recommandée aux per mended for those persons coming to Trinidad and Tobago who sonnes qui, arrivant à la Trinité-et-Tobago, risquent de se rendre dans may enter forested areas during their stay ; who may be required des zones de -

Observatoire Du Vakinankaratra : Enquête Auprès Des Ménages 1995
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fahafahana - Tanindrazana-Fahamarinana Ministère de l'Economie et de la Promotion des Investissements Institut National de la Statistique OBSERVATOIRE DU VAKINANKARATRA ENQUETE AUPRES DES MENAGES 1995 Premiers résultats Février 1996 .version provisoire MADIO (MAdagascar-Dial-Instat-Orstom) est un projet chargé d'apporter aux autorités malgaches un appui à la réflexion macro-économique. Une partie de ses travaux s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de l'appareil statistique national. Le projet est cofmancé par l'Union Européenne, l'Orstom et le Ministère français de la Coopération et du Développement, pour une durée initiale de deux ans (1994-1996). Il est basé dans les locaux de la Direction Générale de l'Iristat à Antananarivo. Adresse: Projet MADIO, Institut National de la Statistique, Bureau 308 B.P. 485, Anosy - Antananarivo 101, Madagascar --ter:2:S8~32:-Fro(:332=50------- AVANT-PROPOS LES OBSERVATOIRES RURAUX : UN OUTIL DE SUIVI DE L'IMPACT DES REFORMES ECONOMIQUES SUR LES MENAGES RURAUX Le projet MADIü a choisi de mettre en place en 1995 des observatoires en milieu rural. L'objectif de cette opération est de suivre l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs de l'impact des politiques économiques sur les producteurs ruraux. Ces indicateurs concernent l'évolution des facteurs' de production agricole (le foncier, le travail et l'équipement agricole), l'offre productive (par exemple 'l'évolution de la production agricole commercialisée en fonction de l'évolution des prix ), mais aussi des indicateurs sur le niveau de vie des ménages (scolarisation, sécurité alimentaire, indicateurs de confort de l'habitat.;.). -

Distr. GENERAL CRC/C/8/Add.5 13 September 1993 ENGLISH Original
Distr. GENERAL CRC/C/8/Add.5 13 September 1993 ENGLISH Original: FRENCH COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES PURSUANT TO ARTICLE 44 OF THE CONVENTION Initial reports of States parties due in 1993 Addendum MADAGASCAR [20 July 1993] CONTENTS Paragraphs Page Introduction ........................ 1- 4 4 I. GENERAL PRINCIPLES .................. 5-34 4 A. Non-discrimination ................ 7-20 4 B. Best interests of the child............ 21-26 7 C. Right to life, survival and development...... 27-31 8 D. Respect for the views of the child ........ 32-34 9 II. BASIC HEALTH AND WELFARE ............... 35-64 10 A. Survival and development ............. 36-43 10 B. Disabled children................. 44-49 11 C. Health and health services ............ 50-61 12 GE.93-18558 (E) CRC/C/8/Add.5 page 2 CONTENTS (continued) Paragraphs Page D. Social security.................. 62- 64 14 E. Standard of living ................ 65- 66 14 III. CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS............... 67-154 15 A. Right of the child to an identity (art. 7) and preservation of identity (art. 8)......... 70-101 15 B. Freedom of expression (art. 13), freedom of thought, conscience and religion (art. 14) and access to information (art. 17).......... 102-139 21 C. Freedom of association and peaceful assembly (art. 15)..................... 140 28 D. Protection of privacy (art. 16).......... 141 28 E. Right not to be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 37 (a)) ............. 142-154 28 IV. FAMILY ENVIRONMENT AND ALTERNATIVE CARE........ 155-210 31 A. Parental guidance (art. 5) ............ 155-166 31 B. -

Analyse De L'erosion Dans Le Bassin Versant
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES SCIENCES DOMAINE SCIENCES ET TECHNOLOGIES MENTION : Bassins Sédimentaires Evolution Conservation PARCOURS : Bassin sédimentaires, Archives de la terre et Ressources du futur (BAR) MEMOIRE DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER II ANALYSE DE L’EROSION DANS LE BASSIN VERSANT SAHASAROTRA VINANINONY-SUD Présenté par : RAHOBISOA Sidonie Colette Soutenu publiquement, le 02 Septembre 2019 Devant les Membres du Jury : Président : Monsieur RASOLOFOTIANA Edmond, Maitre de Conférences Encadreur-Rapporteur: Madame RANAIVOSOA Voajanahary, Docteur ès- Sciences Examinateur : Monsieur RAKOTONDRAZAFY Toussaint, Maitre de Conférences UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES SCIENCES DOMAINE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES MENTION : Bassins Sédimentaires Evolution Conservation PARCOURS : Bassin sédimentaires, Archives de la terre et Ressources du futur (BAR) MEMOIRE DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER II ANALYSE DE L’EROSION DANS LE BASSIN VERSANT SAHASAROTRA VINANINONY-SUD Présenté par : RAHOBISOA Sidonie Colette Soutenu publiquement, le 02 Septembre 2019 Devant les Membres du Jury : Président : Monsieur RASOLOFOTIANA Edmond, Maitre de Conférences Encadreur-Rapporteur: Madame RANAIVOSOA Voajanahary, Docteur ès- Sciences Examinateur : Monsieur RAKOTONDRAZAFY Toussaint, Maitre de Conférences REMERCIEMENTS Je remercie tout d’abord Dieu tout puissant car la réalisation de ce mémoire a été rendue possible grâce à Sa bénédiction et Son amour qu’Il me donne toujours. Et aussi à toutes les personnes, de près ou de loin, qui m’ont prêtés leurs mains. Je voudrais remercier aussi tous les Enseignants au sein de la Mention Bassins sédimentaires Evolution Conservation de la Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo. Mes vives reconnaissances également s’adressent à : Monsieur RAMAHAZOSOA Irrish Parker, Maîtres de Conférences, Doyen de la Faculté des Sciences (Domaine des Sciences et Technologies) de l’Université d’Antananarivo, qui m’a donné l’autorisation de présentation de ce mémoire. -

Diagnostic Territorial De La Région Du Vakinankaratra À Madagascar
« Prospective territoriale sur les dynamiques démographiques et le développement rural en Afrique subsaharienne et à Madagascar » ETUDE pour le compte de l’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RAPPORT PAYS Diagnostic Territorial de la Région du Vakinankaratra à Madagascar Auteurs : Jean-Michel SOURISSEAU, Patrick RASOLOFO, Jean-François BELIERES, Jean-Pierre GUENGANT, Haja Karmen RAMANITRINIONY, Robin BOURGEOIS, Tovonirina Théodore RAZAFIMIARANTSOA, Voahirana Tantely ANDRIANANTOANDRO, Manda RAMARIJAONO, Perrine BURNOD, Hajatiana RABEANDRIAMARO, Nathalie BOUGNOUX Version finale Février 2016 Avant-Propos Ce rapport est un des produits de l’étude « Prospective territoriale sur les dynamiques démographiques et le développement rural en Afrique subsaharienne et à Madagascar » menée dans deux régions d’Afrique : la région de Ségou au Mali et la région de Vakinankaratra à Madagascar Il s’agit du diagnostic territorial rétrospectif de la Région du Vakinankaratra. Une première version a servi à la préparation de l’atelier de prospective « Les avenirs de Vakinankaratra en 2035 » qui s’est tenu du 17 au 21 août 2015 à Antsirabe et qui a donné lieu à la production d’un rapport, également disponible. Une deuxième version, très largement enrichie, datée de janvier 2016, a été éditée à cent cinquante exemplaires, et diffusée lors des ateliers de restitution qui ont eu lieu à Antsirabe et Antananarivo, les 02 et 04 février 2016. Ce document (daté de février 2016) constitue la version finale qui prend en compte les remarques faites lors de ces ateliers. Ce rapport sur la région de Vakinankaratra est le pendant du document établi pour la région de Ségou au Mali. Ses principaux enseignements, complétés par les produits de l’atelier, sont intégrés dans le rapport de synthèse de l’étude, produit final rassemblant les acquis de la prospective dans les deux régions et les perspectives en termes de méthode et de reproduction dans d’autres situations. -

Dimensionnement De La Route Antsirabe-Soanindrariny 1
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE D’ANTANANARIVO DEPARTEMENT BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS MEMOIRE DE FIN D’ ETUDES EN VUE DE L’ OBTENTION DU DIPLOME D’ INGENIEUR DDIIMMEENNSSIIOONNNNEEMMEENNTT DDEE LLAA RROOUUTTEE AANNTTSSIIRRAABBEE--SSOOAANNIINNDDRRAARRIINNYY (( DDUU PP..KK 00++000000 AAUU PP..KK 2288++225500 )) Présenté par : ANDRIANANTOANDRO Hajaniaina Herilalaina Encadré par : RALAIARISON Moïse Date de soutenance : 03 Février 2005 REMERCIEMENTS Le présent travail n’a pu être effectué sans la grâce de Dieu Tout Puissant. J’exprime mes vifs et sincères remerciements ainsi que ma profonde reconnaissance à : M. RANDRIANOELINA Benjamin, Directeur de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo, qui, par son administration clairvoyante a fait de l’école ce qu’elle est ; M. RABENATOANDRO Martin, Chef de département du Bâtiment et Travaux Publics, grâce à qui, j’ai apprécié ma spécialité ; M. RALAIARISON Moïse, Maître de conférence, mon encadreur pédagogique, qui n’a pas ménagé ses conseils pour me guider tout au long du travail ; Je remercie également : Les Maires de la commune de Soanindrariny et de la commune d’Ambohidranandriana ; Tout le personnel enseignant et administratif de l’ ESPA Je ne saurais oublier de remercier ma famille et mes proches qui m’ont toujours soutenu et encouragé tout au long de mes études. SOMMAIRE INTRODUCTION GENERALE PREMIERE PARTIE : ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES Chap. I : DESCRIPTION DU PROJET I- PRESENTATION GLOBALE DU PROJET II- OBJECTIF DU PROJET III- RESULTATS ATTENDUS CONCLUSION PARTIELLE Chap. II : PRESENTATION DE LA ZONE DU PROJET OBJECTIF I- COMMUNE RURALE DE SOANINDRARINY II- COMMUNE URBAINE D’ANTSIRABE III- COMMUNE RURALE D’AMBOHIDRANANDRIANA CONCLUSION PARTIELLE Chap. III : PREVISION SOCIO-ECONOMIQUE I. -
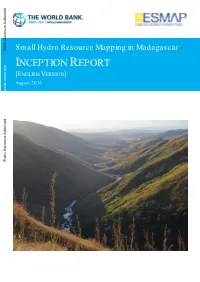
Small Hydro Resource Mapping in Madagascar
Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE 15 SEPTEMBER 1995 ● 70Th YEAR 70E ANNÉE ● 15 SEPTEMBRE 1995
WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, No. 37, 15 SEPTEMBER 1995 • RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 37, 15 SEPTEMBRE 1995 1995, 70, 261-268 No. 37 World Health Organization, Geneva Organisation mondiale de la Santé, Genève WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE 15 SEPTEMBER 1995 c 70th YEAR 70e ANNÉE c 15 SEPTEMBRE 1995 CONTENTS SOMMAIRE Expanded Programme on Immunization – Programme élargi de vaccination – Lot Quality Assurance Evaluation de la couverture vaccinale par la méthode dite de Lot survey to assess immunization coverage, Quality Assurance (échantillonnage par lots pour l'assurance de la qualité), Burkina Faso 261 Burkina Faso 261 Human rabies in the Americas 264 La rage humaine dans les Amériques 264 Influenza 266 Grippe 266 List of infected areas 266 Liste des zones infectées 266 Diseases subject to the Regulations 268 Maladies soumises au Règlement 268 Expanded Programme on Immunization (EPI) Programme élargi de vaccination (PEV) Lot Quality Assurance survey to assess immunization coverage Evaluation de la couverture vaccinale par la méthode dite de Lot Quality Assurance (échantillonnage par lots pour l'assurance de la qualité) Burkina Faso. In January 1994, national and provincial Burkina Faso. En janvier 1994, les autorités nationales et provin- public health authorities, in collaboration with WHO, con- ciales de santé publique, en collaboration avec l’OMS, ont mené ducted a field survey to evaluate immunization coverage une étude sur le terrain pour évaluer la couverture vaccinale des for children 12-23 months of age in the city of Bobo enfants de 12 à 23 mois dans la ville de Bobo Dioulasso. L’étude a Dioulasso. The survey was carried out using the method of utilisé la méthode dite de Lot Quality Assurance (LQA) plutôt que Lot Quality Assurance (LQA) rather than the 30-cluster la méthode des 30 grappes plus couramment utilisée par les pro- survey method which has traditionally been used by immu- grammes de vaccination. -

Banque Mondiale Evaluation Du Programme Transfert
BANQUE MONDIALE EVALUATION DU PROGRAMME TRANSFERT MONETAIRE CONDITIONNEL DE BETAFO RAPPORT DEFINITIF Paul RANDRIANIRINA Consultant Décembre 2018 TABLE DES MATIERES LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................ v LISTE DES GRAPHIQUES ........................................................................................................................... vi SIGLES ET ACRONYMES ......................................................................................................................... viii RESUME EXECUTIF ................................................................................................................................... ix 1. PRESENTATION GENERALE DE L'ETUDE .......................................................................................... 2 1.1. ZONE D’ETUDE ......................................................................................................................... 2 1.2. PROGRAMME TMC .................................................................................................................. 3 1.3. OBJECTIFS DE L’ETUDE ............................................................................................................ 5 1.4. METHODOLOGIE ...................................................................................................................... 5 2. PROFIL DES MENAGES .................................................................................................................... -

1407 Mandoto
dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 140701010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBARARATA dfggfdgffhCommune: MANDOTO dfggfdgffhDistrict: MANDOTO dfggfdgffhRegion: VAKINANKARATRA dfggfdgffhProvince: ANTANANARIVO Inscrits : 394 Votants: 198 Blancs et Nuls: 1 Soit: 0,51% Suffrages exprimes: 197 Soit: 99,49% Taux de participation: 50,25% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 55 27,92% 25 RAVALOMANANA Marc 142 72,08% Total voix: 197 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 140701030101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMPARIHY FENOMANANA dfggfdgffhCommune: MANDOTO dfggfdgffhDistrict: MANDOTO dfggfdgffhRegion: VAKINANKARATRA dfggfdgffhProvince: ANTANANARIVO Inscrits : 602 Votants: 306 Blancs et Nuls: 8 Soit: 2,61% Suffrages exprimes: 298 Soit: 97,39% Taux de participation: 50,83% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 73 24,50% 25 RAVALOMANANA Marc 225 75,50% Total voix: 298 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

Madagascar Household Outcome Monitoring Survey Comparisons 1 After the Political Crisis in 2009, in Response to the U.S
MADAGASCAR HOUSEHOLD OUTCOME MONITORING SURVEY 2007–2010 COMPARISONS This publication was produced for the United States Agency for International Development. It was prepared by Orlando Hernandez under the USAID Hygiene Improvement Project by the Academy for Educational Development. The USAID Hygiene Improvement Project (HIP) is a six-year (2004-2010) project funded by the USAID Bureau for Global Health, Office of Health, Infectious Diseases and Nutrition, led by the Academy for Educational Development (contract # GHS-I-00-04-00024-00) in partnership with ARD Inc., the IRC International Water and Sanitation Centre, and the Manoff Group. HIP aims to reduce diarrheal disease prevalence through the promotion of key hygiene improvement practices, such as hand washing with soap, safe disposal of feces, and safe storage and treatment of drinking water at the household level. April 2011 Contact Information: USAID Hygiene Improvement Project Academy for Educational Development 1825 Connecticut Avenue, NW Washington, DC 20009-5721 Tel. 202-884-8000; Fax: 202-884-8454 [email protected] - www.hip.watsan.net Submitted to: Merri Weinger Office of Health, Infectious Diseases and Nutrition Bureau for Global Health U.S. Agency for International Development Washington, DC 20523 Acknowledgements Special thanks to Orlando Hernandez, Clement Randriantelomanana, Dr. Odile Randriamanajara, PENSER, the enumerator teams, and community members who participated in this survey. CONTENTS INTRODUCTION ...........................................................................................................................................