La Décolonisation Vue De Besançon P
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jotjfnal OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES ASSIEM BLÈE NATIONALE
Année 1987. - No 62 [2] A. N. (C. R.) Mercredi 14 octobre 1987 JOtJFNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES ASSIEM BLÈE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1.958 8e Législature PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1987-1988 (14• SÉANCE) COMPTE RENDU INTÉGRAL 2e séance du mardi 13 octobre 1987 142 421S ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 13 OCTOBRE 1987 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON M me Françoise de Panafieu, MM . Jean Jarosz, Christian Pierret, Alain Juppé, ministre délégué 1 . Fixation de l 'ordre du jour (p. 4217). auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, porte-parole du Gouvernement. 2. Loi de finances pour 19R. - Suite de la discussion générale d 'un projet de loi (n. 4217). MM . le président, Christian Pierret. Question préalable de M. Lajoinie : MM . Roger Com- Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance. brisson, Philippe Auberger . - Rejet par scrutin. MM. Franck Borotra, Jean Giard, 3. Dépôt d'un projet de loi adopté par I . Sénat Christian Goux, (p. 4240). Gérard Trémége, Pascal Arrighi, Jean Royer, 4. Ordre du jour (p . 4240). ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 13 OCTOBRE 1987 4217 COMPTE RENDU INTEGRAL PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON, 2 vice-président La séance est ouverte à vingt et une heures trente. LOI DE FINANCES POUR 1958 M . le président. La séance est ouverte. Suite de la discussion générale d'un projet de loi 1 M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion générale du projet de loi de finances pour 1988 (nos 941, 960). -
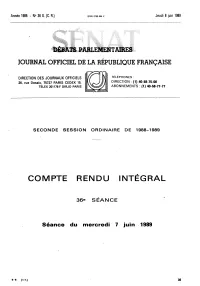
Compte Rendu Intégral
Année 1989. - No 36 S. (C. R.) ISSN 0755-544 X Jeudi 8 juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS TÉLÉPHONES : 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15. DIRECTION : (1) 40-58-75-00 TELEX 201176 F DIRJO PARIS ABONNEMENTS : (1) 40-58-77-77 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 19887 1989 COMPTE RENDU INTÉGRAL 36e SÉANCE Séance du mercredi 7 juin . 1989 * * (1 f.) 36 1200 SÉNAT - SÉANCE DU 7 JUIN 1989 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE Amendements nos 4 de la commission et 37 de M. Ray- M. PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER mond Bourgine, rapporteur pour avis. - MM. Charles Jolibois, rapporteur ; le rapporteur pour avis, le ministre d'Etat, Etienne Dailly, Michel Darras. - Adoption de 1. Procès-verbal (p. 1202). l'amendement n° 4, l'amendement n° 37 devenant sans objet. 2. Conférence des présidents (p. 1202). Amendement n° 5 de la commission. - MM. Charles Jolibois, rapporteur ; le ministre d'Etat. - Adoption. Amendement n° 32 de M. Raymond Bourgine, rapporteur 3. Demande d'autorisation d'une mission d'informa- pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, Charles tion (p. 1204). Jolibois, rapporteur ; le ministre d'Etat. - Adoption. Amendement n° 33 rectifié de M. Raymond - Bourgine, _rap- 4. Sécurité et transparence du marché financier. porteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, -Discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 1204). Charles Jolibo4, rapporteur ; le ministre d'Etat. - Discussion générale : MM. Pierre Bérégovoy, ministre Adoption. d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du Amendement no 34 rectifié bis de M. Raymond Bourgine, budget ; Charles Jolibois et Etienne Dailly, rapporteurs rapporteur pour avis. -

L'académie Des Sciences Dans La Presse En 2010
L'Académie des sciences dans la presse en 2010 Aperçu des articles parus sur l'Académie des sciences dans la presse nationale, régionale et spécialisée. Le critère qui régit la sélection est que l'article comprend les mots "Académie des sciences". Janvier 2010 Dans un entretien, Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, cite la participation de l'Académie dans la mise en place des primes d'excellence. La recherche janvier Publications Signalement de l'ouvrage "L'imagination et l'intuition dans les sciences" Livres hebdo 15 janvier Parution sur le site de l'Académie des sciences de "Libres points de vue d'Académiciens sur l'environnement et le développement durable" (voir revue de presse précédente) Plaisirs de la chasse janvier Le 17 décembre, l'Académie des sciences, avec l'Académie nationale de médecine et l'Académie des technologies, a publié un avis intitulé "Réduire l'exposition aux ondes des antennes-relais n'est pas justifié scientifiquement". (voir revue de presse précédente) Le Bulletin de l'arrondissement de Rouen 12 janvier / Top santé février / Le Canard enchaîné 23 décembre / Autoroutes de l'information et territoires 15 janvier / www.iutcolmar.uha.fr 19 janvier / Paris-Normandie 5 janvier / Le Havre Presse 5 janvier / Le Monde 5 janvier / JAC janvier La série Palevol des Comptes Rendus de l'Académie des sciences a publié un article sur un site archéologique exceptionnel découvert dans l'Hérault en 2008, renfermant les plus vieilles traces d'activité humaine en Europe occidentale. (voir revue de presse précédente) Midi libre 11 janvier Séances publiques Annonce des séances publiques du 12 janvier (Le stress) et du 19 janvier 2010 (Les grottes ornées) La Croix 12 janvier Après la conférence "Le stress : hier, aujourd'hui" qu'il a donnée le 12 janvier 2010 dans le cadre des "Défis scientifiques du XXIe siècle", longue interview de Michel Le Moal. -

CHAPITRE 4 / LE FRONT NATIONAL ET LA NOUVELLE DROITE Jean-Yves Camus
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes Paris 5 193.51.85.60 03/06/2016 19h10. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) CHAPITRE 4 / LE FRONT NATIONAL ET LA NOUVELLE DROITE Jean-Yves Camus in Sylvain Crépon et al., Les faux-semblants du Front national Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) | « Académique » 2015 | pages 97 à 120 ISBN 9782724618105 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.cairn.info/les-faux-semblants-du-front-national--9782724618105-page-97.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- !Pour citer cet article : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jean-Yves Camus, « Chapitre 4 / Le Front National et la nouvelle droite », in Sylvain Crépon et al., Les faux-semblants du Front national, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Académique », 2015 (), p. 97-120. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.). © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.). Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes Paris 5 193.51.85.60 03/06/2016 19h10. -

Un Ancien Dirigeant De L'extrême Droite Représente La Presse Française
Un ancien dirigeant de l'extrême droite représente la presse française Extrait du Acrimed | Action Critique Médias http://www.acrimed.org/Un-ancien-dirigeant-de-l-extreme-droite-represente-la-presse-francaise Un ancien dirigeant de l'extrême droite représente la presse française - Les journalismes - Métiers et fonctions - Associations et syndicats - Date de mise en ligne : février 2005 Date de parution : 19 décembre 2004 Description : Avant Valeurs actuelles, François d'Orcival écrivait dans Défense de l'Occident et Europe-Action. Copyright © Acrimed | Action Critique Médias - Tous droits réservés Copyright © Acrimed | Action Critique Médias Page 1/3 Un ancien dirigeant de l'extrême droite représente la presse française François d'Orcival, président du comité éditorial du groupe Valmonde (Valeurs actuelles, Le Spectacle du monde, propriétés de Dassault) a été élu le 15 décembre 2004 président de la Fédération Nationale de la Presse Française (FNPF), organisation patronale de la presse. François d'Orcival a été l'un des principaux dirigeants de la mouvance nationaliste-européenne de l'extrême droite française. Il a été l'un des animateurs de Jeune Nation, groupe violent dissous par le gouvernement en 1958 après un attentat à la bombe à l'Assemblée nationale, mais qui poursuivra ses activités avec pour objectif de renverser la Ve République. En 1960, D'Orcival est l'un des fondateurs de la Fédération des étudiants nationalistes (FEN) - qui s'oppose à l'UNEF et soutient les défenseurs de l'Algérie française -, dont il va s'" imposer comme le leader incontesté ", " le chef historique et emblématique " [1]. A la fin de la guerre d'Algérie, des militants de la FEN participent aux attentats de l'OAS, et au début de l'année 1962, après une " nuit bleue ", D'Orcival fait partie des militants embarqués par la police, et internés au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise (Gard), où il reste quatre semaines. -

La Recherche En FWB?
103 LE MAGAZINE DU FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - FNRS - TRIMESTRIEL N°103 • Décembre 2015 Décembre 2015 Comment est financée la recherche en FWB? www.frs-fnrs.be • quatrième trimestre 2015 • bureau de dépôt Liège X DOSSIER Comment est financée la 12 Essentiel, le financement recherche en Fédération public Wallonie Bruxelles? 14 La recherche peut-elle se passer de mécènes ? 16 Financement participatif : 10 pour ou contre ? PORTRAIT SCIENCES Cinq carrières 20 Marc Henneaux : De la beauté des théories physiques SOCIALES ET scientifiques à l'honneur 22 Philippe Dubois : Des polymères très performants et verts 24 Axel Cleeremans : Comprendre la conscience est l’un des plus POLITIQUES grands défis scientifiques actuels Réfugiés climatiques 26 Cédric Blanpain : Des prémices des cellules souches à leur apogée 18 28 Christos Sotiriou : Dévoiler tous les secrets du cancer du sein 30 ÉCONOMIE SCIENCES GÉOPHYSIQUE Migration : investir SOCIALES Gaz de schistes, dans le capital humain atmosphère L’enfermement des et spectroscopie étrangers illégaux 32 34 36 BIOLOGIE CLIMATOLOGIE TÉLÉVIE Une coralliculture La terre entre chaud Liste des 110 projets équitable et éthique et froid de recherches financés grâce au Télévie 2015 38 40 42 Editeur en Chef : Véronique Halloin Remerciements : La reproduction des articles La rédaction remercie celles et ceux qui ont contribué publiés n’est pas autorisée, Secrétaire générale, rue d’Egmont 5 - 1000 Bruxelles sauf accord préalable du Fonds à l’élaboration des articles et des illustrations. de la Recherche Scientifique Rédacteur en Chef : Christel Buelens F.R.S.-FNRS et mention de leur [email protected] provenance. fnrs news est édité par le Fonds de la Rédaction : Alix Botson, Christel Buelens, Recherche Scientifique - F.R.S.-FNRS Virgine Chantry, Elise Dubuisson, Pierre Dewaele, Une version électronique Marie-Françoise Dispa, Carine Maillard, de fnrs news est disponible Philippe Lambert, Alexandre Wajnberg. -

Table Des Débats Du Sénat
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TABLE DES DÉBATS DU SÉNAT Sessions de 1983 TABLE DES MATIÈRES ÉTABLIE PAR LE SERVICE DES ARCHIVES DU SÉNAT 26 lume Vo JOURNAUX OFFICIELS 26, rue Desaix — 75727 PARIS CEDEX 15 SÉNAT TABLE DES MATIÈRES Seconde session ordinaire de 1982-1983 . Du 2 avril au 30 juin 1983. Session extraordinaire Du ter juillet au 7 juillet 1983. Première session ordinaire de 1983-1984 Du 3 octobre au 21 décembre 1982. Session extraordinaire Le 22 décembre 1983. NOTA. — Les impressions du Sénat sont numérotées, pour chaque année, à compter du premier jour de la première session ordinaire (2 octobre) jusqu'au premier jour de la première session ordinaire de l'année suivante. ■■ AVERTISSEMENT La Table des Débats a pour objet de faciliter la recherche sur les sujets traités au cours des débats du Sénat. Elle se compose de deux parties distinctes : une Table nominative et une Table des matières. Elle met à la disposition du lecteur : — en regard des noms de MM. les Sénateurs et de MM. les Ministres, un résumé chronologique de leur activité au Sénat pendant l'année (Table nominative) ; —pour chacune des matières examinées par le Sénat, le résumé et l'analyse des travaux de ladite assemblée (Table des matières). Pour l'usage de la présente Table, il est précisé que les dates, seules, indiquent les dates des séances publiques concernées ; les dates, précédées des mentions «J O, Débats », renvoient aux dates du Journal officiel, Débats parlementaires, Sénat. Cette table des matières a été éditée principalement à partir de la base de donnée « Travaux du Sénat » élaborée par le Service des Archives du Sénat, en liaison avec le Service des Impressions, de la Documentation parlementaire et de l'Informatique, et interrogeable sur le centre serveur du Groupement de la Caisse des dépôts - Centre d'automatisation pour le management (GCAM). -

Conseil Constitutionnel Lundi 22 Janvier 1990
Conseil constitutionnel lundi 22 janvier 1990 - Décision N° 89-269 DC Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé NOR : CSCX9010591S Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1989, d’une part, par MM Bernard Pons, Jacques Chirac, Alain Juppé, Michel Péricard, Etienne Pinte, Alain Jonemann, Pierre Bachelet, Pierre-Rémy Houssin, Mme Christiane Papon, MM Jacques Chaban-Delmas, Arthur Dehaine, Philippe Auberger, Mme Michèle Alliot-Marie, MM François Grussenmeyer, Claude Barate, Gabriel Kaspereit, Michel Inschauspé, Alain Cousin, René Couveinhes, Pierre Pasquini, Robert- André Vivien, Christian Estrosi, Jean-Paul de Rocca Serra, Régis Perbet, Pierre Raynal, Didier Julia, Claude-Gérard Marcus, Robert Pandraud, Eric Raoult, Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Couve, Mme Roselyne Bachelot, MM Patrick Balkany, Jacques Toubon, Pierre Mazeaud, Mmes Elisabeth Hubert, Suzanne Sauvaigo, Nicole Catala, MM Louis de Broissia, Dominique Perben, Pierre Mauger, Jean-Luc Reitzer, Bernard Schreiner, Michel Giraud, Christian Cabal, Olivier Dassault, Georges Gorse, Robert Poujade, Patrick Devedjian, Jean Kiffer, Mmes Michèle Barzach, Lucette Michaux-Chevry, MM Jean Besson, Michel Cointat, Roland Nungesser, Jean-Paul Charié, Jean- Claude Mignon, Henri Cuq, Léon Vachet, Christian Bergelin, Edouard Balladur, Serge Charles, Bernard Debré, Charles Millon, Pierre Micaux, Georges Colombier, François-Michel Gonnot, Jean- Pierre de Peretti della Rocca, Alain Moyne-Bressand, Michel Meylan, Jean-Pierre Philibert, Paul Chollet, -
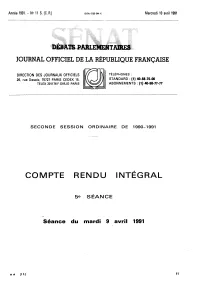
Compte Rendu Intégral
Année 1991. - No 11 S. (C. R.) ISSN 0755-544 X Mercredi 10 avril 1991 DÉBATS PARLEMENTAIRES JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS TÉLÉPHONES : 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15. STANDARD : (1) 40-58-75-00 TELEX 201176 F DIRJO PARIS ABONNEMENTS : (1) 40-58-77-77 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991 COMPTE RENDU INTÉGRAL 5e SÉANCE Séance du mardi 9 avril 1991 * * (1 f.) 11 378 SÉNAT - SÉANCE DU 9 AVRIL 1991 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M. ALAIN POHER Article 2 (p. 395) Amendements nos 10 rectifié bis de M. Franck Sérusclat, 1. Procès-verbal (p. 380). 2 de la commission et sous-amendement no 27 rectifié de M. Etienne Dailly. - MM. Franck Sérusclat, le rappor- teur, Etienne Dailly, le ministre, Michel Darras, Paul 2. Eloge funèbre de M. Raymond Bourgine, sénateur Souffrin, Jean-Pierre Fourcade, président de la commis- de Paris (p. 380). sion des affaires sociales ; Gérard Delfau. - Retrait de l'amendement no 10 rectifié bis ; adoption du sous- MM. le président, Jacques Pelletier, ministre de la coopéra- amendement no 27 rectifié et de l'amendement no 2 tion et du développement. modifié. Suspension et reprise de la séance (p. 381) Adoption de l'article modifié. PRÉSIDENCE DE M. JEAN CHAMANT Suspension et reprise de la séance (p. 399) 3. Communication de M. le président de l'Assemblée nationale (p. 381). PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER 4. Dépôt du rapport du Conseil supérieur de l'audio- visuel (p. 381). Article additionnel après l'article 2 (p. 399) Amendement no 11 rectifié de M. -

Nos Soldats Ces Héros.Pdf
VALEURS ACTUELLES –HORS-SÉRIE N° 17 VALEURSACTUELLES.COM 9,90 € HORS- SÉRIE NOSSOLDATS CESHÉROS Bravoure,coupsd’éclat,sacrifices…Desesoriginesànosjours, lafabuleuseépopéedescombattantsdelaFrance. A:11,30 €–BEL /LUX :11,30 €–ESP/ITAL/PORT CONT :10,70 € GR :12,50 €–CAN :13,99 $CAN –DOM :10,70 €–TOM : 1700 XPF –CH:17,80 FS –MAR :100 MAD –TUN :12.00 DT L16553 -17H-F: 9,90 € -RD 8 — VALEURS ACTUELLES — 29 novembre2018 PRÉFACE Par François d’Orcival, de l’Institut LaFrance,unehistoiredesoldats “Nulnepeutsenommercapitainedegensd’armess’iln’estnomméparleroi”(CharlesVII,1445). “LaFrancefutfaiteàcoupsd’épée”(deGaulle,1938). edestinavouluque la France,bâtie à coupsd’épée, PasdeVeRépublique non plus sans armée, puisque fûtune nation militaire. « Le corpsmilitaire est c’estgrâce à un coup d’Étatmilitaire (à Alger, à Ajaccio) l’expression la pluscomplète de l’esprit d’une quelaIVe République à l’agonie s’abandonnecorps et société », écrit CharlesdeGaulleen1934(Vers âme à un général, de Gaulle… Qui, dix ansplustard, L l’arméedemétier). Soixante-dix ansplustôt, l’his- mettra fin à la “chienlit” de Mai68par un autrecoup, lui torien DenisFusteldeCoulanges observedéjà:«L’état aussimilitaire(sonsaut à Baden-Baden)… socialetpolitiqued’une nation esttoujoursenrapport avec la nature et la compositiondeses armées » (La Cité ntre de Gaulleetses successeurs, unecontinuité exem- antique). plaire dans l’exercice desfonctions de chef desarmées Investie parles armes, la monarchiefrançaise aura E(article15delaConstitution). FrançoisMitterrand résisté grâce à elles. QuandLouis XIV fait graver surses résume,en1983:«Ladissuasion (nucléaire),c’est moi. » canonssadevise “Ultima ratioregum” (“le dernierargu- Le 13 juillet2017, Emmanuel Macron, à peine élu,pro- mentdes rois”), il sait ce qu’ildoit à sonprédécesseur, le clamedevant sesofficiers généraux et chefsd’état-major: petitroi CharlesVII,sauvé parlemiracledeJeanned’Arc, «Jesuisvotre chef. -

Jeudi 8 Décembre 1988
Année 1988. - No 57 S. (C. R.) ISSN 0755-544 X Vendredi 9 décembre 1988 1 r: JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIà DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS TÉLÉPHONES: 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15. DIRECTION : (1) 40-58-75-00 TELEX 201176 F DIRJO PARIS .ABONNEMENTS : (1) 40-58-77-18 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1988-1989 COMPTE RENDU INTÉGRAL 41e SÉANCE Séance du jeudi 8 décembre 1988 ** (2 f.) 57 2416 SÉNAT - SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1988 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M. ÉTIENNE DAILLY 6. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (p. 2448). 1. Procès-verbal (p. 2418). Suspension et reprise de la séance (p. 2448) 2. Hommage aux victimes d'une catastrophe en Arménie (p. 2418). Loi de finances pour 1989. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 2448). 3. Conférence des présidents (p. 2418). Culture, communication, grands travaux et Bicentenaire (p. 2448) 4. Candidatures à une commission mixte paritaire (p. 2420). Communication et information (p. 2448) M. Jack Lang, ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire ; Mme Catherine 5. Loi de finances pour 1989. - Suite de la discussion d'un Tasca, ministre délégué auprès du ministre de la culture, projet de loi (p. 2420). de la communication, des grands travaux et du Bicente- naire, chargé de la communication ; MM. Jean Cluzel, Culture, communication, grands travaux et Bicentenaire rapporteur spécial de la commission des finances ; Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis de la commis- sion des affaires culturelles ; François Autain, Jacques Culture et grands travaux (p. 2420) Habert, Michel Miroudot, Paul Caron, Henri Collette, François Louisy, Rodolphe Désiré. -

La Droite Aujourd'hui
La Droite aujourd'hui JEAN-PIERRE APPARU La Droite aujourd'hui Albin Michel © Éditions Albin Michel, 1979 22, rue Huyghens, 75014 Paris ISBN 2-226-00873-X La DroiteDroite aujourd 'hui vue par A.D.G. • René Andrieu • Philippe Ariès Alain Bayard • Maurice Bardèche Alain de Benoist • Pierre de Boisdeffre Gérard Bonnot • Jean-Louis Bory • Alain Bosquet Jean Bourdier • Raymond Bourgine Pierre Boutang • Cabu • Jean Cau • Pierre Chaunu Rémy Chauvin • Jean-François Chiappe Maurice Clavel • Copi • Henri Coston • Pierre Daix Jean Daniel • Frédéric Dard • Michel Debré Michel Déon • Jean-Marie Domenach Jacques Duquesne • Jean Dutourd • Jean Duvignaud Jean-Claude Faur • Pascal Gauchon Raoul Girardet • Michel Giroud Jean Gourmelin • Michel Gurfinkiel Éric Houllefort • Claude Imbert Jacques Laurent • Jean-Clarence Lambert Michel Marmin • Michel Mourlet François Nourissier • Louis Pauwels Jean-Marie Le Pen • Michèle Perrein Pierre Pujo • Pinatel • Jacky Redon • Reiser René Rémond • Bertrand Renouvin LouisMichel Rougier de Saint • Saint-Loup Pierre Philippe de Saint Robert • Pierre Sergent Philippe Sollers • François Solo Georges Suffert • Olivier Todd Jean-Claude Valla • Dominique Venner Le pasteur Viot • Wolinski Pour, dans l'ordre de sortie de scène : Cédric, Gilbert, Jacqueline. dans l'ordre d'entrée en scène : Thierry, Benoist, Lison. Avertissement I éloge, ni pamphlet, La Droite aujourd'hui n'est pas davantage un livre d'histoire. Alors un essai, un dossier, une enquête? Assurément Ntout cela, mais surtout un regard sur la vie quotidienne du mot « droite ». La première partie : « Héritier ayant perdu son chemin cherche les origines de son héritage », propose sous forme de trois brefs discours une écriture du doute. La deuxième : « La droite, disent-ils...», est une photographie sans retouches.