Septembre, 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Centre Souscentreserie Numéro Nom Et Prenom
Centre SousCentreSerie Numéro Nom et Prenom MORONI Chezani A1 2292 SAID SAMIR BEN YOUSSOUF MORONI Chezani A1 2293 ADJIDINE ALI ABDOU MORONI Chezani A1 2297 FAHADI RADJABOU MORONI Chezani A4 2321 AMINA ASSOUMANI MORONI Chezani A4 2333 BAHADJATI MAOULIDA MORONI Chezani A4 2334 BAIHAKIYI ALI ACHIRAFI MORONI Chezani A4 2349 EL-ANZIZE BACAR MORONI Chezani A4 2352 FAOUDIA ALI MORONI Chezani A4 2358 FATOUMA MAOULIDA MORONI Chezani A4 2415 NAIMA SOILIHI HAMADI MORONI Chezani A4 2445 ABDALLAH SAID MMADINA NABHANI MORONI Chezani A4 2449 ABOUHARIA AHAMADA MORONI Chezani A4 2450 ABOURATA ABDEREMANE MORONI Chezani A4 2451 AHAMADA BACAR MOUKLATI MORONI Chezani A4 2457 ANRAFA ISSIHAKA MORONI Chezani A4 2458 ANSOIR SAID AHAMADA MORONI Chezani A4 2459 ANTOISSI AHAMADA SOILIHI MORONI Chezani D 2509 NADJATE HACHIM MORONI Chezani D 2513 BABY BEN ALI MSA MORONI Dembeni A1 427 FAZLAT IBRAHIM MORONI Dembeni A1 464 KASSIM YOUSSOUF MORONI Dembeni A1 471 MOZDATI MMADI ADAM MORONI Dembeni A1 475 SALAMA MMADI ALI MORONI Dembeni A4 559 FOUAD BACAR SOILIHI ABDOU MORONI Dembeni A4 561 HAMIDA IBRAHIM MORONI Dembeni A4 562 HAMIDOU BACAR MORONI Dembeni D 588 ABDOURAHAMANE YOUSSOUF MORONI Dembeni D 605 SOIDROUDINE IBRAHIMA MORONI FoumboudzivouniA1 640 ABDOU YOUSSOUF MORONI FoumboudzivouniA1 642 ACHRAFI MMADI DJAE MORONI FoumboudzivouniA1 643 AHAMADA MOUIGNI MORONI FoumboudzivouniA1 654 FAIDATIE ABDALLAH MHADJOU MORONI FoumbouniA4 766 ABDOUCHAKOUR ZAINOUDINE MORONI FoumbouniA4 771 ALI KARIHILA RABOUANTI MORONI FoumbouniA4 800 KARI BEN CHAFION BENJI MORONI FoumbouniA4 840 -

Mission 1 Cadre Institutionnel
UNION DES COMORES --------------------- VICE –PRESIDENCE EN CHARGE DU MINISTERE DE LA PRODUCTION, DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT ------------------- DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DE L’EAU (DGEME) UNITE DE GESTION DU PROJET ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT --------------------- PROJET D ’A LIMENTATION EN EAU POTABLE ET D SSAINISSEMENT DANS LES ILES DE ’A (AEPA) 3 L’U NION DES COMORES (F INANCEMENT BAD) ETUDES TECHNIQUES, DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DU PROGRAMME NATIONAL D’AEPA Mission 1 : Elab oration du cadre institutionnel, o rganisationnel et financier du s ecteur d’AEPA Edition définitive JUIN 2013 71, Avenue Alain Savary Bloc D – 2ème étage - App 23 ENTREPRISE D’ETUDES DE DEVELOPPEMENT RURAL 1003 Cité El Khadra - Tunis EEDR MAMOKATRA S.A. Tél : (216) 71 809 686 Société Anonyme au capital de 20.000.000 d’Ariary Fax : (216) 71 806 313 Siège social : Villa Mamokatra Nanisana E-mail : [email protected] 101 ANTANANARIVO Site web : www.hydroplante.com …: (261.20) 22 402-14 ; 22 403-78 * 961 E-mail : [email protected] 1 Elaboration du cadre institutionnel, organisationnel et financier du secteur de l’AEPA des Comores PAEPA PREFACE L’élaboration du cadre institutionnel, organisationnel et financier du secteur d’eau potable et d’Assainissement s’inscrit dans le cadre de la composante 1 du Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement (PAEPA – Comores – projet n : P-KM-EA0-001) financé par un don de la Banque Africaine de Développement. Tel que défini par le rapport d’évaluation du projet, le PAEPA comprend quatre (4) composantes: (i) l’Etude du Cadre institutionnel, organisationnel et financier ainsi que l’élaboration d’un plan stratégique à l’horizon 2030; (ii) le développement et la réhabilitation des infrastructures d’alimentation en eau potable et d’assainissement (AEPA) de plusieurs localités dont Moroni, Ouani, Mutsamudu, Fomboni et Mbéni; (iii) l’Appui Institutionnel et (iv) la Gestion du Projet. -

PDC Mitsamihouli
Ce Plan de Développement Communal a été élaboré avec le soutien technique et financier de l’AFD et des ONG ID et MAEECHA. TABLE DES MATIERES I. LISTE DES ACRONYMES 5 II. LE MOT DU MAIRE 6 III. INTRODUCTION : Une décentralisation en marche 7 IV. METHODOLOGIE : Une démarche orientée participation et concertation 10 des forces vives de la commune a. PHASE PREPARATOIRE (6 mois, de mars à septembre 2013) 10 b. PHASE D’ELABORATION (9 mois, décembre 2013 à septembre 2014) 11 c. PHASE DE VALIDATION, CORRECTION ET DE DIFFUSIO 14 (5 mois, d’octobre 2014 à mars 2015) V. PARTIE 1 : MONOGRAPHIE 15 a SITUATION PHYSIQUE ET HUMAINE 15 i. Situation administrative et géographique 15 ii. Histoire et peuplement 18 iii. La mairie de Mitsamihouli aujourd’hui 20 b. SITUATION SOCIALE 25 i.L’éducation : un enseignement public en souffrance face 25 à un enseignement privé porteur d’espoir mais souvent décrié ii. La santé : une bonne couverture sanitaire mais de nombreux 33 défis à relever iii.L’eau et l’assainissement : une commune à fort potentiel 38 c. SITUATION ECONOMIQUE 43 i. L’agriculture : un secteur porteur amoindri par le déclin 43 du tourisme et une production de rente en baisse ii. La pêche, 2ème activité génératrice de revenus 51 iii. L’élevage, délaissé ces dix dernières années 53 iv. L’artisanat et le commerce résistent à la crise 54 v. Le tourisme, un secteur en déclin offrant pourtant de multiples potentialités 58 vi. L’accès à l’énergie, une préoccupation d’envergure nationale 51 63 VI. PARTIE 2 : PLANIFICATION a. -

Evaluation of Dubai Cares' Support to Quality Basic
VALUATION OF UBAI ARES E D C ’ SUPPORT TO QUALITY BASIC EDUCATION IN COMOROS ISLANDS FINAL REPORT JANUARY 2015 EVALUATION OF DUBAI CARES’ SUPPORT TO QUALITY BASIC EDUCATION IN COMOROS ISLANDS Contents Acronyms and abbreviations ........................................................................................................ 4 Executive summary ...................................................................................................................... 6 Brief program description and context ............................................................................................... 6 Purpose and expected use of the evaluation ..................................................................................... 6 Objectives of the evaluation ............................................................................................................... 6 Evaluation methodology ..................................................................................................................... 6 Principal findings and conclusions ...................................................................................................... 7 Key recommendations ........................................................................................................................ 7 Lessons learned for future programs .................................................................................................. 8 I. Audience and use of the evaluation ................................................................................... -

La Fonction Du « Grand Mariage » Dans La Politique Comorienne : Cas Des Maires-Notables Des Communes En Grande-Comore
FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE ------------------------- DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE ------------------------- MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES D.E.A La fonction du « Grand mariage » dans la politique comorienne : cas des Maires-notables des communes en Grande-Comore . Présenté par : CHAKIRA Ibouroi Soilihi Le 15 Janvier 2014 Membres du jury : Présidente du jury : Professeur RAMANDIMBIARISON Noeline Juge : Docteur ETIENNE Stefano Raherimalala Sous la direction de : Pr RAMANDIMBIARISON Jean Claude Année universitaire : 2012 – 2013 La fonction du « Grand mariage » dans la politique comorienne : cas des Maires-notables des communes en Grande-Comore . REMERCIEMENTS Avant d’adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce travail de mémoire, je tiens à remercier DIEU tout puissant de m’avoir donné force et santé depuis le début de mes études jusqu’à maintenant. Je témoigne mes remerciements à : Monsieur ANDRIAMAMPANDRY Todisoa, Chef de Département Sociologie, qui n’a pas ménagé ses efforts et ses conseils pour la réussite de notre formation. Mes vifs remerciements vont à l’endroit : Des membres de Jury, qui ont eu l’obligeance de me consacrer une partie de leur temps, que je sais précieux, pour parcourir ce document et y apporter leurs avis. Des membres du corps enseignant et administratif de la filière Sociologie de la Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie (DEGS) de l’Université d’Antananarivo. Ils ont su partager généreusement leur savoir et leur compétence ci chère. Mes profondes gratitudes s’adressent à : Monsieur le Professeur RAMANDIMBIARISON Jean Claude , Directeur du présent mémoire, pour ses conseils précieux et ses orientations bénéfiques à sa réalisation. -

COMORES Mitsamiouli Capitale D'état GRANDE COMORE (Plus De 40 000 Hab.) 11°20' Plus De 20 000 Hab
43°20' 43°30' 43° 44° 45° COMORES Mitsamiouli Capitale d'État GRANDE COMORE (plus de 40 000 hab.) 11°20' 43°10' GRANDE COMORE Mbéni Plus de 20 000 hab. Bangoua Kouni Plus de 15 000 hab. Trou du Niamaoui (Lac Salé) (NGAZIDJA) Prophète O C É A N I N D I E N Koimbani Plus de 10 000 hab. Mitsamiouli I oua i Ouéla v n Ntsoudjini Plus de 5 000 hab. Ouzio Choua Chandroudé Membouadjou Koua (Île aux Tortues) MORONI Kartala Plus de 2 000 hab. Ma a Ndroudé 2361 ndz Récif Vailheu Djomani 904 Hantsindzi Chézani Mitsoudjé Autre ville ou village Helendjé Nioumamilina Foumbouni Mrémani Préfecture Oussoudjou Mouadja Dembéni Maouéni 1077 C O M O R E S Ntsaouéni Itsandzéni Route principale Dimadjou Ouellah 12° 12° Ivembéni Saondzou Bouni Domoni Autre route 1087 Séléyani 11°30' Mbéni Ouani Chemin ou piste Aéroport international Salémani Moutsamoudou de Moroni-Hahaïa ANJOUAN Aéroport, aérodrome A MOHÉLI Mil a i Fomboni Sima év n Héroumbili 1595 Domoni r 790 Hahaïa Dibouani c Ouanani Mrémani Niouma houa Itsikoudi h c Oussivo i Vanambouani 659 Mtsamdou p Dzahadjou Batsa Koimbani e MAYOTTE Grotte du l Capitaine Dubois Chomoni (FRANCE) Bahani Chissioua Ntsoudjini Hantsongoma d Mtsamboro 11°40' e BANDRABOUA Itsandra Maouéni Sidjou s MTSAMBORO KOUNGOU F MAMOUDZOU Salimani Ntsoralé o C DZAOUDZI MORONI Maou i o MTSANGAMOUJI Tsidjé r n m PAMANDZI ê o SADA Mvouni Idjikoundzi r t Tsangadjou e s 660 BOUÉNI h M Bandamré ori BANDRÉLÉ dé 0 50 km Mkazi K A R T A L A CHIRONGUI I I o i d I k n I Boboni 2361I 13° KANI-KÉLI 13° I I I u I I I Oungoni I I I I I I ou ou i I Choungou -

Projet De Prévention Et D'atténuation Des Impacts De La COVID-19 Sur L
Union des Comores Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement et de la Recherche scientifique Projet de Prévention et d’atténuation des impacts de la COVID-19 sur l’éducation aux Comores (2Pi2C) Document de Projet pour une Requête de financement de l’Union des Comores à l’attention du secrétariat du Partenariat Mondial pour l’Éducation pour un financement accéléré pour la riposte à la pandémie de la COVID-19 Document du programme Septembre 2020 Note de couverture de la requête d’un financement accéléré COVID-19 CONTEXTE Pays : Union des Comores Agent (s) partenaire(s) : UNICEF Agence(s) de coordination : Coopération française Projet de Prévention et d’atténuation des impacts Intitulé du programme : de la COVID-19 sur l’éducation aux Comores (2Pi2C) Montant total du financement accéléré COVID-19 : 750 000 USD Commissions de l’agent partenaire (en supplément du montant total du financement accéléré COVID-19 52 500 USD demandé)1 : Commissions de l’agent partenaire en % du montant 7% total du financement accéléré demandé : Date de soumission de la requête pour un financement 9/30/2020 accéléré COVID-19 : Date estimée de démarrage du financement accéléré 11/1/2020 COVID-19 : Date estimée de clôture du financement accéléré COVID-19 (doit correspondre au dernier jour du mois, 12/31/2021 par exemple : le 30 juin 2021) : Date prévue pour la remise du rapport de fin d’exécution (au maximum 6 mois après la date de 5/15/2022 clôture du programme) : Fonds commun sectoriel Modalités du financement - (mettre un ‘X’) Fonds commun de projet / Cofinancement X Projet autonome 1 Commissions de l’agent partenaire : Les commissions générales de l’agent partenaire s’ajoutent à l’AMP et sont déterminées selon les règles internes de l’agent partenaire. -

Arret N°16-015 Gouverneur 1 Tour Ngazidja
~t~ UNION DES COMORES cour constitUtionnelfe Unité- Solidarité- Développement DL i'1 \1"\ Ill', (OIIOHF:- ARRET N°16-015/E/G/NG/CC PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINTIFS DU PREMIER TOUR DE L'ELECTION DU GOUVERNEUR DE L'ILE AUTONOME DE NGAZIDJA. La Cour constitutionnelle, VU la Constitution du 23 décembre 200 1, telle que révisée; VU la loi organique n004-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour constitutionnelle; VU la loi organique n° 05-014/ AU du 03 octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique n° 14-0 16/AU du 26 juin 2014; VU la loi n° 14-004/ AU du 12 avril 2014 relative au code électoral; VU le décret n" 15-184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles autonomes; VU l'arrêt n? 16-002/E/CC du 02 janvier 2016 portant liste définitive des candidats à l'élection du Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja du 21 février 2016 ; VU l'arrêté n? 15-130/MIIDIICAB du 01 décembre 2015 relatif aux horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles autonomes; VU la note circulaire n° 16-038/MIIDIICAB du 19 février 2016 relative aux scrutins du 21 février et du 10 avril 2016 ; VU le communiqué du 20 février 2016 du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) interdisant le vote par procuration; VU la proclamation des résultats provisoires du premier -

MW PDL Mbatsé 2009 2013
UNION DES COMORES -------------------- ILE AUTONOME DE MWALI -------------------- CREDIT/IDA 3868-COM Fonds d’Appui au développement Communautaire (FADC) Secrétariat Exécutif Régional Cité Coopérant - Fomboni TEL/FAX : 72 04 32 FOMBONI - Mohéli E-mail : [email protected] ------------------------------------------- Communauté de Mbatsé Plan de Développement Local 2009 – 2013 1 RESUME Ce document porte sur le Plan de Développement Local (PDL) de la communauté de Mbatsé, situé dans la préfecture du centre à 7 kilomètres de la capitale Fomboni de l’île Autonome de Mwali. Ce PDL couvre une période de quatre (4 ans) entre 2009-2013 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps. Le PDL de Mbatsé comporte sur les potentialités, les contraintes, la situation de référence et les actions prioritaires de développement du village. Ils ont été tous identifiés par les différentes couches sociales de la communauté de Mbatsé (les jeunes, les femmes, les hommes, les notables et les personnes vulnérables) de la localité. Le PDL est le document de référence pour l’identification des sous-projets identifiés et reconnus comme actions par les focus groupes représentants de la communauté de Mbatsé. L’élaboration de ce document est financée par l’Etat comorien à travers le Projet de Soutien aux Services (PSS) dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale) est réalisé par la communauté de Mbatsé avec l’appui d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du FADC de Mwali. La période d’intervention du PDL est de 2009 à 2013. Le Plan de développement Local de Mbasté vise à améliorer les conditions économiques et sociales de tous les membres de la communauté à travers la réalisation des sous projets identifiés dans ce document. -

ABDALLAH, Msahazi ESPA ING 10
LISTE DES TABLEAUX TABLEAU 1 : CLIMAT CONVENANT A LA PLANTATION DE CHAQUE ESPECE..........................................................6 TABLEAU 2 : RENDEMENT D’UNE PLANTE D’ALEURITE EN FONCTION DE L’AGE...................................................6 TABLEAU 3 : QUELQUES ACIDES GRAS SATURES IMPORTANTS.............................................................................17 TABLEAU 4 : QUELQUES ACIDES GRAS INSATURES IMPORTANTS.........................................................................18 TABLEAU 5 : RENDEMENT DES DIFFERENTES PARTIES DE LA GRAINE...................................................................43 TABLEAU 6 : TENEUR EN HUILE DE L’AMANDE A PARTIR D’UNE PRESSE..............................................................45 TABLEAU 7 : RENDEMENT EN HUILE DE L’AMANDE A PARTIR DU SOXHLET.........................................................47 TABLEAU 8 : RESULTAT DE LA MACERATION DES TOURTEAUX.............................................................................48 TABLEAU 9 : DENSITE DE L’HUILE...........................................................................................................................50 TABLEAU 10 : RESULTATS DE L’INDICE DE REFRACTION........................................................................................51 TABLEAU 11 : RESULTATS DE L’INDICE D’ACIDE.....................................................................................................53 TABLEAU 12 : RESULTATS DE L’INDICE DE SAPONIFICATION.................................................................................54 -
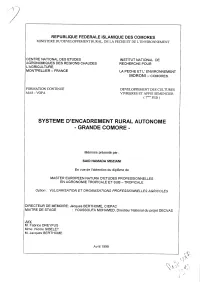
Systeme D'encadrement Rural Autonome - Grande Comore
REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL, DE LA PECHE ET DE L'ENVIRONNEMENT CENTRE NATIONAL DES ETUDES INSTITUT NATIONAL DE AGRONOMIQUES DES REGIONS CHAUDES RECHERCHE POUR L'AG RI CUL TURE, MONTPELLIER - FRANCE LA PECHE ET L'ENVIRONNEMENT MORONI - COMORES. FORMATION CONTINUE DEVELOPPEMENT DES CULTURES MAS - VOPA VIVRIERES ET APPUI SEMENCIER (7°1110 FED) SYSTEME D'ENCADREMENT RURAL AUTONOME - GRANDE COMORE - Mémoire présenté par: SAlO HAMADA MDZIANI En vue de l'obtention du diplôme de MASTER EUROPEEN NATURA D'ETUDES PROFESSIONNELLES EN AGRONOMIE TROPICALE ET SUB - TROPICALE Option: VULGARISA TlON ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES DIRECTEUR DE MEMOIRE: Jacques BERTHOME, CIEPAC MAITRE DE STAGE : YOUSSOUFA MOHAMED, Directeur National du projet DECVAS ~ M. Fabrice DREYFUS Mme. Nicole SIBELET M. Jacques BERTHOME Avril 1999 / REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL, DE LA PECHE ET DE L'ENVIRONNEMENT CENTRE NATIONAL DES ETUDES INSTITUT NATIONAL DE AGRONOMIQUES DES REGIONS CHAUDES RECHERCHE POUR L'AG RI CUL TURE, MONTPELLIER - FRANCE LA PECHE ET L'ENVIRONNEMENT MORONI- COMORES. FORMATION CONTINUE DEVELOPPEMENT DES CULTURES MAS - VOPA VIVRIERES ET APPUI SEMENCIER (7eme FED) SYSTEME D'ENCADREMENT RURAL AUTONOME - GRANDE COMORE - Mémoire présenté par: SAlO HAMADA MDZIANI En vue de l'obtention du diplôme de MASTER EUROPEEN NATURA D'ETUDES PROFESSIONNELLES EN AGRONOMIE TROPICALE ET SUB - TROPICALE Option: VULGARISATION ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES DIRECTEUR DE MEMOIRE: Jacques BERTHOME, CIEPAC MAITRE DE STAGE : YOUSSOUFA MOHAMED, Directeur National du projet DECVAS ~ M. Fabrice DREYFUS Mme. Nicole SIBELET M. Jacques BERTHOME Avril 1999 RESUME Notre étude a été réalisée dans le cadre du projet de Développement des Cultures Vivrières et d'Appui Semencier (DECVAS), du Ministère de Développement Rural de la Pêche et de l'Environnement, sur l'île de la Grande Comore, plus grande île de l'archipel des Comores. -

Ministère Du Plan, De L'aménagement Du Territoire
UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement ----------------------------- MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PLAN ----------------------------- COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN Direction Nationale du Recensement ------------------------------ pauvreté aux comores « Analyse des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2003 » Rédigé par : NAILANE MHADJI Statisticien Moroni, juin 2007…….. Sommaire INTRODUCTION ..................................................................................................................... 4 I.1 Objectifs de l’étude ............................................................................................................ 6 I.2 Contexte national et importance du sujet .......................................................................... 7 II. Méthodologie et Concepts .................................................................................................. 7 II.1 Définitions ........................................................................................................................ 7 II.2 Méthodologie d’analyse ................................................................................................... 8 II.2.1 Construction de l’indice composite de la pauvreté ....................................................... 8 III. Caractéristiques des principales variables ....................................................................... 9 III.1 éducation ........................................................................................................................