PDC Mitsamihouli
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Centre Souscentreserie Numéro Nom Et Prenom
Centre SousCentreSerie Numéro Nom et Prenom MORONI Chezani A1 2292 SAID SAMIR BEN YOUSSOUF MORONI Chezani A1 2293 ADJIDINE ALI ABDOU MORONI Chezani A1 2297 FAHADI RADJABOU MORONI Chezani A4 2321 AMINA ASSOUMANI MORONI Chezani A4 2333 BAHADJATI MAOULIDA MORONI Chezani A4 2334 BAIHAKIYI ALI ACHIRAFI MORONI Chezani A4 2349 EL-ANZIZE BACAR MORONI Chezani A4 2352 FAOUDIA ALI MORONI Chezani A4 2358 FATOUMA MAOULIDA MORONI Chezani A4 2415 NAIMA SOILIHI HAMADI MORONI Chezani A4 2445 ABDALLAH SAID MMADINA NABHANI MORONI Chezani A4 2449 ABOUHARIA AHAMADA MORONI Chezani A4 2450 ABOURATA ABDEREMANE MORONI Chezani A4 2451 AHAMADA BACAR MOUKLATI MORONI Chezani A4 2457 ANRAFA ISSIHAKA MORONI Chezani A4 2458 ANSOIR SAID AHAMADA MORONI Chezani A4 2459 ANTOISSI AHAMADA SOILIHI MORONI Chezani D 2509 NADJATE HACHIM MORONI Chezani D 2513 BABY BEN ALI MSA MORONI Dembeni A1 427 FAZLAT IBRAHIM MORONI Dembeni A1 464 KASSIM YOUSSOUF MORONI Dembeni A1 471 MOZDATI MMADI ADAM MORONI Dembeni A1 475 SALAMA MMADI ALI MORONI Dembeni A4 559 FOUAD BACAR SOILIHI ABDOU MORONI Dembeni A4 561 HAMIDA IBRAHIM MORONI Dembeni A4 562 HAMIDOU BACAR MORONI Dembeni D 588 ABDOURAHAMANE YOUSSOUF MORONI Dembeni D 605 SOIDROUDINE IBRAHIMA MORONI FoumboudzivouniA1 640 ABDOU YOUSSOUF MORONI FoumboudzivouniA1 642 ACHRAFI MMADI DJAE MORONI FoumboudzivouniA1 643 AHAMADA MOUIGNI MORONI FoumboudzivouniA1 654 FAIDATIE ABDALLAH MHADJOU MORONI FoumbouniA4 766 ABDOUCHAKOUR ZAINOUDINE MORONI FoumbouniA4 771 ALI KARIHILA RABOUANTI MORONI FoumbouniA4 800 KARI BEN CHAFION BENJI MORONI FoumbouniA4 840 -

Mission 1 Cadre Institutionnel
UNION DES COMORES --------------------- VICE –PRESIDENCE EN CHARGE DU MINISTERE DE LA PRODUCTION, DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT ------------------- DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DE L’EAU (DGEME) UNITE DE GESTION DU PROJET ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT --------------------- PROJET D ’A LIMENTATION EN EAU POTABLE ET D SSAINISSEMENT DANS LES ILES DE ’A (AEPA) 3 L’U NION DES COMORES (F INANCEMENT BAD) ETUDES TECHNIQUES, DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DU PROGRAMME NATIONAL D’AEPA Mission 1 : Elab oration du cadre institutionnel, o rganisationnel et financier du s ecteur d’AEPA Edition définitive JUIN 2013 71, Avenue Alain Savary Bloc D – 2ème étage - App 23 ENTREPRISE D’ETUDES DE DEVELOPPEMENT RURAL 1003 Cité El Khadra - Tunis EEDR MAMOKATRA S.A. Tél : (216) 71 809 686 Société Anonyme au capital de 20.000.000 d’Ariary Fax : (216) 71 806 313 Siège social : Villa Mamokatra Nanisana E-mail : [email protected] 101 ANTANANARIVO Site web : www.hydroplante.com …: (261.20) 22 402-14 ; 22 403-78 * 961 E-mail : [email protected] 1 Elaboration du cadre institutionnel, organisationnel et financier du secteur de l’AEPA des Comores PAEPA PREFACE L’élaboration du cadre institutionnel, organisationnel et financier du secteur d’eau potable et d’Assainissement s’inscrit dans le cadre de la composante 1 du Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement (PAEPA – Comores – projet n : P-KM-EA0-001) financé par un don de la Banque Africaine de Développement. Tel que défini par le rapport d’évaluation du projet, le PAEPA comprend quatre (4) composantes: (i) l’Etude du Cadre institutionnel, organisationnel et financier ainsi que l’élaboration d’un plan stratégique à l’horizon 2030; (ii) le développement et la réhabilitation des infrastructures d’alimentation en eau potable et d’assainissement (AEPA) de plusieurs localités dont Moroni, Ouani, Mutsamudu, Fomboni et Mbéni; (iii) l’Appui Institutionnel et (iv) la Gestion du Projet. -

Socmon Comoros NOAA
© C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme 2010 C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme is a collaborative initiative between Community Centred Conservation (C3), a non-profit company registered in England no. 5606924 and local partner organizations. The study described in this report was funded by the NOAA Coral Reef Conservation Program. Suggested citation: C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme (2010) SOCIO- ECONOMIC ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL SITES FOR COMMUNITY-BASED CORAL REEF MANAGEMENT IN THE COMOROS. A Report Submitted to the NOAA Coral Reef Conservation Program, USA 22pp FOR MORE INFORMATION C3 Madagascar and Indian Ocean NOAA Coral Reef Conservation Program Islands Programme (Comoros) Office of Response and Restoration BP8310 Moroni NOAA National Ocean Service Iconi 1305 East-West Highway Union of Comoros Silver Spring, MD 20910 T. +269 773 75 04 USA CORDIO East Africa Community Centred Conservation #9 Kibaki Flats, Kenyatta Beach, (C3) Bamburi Beach www.c-3.org.uk PO BOX 10135 Mombasa 80101, Kenya [email protected] [email protected] Cover photo: Lobster fishers in northern Grande Comore SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL SITES FOR COMMUNITY-BASED CORAL REEF MANAGEMENT IN THE COMOROS Edited by Chris Poonian Community Centred Conservation (C3) Moroni 2010 ACKNOWLEDGEMENTS This report is the culmination of the advice, cooperation, hard work and expertise of many people. In particular, acknowledgments are due to the following for their contributions: COMMUNITY CENTRED -
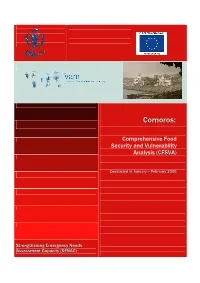
Comoros: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA)
CCoommoorrooss:: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA) Conducted in January – February 2006 Strengthening Emergency Needs Assessment Capacity (SENAC) 2 Comoros: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA) Prepared by Tango International March, 2006 © World Food Programme, Vulnerability Analysis and Mapping Branch (ODAV) This study was prepared under the umbrella of the “Strengthening Emergency Needs Assessment Capacity” (SENAC) project. The SENAC project aims to reinforce WFP’s capacity to assess humanitarian needs in the food sector during emergencies and the immediate aftermath through accurate and impartial needs assessments. For any queries on this document or the SENAC project, please contact [email protected] or Krystyna Bednarska, Country Director Madagascar: [email protected] Eric Kenefick Regional VAM Officer Johannesburg: [email protected] For information on the VAM unit, please visit us at http://vam.wfp.org/ United Nations World Food Programme Headquarters: Via C.G. Viola 68, Parco de’ Medici, 00148, Rome, Italy This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. 3 4 Comoros: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA) Conducted January-February 2006 5 6 Acknowledgements The authors of this report would like to thank the United Nations-Comoros staff in Moroni for their assistance and support throughout the mission. Particular appreciation is due to Ms. Guiseppina Mazza, the UNDP Resident Representative, who assured our logistic and material support. In addition, we would like to acknowledge the efforts of the UN staff on Anjouan (Houmadi Abdallah) and on Mohéli (Nafion Mohammed). -

Arret N°16-016 Primaire Ngazidja
H h ~I'-I courcon5t~liorwr~ UNION DES COMORES Olll\;I\IHliWif,!' Unité - Solidarité - Développement ARRET N° 16-016/E/P/CC PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DE L'ELECTION PRIMAIRE DE L'ILE DE NGAZIDJA La Cour constitutionnelle, VU la Constitution du 23 décembre 200 l, telle que révisée; VU la loi organique n° 04-001/ AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour constitutionnelle; VU la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique n° 14-016/AU du 26juin 2014; VU la loi organique n° 05-009/AU du 04 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du Président de l'Union et les modalités d'application de l'article 13 de la Constitution, modifiée par la loi organ ique n? 10-019/ AU du 06 septembre 2010 ; VU la loi n° 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral; VU le décret n° 15- 184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles autonomes; VU l'arrêt n? 16-001 /E/CC du 02 janvier 2016 portant liste définitive des candidats à l'élection du Président de l'Union de 2016; VU l'arrêté n° 15- 130/MIIDIICAB du 01 décembre 2015 relatif aux horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles Autonomes; VU le circulaire n? 16-037/MIIDIICAB du 19 février 2016 relatifau vote par procuration; VU la note circulaire n° 16-038/MIIDIICAB du 19 février -

(Diptera: Psychodidae\) in the Comoros Archipelago
Article available at http://www.parasite-journal.org or http://dx.doi.org/10.1051/parasite/2012193195 FIRST RECORD OF PHLEBOTOMINE SANDFLIES (DIPTERA: PSYCHODIDAE) IN THE COMOROS ARCHIPELAGO WITH DESCRIPTION OF SERGENTOMYIA (VATTIEROMYIA) PESSONI N. SP. AND S. (RONDANOMYIA) GOODMANI COMORENSIS N. SSP. RANDRIANAMBININTSOA F.J.*,**,***, DEPAQUIT J.**, BRENGUES C.***, DHONDT C.**, YAHAYA I.****, OULEDI A.*****, LÉGER N.****** & ROBERT V.*** Summary: Résumé : PREMIÈRE MENTION DE PHLÉBOTOMES (DIPTERA : PSYCHODIDAE) DANS L’ARCHIPEL DES COMORES ET DESCRIPTION DE SERGENTOMYIA No Phlebotomine sandflies had ever been reported in the Comoros (VATTIEROMYIA) PESSONI N. SP. ET S. (RONDANOMYIA) GOODMANI Archipelago, including the three islands of the Republic of the COMORENSIS N. SSP. Union of Comoros (Grande Comore, Mohéli and Anjouan) and Aucun phlébotome n’avait jamais été rapporté dans l’archipel des the French oversea department of Mayotte. During three field Comores, incluant les trois îles de l’Union des Comores (la Grande surveys carried out in 2003, 2007 and 2011, we provided the Comore, Mohéli et Anjouan) et le département français d’outre- first record of Phlebotomine sandflies in this area. A total of 85 mer, Mayotte. Au cours de trois campagnes d’études sur le terrain specimens belonging to three species were caught: a new species en 2003, 2007 et 2011, nous avons fait la première observation S. (Vattieromyia) pessoni n. sp. (two females from Grande Comore), de phlébotomes dans cette zone. 85 spécimens appartenant à trois a new subspecies of Sergentomyia (Rondanomyia) goodmani (80 espèces ont été capturés : une nouvelle espèce, S. (Vattieromyia) specimens from Grande Comore and one from Anjouan) and pessoni n. -

RNAP DES COMORES Unité – Solidarité – Développement
UNIONRNAP DES COMORES Unité – Solidarité – Développement Vice-Présidence en charge du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme Direction Générale de l’Environnement et des Forêts Draft Stratégie d’Expansion du Système National des Aires Protégées Aux Comores 2017 – 2021 26 octobre 2017 Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles du PNUD, du GEF, ni du Gouvernement Comorien. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Fouad ABDOU RABI Coordinateur du projet RNAP, PNUD/ GEF [email protected] Youssouf Elamine Y. MBECHEZI Directeur Général de l’Environnement et des forêts (DGEF) Directeur du Projet RNAP-Comores (PNUD/ GEF) [email protected] Eric LACROIX AT projet RNAP [email protected] ; [email protected] Publié par : DGEF-PNUD/ GEF Comores Droits d’auteur : ©DGEF-PNUD/ GEF Comores. © Parcs nationaux des Comores. La reproduction de cette publication à des fins non commerciales, notamment éducatives, est permise et même encouragée sans autorisation écrite préalable du détenteur des droits d’auteur à condition que la source soit dûment citée. Page de garde : Photo 1,: Îlot de la Selle, Parc national Shisiwani. © Eric Lacroix PNC Citation : DGEF Comores (2017). Stratégie d’expansion du système national des aires protégées aux Comores. 2017 - 2021. Vice-Présidence en charge du Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Direction générale de l’environnement et des forêts. Projet PNUD/ GEF : Système national des aires protégées aux Comores. 158 p + Annexes 16 p. -

Karthala Volcanic Eruption "According to the Local Authorities, As Many As OCHA Situation Report No
Comoros: Karthala Volcanic Eruption "According to the local authorities, as many as OCHA Situation Report No. 1 10,000 people may have fled from their homes in Issued 18 April 2005 the eastern region in order to seek refuge in GLIDE: VO-2005-000060-COM other parts of the island." SITUATION Karthala Volcano showed signs of increasing activity over past week; lava flow has been confirmed via overflight. Clouds of ash and smoke released on 16 April 2005. On 17 April, populations in affected areas Mitsamiouli fled in fear of gas and lava flow to other parts of Grande Comore island; as many as 10,000 people may have left their homes. Majority of fleeing population seeking Grande Comore refuge among family members in other parts of island. Moroni Karthala Volcano ACTION Authorities are providing emergency assistance and have issued a warning advising populations to avoid Dembeni affected areas. Mobile command post established with two medical teams and vehicles for evacuation. Rapid Ouani Anjouan assessment teams dispatched; results not yet known. UNICEF has made personnel available to strengthen Fomboni Bambao national response capacity, in addition to non-food assistance, essential drugs, and education materials. As Moya Ouallah of 18 April, authorities have not requested external Moheli assistance. Map data source: ESRI, Global Discovery, USGS Mayotte Code: OCHA-GVA - 2005/0066 Bandele Dapani Populated places National Capital 0 20 40 80 120 160 Km Produced by the ReliefWeb Map Centre Office for the Coordination of Humanitarian Affairs The names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. -

Evaluation of Dubai Cares' Support to Quality Basic
VALUATION OF UBAI ARES E D C ’ SUPPORT TO QUALITY BASIC EDUCATION IN COMOROS ISLANDS FINAL REPORT JANUARY 2015 EVALUATION OF DUBAI CARES’ SUPPORT TO QUALITY BASIC EDUCATION IN COMOROS ISLANDS Contents Acronyms and abbreviations ........................................................................................................ 4 Executive summary ...................................................................................................................... 6 Brief program description and context ............................................................................................... 6 Purpose and expected use of the evaluation ..................................................................................... 6 Objectives of the evaluation ............................................................................................................... 6 Evaluation methodology ..................................................................................................................... 6 Principal findings and conclusions ...................................................................................................... 7 Key recommendations ........................................................................................................................ 7 Lessons learned for future programs .................................................................................................. 8 I. Audience and use of the evaluation ................................................................................... -

Diptera : Psychodidae
FIRST RECORD OF PHLEBOTOMINE SANDFLIES (DIPTERA: PSYCHODIDAE) IN THE COMOROS ARCHIPELAGO WITH DESCRIPTION OF SERGENTOMYIA (VATTIEROMYIA) PESSONI N. SP. AND S. (RONDANOMYIA) GOODMANI COMORENSIS N. SSP. RANDRIANAMBININTSOA F.J.*,**,***, DEPAQUIT J.**, BRENGUES C.***, DHONDT C.**, YAHAYA I.****, OULEDI A.*****, LÉGER N.****** & ROBERT V.*** Summary: Résumé : PREMIÈRE MENTION DE PHLÉBOTOMES (DIPTERA : PSYCHODIDAE) DANS L’ARCHIPEL DES COMORES ET DESCRIPTION DE SERGENTOMYIA No Phlebotomine sandflies had ever been reported in the Comoros (VATTIEROMYIA) PESSONI N. SP. ET S. (RONDANOMYIA) GOODMANI Archipelago, including the three islands of the Republic of the COMORENSIS N. SSP. Union of Comoros (Grande Comore, Mohéli and Anjouan) and Aucun phlébotome n’avait jamais été rapporté dans l’archipel des the French oversea department of Mayotte. During three field Comores, incluant les trois îles de l’Union des Comores (la Grande surveys carried out in 2003, 2007 and 2011, we provided the Comore, Mohéli et Anjouan) et le département français d’outre- first record of Phlebotomine sandflies in this area. A total of 85 mer, Mayotte. Au cours de trois campagnes d’études sur le terrain specimens belonging to three species were caught: a new species en 2003, 2007 et 2011, nous avons fait la première observation S. (Vattieromyia) pessoni n. sp. (two females from Grande Comore), de phlébotomes dans cette zone. 85 spécimens appartenant à trois a new subspecies of Sergentomyia (Rondanomyia) goodmani (80 espèces ont été capturés : une nouvelle espèce, S. (Vattieromyia) specimens from Grande Comore and one from Anjouan) and pessoni n. sp. (deux femelles de la Grande Comore), une nouvelle Grassomyia sp. (two females from Mohéli). -

La Fonction Du « Grand Mariage » Dans La Politique Comorienne : Cas Des Maires-Notables Des Communes En Grande-Comore
FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE ------------------------- DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE ------------------------- MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES D.E.A La fonction du « Grand mariage » dans la politique comorienne : cas des Maires-notables des communes en Grande-Comore . Présenté par : CHAKIRA Ibouroi Soilihi Le 15 Janvier 2014 Membres du jury : Présidente du jury : Professeur RAMANDIMBIARISON Noeline Juge : Docteur ETIENNE Stefano Raherimalala Sous la direction de : Pr RAMANDIMBIARISON Jean Claude Année universitaire : 2012 – 2013 La fonction du « Grand mariage » dans la politique comorienne : cas des Maires-notables des communes en Grande-Comore . REMERCIEMENTS Avant d’adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce travail de mémoire, je tiens à remercier DIEU tout puissant de m’avoir donné force et santé depuis le début de mes études jusqu’à maintenant. Je témoigne mes remerciements à : Monsieur ANDRIAMAMPANDRY Todisoa, Chef de Département Sociologie, qui n’a pas ménagé ses efforts et ses conseils pour la réussite de notre formation. Mes vifs remerciements vont à l’endroit : Des membres de Jury, qui ont eu l’obligeance de me consacrer une partie de leur temps, que je sais précieux, pour parcourir ce document et y apporter leurs avis. Des membres du corps enseignant et administratif de la filière Sociologie de la Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie (DEGS) de l’Université d’Antananarivo. Ils ont su partager généreusement leur savoir et leur compétence ci chère. Mes profondes gratitudes s’adressent à : Monsieur le Professeur RAMANDIMBIARISON Jean Claude , Directeur du présent mémoire, pour ses conseils précieux et ses orientations bénéfiques à sa réalisation. -

Les Partenaires Au Développement Sensibilisés Sur La Stratégie
Paraît tous LLaa GGaazdzesee Ctotmttoree es les jours sauf les week-end Quotidien Indépendant d’Informations Générales 18 ème année - N° 2977 - Vendredi 11 Août 2017 - Prix : 200 Fc ASSISES SUR L’ÉNERGIE Les partenaires au développement sensibilisés sur la stratégie Le vice président Djaffar avec les partenaires pour les assises sur l'énergie INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES Prières aux heures officielles Du 11 au 16 Août 2017 Plus de 10 milliards pour la réfection Lever du soleil: 06h 22mn des routes Hahaya-Galawa et Coucher du soleil: Dindrini-Lingoni 18h 03mn LIRE PAGE 3 Fadjr : 05h 11mn Dhouhr : 12h 17mn Ansr : 15h 18mn Visitez le site de la Gazette Maghrib: 18h 06mn www.lagazettedescomores.com Incha: 19h 20mn La Gazette des Comores. Tel :( 0269) 763 26 20 Courriel : [email protected] SOCIÉTÉ LGDC du Vendredi 11 Août 2017 - Page 2 INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES Plus de 10 milliards pour la réfection des routes Hahaya-Galawa et Dindrini-Lingoni e gouvernement comorien de dix milliards de francs como - poursuit son action dans le riens. secteur des infrastructures A part les deux signataires à Lroutières. Hier jeudi, le vice-prési - savoir Moustadroine Abdou pour la dent en charge de l’aménagement du partie comorienne et Li Boxhi pour territoire et de l’urbanisme, les chinois, cette cérémonie de Moustadroine Abdou a procédé avec signature a vu la présence du secré - le directeur général de la société taire général du gouvernement et du China Geo Ingeenering Corporation ministre des finances. La vice-prési - à la signature d’un contrat pour la dence en charge de l’aménagement réfection des routes à Ngazidja et à du territoire a assuré que les travaux Anjouan.