L'image Du Chouan… Deux Siècles Plus Tard
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gobineau Y El Movimiento Gobinista
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Revistas de la Universidad Nacional de Córdoba -328- Gobineau y el movimiento Gobinista I. LA VIDA DE GOBINEAU 1816. Nace en Ville d'Avray, el 14 de julio. Educado en :B'rancia hasta los 14 años. 1830. Partida para Suiza con su madre y su preceptor. Viaje de cuatro a cinco meses a Durlingen en el país de Bade. Par- , \ / tida para Brienne en el cantón de Berna; entra como in- terno en el colegio, donde los cursos se dictaban en ale mán. Allí sintió el gusto por las lenguas arientales. 1832. Su padre le hace ir a Lorient, donde bajo sa dirección con tinúa sus estudios orientales. Estudia las costumbres cél ticas y la historia de la Armónica, y escr:be ws primeros versos. 1835. Fin de sus estudios. Partida hacia París. Ocupa modes tas posiciones en el Correo, en la Socieflud de Gas. Es cribe sus primeros artículos periodísticos. 1841 . * Alviano, condottl<:l!'~ ('Uni té") . ,y,, Capo d'Istria ("Revue des Deux Mondes", 15 de abril). 1843. f., Artículos de política, crítica literaria, etc. ("Uni té") . * Artículos ('' Quotidienne' ') . q, Scaramouche, folletín de "Unité". 1844. :B'undación de una agrupación de jóvenes .. ''Los Primos de Isis". *Les Adieux de Don Juan. (Jues Labitte). *Artículos (" Quotidienne ", "Revue de París") . 1845. * Artículos (" Quotidienne ", "Revue de Parü;; ", Commer . ce"). 1846. *Artículos ("I.~a Revue Nouvelle"). *Le Prisionnier chanceux ou les Aventure¡> de Jean de la Tour Mira ele (Folletín de '' Quotidienne' ', 31 de marzo y siguientes). -

Folklore and Etymological Glossary of the Variants from Standard French in Jefferson Davis Parish
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1934 Folklore and Etymological Glossary of the Variants From Standard French in Jefferson Davis Parish. Anna Theresa Daigle Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Part of the French and Francophone Language and Literature Commons Recommended Citation Daigle, Anna Theresa, "Folklore and Etymological Glossary of the Variants From Standard French in Jefferson Davis Parish." (1934). LSU Historical Dissertations and Theses. 8182. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/8182 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. FOLKLORE AND ETYMOLOGICAL GLOSSARY OF THE VARIANTS FROM STANDARD FRENCH XK JEFFERSON DAVIS PARISH A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF SHE LOUISIANA STATS UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE IN PARTIAL FULLFILLMENT FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN THE DEPARTMENT OF ROMANCE LANGUAGES BY ANNA THERESA DAIGLE LAFAYETTE LOUISIANA AUGUST, 1984 UMI Number: EP69917 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. UMI Dissertation Publishing UMI EP69917 Published by ProQuest LLC (2015). -

Prostitution in Bristol and Nantes, 1750-1815: a Comparative Study
Prostitution in Bristol and Nantes, 1750-1815: A comparative study Thesis submitted for the degree of Doctor in Philosophy at the University of Leicester Marion Pluskota Centre for Urban History University of Leicester July 2011 Abstract This thesis is centred on prostitution in Nantes and Bristol, two port cities in France and England, between 1750 and 1815. The objectives of this research are fourfold: first, to understand the socio-economic characteristics of prostitution in these two port cities. Secondly, it aims to identify the similarities and the differences between Nantes and Bristol in the treatment of prostitution and in the evolution of mentalités by highlighting the local responses to prostitution. The third objective is to analyse the network of prostitution, in other words the relations prostitutes had with their family, the tenants of public houses, the lodging-keepers and the agents of the law to demonstrate if the women were living in a state of dependency. Finally, the geography of prostitution and its evolution between 1750 and 1815 is studied and put into perspective with the socio- economic context of the different districts to explain the spatial distribution of prostitutes in these two port cities. The methodology used relies on a comparative approach based on a vast corpus of archives, which notably includes judicial archives and newspapers. Qualitative and quantitative research allows the construction of relational databases, which highlight similar patterns of prostitution in both cities. When data is missing and a strict comparison between Nantes and Bristol is made impossible, extrapolations and comparisons with studies on different cities are used to draw subsequent conclusions. -

Les Vendéens D'anjou (1793) : Analyse Des Structures Militaires
ISSN 0300-7979 MÉMOIRES ET' DOCUMENTS publiés par les soins du Ministère des Universités XXXVIII La Commission d'histoire économique et sociale de la Révolution française (Sous-commission permanente) a décidé, dans sa séance du 8 décembre 1979, de publier l'ouvrage de M. Claude PETITFRÈRE intitulé Les Vendéens d'Anjou (1793). Analyse des structures militaires, sociales et mentales. En vente à Paris, à la Bibliothèque nationale Service de vente des catalogues, 71, rue de Richelieu. COMMISSION D'HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE MÉMOIRES ET DOCUMENTS XXXVIII Claude PETITFRÈRE Professeur à l'Université de Tours LES VENDÉENS D'ANJOU (1793) ANALYSE DES STRUCTURES MILITAIRES, SOCIALES ET MENTALES Préface par Jacques GODECHOT PARIS BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 1981 ISBN 2-7177-1597-5 @ BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, PARIS, 1981 Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction, par tous procédés, y compris la photographie et le microfilm, réservés pour tous pays. AVERTISSEMENT Cet ouvrage constitue la première partie, quelque peu remaniée et surtout allégée, de la thèse de doctorat ès-lettres que nous avons soutenue à l'Université de Toulouse-Le Mirail en janvier 1977. Il devrait être suivi d'un second consacré aux gardes nationaux et aux volontaires de 1791 - 1792. Nous tenons à exprimer ici notre profonde reconnaissance à notre directeur de thèse, Monsieur le Doyen Godechot, ainsi qu'à Messieurs les Professeurs P. Bois, M. Bouloiseau, F. Lebrun, J. Meyer, J. Sentou et A. Soboul. Nous remercions également les Directeurs successifs des Archives départementales du Maine-et-Loire, Monsieur Robert Favreau et Made- moiselle Françoise Poirier-Coutansais, la Directrice de la Bibliothèque municipale d'Angers, Mademoiselle Isabelle Battez ainsi que le personnel de ces établissements, nos collègues J.P. -

C - 1027 - I - 1154 - N - 1243 - S - 1317 - Y - 1392 - D - 1077 - J - 1167 - O - 1253 - T - 1356 - Z - 1394 - E - 1096
956 - F - 1114 - K - 1173 - P - 1262 - U - 1369 - A - 956 - G - 1127 - L - 1175 - Q - 1299 - V - 1371 - B - 1003 - H - 1147 - M - 1206 - R - 1300 - W - 1390 - C - 1027 - I - 1154 - N - 1243 - S - 1317 - Y - 1392 - D - 1077 - J - 1167 - O - 1253 - T - 1356 - Z - 1394 - E - 1096 INDEX SÉLECTIF Le présent index renvoie aux cotes des documents. Pour les innombrables séries départementales de la période 1789-1830, l’indexation est fonction de l’importance présumée des dossiers et n’a donc qu’une valeur indicative. D’autre part, l’index ne prend pas en compte les dossiers personnels cotés F7 15475 à 15539, et F7 15741 à 15765. Conformément à l’usage, les noms de personnes sont en petites capitales, les noms géographiques en italiques et les noms communs en caractères romains. Les noms de navires, de journaux, de théâtres et d’oeuvres sont en italiques. La flèche (Î) signifie : "voir aussi" et renvoie aux mots d’intérêt voisin. - A - AARVANGUE : voir Muller d'Aarvangue. Abattoir : voir Paris. Abbaye : voir Communauté religieuse. Abbaye (l’), prison parisienne : 329914, 4408, 4433, 6158, 6185, 7350. Abbeville (Somme): 6290, 7126.— conjuration de l’an XII : 6361-6365. ABD EL-KRIM : 13413, 14878 ABÉLARD (tombeau d’): 4258B. ABETZ (Otto), ambassadeur d'Allemagne en France : 15317, 15331-15332. ABLEMONT (Martel-Marie-Jacques d’), émigré : 7727. Ablon (Calvados) : 12808. Abonnement : voir Presse. 957 ABRIAL, haut fonctionnaire de police : 9781. Abyssinie : 15168. Académie de médecine : voir Médecine. Accaparement : voir Subsistances. Accident : états sous l’Empire : 2271-2274.— états des décès accidentels (1815-1838): 9713- 9730.— collisions (1845-1846): 12243.— accidents du travail (IIIe République): 12533, 13595.— sinistres et catastrophes (1907-1910): 12649. -

Bank Notes of the French Revolution, Part I – the Royal Assignats
BANK NOTES OF THE FRENCH REVOLUTION, PART I – THE ROYAL ASSIGNATS John E. Sandrock Prelude to Revolution Conditions in France under the monarchy at the end of the eighteenth century were bad both economically and socially. The monarchy was supreme, ruling by Divine Right. As a result, there being no parliament or other body to act as a check on extremes, the king was responsible only to himself. Although Louis XVI meant well, he was sluggish and ignorant when it came to domestic and foreign affairs. His love of hunting and his passion for tinkering with locks consumed his concentration. The problems associated with statesmanship were beyond his grasp. To make matters worse his Austrian born wife, Marie Antoinette, was both frivolous and erratic without any understanding of her subjects or their plight. France at this time was an agrarian nation with all but a small percentage of the population working the land. Crops had been very poor for several years and the winter hail storms of 1788-1789 was uncommonly severe. This made the collection of taxes, always an onerous chore which was badly administered, much more difficult. When we add to this the agrarian troubles, continual unbalanced budgets, foreign trade stifled for lack of credit, and a monarchy unable to raise money due to its bad credit, we have the grounds for bankruptcy. Transcending all this was a bureaucracy where privilege was rife. An enormous amount of wealth (some say up to twenty-five percent) was tied up in the hands of the church and clergy. Soon many writers began to attack the outmoded privileges and abuses of the aristocracy. -

Brittany & Its Byways by Fanny Bury Palliser
The Project Gutenberg EBook of Brittany & Its Byways by Fanny Bury Palliser This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.guten- berg.org/license Title: Brittany & Its Byways Author: Fanny Bury Palliser Release Date: November 9, 2007 [Ebook 22700] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK BRITTANY & ITS BYWAYS*** Brittany & Its Byways by Fanny Bury Palliser Edition 02 , (November 9, 2007) [I] BRITTANY & ITS BYWAYS SOME ACCOUNT OF ITS INHABITANTS AND ITS ANTIQUITIES; DURING A RESIDENCE IN THAT COUNTRY. BY MRS. BURY PALLISER WITH NUMEROUS ILLUSTRATIONS London 1869 Contents Contents. 1 List of Illustrations. 7 Britanny and Its Byways. 11 Some Useful Dates in the History of Brittany. 239 Chronological Table of the Dukes of Brittany. 241 Index. 243 Transcribers' Notes . 255 [III] Contents. CHERBOURG—Mont du Roule—Visit of Queen Victoria—Har- bour, 1—Breakwater—Dock-Yard, 2—Chantereyne—Hôpi- tal de la Marine, 3—Castle—Statue of Napoleon I.—Li- brary—Church of La Trinité, 4—Environs—Octeville, 5—Lace- school of the Sœurs de la Providence, 11. QUERQUEVILLE—Church of St. Germain, 5—Château of the Comte de Tocqueville, 6. TOURLAVILLE—Château, 7—Crêpes, 11. MARTINVAST—Château, 12. BRICQUEBEC—Castle—History, 12—Valognes, 14. ST.SAUVEUR-le-Vicomte—Demesne—History, 15—Cas- tle—Convent—Abbey, 16. PÉRI- ERS, 17—La Haye-du-Puits, 17—Abbey of Lessay—Mode of Washing—Inn-signs, 18—Church, 19. -

Exploring a Database of “Notable People”
Discussion paper 2016-03 A BRIEF HISTORY OF HUMAN TIME: Exploring a database of “notable people” Olivier Gergaud Morgane Louenan Etienne Wasmer Sciences Po Economics Discussion Papers ABriefHistoryofHuman Time Exploring a database of “notable people” (3000BCE-2015AD) Version 1.0.1⇤ Olivier Gergaud,† Morgane Laouenan,‡ Etienne Wasmer§ February 8, 2016 Abstract This paper describes a database of 1,243,776 notable people and 7,184,575 locations (Geolinks) associated with them throughout human history (3000BCE-2015AD). We first describe in details the various approaches and procedures adopted to extract the relevant information from their Wikipedia biographies and then analyze the database. Ten main facts emerge. 1. There has been an exponential growth over time of the database, with more than 60% of notable people still living in 2015, with the exception of a relative decline of the cohort born in the XVIIth century and a local minimum between 1645 and 1655. 2. The average lifespan has increased by 20 years, from 60 to 80 years, between the cohort born in 1400AD and the one born in 1900AD. 3. The share of women in the database follows a U-shape pattern, with a minimum in the XVIIth century and a maximum at 25% for the most recent cohorts. 4. The fraction of notable people in governance occupations has decreased while the fraction in occupations such as arts, literature/media and sports has increased over the centuries; sports caught up to arts and literature for cohorts born in 1870 but remained at the same level until the 1950s cohorts; and eventually sports came to dominate the database after 1950. -

A Companion to the French Revolution Peter Mcphee
WILEY- BLACKwELL COMPANIONS WILEY-BLACKwELL COMPANIONS TO EUROPEAN HISTORY TO EUROPEAN HISTORY EDIT Peter McPhee Wiley-blackwell companions to history McPhee A Companion to the French Revolution Peter McPhee Also available: e Peter McPhee is Professorial Fellow at the D BY University of Melbourne. His publications include The French Revolution is one of the great turning- Living the French Revolution 1789–1799 (2006) and points in modern history. Never before had the Robespierre: A Revolutionary Life (2012). A Fellow people of a large and populous country sought to of both the Australian Academy of the Humanities remake their society on the basis of the principles and the Academy of Social Sciences, he was made of popular sovereignty and civic equality. The a Member of the Order of Australia in 2012 for drama, success, and tragedy of their endeavor, and service to education and the discipline of history. of the attempts to arrest or reverse it, have attracted scholarly debate for more than two centuries. the french revolution Contributors to this volume Why did the Revolution erupt in 1789? Why did Serge Aberdam, David Andress, Howard G. Brown, it prove so difficult to stabilize the new regime? Peter Campbell, Stephen Clay, Ian Coller, What factors caused the Revolution to take Suzanne Desan, Pascal Dupuy, its particular course? And what were the Michael P. Fitzsimmons, Alan Forrest, to A Companion consequences, domestic and international, of Jean-Pierre Jessenne, Peter M. Jones, a decade of revolutionary change? Featuring Thomas E. Kaiser, Marisa Linton, James Livesey, contributions from an international cast of Peter McPhee, Jean-Clément Martin, Laura Mason, acclaimed historians, A Companion to the French Sarah Maza, Noelle Plack, Mike Rapport, Revolution addresses these and other critical Frédéric Régent, Barry M. -

La Mort De Jean Chouan Et Sa Prétendue Postérité, Mamers, G
Auteur, titre et références du texte : LA SICOTIÈRE (L. de), La mort de Jean Chouan et sa prétendue postérité, Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1877, 38 p. (tiré-à-part de la Revue historique et archéologique du Maine). Mis en ligne par : Archives départementales de la Mayenne 6 place des Archives — 53000 LAVAL, France Date de première mise en ligne : 2 janvier 2004. Référence : FR-AD53-BN-0006 Texte relu par : Joël Surcouf d’après un exemplaire conservé aux Archives départementales de la Mayenne (cote : AH 291). D’autres textes sont disponibles sur le site des Archives de la Mayenne LA MORT DE JEAN CHOUAN ET SA PRÉTENDUE POSTÉRITÉ PAR M. L. DE LA SICOTIÈRE I. Les vers que M. Victor Hugo publiait, dans ces derniers temps, sur la mort de Jean Chouan, et la polémique assez singulière dont ils ont été l'occasion entre un prétendu descendant de ce hardi partisan et plusieurs journaux, ont rappelé l'intérêt public sur cet épisode, un des plus touchants et des plus héroïques assurément des guerres de l'Ouest. J'aurais été heureux qu'un compatriote de Jean Chouan, mieux placé que moi pour connaître la vérité dans tous ses détails, fît à cette occasion à la Revue du Maine, une communication qui rentrait tout à fait dans son cadre et que ses lecteurs auraient accueillie avec reconnaissance. Personne ne s'étant présenté, je me hasarde à lui envoyer de loin quelques documents glanés, comme on le verra, dans des champs bien divers. J'ai trouvé à les colliger un intérêt que je n'espérais pas tout d'abord, et que je voudrais faire partager. -
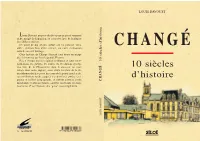
La Mayenne È
LOUIS DAVOUST e Louis Davoust propose de découvrir un passé vraiment riche, malgré la disparition, au cours des âges, de la plupart des édifices anciens. CHANGÉ Ce passé de dix siècles, même s’il est presque “invi- sible”, méritait bien d’être retracé, car notre civilisation les d’histoir actuelle en est l’héritage. Cette histoire de Changé s’inscrit sans doute en marge des événements qui font la grande Histoire. Elle n’évoque pas les régimes politiques et leurs trans- 10 sièc formations, les guerres, les traités, les révolutions (excep- - tion faite de la Chouannerie dont le souvenir est resté 10 siècles vivace dans notre région), mais plutôt les faits de la vie quotidienne des travaux et des jours de la population locale, essentiellement rurale jusqu’à ces dernières années (sei- d’histoire gneurs et nobles campagnards, et surtout paysans, petits CHANGÉ marchands et artisans ruraux, ouvriers tisserands ou chau- fourniers). C’est l’histoire des “gens”, tout simplement. OUST AV LOUIS D 53 - MAYENNE CHANGÉ 10 siècles d’histoire ÉDITEUR 22, rue du Jeu-de-Paume 53000 LAVAL 25, rue des Carmélites 44000 NANTES © Siloë, 1995 ISBN 2-84231-006-3 LOUIS DAVOUST CHANGÉ 10 siècles d’histoire SOMMAIRE I I. DU MOYEN ÂGE À LA RÉVOLUTION DE 1789................................9 Le château de Beauvais .........................................................................................................11 Les fiefs et seigneuries ...........................................................................................................15 Les terres nobles.............................................................................................................................23 -

The Development of French Counter-Espionage, 1791-1794
Securing the Revolutionary State: The Development of French Counter-Espionage, 1791-1794 By Carlos GARCIA DE LA HUERTA Submitted in partial fulfilment of the requirements of Kingston University for the university degree of Doctor of Philosophy in History September 2020 [Page intentionally left blank] i Supervision: Professor Marisa LINTON (First Supervisor) 1 Dr Rachael JOHNSON 2 1 Professor in History Kingston University London Kingston School of Art School of Arts, Culture and Communication Department of Humanities Penrhyn Road Kingston upon Thames KT1 2EE United Kingdom 2 Senior Lecturer in History Kingston University London Kingston School of Art School of Arts, Culture and Communication Department of Humanities Penrhyn Road Kingston upon Thames KT1 2EE United Kingdom ii [Page intentionally left blank] iii Abstract The history of counter-espionage during the early years of the French Revolution has been curiously overlooked by scholars and non-fiction writers alike. Until now, no single study has appeared, or indeed been published, charting the course of its development during the period in discussion. This thesis aims to fill this lacuna, not by offering an episodic account of its activities but by examining the precepts, perceptions and procedures that determined its conduct as it relates to la sûreté de l’état. Its objective, in other words, is to demonstrate how the pursuit and punishment of spies is not a simple cloak and dagger tale of hidden plots and secret agents but a fundamental question of national security. As this thesis will explain, the role that counter-espionage played is actually of central importance to our understanding of how the revolutionaries defended and securitized their embryonic state at a crucial juncture in its existence.