Laimgjqfla®® [Pdiimmderagj
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fact Sheets French, Arabic, Simplified and Traditional Chinese, Somali, Spanish
Translated COVID-19 Resources – September 24, 2020 Page 1 of 4 COVID-19 Resources Available in Multiple Languages Please note that not all resources will be appropriate for the local context. Government of Canada (all webpages available in French) Awareness resources are available in the following languages: Arabic, Bengali, Simplified or Traditional Chinese, Cree, Dene, Farsi, German, Greek, Gujarati, Hindi, Innu-Aimun, Inuinnaqtun, Inuktitut (Nunavik), Italian, Korean, Michif, Mikmaq, Ojibwe Eastern and Western, Oji-Cree, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Somali, Spanish, Tagalog, Tamil, Ukrainian, Urdu, Vietnamese Relevant Resources (selected) Languages About COVID-19 All Reduce the spread of COVID-19: Wash All your hands infographic How to care for a child with COVID-19 at All home: Advice for caregivers Physical distancing: How to slow the All except Bengali, Romanian or spread of COVID-19 Vietnamese COVID-19: How to safely use a non- All except Bengali, Traditional Chinese, medical mask or face covering (poster) Greek, Gujarati, Polish, Romanian, Urdu or Vietnamese How to quarantine (self-isolate) at home All except Bengali, Traditional Chinese, when you may have been exposed and Greek, Gujarati, Polish, Romanian, Urdu have no symptoms or Vietnamese Government of Ontario (all webpages available in French) Relevant Resources Languages COVID-19: Reopening schools and child French, Simplified and Traditional care Chinese, Farsi, Greek, Gujarati, Hindi, Italian, Korean, Polish Punjabi, Spanish, Tamil, Ukrainian, Urdu 519-822-2715 -

The Ukrainian Weekly 1983, No.23
www.ukrweekly.com eere Published by the Ukrainian National Association Inc., a fraternal non-profit association) X09 I I У Vol. LI No. 23 THE UKRAINIAN WEEKLY SUNDAY, JUNE 5, 1983 Yuzyk marks 20 years in Senate Soviets accept neutrals' draft by Mykhailo Bociurkiw reeky of the Toronto Ukrainian Catho lic Eparchy; Alberta's Sen. Martha for Madrid concluding document OTTAWA - Canadian Sen. Paul Bielish; newly appointed Ontario Ap MADRID - The Soviet Union on final communique, did little more than Yuzyk was honored on the occasion of peals Court Judge Walter ТагпороІ– May 6 accepted a draft for a concluding assure that another follow-up meeting the 20th anniversary of his appointment sky; and Laverne Lewicky, member of document put forth by professed neutral would convene in three years. to the Senate with a banquet held at Parliament for Dauphin. Man. and non-aligned countries aimed at When the Madrid Conference open Parliament Hill's Confederation Ball Other guests arrived from as faraway breaking the deadlock at the Madrid ed in the shadow of the Soviet invasion room on Friday, May 13. as Winnipeg, New York and Florida. Conference to review the 1975 Helsinki of Afghanistan and the mass arrests of Over 100 friends and relatives attend Thanks to the foresight of the ban Accords, which had been meeting here dissidents prior to the start of the ed the Parliament Hill function to pay quet organizer, Mr. Sirskyj, the even for two and half years. Moscow Summer Olympics, the NATO tribute to the senator, who is highly ing was conducted without the pro But whether the 35-country meeting bloc was determined to use the meeting regarded for his contributions to the longed speeches and greetings charac can be brought to a successful conclu as an effective platform to score Soviet Ukrainian community and to ethnic teristic of many Ukrainian community sion remains unclear because Western behavior abroad and on the domestic minority rights in Canada. -
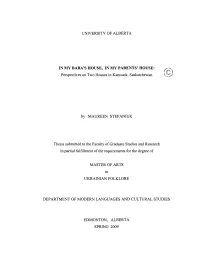
Proquest Dissertations
UNIVERSITY OF ALBERTA IN MY BABA'S HOUSE, IN MY PARENTS' HOUSE: ^=% Perspectives on Two Houses in Kamsack, Saskatchewan C. by MAUREEN STEFANKJK Thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in UKRAINIAN FOLKLORE DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES AND CULTURAL STUDIES EDMONTON, ALBERTA SPRING 2009 Library and Archives Bibliotheque et 1*1 Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de Pedition 395 Wellington Street 395, rue Wellington OttawaONK1A0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre r6f6rence ISBN: 978-0-494-54623-9 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-54623-9 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par Nnternet, prefer, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre imprimes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

Ukrainian Language in Canada: from Prosperity to Extinction?
Ukrainian language in Canada: From prosperity to extinction? Khrystyna Hudyma University of Saskatchewan In this paper I want to explore in what way and due to what factors the Ukrainian language in Canada evolved from being a mother tongue for one of the biggest country’s ethnic groups to just an ethnic language hardly spoken by younger generations. Ukrainian was brought to the country by peasant settlers from Western Ukraine at the end of the 19th century; therefore, it is one of the oldest heritage languages in Canada. Three subsequent waves of Ukrainian immigration supplied language retention; however had their own language-related peculiarities. Initially, the Ukrainian language in Canada differed from standard Ukrainian, with the pace of time and under influence of the English language they diverged even more. Profound changes on phonetic, lexical and grammatical levels allow some scholars to consider Canadian Ukrainian an established dialect of standard Ukrainian. Once one of the best maintained mother tongues in Canada, today Ukrainian experiences a significant drop in number of native speakers and use at home, as well as faces a persistent failure of transmission to the next generation. Although, numerous efforts are made to maintain Ukrainian in Canada, i.e. bilingual schools, summer camps, university courses, the young generation of Ukrainian Canadians learn it as a foreign language and limit its use to family and school settings. Such tendency fosters language shift and puts Canadian Ukrainian on the brink of extinction in the nearest future. 1 Introduction The first records of immigrants arriving from the territory of modern Ukraine to Canada go back to 1892, and thus, have more than a century of history. -

V Ol. 21 Issue 1 (November 2011) Working Papers of the Linguistics Circle of the University of Victoria
WPLC Working Papers of the Linguistics Circle of the University of Victoria The Proceedings of the 27th Northwest Linguistics Conference February 19-20 2011 V ol. 21 Issue 1 (November 2011) Working Papers of the Linguistics Circle of the University of Victoria – Vol. 21 – Proceedings of the 27th Northwest Linguistics Conference Published by the graduate students of the University of Victoria Linguistics Department Department of Linguistics University of Victoria P.O. Box 3045 Victoria, B.C., Canada V8W 3P4 ISSN 1200-3344 (print) ISSN 1920-440X (digital) http://web.uvic.ca/~wplc | [email protected] © 2011 All rights retained by contributing authors. ii Table of Contents Acknowledgements v Preface v Editorial committee vi CONTRIBUTIONS IN PHONOLOGY AND PHONETICS Leane Secen & Tae-Jin Yoon 1 Degrees of phonetic enhancement by speech clinicians towards speech-/ language- impaired children Aliana Parker 9 It’s that schwa again! Towards a typology of Salish schwa Khaled Karim 22 An Optimality Theoretic (OT) account of word-final vowel epenthesis and deletion processes in the incorporation of loanwords into the Dhaka dialect of Bangla Christen Harris 34 The structural category of past tense woon in Wolof Akitsugu Nogita 43 Epenthesis, intrusion, or deletion? Vowel alternation in consonant clusters by Japanese ESL learners CONTRIBUTIONS IN SYNTAX AND MORPHOLOGY Reem Alsadoon 52 Non-derivational approach to ditransitive constructions in MSA Hailey Ceong 61 The “Gradient Structure” of Korean “Words” Emrah Görgülü 70 Plural marking in Turkish: Additive -

ECFG-Ukraine-2020R.Pdf
About this Guide This guide is designed to prepare you to deploy to culturally complex environments and achieve mission objectives. The fundamental information contained within will help you understand the cultural dimension of your assigned location and gain skills necessary for success (Photo: Ukrainian and Polish soldiers compete in a soccer during cultural day at the International Peacekeeping and Security Center in Yavoriv, Ukraine). The guide consists of 2 parts: ECFG Part 1 “Culture General” provides the foundational knowledge you need to operate effectively in any global environment with a focus on Eastern Europe. Ukraine Part 2 “Culture Specific” describes unique cultural features of Ukrainian society. It applies culture-general concepts to help increase your knowledge of your assigned deployment location. This section is designed to complement other pre-deployment training (Photo: A Ukrainian media woman dances as the US Air Forces in Europe Band plays a song in Dnipro, Ukraine). For further information, visit the Air Force Culture and Language Center (AFCLC) website at www.airuniversity.af.edu/AFCLC/ or contact the AFCLC Region Team at [email protected]. Disclaimer: All text is the property of the AFCLC and may not be modified by a change in title, content, or labeling. It may be reproduced in its current format with the express permission of the AFCLC. All photography is provided as a courtesy of the US government, Wikimedia, and other sources. GENERAL CULTURE PART 1 – CULTURE GENERAL What is Culture? Fundamental to all aspects of human existence, culture shapes the way humans view life and functions as a tool we use to adapt to our social and physical environments. -

Association of United Ukrainian Canadian Fonds MG 28, V 154 Container File File Title Date
Manuscript Division des Division manuscrits ASSOCIATION OF UNITED UKRAINIAN CANADIAN FONDS MG 28, V 154 Finding Aid No. 2179 / Instrument de recherche no 2179 Prepared in 1999 by Myron Momryk for the Social Préparé en 1999 par Myron Momryk pour les Archives and Cultural Archives sociales et culturels ii TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ..................................................................................... iv ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL MATTERS .........................................................1 Ukrainian Labour and Farmer Temple Association and the Workers Benevolent Association - Financial and Other Records ....................................................1 Conventions ...........................................................................................1 National Committee .....................................................................................4 National Executive Committee - Minutes ...................................................................5 Special Meetings and Discussions .......................................................................6 Organizational/Fund-Raising Campaigns ..................................................................7 Financial Records ......................................................................................8 CORRESPONDENCE ...................................................................................9 Provincial Committees ..................................................................................9 Junior Sections .......................................................................................12 -

Remembrances of a Ukrainian Canadian Immigrant Farm Woman EXAMINING COMMITTEE
HIDDEN ON THE FARM: REMEMBRANCES OF A UKRAINIAN CANADIAN IMMIGRANT FARM WOMAN Pamela J. Sinclair B.A., Simon Fraser University, 1989 THESIS SUBMllTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in the Faculty of Education @ Pamela J. Sinclair, 1996 SIMON FRASER UNJVERSJTY August 1996 All rights reserved. This work may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without permission of the author. APPROVAL NAME Pamela Joan Sinclair DEGREE Master of Arts TITLE Hidden on the Farm: Remembrances of a Ukrainian Canadian Immigrant Farm Woman EXAMINING COMMITTEE: Chair Kieran Egan Celia Haig-Brown Senior Supervisor Janis Dawson Assistant Professor Member Dr. Betty Carter Associate Professor School of Social Work Universitv of British Columbia External Examiner PARTIAL COPYRIGHT LICENSE I hereby grant to Simon Fraser University the right to lend my thesis, project or extended essay (the title of which is shown below) to users of the Simon Fraser University Library, and to make partial or single copies only for such users or in response to a request from the library of any other university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. I further agree that permission for multiple copying of this work for scholarly purposes may be granted by me or the Dean of Graduate Studies. It is understood that copying or publication of this work for financial gain shall not be allowed without my written permission. Title of Thesis/Project/Extended Essay Hidden on the Farm: Remembrances of a Ukrainian Canadian Immigrant Farm Woman Author: - - (Signature) Pamela Joan Sinclair (Name) ABSTRACT Until recently, there have been few published works on the roles women played in the settling of Canada. -

Differences and Similarities in Attitudes Towards Intellectual and Visual Culture Within the Ukrainian-Canadian Community in Edmonton, Alberta.1
Volume 3.1 / Fall 2016 Differences and Similarities in Attitudes towards Intellectual and Visual Culture within the Ukrainian-Canadian Community in Edmonton, Alberta.1 Susanna M. Lynn Abstract Ukrainian-Canadians are a relatively well-established group in Canada. This paper draws on data gathered from ten interviews about ethnic identity discourses which I conducted with new and established members of the Ukrainian-Canadian community in Edmonton, Alberta. Using critical discourse analysis, I investigate the responses to nine of the original thirty-seven interview questions, which included two ranking questions; these questions inquired about participants’ opinions and evaluations of [Ukrainian] literature, language, music and important “kinds” and aspects of culture. Responses exposed some of the similarities and differences in attitudes the two groups held towards intellectual and visual culture, highlighting the evolving nature of this community, and providing detail that enhances understanding of these attitudes. I present key arguments as to why these similarities and differences may, at least in part, correlate to the unique socio-cultural environments in which each group has been developing culture since Ukraine’s Independence. In particular, I posit that “the linguistic factor” (a term I use to summarize the interconnected influence that language, literature, and linguistic ability have on each other) is one of the most salient forces in shaping and informing these similarities and differences in attitudes towards intellectual and visual culture. 1 This research received support from the Shevchenko Scientific Society of Canada and the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC). Introduction Ukrainian-Canadians have been a part of Canada’s foundation since the 1890s, and have been the focus of a respectable amount of literature, especially concerning their early history. -

PF Vol3 No1.Pdf (2.137Mb)
PRAIRIE FORUM Vol. 3, No. 1 Spring, 1978 CONTENTS Schools and Social Disintegration in the Alberta Dry Belt of the Twenties 1 David C. Jones The Colonial Office and the Prairies in the Mid-Nineteenth Century 2 1 David McNab A Research Strategy for the Canada West Region J. W. T. Spinks Attitudes of Saskatchewan Businessmen Toward Government Export Assistance 45 Richard Burke and Robin Karpan Wooing the 'Foreign Vote': Saskatchewan Politics and the Immigrant, 1905-1 91 9 61 J. William Brennan The Metis: The People and the Term J. E. Foster Report on the "Alternatives" Conference Peter McCormick Book Reviews (see overleaf) 95 PRAIRIE FORUM is published twice yearly, in May and November, at an annual subscription of $1 0.00. All subscriptions, correspondence and contributions should be sent to The Editor, Prairie Forum, Canadian Plains Research Center, University of Regina, Saskatchewan, Canada, S4S OA2. Subscribers will also receive the Canadian Plains Bulletin, the newsletter of the Canadian Plains Research Center. PRAIRIE FORUM is not responsible for statements, either of fact or of opinion, made by contributors. COPYRIGHT 1978 CANADIAN PLAINS RESEARCH CENTER BOOK REVIEWS DEMPSEY, The Rundle Journals by John E. Foster SWYRIPA, Ukrainian Canadians: A Survey of their Portrayal in English Language Works by Nadia Kazymyra ARTiBISE, Winnipeg, An Illustrated History by Donald Kerr LUTZ, A Mother Braving a Wilderness by Clinton 0. White VALGARDSON, Red Dust by Kristjana Gunners Regina Geographical Studies No. 1 by Elbert E. Miller ROBINSON, Seas of Earth: An Annotated Bibliography of Saskatchewan Literature as it Relates to the Environment by Doris E. -

Fall Winter 2016
More newsFall/Winter 2016 DEAN`S INSTALLATION STM NEW DEAN DR. ARUL KUMARAN STM SNAPSHOT THE COLLEGE REVEALED BY THE NUMBERS SELLING STM HENRI BIAHÉ Recruitment Officer, TRANSLATING INTO STUDENT SUPPORT Linda Huard COLLEGE ANNIVERSARY CELEBRATIONS KURELEK MURAL; NEWMAN CLUB STM DISTINGUISHED ALUMNI AWARDS RECOGNIZING COMMUNITY LEADERSHIP President’s Message The late Czech playwright and president, Vaclav Havel, wrote that the great forces for change in human history are not military might or ideology. Rather, change is powered by the human spirit, by conscience, by ques- tioning the prevailing orthodoxy, by a sustained sense of justice, responsibility and compassion. The Catholic intellectual tradition that animates St. Thomas More College enables our students to be the forces for transformation that Havel describes. By encompassing a rich diversity of voices and opinions, this tradition is the catalyst for a dynamic intersection of faith and reason that hones consciences, celebrates the inherent dignity of each and every person, inspires the confidence and desire to question an unjust status quo, and attends to the obligations of social justice. In practice, this requires persistent observance of the rigours of academic freedom including the obligation to vigorously pursue truth by intensive, systematic research, and to effectively articulate findings for scholarly colleagues and students; this demands teaching excellence that offers exceptional classroom experiences, engaged learning that motivates and inspires, experiential learning -

The Canadian Institute of Ukrainian Studies: Foundations, EWJUS, Vol
The Canadian Institute of Ukrainian Studies: Foundations Volodymyr Kravchenko University of Alberta Abstract: The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) became the second academic institution in the Western world to fully specialize in exploring Ukrainian history, culture, and current affairs after the Harvard Ukrainian Research Institute (HURI). Establishment of the CIUS in Edmonton was not predetermined. There were other ideas and competing projects with regard to place, profile, and institutional model of Ukrainian studies in Canada. Edmonton became a winner due to a unique combination of Western regionalism, multiculturalism, the makeup of the Ukrainian local community, and the personal qualities of that community’s leaders. Contrary to widespread opinion, the CIUS did not copy the institutional model of the HURI. The CIUS model is unique, as it embraces a broad, interdisciplinary research agenda, and community-oriented activities related to education and culture. Keywords: Canadian Institute of Ukrainian Studies, Edmonton, Winnipeg, Toronto, multiculturalism. INTRODUCTION or over forty years the Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) has F been one of the only two academic institutes in the Western world fully specialized in exploring Ukrainian history, culture, and current affairs. Its purview has particularly embraced a broad variety of topics related to the Ukrainian community in Canada, as well as institutional and intellectual aspects of Ukrainian studies in the West since the 1960s. Although many insightful observations