WAGNER Le Vaisseau Fantôme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
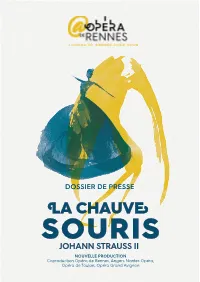
Dpresse Lachauve-Souris
DOSSIER DE PRESSE LA CHAUVE SOURIS JOHANN STRAUSS II NOUVELLE PRODUCTION Coproduction Opéra de Rennes, Angers Nantes Opéra, Opéra de Toulon, Opéra Grand Avignon DISTRIBUTION LES RAISONS D’UNE ŒUVRE Claude Schnitzler Stephan Genz Opérette viennoise en trois actes Inspirée d’une pièce française signée des qui, aux côtés de l’Orchestre National Direction musicale Gabriel von Eisenstein 1874 - Livret de Richard Genée et librettistes de Carmen, Meilhac et Halévy, de Bretagne et du Chœur de chambre Carl Haffner d’après le Réveillon Die Fledermaus (La Chauve-Souris) fut le Mélisme(s), fera vivre de l’intérieur la Vienne Jean Lacornerie Eleonore Marguerre de Henri Meilhac et Ludovic coup d’essai mais surtout le coup de maître impériale de François Joseph. Mise en scène Rosalinde, son épouse Halévy de Johann Strauss II, roi de la valse et Bruno de Lavenère Claire de Sévigné Durée 2h15 de l’opérette viennoise. Un chef-d’œuvre Scénographie, costumes Adèle, servante de Rosalinde opéra chanté en allemand et Autre maître d’œuvre de cette production, qui n’a jamais pris l’ombre d’une ride et surtitré en français le chef Claude Schnitzler, partenaire fidèle Kevin Briard Veronika Seghers qui symbolise à juste titre cet âge d’or de de l’Opéra de Rennes, interprète comme nul Lumières Ida, sœur d’Adèle captation Vienne sur lequel il semble porter, déjà, un autre cet esprit musical autrichien… et pour 8 mai à 18h regard doucement nostalgique. Raphaël Cottin Milos Bulajic cause, il a dirigé La Chauve-Souris dans 10 et 12 mai 2021 à 20H Chorégraphe, assistant à la Alfred, un maître de chant plusieurs grandes maisons européennes, avec les moyens techniques À l’occasion d’un bal masqué organisé mise en scène dont le Volksoper de Vienne, considéré Thomas Tatzl de France Télévisions et Radio dans la villégiature du Prince Orlofsky, comme la Mecque de l’opérette viennoise. -

Claire Rutter Soprano
Claire Rutter Soprano The renowned international soprano Claire UK highlights include Minnie La Fanciulla del Rutter of Norwegian-British ancestry began West, Violetta, Elvira and the title roles in her studies at the Guildhall School of Music new productions of Norma, Madama and Drama and joined the ensemble at the Butterfly and Tosca all of which she sang at National Opera Studio where she was Grange Park Opera. For three years, Claire sponsored by English National Opera. She was a company principal at Scottish Opera, went on to build her career singing the title where her roles included roles in ENO’s new productions of Lucrezia Maddalena Andrea Chenier, Fiordiligi Cosi Borgia, Tosca and Aïda, as well as appearing fan tutte, Elettra Idomeneo, CountessA on the ENO stage as Donna Anna Don lmaviva Le nozze di Figaro, the title role Giovanni, Amelia, Elvira Ernani, in Turandot, Rosalinde DieFledermaus, Gilda Rigoletto and Violetta La Traviata. Gilda Rigoletto, Violetta and Leonora Il trovatore. Chelsea Opera Group engaged the Engagements that could sadly not take place artist for several opera-in-concert in 2020 include her return to ENO for the role performances, including the title roles of Foreign Princess Rusalka in a new in Manon Lescaut and Giovanna d’Arco, production, which also planned to tour to the title role in La Théâtre de la Ville de Luxembourg, a Gioconda and Abigaille Nabucco for Opera performance of Verdi‘s Requiem with Sir Mark North, Gilda and Violetta forWelsh National Elder and the Hallé Orchestra, and concert Opera. performances of Tristan und Isolde (Isolde) and Götterdämmerung (Brünnhilde). -

Programmes Et Publications Du Theatre National De L'opera-Comique
PROGRAMMES ET PUBLICATIONS DU THEATRE NATIONAL DE L'OPERA-COMIQUE Répertoire numérique détaillé du versement 20150323 Justine Dilien, sous la direction de la Mission des archives du ministère de la Culture et de la communication Première édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2015 1 Mention de note éventuelle https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054416 Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte. Ce document est écrit en ilestenfrançais.. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales, il a reçu le visa du Service interministériel des Archives de France le ..... 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 20150323/1-20150323/24 Niveau de description groupe de documents Intitulé Programmes des représentations par saisons, et des publications internes et externes de, et sur l'Opéra-Comique. Date(s) extrême(s) 1909-2015 Nom du producteur • Service de la communication de la RTLN (Réunion des théâtres lyriques nationaux), du théâtre national de l'Opéra, de l'association de l'Opéra-Comique et du TNOP (Théâtre national de l'Opéra-Comique). • Théâtre national de l'Opéra-Comique (Paris ; 1714-....) Importance matérielle et support 12 cartons Dimab Localisation physique Pierrefitte-sur-Seine Conditions d'accès Librement communicable Conditions d'utilisation Selon le règlement de la salle de lecture DESCRIPTION Présentation du contenu Ce fonds contient des programmes de représentations, galas, concerts et récitals de 1948 à 2015 (395 programmes différents soit 792 exemplaires), ainsi que des publications internes à l'Opéra et externes tel qu'un numéro spécial du Figaro. -

FRENCH SYMPHONIES from the Nineteenth Century to the Present
FRENCH SYMPHONIES From the Nineteenth Century To The Present A Discography Of CDs And LPs Prepared by Michael Herman NICOLAS BACRI (b. 1961) Born in Paris. He began piano lessons at the age of seven and continued with the study of harmony, counterpoint, analysis and composition as a teenager with Françoise Gangloff-Levéchin, Christian Manen and Louis Saguer. He then entered the Paris Conservatory where he studied with a number of composers including Claude Ballif, Marius Constant, Serge Nigg, and Michel Philippot. He attended the French Academy in Rome and after returning to Paris, he worked as head of chamber music for Radio France. He has since concentrated on composing. He has composed orchestral, chamber, instrumental, vocal and choral works. His unrecorded Symphonies are: Nos. 1, Op. 11 (1983-4), 2, Op. 22 (1986-8), 3, Op. 33 "Sinfonia da Requiem" (1988-94) and 5 , Op. 55 "Concerto for Orchestra" (1996-7).There is also a Sinfonietta for String Orchestra, Op. 72 (2001) and a Sinfonia Concertante for Orchestra, Op. 83a (1995-96/rév.2006) . Symphony No. 4, Op. 49 "Symphonie Classique - Sturm und Drang" (1995-6) Jean-Jacques Kantorow/Tapiola Sinfonietta ( + Flute Concerto, Concerto Amoroso, Concerto Nostalgico and Nocturne for Cello and Strings) BIS CD-1579 (2009) Symphony No. 6, Op. 60 (1998) Leonard Slatkin/Orchestre National de France ( + Henderson: Einstein's Violin, El Khoury: Les Fleuves Engloutis, Maskats: Tango, Plate: You Must Finish Your Journey Alone, and Theofanidis: Rainbow Body) GRAMOPHONE MASTE (2003) (issued by Gramophone Magazine) CLAUDE BALLIF (1924-2004) Born in Paris. His musical training began at the Bordeaux Conservatory but he went on to the Paris Conservatory where he was taught by Tony Aubin, Noël Gallon and Olivier Messiaen. -

Le Dossier De Presse De La Saison 2019-2020
opera.metzmetropole.fr catégories / 1-1078078 2-1078079 3-1078080. catégories e et 3 e , 2 OperaTheatreMetzMetropole er OperaMetz METZ MÉTROPOLE OPÉRA-THÉÂTRE - METZ MÉTROPOLE SAISON 4-5 place de la Comédie - 57000 Metz Réservations 03 87 15 60 60 1 9 • 2 0 Administration 03 87 15 60 51 [email protected] de 1 de spectacles Licence d’entrepreneur / Metz Métropole. de la Communication / Direction Ferry : Christophe graphique Création Sommaire Présentation de la saison 2019/2020 3 Présentation de la saison La 267e saison de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole propose cinq spectacles lyriques, quatre 2019/2020 ballets, six pièces de théâtre et un spectacle destiné au jeune public. Une saison marquée par trois anniversaires, ceux d’Offenbach, Beethoven et des 800 ans de la Cathédrale de Metz, ainsi que par la mise en avant d’un thème hélas très actuel, celui des violences faites aux femmes. 4 Spectacles Le répertoire lyrique italien est mis à l’honneur avec une avec des structures régionales : Théâtre en Scène Compa- trilogie verdienne (Rigoletto, La Traviata, Giovanna d’Arco) gnie Vincent Goethals, la Compagnie Les Heures Paniques et l’humour truculent du Comte Ory de Rossini. Les fêtes ou le Festival Passages. 12 Autres rendez-vous de fin d’année seront quant à elles placées sous le signe Il accueille également d’autres propositions artistiques de l’opérette à grand spectacle avec la production de et collaborations dans le cadre de collaborations avec le Centre Pompidou- La Vie Parisienne d’Offenbach, dans la reprise de la mise Metz, le Festival Constellations de Metz, les 800 ans de la en scène signée Jérôme Savary. -

The Fourteenth Season: Russian Reflections July 15–August 6, 2016 David Finckel and Wu Han, Artistic Directors Experience the Soothing Melody STAY with US
The Fourteenth Season: Russian Reflections July 15–August 6, 2016 David Finckel and Wu Han, Artistic Directors Experience the soothing melody STAY WITH US Spacious modern comfortable rooms, complimentary Wi-Fi, 24-hour room service, fitness room and a large pool. Just two miles from Stanford. BOOK EVENT MEETING SPACE FOR 10 TO 700 GUESTS. CALL TO BOOK YOUR STAY TODAY: 650-857-0787 CABANAPALOALTO.COM DINE IN STYLE Chef Francis Ramirez’ cuisine centers around sourcing quality seasonal ingredients to create delectable dishes combining French techniques with a California flare! TRY OUR CHAMPAGNE SUNDAY BRUNCH RESERVATIONS: 650-628-0145 4290 EL CAMINO REAL PALO ALTO CALIFORNIA 94306 Music@Menlo Russian Reflections the fourteenth season July 15–August 6, 2016 D AVID FINCKEL AND WU HAN, ARTISTIC DIRECTORS Contents 2 Season Dedication 3 A Message from the Artistic Directors 4 Welcome from the Executive Director 4 Board, Administration, and Mission Statement 5 R ussian Reflections Program Overview 6 E ssay: “Natasha’s Dance: The Myth of Exotic Russia” by Orlando Figes 10 Encounters I–III 13 Concert Programs I–VII 43 Carte Blanche Concerts I–IV 58 Chamber Music Institute 60 Prelude Performances 67 Koret Young Performers Concerts 70 Master Classes 71 Café Conversations 72 2016 Visual Artist: Andrei Petrov 73 Music@Menlo LIVE 74 2016–2017 Winter Series 76 Artist and Faculty Biographies A dance lesson in the main hall of the Smolny Institute, St. Petersburg. Russian photographer, twentieth century. Private collection/Calmann and King Ltd./Bridgeman Images 88 Internship Program 90 Glossary 94 Join Music@Menlo 96 Acknowledgments 101 Ticket and Performance Information 103 Map and Directions 104 Calendar www.musicatmenlo.org 1 2016 Season Dedication Music@Menlo’s fourteenth season is dedicated to the following individuals and organizations that share the festival’s vision and whose tremendous support continues to make the realization of Music@Menlo’s mission possible. -

Appropriations of Gregorian Chant in Fin-De-Siècle French Opera: Couleur Locale – Message-Opera – Allusion?
Journal of the Royal Musical Association, 145/1, 37–74 doi:10.1017/rma.2020.7 Appropriations of Gregorian Chant in Fin-de-siècle French Opera: Couleur locale – Message-Opera – Allusion? BENEDIKT LESSMANN Abstract This article compares three French operas from the fin de siècle with regard to their appropriation of Gregorian chant, examining their different ideological and dramaturgical impli- cations. In Alfred Bruneau’s Le rêve (1891), the use of plainchant, more or less in literal quotation and an accurate context, has often been interpreted as naturalistic. By treating sacred music as a world of its own, Bruneau refers to the French idea of Gregorian chant as ‘other’ music. In Vincent d’Indy’s L’étranger (1903), a quotation of Ubi caritas does not serve as an occasional illustration, but becomes essential as part of the leitmotif structure, thus functioning as the focal point of a religious message. Jules Massenet’s Le jongleur de Notre-Dame (1902) provides a third way of using music associated with history and Catholicism. In this collage of styles, plainchant is not quoted literally, but rather alluded to, offering in this ambiguity a mildly anti-clerical satire. Thus, through an exchange, or rather through a bizarre and unfortunate reversal, church music in the theatre is more ecclesiastical than in the church itself. Camille Bellaigue1 In an article in the Revue des deux mondes of 1904, the French critic Camille Bellaigue described the incorporation of church music into contemporary opera, referring to anticipated examples by Meyerbeer and Gounod; to works less well known today, such as Lalo’s Le roi d’Ys (which quotes the Te Deum); and also (quite extensively) to Wagner’s Parsifal, the ‘masterpiece […] or the miracle of theatrical art that is not only Email: [email protected] I am grateful to Stefan Keym for his support and advice with my doctoral studies and beyond. -

JULES MASSENET – His Life and Works by Nick Fuller I
JULES MASSENET – His Life and Works By Nick Fuller I. Introduction Jules Massenet’s operas made him one of the most popular composers of the late nineteenth century, his works performed throughout Europe, the Americas and North Africa. After World War I, he was seen as old- fashioned, and nearly all of his operas, apart from Werther and Manon , vanished from the mainstream repertoire. The opera-going public still know Massenet best for Manon , Werther , and the Méditation from Thaïs , but to believe, as The Grove Dictionary of Opera wrote in 1954, that ‘to have heard Manon is to have heard all of him’ is to do the composer a gross disservice. Massenet wrote twenty-seven operas, many of which are at least as good as Manon and Werther . Nearly all are theatrically effective, boast beautiful music and display insightful characterisation and an instinct for dramatic and psychological truth. In recent decades, Massenet’s work has regained popularity. Although he Figure 1 Jules Massenet, drawing by Ernesto Fontana (Source: is not the household name he once http://artlyriquefr.fr/personnages/Massenet%20Jules.html) was, and many of his operas remain little known, he has been winning new audiences. Conductors like Richard Bonynge, Julius Rudel and Patrick Fournillier have championed Massenet, while since 1990 a biennial Massenet festival has been held in his birthplace, Saint-Étienne, in the Auvergne-Rhône-Alpes, its mission to rediscover Massenet’s operas. His work has been performed in the world’s major opera houses under the baton of conductors Thomas Beecham, Colin Davis, Charles Mackerras, Michel Plasson, Riccardo Chailly and Antonio Pappano, and sung by Joan Sutherland, José van Dam, Frederica von Stade, Nicolai Gedda, Roberto Alagna, Renée Fleming, Thomas Hampson and Plácido Domingo. -

Dossier De Presse
D OSSIER DE PRESSE Contact Presse Angers Nantes Opéra : Bénédicte de Vanssay – 06 76 86 50 50 — [email protected] Guizard Photo : Laurent Opéra de Rennes : Lilian Madelon - 02 23 62 28 19 – [email protected] LA CHAUVE-SOURIS JOHANN STRAUSS OPÉRA SUR ÉCRANS GRATUIT Mercredi 9 juin 2021 - 20h30 Mercredi 9 juin 2021 - 20h00 En simultané sur 11 télévisions et radio : à Nantes Télénantes, L’Hippodrome LMtv Sarthe, Les Nefs TV Vendée, à Angers TV Tours, Le Cloître Toussaint La Chaine Normande LCN, à Rennes TVR, Le Vélodrome Tebeo, Le Théâtre de verdure du parc du Thabor Tebesud La Maison des Associations La Halle du Triangle Les sites web de : La Maison de quartier de la Bellangerais France 3 Pays de la Loire, La Maison des Associations, France 3 Bretagne Le Tambour - Université Rennes 2 Angers Nantes Opéra et des terrasses de cafés Opéra de Rennes EHPAD Saint Thomas de Villeneuve Centre médico et pédagogique de Beaulieu Diffusion sur France Musique le samedi 5 juin 2021 à 20h en Bretagne Arradon, La Bouexière, Loudéac, Lannion, Lamballe et Bécherel, Betton, Cesson-Sévigné, Corps-Nuds, Dinard, La Chapelle – Thouarault, Le Rheu, Mélesse, Noyal-Chatillon-sur-Seiche (avec Chartres de Bretagne), Pacé, Partenay- de-Bretagne, Thorigné-Fouillard, Romillé, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet. en Pays de la Loire Bouchemaine, Saint-Nazaire, Le Croisic, La Baule, Pornic, Notre-Dame-de-Monts, Saint- Gilles-Croix-de-Vie, Boin, la Tranche-sur-Mer, l’Ile d’Yeu, la communauté de communes Sud Vendée… Juillet 2021 Diffusion en différé sur les îles anglo- normandes de Jersey et Guernesey 2 OPÉRA SUR ÉCRANS 2021 LA CHAUVE- SOURIS DE Johann STRAUSS Un événement lyrique unique en Europe dans sa dimension territoriale et dont la vocation est d’offrir l’art lyrique au plus grand nombre. -

Vendredi 9 Novembre 20H Dimanche 11 Novembre 17H Concert Commémorant Le Centenaire De L'armistice De 1918
SAISON 2018-2019 VENDREDI 9 NOVEMBRE 20H DIMANCHE 11 NOVEMBRE 17H CONCERT COMMÉMORANT LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 CONTACTS PRESSE Opéra de Toulon AEC - Imagine Valérie Caranta William Chatrier Attachée de Communication Port. 06 63 56 35 26 Tél. 04 94 92 58 62 [email protected] operadetoulon.fr [email protected] Pierrette Chastel Port. 06 33 55 29 88 [email protected] Grand Mécène Banque Populaire Méditerranée Mécènes & sponsors principaux Réseau Mistral, EDF, Groupe JPV/Lexus, Caisse des Dépôts, Mutuelle Verte, Naval Group Club Orfeo - Camerata PROGRAMME 1re partie Franz Schubert Symphonie n°8 en si mineur, D. 759 « Inachevée » 1. Allegro moderato en si mineur 2. Andante con moto en mi majeur Direction musicale Jurjen Hempel Orchestre de l’Opéra de Toulon Franz Schubert débute la composition de sa 8e Symphonie à l’âge de 25 ans (1822). Elle restera inachevée sûrement à cause de son état de santé calamiteux. Il meurt à 31 ans en 1828. Le manuscrit fut découvert en 1865. Cette symphonie que Schubert n’a jamais entendu devient son œuvre la plus célèbre. Durée 25 mn environ 2e partie Wolfgang Amadeus Mozart Messe de Requiem en ré mineur, K. 626 I. Introitus : Requiem æternam II. Kyrie III. Sequentia 1. Dies iræ 2. Tuba mirum 3. Rex tremendae 4. Recordare 5. Confutatis 6. Lacrimosa IV. Offertorium 1. Domine Jesu 2. Hostias V. Sanctus VI. Benedictus VII. Agnus Dei VIII. Communio : Lux æterna PROGRAMME Direction musicale Jurjen Hempel Soprano Anna Maria Sarra Contralto Yael Raanan-Vandor Ténor Marco Ciaponi Basse Edwin Crossley-Mercer Orchestre de l’Opéra de Toulon Chœur de l’Opéra de Toulon Chef de chœur Christophe Bernollin Chœur de chambre Kallisté Chef de chœur Régine Gasparini Chorale La Clef des Chants Chef de chœur Madalina Spataru Chœur Euterpia Chef de chœur Philippe Médail 1791 est une année aussi exceptionnelle que funeste pour Mozart. -

De Jacques Offenbach
DOSSIER PÉDAGOGIQUE LA VIE © Nelly Blaya © Nelly PARISIENNE OPÉRA-BOUFFE DE JACQUES OFFENBACH CONTACTS ACTION CULTURELLE Marjorie Piquette / 01 69 53 62 16 / [email protected] Eugénie Boivin / 01 69 53 62 26 / [email protected] 1 LA VIE PARISIENNE D’OFFENBACH répétition générale : vendredi 17 janvier 2020 à 20h Samedi 18 janvier à 20h / Dimanche 19 janvier à 16h OPÉRA-BOUFFE EN CINQ ACTES Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy, adapté par Jérôme Savary Création au Théâtre du Palais Royal, Paris, 31 octobre 1866 Direction musicale Claude Schnitzler Mise en scène Jérôme Savary réalisée par Frédérique Lombart Décors Michel Lebois • Costumes Michel Dussarat • Lumières Patrice Willaume Chorégraphe Nadège Maruta • Chef de chant Nathalie Dang Avec La Baronne de Gondremarck Sylvie Bichebois Gabrielle Capucine Daumas Métella Irina Stopina Pauline Nina Savary Mme de Quimper-Karadec Marie-Emeraude Alcime Le Baron de Gondremarck Laurent Montel Raoul de Gardefeu Carl Ghazarossian Bobinet Rémy Mathieu Le Brésilien / Frick Scott Emerson Prosper / Alphonse Frédéric Longbois Alfred / Le Maître d’hôtel Hervé Mathieu Gontran / Joseph / Trébuchet Eric Mathurin Urbain / Le Général Péruvien Jean-Marc Guerrero Charlotte Aurore Weiss Clara Cécile Dumas Léonie Isabelle Baudinet Louise Françoise Folschweiller-Loy Figuration Charlène François Chœur de l’Opéra Théâtre de Metz Métropole Ballet de l’Opéra Théâtre de Metz Métropole Orchestre de l’Opéra de Massy Production de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole, En collaboration avec l’Opéra de Massy 2 LE COMPOSITEUR Son succès est toujours immense à l’étranger mais JACQUES OFFENBACH moins en France. En 1876, il entame une tournée (1819-1880) triom- phale aux Etats-Unis. -

Programme Carmen Web 1.Pdf
4 rue de Monfort - 35000 RENNES habille les placeurs de l’Opéra 4 rue de Bertrand - 35000 RENNES habille les hôtesses de l’Opéra vous accueille sous les arcades, pour une dégustation de galettes, crêpes et glaces artisanales maison tous les jours en continu GEORGES CARMEN BIZET Opéra-comique en quatre actes Livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy D’après la nouvelle de Prosper Mérimé 1875 opéra chanté et surtitré en français Direction musicale Claude Schnitzler Assistant : Guillaume Rault Mise en scène Carmen Le Dancaïre Nicola Berloffa Julie Robard-Gendre Pierrick Boisseau Assistant : Andrea Bernard Don José Le Remendado Scénographie Antoine Bélanger Olivier Hernandez Rifail Ajdarpasic Micaela Zuniga Costumes Marie-Adeline Henry Ugo Rabec Ariane Isabell Unfried Escamillo Morales Lumières Régis Mengus Jean-Gabriel Saint-Martin Marco Giusti Assistant : Matteo Bambi Frasquita Lillas Pastia Vidéaste Marie-Bénédicte Souquet Benjamin Leblay Paul Secchi Mercédès Danseuses Danses réglèes par Sophie Pondjiclis Marta Negrini Marta Negrini Armelle Daoudal Sarah Kuntz Chef de chant Pierre Delalande Colette Diard Chef de chœur Gildas Pungier Coproduction Theater St Gallen et Auditorio de Tenerife Adan Martin Avec le soutien de la Fondation Orange, la Caisse d’Epargne Bretagne Orchestre Symphonique Pays de Loire, la Caisse des dépôts et consignations, Gavottes, Avoxa, de Bretagne Directeur Musical Grant Llewellyn Chœur de l’Opéra de Rennes Direction Gildas Pungier Mai Juin Maîtrise de Bretagne Direction Jean-Michel Noël Mar. 30 Jeu. 1 Sam.3 Mar.6 Jeu.8 20h 20h 18h 20h 20h spectacle en audiodescription 1 ARGUMENT ACTE 1 Sur une place de Séville, à la sortie du corps de garde et d’une manufacture de tabac, des soldats regardent les passants se promener.