La Gestion Des Ressources En Eau Dans La Commune Rurale De Mahasolo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
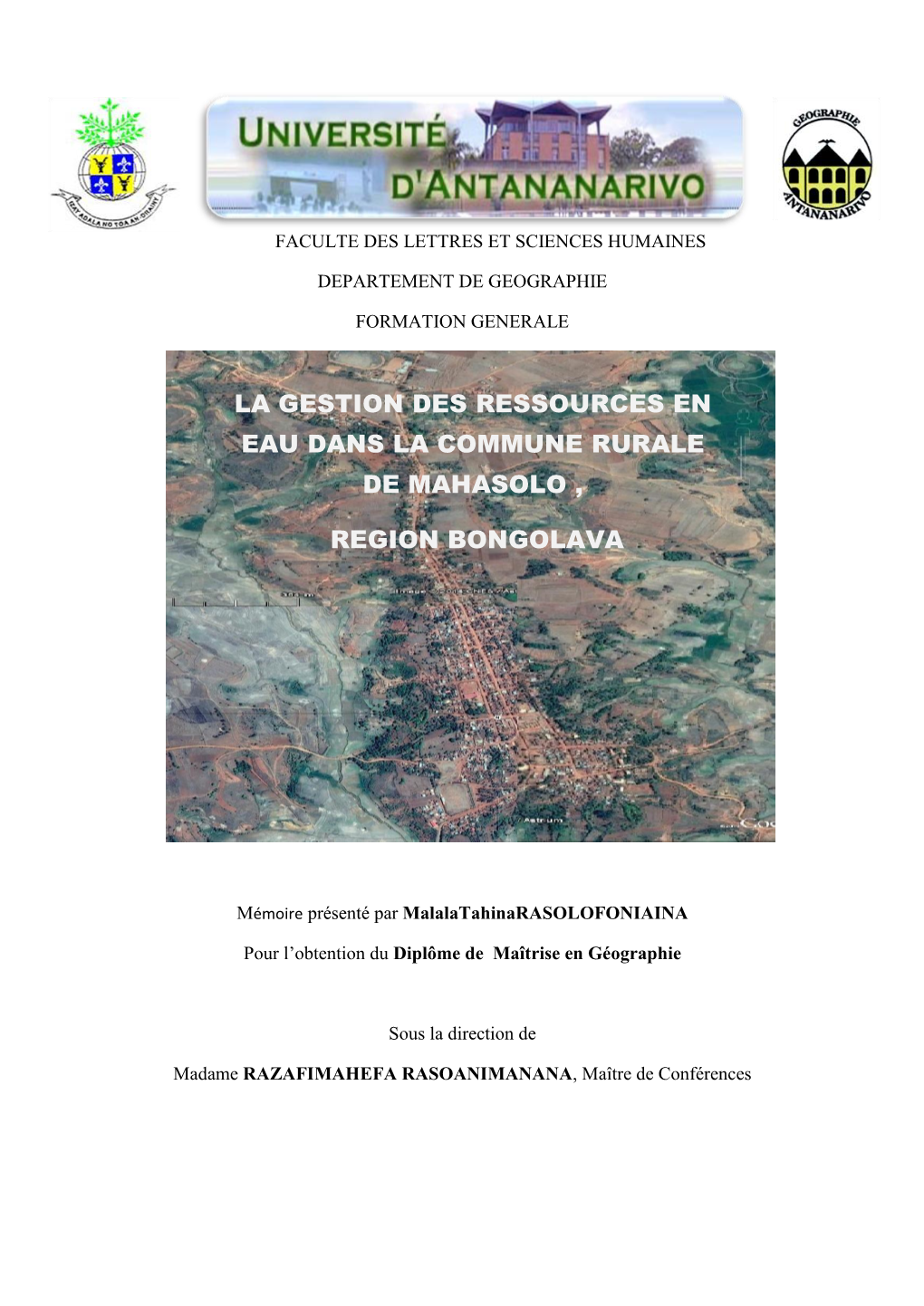
Load more
Recommended publications
-

Stratégies Et Programmation Des Activités
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ET DES TRAVAUX PUBLICS SECRETARIAT GENERAL DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS Stratégies et Programmation des Activités 2020 - 2024 SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS Version finale Novembre 2020 DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS Sommaire 1.État des lieux 5 1.1 Performances du transport routier 5 1.2 Consistance des dépenses publiques 6 2.Stratégies de développement du réseau routier 7 2.1 Vision et repères sectoriels 7 2.2 Cadrage macroéconomique 7 2.3 Logique de développement du réseau 7 2.4 Innovations et réformes 8 3.Programmes d’activités 9 A. Activités physiques 9 a. Routes nationales (RN) 10 b. Autoroutes 10 c. Routes Rurales 10 a.Entretien périodique RN 12 b. Entretien courant RN 12 c.Entretien courant RR 13 B. Activites non physiques 13 4. Moyens du MATP 15 4.1 Ressources humaines 15 4.2 Logistiques et matériels 16 Hypothèses 17 Liste des annexes 18 Catégories priorités projets 19 Annexe 1 20 Coûts km des projets routiers RN 20 Annexe 2 21 Carte des réseaux routiers de Madagascar 21 Annexe 2 bis 22 Prévision de la situation des projets sur RN en 2024 22 Annexe 3 23 Infrastructure structurante du PEM 23 Annexe 4 24 Détails des programmes routiers 24 Préambule Le présent document sur les Stratégies et Programmes des Activités (SPA) du sous-secteur des Travaux Publics (TP) est une nouvelle version du précédent, établi périodiquement pour une période quinquennale glissante initialement jusqu’en 2018. Pour 2020 - 2024, ces stratégies et programmations sont alignées aux actions prévues par la Politique Générale de l’État, le document PEM et le Document Programme du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics. -

RANAIVOARIMANANA, Zo Hariniaina ESPA LC 10X
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO .................. 000 ……………. ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE ….................. 000 ………………. DEPARTEMENT : INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FONCIERE …………...….................. 000 …………………………… Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme de licence ès sciences techniques en topographie et Information Géographique et Foncière ELABORATION D'UN PLAN DE MASSE DU CENTRE ASA AMPASIPOTSY POUR UN PROJET D'ASSAINISSEMENT Présenté par : RANAIVOARIMANANA Zo Hariniaina Encadré par : Monsieur RABETSIAHIN Y Promotion 2009 Date de soutenance : 09 Septembre 2010 ELABORATION D’UN PLAN DE MASSE DU CENTRE A.S.A AMPASIPOTSY POUR UN PROJET D'ASSAINISSEMENT Présenté par : RANAIVOARIMANANA Zo Hariniaina Président du Jury : Monsieur RABARIMANANA Mamy Herisoa Enseignant chercheur à l'ESPA Rapporteur : Monsieur RABETSIAHINY Chef de Département de la filière Information Géographique et Foncière Examinateurs : Monsieur NARY HERILALAO IARIVO, Ingénieur Géodésien Monsieur RAJAONARIVELO Simon, Enseignant à l’E.S.P.A. REMERCIEMENTS Je tiens d’abord à remercier le Seigneur tout puissant pour sa gratitude et sa bénédiction durant mes parcours universitaires au sein de la filière Information Géographique et Foncière. Mes sincères remerciements s’adressent à Monsieur ANDRIANARY Philipe, Directeur de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo (E.S.P.A) qui m’a permis de poursuivre mes études à l’E.S.P.A et m’a autorisé à présenter cette soutenance de mémoire. Mes reconnaissances vont à l'endroit de Monsieur RABETSIAHINY, Chef de Département -

Liste Candidatures Maires Bongolava
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS FENOARIVOBE AMBATOMAINTY SUD 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra Kaominaly) RANDRIAMBOLAZAFY Léonard AMBATOMAINTY SUD MAMIRATRA (Independant FENOARIVOBE AMBATOMAINTY SUD 1 RANDRIANARISOA Ndrianiaina Romule Ambatomainty Sud Mamiratra) TANORA VONONA SY SAHY HAMPANDROSO FENOARIVOBE AMBATOMAINTY SUD 1 RAVELO Albert (Tanora Vonona Sy Sahy Hampandroso) FIRAISANKINA NO ANTOKY NY FAMPANDROSOANA FENOARIVOBE AMBOHITROMBY 1 (Indépendant Firaisankina No Antoky Ny RAMAROSOLOFO Mahefasoa Hoby Laza Fampandrosoana) FENOARIVOBE AMBOHITROMBY 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra Kaominaly) RAKOTONIAINA René FENOARIVOBE AMBOHITROMBY 1 SAHY MARINA (Indépendant Sahy Marina) RABESOA Julien Olivier FENOARIVOBE FENOARIVOBE 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra Kaominaly) RAKOTOARINELINA Hiarilala Harisona Jeremy FENOARIVOBE FENOARIVOBE 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RAZAFINDRAMBOA Fidy Andriatsarafara FENOARIVOBE FENOARIVOBE 1 MMM (Malagasy Miara Miainga) RATOVOARIVAHOAKA Jean FENOARIVOBE FIRAVAHANA 1 MMM (Malagasy Miara Miainga) RAKOTOARISOA Jean FANDRIAMPAHALEMANA ANTOKY NY FAMPANDROSOANA (Indépendant FENOARIVOBE FIRAVAHANA 1 RAZAFIMAHEFA Solonirina André Fandriampahalemana Antoky Ny Fampandrosoana) FENOARIVOBE FIRAVAHANA 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra Kaominaly)RAHARIMANANA Nambinina FENOARIVOBE KIRANOMENA 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra Kaominaly)RANDRIAMIHAJA Jeannot FENOARIVOBE MAHAJEBY 1 TANTSAHA MIRAY (Tantsaha Miray) RAMADISON Gilles ISIKA REHETRA MIARAMANDROSO (Indépendant -

L'energie Verte Pour Tous !
BULLETIN D’INFORMATION TRIMESTRIEL - N°05 - Edition Novembre 2018 L’Energie verte pour tous ! Le Projet Jiro Kanto dans les districts d’Amparafaravola Projet Jiro Taratra : Un premier système hybride hydro- et Ambatondrazaka : en « pleine energie » solaire à Bongolava. Les travaux de montage des turbines de la centrale Le Projet d’aménagement d’un site hydroélectrique hydroélectrique d’Androkabe (1600kW) sont en cours d’une puissance de 600 kW, sur la Rivière Mandalo, et ceux de Maheriara (800kW) débuteront la semaine est une hybridation avec des parcs solaires de 500kWc du 10 decembre 2018. 50% des supports de câbles sont (dont 200kW installés à la Centrale Hydro, 100kW levés à ce jour. 1 500 ménages se sont déjà inscrits. C’est à Bemahatazana, 100kW à Mahasolo et 100kW à l’un des projets qui utilise plus de poteaux en béton pour Ankadinondry Sakay). Ce projet, d’un montant estimé l’électrification rurale. à 6 millions de dollars, desservira en électricité 38 800 population avec 6435 ménages, entre autres 436 écoles, 68 centres de santé, 01 usine et 425 décortiqueries. Le developpement de ce projet est confié à la Société CASIELEC après le processus d’Appel à projets N°1, en partenariat avec l’ADER et l’ONUDI, Projet ERHYGE : 100% Energies Renouvelables : hydrolienne et solaire pour l’électrification d’Amboarakely - Ambatolaona La technologie hydrolienne commence à prendre place à Madagascar pour électrifier des villages ruraux. Le projet pilote d’Electrification Rurale par HYdrolienne Guinard Energies (ERHYGE), réalisé par la société Guinard, Projet CAFE LUMIERE – Tsenan-jiro cofinancé par l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME), en partenariat avec l’ONG GRET Le village d’Ambatonikolahy et la Société SM3E, est installé sur le canal d’Andriandrano, - District de Betafo – sur le pont du village Amboarakely à Ambatolaona. -

IMMIGRATION in the SAKAY DISTRICT, MADAGASCAR/203 I
mf l 27 Irfïmigration in the Sa kay District, Madagascar J.iP. RAISON . 0 .- ... , I , Although lying within 200 km. of Tananarive and the mord Tsiroanomandidy, in the province of Tananarive (Figure 27.2). ‘thickly populated areas of the Malagasy Highlands, the Saka For the sake of convenience we shall confine our study to this bistrict is still today rather thinly populated, and seems t ‘sub-prefecture’, the 9,388 sq. km.2 of which constitute a con- Lxhibit the characteristics of recently occupied ‘new land venient statistical unit. Strictly speaking the Sakay District is (Figure 27.1). Yet it already offers the student of populatio. only a limited portion of the sub-prefecture, roughly corre- movements a complex and varied field, in which are mixed1 sponding to the rural ‘commune’ of Fanjakamandroso (575 sq. together different types of immigration’and space occupation. km.), in which important developments have taken place for In the following pages, the emphasis is on the variety of such nearly twenty years. But these developments have had indirect situations and Ön the historical environments and the methods effects on the evolution of human settlement and the develop- of land development which account for them. The objective is ment of the larger part of the sub-prefecture. In the following to draw conclusions that may influence a policy of development discussions we shall consider the problems of ‘Greater Sakay’ more comprehensive and varied in its methods. as well asthose of the smaller district bearing this name. The sub-prefecture of Tsiroanomandidy is, in the main, REASONS FOR A SPARSE AND BELATED SETTLEMENT made up of a series of bevelled plateaux seldom reaching higher An unusual ‘no-man’s-land‘ than 1,000 metres, with an average height mostly between 850 The Sakay District is mainly a part of the ‘sub-prefecture” of and 950 metres. -

2I.Xn Visakhapatnam, District
Relevé épidém. hebd. I 1969, 44, 29-52 N° 2 Wkly Epidtm. Rec. | ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ WORLD HEALTH ORGANIZATION GENÈVE GENEVA RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD Notifications et informations se rapportant à l’application Notifications under and information on the application of the du Règlement sanitaire international et notes relatives à la International Sanitary Regulations and notes on current incidence fréquence de certaines maladies of certain diseases Service de la Surveillance épidémiologique et de la Quarantaine Epidemiological Surveillance and Quarantine Unit Adresse télégraphique; EPIDNATIONS GENÈVE Telegraphic Address; EPIDNATIONS GENÈVE Télex 22335 Telex 22335 10 JANVIER 1969 44e ANNÉE — 44th YEAR 10 JANUARY 1969 MALADIES QUARANTENAÎRES — QUARANTINABLE DISEASES Territoires infectés au 9 janvier 1969 — Infected areas as on 9 January 1969 Notifications reçues aux termes du Règlement sanitaire international Notifications received under the International Sanitary Regulations relating concernant les circonscriptions infectées ou les territoires où la présence to infected local areas and to areas in which the presence of quarantinaBle de maladies quarantenaires a été signalée (voir page 549). diseases was reported (see page 549). X *= Nouveaux territoires signalés, X = Newly reported areas. ■ = Circonscriptions ou territoires notifiés aux termes de l'article 3 à la ■ — Areas notified under Article 3 on the date indicated. date donnée. Pour les autres territoires, la présence de maladies quarantenaires a été For the other areas, the presence of quarantinaBle diseases was notified notifiée aux termes des articles 4, 5 et 9 a) pour la période se terminant à la under Articles 4, 5 and 9 (a) for the period ending on the date indicated. -

Bubonic Plague Outbreak Investigation in the Endemic District
Journal of Case Reports and Studies Volume 5 | Issue 1 ISSN: 2348-9820 Research Article Open Access Bubonic Plague Outbreak Investigation in the Endemic District of Tsiroanomandidy - Madagascar, October 2014 Rakotoarisoa A*1,2,3, Ramihangihajason T5, Ramarokoto C2, Rahelinirina S4, Halm A6, Piola P2, Ratsitorahina M1,2 and Rajerison M4 1Epidemiological Surveillance Department, Ministry of Health, Madagascar 2Epidemiology Unit, Pasteur Institute Madagascar 3Epidemiology Training Program, Indian Ocean Commission (FETP-IOC), Mauritius 4Plague Unit, Pasteur Institute Madagascar 5Entomology Unit, Pasteur Institute Madagascar 6Health Surveillance Unit, Indian Ocean Commission, Mauritius *Corresponding author: Rakotoarisoa A, Directorate of Health Surveillance and Epidemiological Surveillance (DVSSE) Ministry of Public Health, Precinct INSPC, Mahamasina, Antananarivo CP:101, Madagascar, Tel: +261 34 09 233 64, E-mail: [email protected] Citation: Rakotoarisoa A, Ramihangihajason T, Ramarokoto C, Rahelinirina S, Halm A, et al. (2016) Bubonic Plague Outbreak Investigation in the Endemic District of Tsiroanomandidy - Madagascar, October 2014. J Case Rep Stud 5(1): 103. doi: 10.15744/2348-9820.5.103 Received Date: September 30, 2016 Accepted Date: February 24, 2017 Published Date: February 27, 2017 Abstract Background: Plague remains a major public health problem in Madagascar. Faced with reports of plague cases and deaths in Tsiroanomandidy district, we performed an investigation in October 2014. Our aim was to describe the plague outbreak and to improve the national plague control strategies. Methods: We used the National plague control program case definition. We identified cases from outpatient registers and collected socio-demographic and clinical information. Plague circulation was determined through a retrospective environmental survey of rodents and vectors. -

CV Topo Parfait Ilo 3
RAJERISON Jean Parfait Lot III F 146 Antohomadinika 101 ANTANANARIVO MADAGASCAR Tél : 032 73 523 26 - 032 02 105 64 Nationalité : MALAGASY Situation de famille : Marié, 2 enfants Email : [email protected] DIPLOME ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE d’ANTANANARIVO MADAGASCAR Diplôme INGENIORAT Topographie - Année1994 STAGES 1992 (Sept/Oct) Division Topo Mahajanga Aide Opérateur topographe Immatriculation Foncière 1993 (Oct/Déc.) COLAS Madagascar Adjoint Chef BE Travaux de réhabilitation de la RN7 ; Route d’Ambohimanambola ; RN58 ; … 1995 – 1996 Topo Info – 67ha Logt1763 Antananarivo Mémoire de fin d’études : « Etude sur les méthodes totalement informatisées en matière de topographie et étude géométrique routière à Madagascar LANGUES Malagasy : langue maternelle Français : Lire – Ecrire – Parler Anglais : Lire – Ecrire – Parler (Moyen) Arabe : Lire – Ecrire – Parler (Elémentaire) CERTIFICATS Certificat de bonne conduite vis-à-vis du Service National Certificat de Fidélité Radio South Africa Permis de conduire : « B » 359144 T - 2007 FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 04/06/10 Audit interne COLAS MADAGASCAR 29/04/10 GPS STRATUS COLAS MADAGASCAR 19/05/09 Audit interne COLAS MADAGASCAR 04 - 08/05/09 Assainissement COLAS MADAGASCAR 23 - 25/04/08 QALITEL Doc / Compar COLAS MADAGASCAR 07 - 09/11/07 MSProject COLAS MADAGASCAR 10 - 17/04/07 SMQ – ISO 9001 COLAS MADAGASCAR 06/2003 Covadis COLAS MADAGASCAR 05/2003 Autocad COLAS MADAGASCAR 1 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 2011 RELAIS QUALITE – RESPONSABLE FORMATION – AUDITEUR INTERNE COLAS MADAGASCAR -

Liste Candidatures Conseillers Bongolava
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS INDEPENDANT TANORA VONONA SY SAHY FENOARIVOBE AMBATOMAINTY SUD 1 HAMPANDROSO (Tanora Vonona Sy Sahy RANDRIAMBOLOLOMANANA Léon Zaza Hampandroso) GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra FENOARIVOBE AMBATOMAINTY SUD 1 RAKOTOMALALA Alfred Kaominaly) INDEPENDANT AMBATOMAINTY SUD FENOARIVOBE AMBATOMAINTY SUD 1 MAMIRATRA (Independant Ambatomainty Sud RAMAMINIRINA Jean Samuel Mamiratra) INDEPENDANT FIRAISANKINA NO ANTOKY NY FENOARIVOBE AMBOHITROMBY 1 FAMPANDROSOANA (Indépendant Firaisankina RAVELOMANANTSOA Nirina Juvence No Antoky Ny Fampandrosoana) GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra FENOARIVOBE AMBOHITROMBY 1 ANDRIANIRINASON Rajosiana Joseph Kaominaly) INDEPENDANT SAHY MARINA (Independant FENOARIVOBE AMBOHITROMBY 1 RAFETISON Andriamampandry Sahy Marina) FENOARIVOBE FENOARIVOBE 1 MMM (Malagasy Miara Miainga) RANDRIANARISOA Robinson GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra FENOARIVOBE FENOARIVOBE 1 RAOELIBENJA Rakotondrabe Kaominaly) FENOARIVOBE FENOARIVOBE 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RAMONJIARIVELO Fetra Fenosoa FENOARIVOBE FIRAVAHANA 1 MMM (Malagasy Miara Miainga) RANDRIANANTENAINA Cyriaque Donat FIKAMBANANA FC2A (Indépendant FENOARIVOBE FIRAVAHANA 1 RAZAFIMAHATRATRA Sylvain Fikambanana Fc2a) FANDRIAMPAHALEMANA ANTOKY NY FAMPANDROSOA (Indépendant FENOARIVOBE FIRAVAHANA 1 RAKOTONDRAVELO Irimpenonjato Ny Zo Fandriampahalemana Antoky Ny Fampandrosoana) GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra FENOARIVOBE FIRAVAHANA 1 RANDRIAMAHEFA André Kaominaly) GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra FENOARIVOBE -

1202 Tsiroanomandidy
RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: TSIROANOMANDIDY Commune: AMBALANIRANA Code Bureau: 120201010101 NAVOKOBE EPC ANTSAHAMANITRA INSCRITS: 517 VOTANTS: 185 BLANCS ET NULS: 1 SUFFRAGE EXPRIMES: 184 N° Partie Voix Poucentage 1 IRD 74 40,22% 2 INDEPENDANT NDIMBIARISOA SOLONIRINA JOSE 32 17,39% 3 INDEPENDANT RAHOLIJAONA HARSON 31 16,85% 4 INDEPENDANT RANDIMBIELSON WILLIAM 5 2,72% 5 INDEPENDANT ZOKY JAONA 2 1,09% 6 TIM 40 21,74% Total des voix 184 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: TSIROANOMANDIDY Commune: AMBALANIRANA Code Bureau: 120201020101 AMBATOMAVO EPP AMBATOMAVO INSCRITS: 579 VOTANTS: 137 BLANCS ET NULS: 6 SUFFRAGE EXPRIMES: 131 N° Partie Voix Poucentage 1 IRD 10 7,63% 2 INDEPENDANT NDIMBIARISOA SOLONIRINA JOSE 31 23,66% 3 INDEPENDANT RAHOLIJAONA HARSON 70 53,44% 4 INDEPENDANT RANDIMBIELSON WILLIAM 2 1,53% 5 INDEPENDANT ZOKY JAONA 4 3,05% 6 TIM 14 10,69% Total des voix 131 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: TSIROANOMANDIDY Commune: AMBALANIRANA Code Bureau: 120201030101 AMBOHIBARY EPP AMBOHIBARY SALLE 1 INSCRITS: 370 VOTANTS: 105 BLANCS ET NULS: 4 SUFFRAGE EXPRIMES: 101 N° Partie Voix Poucentage 1 IRD 16 15,84% 2 INDEPENDANT NDIMBIARISOA SOLONIRINA JOSE 40 39,60% 3 INDEPENDANT RAHOLIJAONA HARSON 15 14,85% 4 INDEPENDANT RANDIMBIELSON WILLIAM 3 2,97% 5 INDEPENDANT ZOKY JAONA 3 2,97% 6 TIM 24 23,76% Total des voix 101 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: TSIROANOMANDIDY Commune: AMBALANIRANA Code Bureau: 120201030102 AMBOHIBARY EPP AMBOHIBARY SALLE 2 INSCRITS: 367 VOTANTS: 119 BLANCS ET NULS: 3 SUFFRAGE -

RAHARIMAMONJY Koloniaina Monsieur REJELA Michel Norbert
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE --------------------------------- UNIVERSITE DE TOLIARA ------------------- FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES -------------------------------- DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE Présentée par : RAHARIMAMONJY Koloniaina Sous la Direction de : Monsieur REJELA Michel Norbert Maître de Conférences à l’Université de Tuléar Date de soutenance : 27 Juillet 2012 Année Universitaire : 2010-2011 REMERCIEMENTS C’est avec un grand honneur que nous vous présentons le fruit de nos travaux de recherche. Malgré les difficultés rencontrées durant la réalisation de ce travail, nous avons pu accomplir cette tâche qui concerne le phénomène migratoire dans le district de Tsiroanomandidy. Pour cela, il est nécessaire de signaler que la migration n’est pas une manifestation récente dans cette zone. Alors, l’étudier nous apparait intéressant dans le cadre de notre Mémoire de Maîtrise. Ce travail n’a pas pu aboutir à terme sans l’aide de plusieurs personnes par leurs conseils, leurs exigences, leurs aides morales, matérielles ainsi que financières. Nous leur adressons nos remerciements les plus sincères! Nous tenons donc à exprimer notre profonde reconnaissance à : DIEU tout puissant qui nous a donné la force ainsi que la bonne santé à l’élaboration de ce travail de Mémoire. Monsieur REJELA Michel Norbert, Maître de Conférences à l’Université de Toliara, qui a accepté de nous orienter à la réalisation de ce travail malgré ses multiples occupations. Monsieur SOLO Jean Robert, Directeur du Département du Géographie, qui nous a donné l’autorisation d’enquêtes sur terrain et de recherche bibliographique. Tous les Enseignants-Chercheurs des Départements de Géographie et d’Histoire qui nous ont encadrés durant notre cursus universitaire de la première année en quatrième année. -

Programme De Coopération Décentralisée Entre Le Finistère Et La
Grande Comore COMORES Iles Glorieuses Cap d'Ambre Moroni (France) (Tanjona Bobaomby) Anjouan Antsiranana (Diégo-Suarez) Mohéli Ambohitra Ambolobozokely Grande Comore 1475 COMORES Iles Glorieuses Cap d'Ambre Moroni (France) (Tanjona Bobaomby) Anjouan Antsiranana (Diégo-Suarez) Mohéli Ambohitra Ambolobozokely Bobasakoa 1475 Anivorano Avaratra Bobasakoa Anivorano Avaratra Ile Mitsio ANTSIRANANA Antsohimbondrona Mayotte (France) Daraina Nosy Be Ambilobe Betsiaka M a Andoany (Hell-Ville) h Aharana a v a (Vohemar) v Ile Mitsio y Fanambana Ambanja Antsaba 1785 du assif Marovato M Antsirabe Avaratra emarivo Maromokotro 2876 B Maromandia Amboahangibe Sambava 2262 ANTSIRANANA 2133 e Ile Lava Bealanana Marojezy M Analalava aev o u aran Andapa Antsambalahy q Antsahabe Antsohihy Matsoandakana Antsohimbondrona i 1438 Antalaha Baie de Maromandia b la Mahajamba Antsakabary Befandriana Ambohitralanana Mahajanga Mariarano Boriziny Avaratra Maroantsetra Cap Est m B (Port-Bergé) Sofia a (Tanjona i e 1105 d Angonsty) (Majunga) Rantabe ' Daraina A a Mayotte (France) n Tsinjomitondraka t Katsepy a o n Vinanivao n Marovato Mandritsara g i Ambilobe z i l Cap Masoala M Mitsinjo Mampikony an Cap St-André Soalala o B an Manambololosy (Tanjona Masoala) Betsiaka e ara m o (Tanjona Vilanandro) Marovoay B a Marotandrano Nosy Be Lac Kinkony riv Mananara Avaratra o g o Tsaramandroso Ile Chesterfield Ankasakasa n Ambinda o Madirovalo Sandrakatsy b Atanambre M M Ambato Boeny m Miarinarivo A Bekapaika 1301 Andranomavo Ambodiatafana Besalampy Sitampiky MAHAJANGA M Tsararanana