Xviii2015 Livre.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Onomastikas Pētījumi Onomastic Investigations
Onomastikas pētījumi Onomastic Investigations Rīga 2014 Onomastikas pētījumi / Onomastic Investigations. Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli / Proceedings of the International Scientific Conference to commemorate the 100th anniversary of Vallija Dambe. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 392 lpp. LU LATVIEŠU VALODAS INSTITŪTS Latvian LANGuaGE Institute, UniversitY OF Latvia Reģistrācijas apliecība Nr. 90002118365 Adrese / Address Akadēmijas lauk. 1-902, Rīga, LV-1050 Tālr. / Phone: 67227696, fakss / fax: +371 67227696, e-pasts / e-mail: [email protected] Atbildīgie redaktori / Editors Dr. habil. philol. Ojārs Bušs Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe Dr. philol. Sanda Rapa Redakcijas kolēģija / Editorial Board Dr. philol. Laimute Balode Dr. philol. Pauls Balodis Asoc. prof. emeritus Botolv Helleland Dr. habil. philol. Ilga Jansone Dr. philol. Volker Kohlheim Dr. philol. Anna Stafecka Mg. philol. Ilze Štrausa Dr. philol. Anta Trumpa Dr. philol. Nataliya Vasilyeva Maketētāja Gunita Arnava ISBN 978-9984-742-75-5 © rakstu autori / authors of articles, 2014 © LU Latviešu valodas institūts, 2014 Saturs / Contents Priekšvārds / Foreword..................................................... 5 Приветствие участникам конференции от доктора филологических наук, профессора Александры Васильевны Суперанской ............................... 8 Philip W Matthews (Lower Hutt). Māori and English in New Zealand toponyms ............................................. 9 Harald Bichlmeier (Halle/Jena/Mainz). Welche Erkenntnisse lassen -

Elettorato Attivo 16 17
ELETTORATO ATTIVO Cognome Nome Corso di studi ADAMO ELISA LINGUE E CULTURE DELL'EURASIA E DEL MEDITERRANEO ABAKAH RITA Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABATE MARCO CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ABBAD SOUMIA ECONOMIA E COMMERCIO ABBATE ISABELLA LINGUE E CIVILTA' ORIENTALI ABBATE LAURA LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI ABBATE ALESSANDRA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ABBIENDI MATTEO GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE ABBONIZIO JACOPO CHIMICA E TECNOLOGIE SOSTENIBILI ABBRUSCATO JACOPO Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABBRUZZESE SOFIA Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABDALLA NELLY LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABDEL RAHMAN IMAN Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABDELHAMID MOHAMED NADIA SCIENZE DEL LINGUAGGIO ABDELKERIM SARA LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABEBE SEYUM ASSEFA INFORMATICA - COMPUTER SCIENCE ABICCA STELLA LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABINANTI SUSHMA LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABOAF FEDERICO ITALIANISTICA ABOU EL SEOUD HENI LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABRAM FRANCA MARIA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ABRAM JACOPO ECONOMIA AZIENDALE ACAMPORA LUIGI Informatica ACAMPORA NAOMI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ACCARDI GRETA Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ACCARDI VIRGINIA Lingue, civiltà -

Capriasca, Un Comune Equosolidale Capriasca È Stato Il Primo Comune in Ticino Ad Ottenere Il Riconoscimento Città Equosolidale “Fair Trade Town”
Capriasca citta equosolidale - marzo 2020 Capriasca, un comune equosolidale Capriasca è stato il primo comune in Ticino ad ottenere il riconoscimento città equosolidale “Fair trade town” Attualmente in Svizzera ci sono dieci comuni o città equosolidali (fair trade town), di cui già due in Ticino: Bellinzona e Capriasca. La prima ad ottenere questo riconoscimento a livello svizzero è stata Glarona Nord nel febbraio 2017, mentre Capriasca l’ha ricevuto il 16 giugno 2018, seguita da Bellinzona lo scorso 25 maggio. Nel frattempo, altri 12 comuni svizzeri hanno inoltrato la richiesta per divenire città equosolidale e sono già elencati sul sito internet www.fairtradetown.ch. Oltre che in Svizzera, l’associazione Fair trade town è attiva con successo in più di 30 paesi di tutto il mondo, dove si contano oltre duemila città equosolidali. Capriasca, un processo già in atto nel 2000 Ma cosa significa essere città equosolidale? L’adesione di Capriasca è il frutto di un'iniziativa partita dal basso, con una mozione interpartitica e idee di privati, tra cui una serie di attività già organizzate in precedenza sul territorio. Un primo approccio in questa direzione lo si ritrova anche nel Regolamento del Comune di Capriasca, nato nel 2000 con l’unione di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala Capriasca, Tesserete e Vaglio, ai quali s’aggregarono nel 2008 anche Bidogno, Corticiasca e Lugaggia. Nel documento venne infatti introdotto un preambolo con una relazione alla sostenibilità: “Il Comune di Capriasca promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future […], attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l’equità sociale, la protezione ambientale e l’efficienza economica. -

ARCHIVIO DEI NOMI DI LUOGO ANL Cagiallo - Libro - Def. ANL Layout 07.10.13 06:54 Pagina 2
_ANL_Cagiallo - Libro - def._ANL Layout 07.10.13 06:54 Pagina 1 ARCHIVIO DEI NOMI DI LUOGO _ANL_Cagiallo - Libro - def._ANL Layout 07.10.13 06:54 Pagina 2 Repertorio toponomastico ticinese Archivio di Stato Viale Stefano Franscini 30a CH-6501 Bellinzona Telefono +41 91 814 14 90 Telefax +41 91 814 14 99 Internet [email protected] - www.ti.ch/archivio-rtt Archivio dei nomi di luogo 32. CAGIALLO © 2013 Archivio di Stato del Cantone Ticino Tutti i diritti riservati. ISBN 978-88-96200-19-3 Printed in Switzerland Progetto grafico: Chris Carpi Stampa: Tipo-offset Jam SA _ANL_Cagiallo - Libro - def._ANL Layout 07.10.13 06:54 Pagina 3 CAGIALLO A CURA DI MARCO IMPERADORE IN COLLABORAZIONE CON ALDO MOROSOLI E PIERCARLO BESOMI ARCHIVIO DEI NOMI DI LUOGO REDAZIONE CLAUDIO BOZZINI, MARCO IMPERADORE, TARCISIO PELLANDA CARTOGRAFIA CLAUDIO BOZZINI 32 ARCHIVIO DI STATO DEL CANTONE TICINO, BELLINZONA JAM EDIZIONI, PROSITO _ANL_Cagiallo - Libro - def._ANL Layout 07.10.13 06:54 Pagina 4 La foto scattata all’inizio del Novecento, ci riporta indietro nel tempo quando la strada che scende nella piazza del paese chiamata Pasquè era ancora in terra battuta. Sul lato sinistro l’oratorio di santa Lucia. Più oltre la stalla di Martina Ferrari e quella di Antonio Cattaneo; in quest’ultima era presente anche la sua bottega di falegname. _ANL_Cagiallo - Libro - def._ANL Layout 07.10.13 06:54 Pagina 5 SALUTO DEL MUNICIPIO DI CAPRIASCA Per la terza volta, dopo Sala Capriasca e Roveredo, il Comune di Capriasca ha il grande privilegio di figurare tra i volumi pubblicati dall’«Archivio dei nomi di luogo». -

Classicacc512010.Pdf
Classica et Christiana Revista Centrului de Studii Clasice şi Creştine Fondator: Nelu ZUGRAVU 5/1, 2010 Classica et Christiana Periodico del Centro di Studi Classici e Cristiani Fondatore: Nelu ZUGRAVU 5/1, 2010 ISSN: 1842 - 3043 Comitetul ştiinţific / Comitato scientifico Ovidiu ALBERT (Würzburg) Marija BUZOV (Zagreb) Dan DANA (Rouen) Mario GIRARDI (Bari) Attila JAKAB (Budapest) Domenico LASSANDRO (Bari) Aldo LUISI, direttore del Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell’Università degli Studi di Bari Giorgio OTRANTO (Bari) Evalda PACI (Scutari) Marcin PAWLAK (Torun) Vladimir P. PETROVIĆ (Beograd) Luigi PIACENTE (Bari) Mihai POPESCU (Paris) Comitetul de redacţie / Comitato di redazione Mihaela PARASCHIV (Iaşi) Claudia TĂRNĂUCEANU (Iaşi) Nelu ZUGRAVU, direttore del Centro di Studi Classici e Cristiani della Facoltà di Storia dell’Università „Alexandru I. Cuza” di Iaşi (director responsabil / direttore responsabile) Corespondenţa / Corrispondenza: Prof. univ.dr. Nelu ZUGRAVU Facultatea de Istorie, Centrul de Studii Clasice şi Creştine Bd. Carol I, nr 11, 700506 – Iaşi, România Tel. ++40 232 201634 / ++ 40 742119015, Fax ++ 40 232 201156 e-mail: [email protected] UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ISTORIE CENTRUL DE STUDII CLASICE ŞI CREŞTINE Classica et Christiana 5/1 2010 Tehnoredactor: Nelu ZUGRAVU Coperta: Manuela OBOROCEANU ISSN: 1842 - 3043 Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 700511 - Iaşi, str. Păcurari nr. 9, tel./fax ++ 40 0232 314947 SUMAR / INDICE ABREVIERI – ABBREVIAZIONI / 7 Anton ADĂMUŢ, Note asupra pragmatismului ambrozian / 11 Neil ADKIN, More additions to Maltby’s Lexicon of Ancient Latin Etymologies and Marangoni’s Supplementum Etymologicum: The scholia to Lucan / 31 Nicola BIFFI, La rinuncia di Plauto al miles / 77 Antonella BRUZZONE, Sull’ethos militare di Aezio: congettura a Merob. -

Descrizione Degli Stemmi Dei Comuni Della Capriasca E Della Val Colla
Descrizione degli stemmi dei comuni che formano Capriasca Dall'Armoriale dei Comuni ticinesi, di Gastone Cambin. Lugano, 1953. Bidogno Di rosso, alla pianticella d'avena d'oro nascente, sormontata da un capro di nero passante. La capra sta a ricordare l'allevamento, l'avena richiama le coltivazioni. Cagiallo Di rosso, all'agnello d'argento; in capo la croce trifogliata di san Maurizio. L'agnello, in dialetto "barín", è il nomignolo degli abitanti; san Maurizio è il patrono della chiesa. Campestro Di verde, al gatto passante d'argento posto in banda, accompagnato da due rose del medesimo. Gli abitanti del paese venivano chiamati "gatt". Corticiasca Trinciato: il 1° d'argento, al mezzo capro di nero; il 2° di verde a tre pecore d'argento poste in banda. Allude agli allevamenti a cui era dedita gran parte della popolazione. Lopagno Traversato di 10 pezzi d'oro e di verde, caricato da una divisa ondata e abbassata d'argento, sormontata sul tutto da un capro reciso e bardato di nero.La capra di Capriasca è accompagnata dall'onda che simboleggia il fiume Cassarate. Lugaggia D'azzurro, al monte di verde, infiammato di rosso bordato d'oro. È un simbolo che allude al presunto saccheggio e all'incendio del 15 marzo 1500. Roveredo D'oro, al capro passante di nero, sostenuto da tre monti di verde; in capo un ramo di quercia fruttificato di tre pezzi dello stesso. "Becch", caprone, è il soprannome degli abitanti; rovere, da qui forse il nome del paese, è sinonimo di quercia. Sala D'azzurro all'albero di verde, sostenuto da due capre controrampanti d'argento, nodrito su una campagna di verde. -

Und Werkindex Zu Den Werken Von Stefan Zweig
Autoren-, Künstler- und Werkindex zu den Werken von Stefan Zweig erstellt von Frank Geuenich 8., ergänzte Version Aachen, 2020 Der Index enthält, soweit eruierbar, Autoren/Verfasser und Künstler sowie literarische, wissenschaftliche und sonstige (Kunst)werke, die in den Werken von Stefan Zweig (SZ) Erwähnung finden. Die Werke finden sich, soweit zuordenbar, unter den Einträgen ihrer jeweiligen Verfasser/Urheber und werden – je nach SZs Praxis – mit ihrem ursprünglichen oder einem übersetzten Titel aufgeführt. Werke, die keinem Verfasser zuzuordnen sind, sind in die allgemeine alphabetische Reihenfolge eingeordnet (z.B. Bibel oder Tausendundeine Nacht ). Werke/Titel von Zweig selbst sind aufgenommen, sofern er sich an anderer Stelle auf sie bezieht. Die Verweise beziehen sich auf die im S. Fischer Verlag von Knut Beck herausgegebene Ausgabe „Gesammelte Werke in Einzelbänden“: Der Amokläufer (4. Auflage 2002) Auf Reisen (2. Auflage 2004) Balzac (1990) Begegnungen mit Büchern (2. Auflage 2006) Ben Jonson`s „Volpone“ und andere Nachdichtungen und Übertragungen für das Theater (1987) Brasilien (1990) Brennendes Geheimnis (3. Auflage 2002) Buchmendel (1990) Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen die Gewalt (3. Auflage 2007) Clarissa (4. Auflage 1991) Drei Dichter ihres Lebens (3. Auflage 2004) Drei Meister (2. Auflage 1982) Emile Verhaeren (1984) Das Geheimnis des künstlerischen Schaffens (2. Auflage 2007) Die Heilung durch den Geist (4. Auflage 2007) Joseph Fouché (6. Auflage 2002) Der Kampf mit dem Dämon (3. Auflage 2004) Das Lamm des Armen (1984) Magellan (4. Auflage 1997) Maria Stuart (6. Auflage 2004) Marie Antoinette (5. Auflage 2007) Phantastische Nacht (5. Auflage 2002) Rahel rechtet mit Gott (2. Auflage 2002) Rausch der Verwandlung (6. -

Nicholas Murray BUTLER Arranged Correspondence Box Contents Box
Nicholas Murray BUTLER Arranged Correspondence Box contents Box# Box contents 1 Catalogued correspondence 2 A-AB 3 AC - ADAMS, J. 4 ADAMS, K.-AG 5 AH-AI 6 AJ-ALD 7 ALE-ALLEN, E. 8 ALLEN, F.-ALLEN, W. 9 ALLEN, Y. - AMERICAN AC. 10 AMERICAN AR. - AMERICAN K. 11 AMERICAN L.-AMZ 12 ANA-ANG 13 ANH-APZ 14 AR-ARZ 15 AS-AT 16 AU-AZ 17 B-BAC 18 BAD-BAKER, G. 19 BAKER, H. - BALDWIN 20 BALE-BANG 21 BANH-BARD 22 BARD-BARNES, J. 23 BARNES, N.-BARO 24 BARR-BARS 25 BART-BAT 26 BAU-BEAM 27 BEAN-BED 28 BEE-BELL, D. 29 BELL,E.-BENED 30 BENEF-BENZ 31 BER-BERN 32 BERN-BETT 33 BETTS-BIK 34 BIL-BIR 35 BIS-BLACK, J. 36 BLACK, K.-BLAN 37 BLANK-BLOOD 38 BLOOM-BLOS 39 BLOU-BOD 40 BOE-BOL 41 BON-BOOK 42 BOOK-BOOT 43 BOR-BOT 44 BOU-BOWEN 45 BOWER-BOYD 46 BOYER-BRAL 47 BRAM-BREG 48 BREH-BRIC 49 BRID - BRIT 50 BRIT-BRO 51 BROG-BROOKS 52 BROOKS-BROWN 53 BROWN 54 BROWN-BROWNE 55 BROWNE -BRYA 56 BRYC - BUD 57 BUE-BURD 58 BURE-BURL 59 BURL-BURR 60 BURS-BUTC 61 BUTLER, A. - S. 62 BUTLER, W.-BYZ 63 C-CAI 64 CAL-CAMPA 65 CAMP - CANFIELD, JAMES H. (-1904) 66 CANFIELD, JAMES H. (1905-1910) - CANT 67 CAP-CARNA 68 CARNEGIE (1) 69 CARNEGIE (2) ENDOWMENT 70 CARN-CARR 71 CAR-CASTLE 72 CAT-CATH 73 CATL-CE 74 CH-CHAMB 75 CHAMC - CHAP 76 CHAR-CHEP 77 CHER-CHILD, K. -

Descargar Descargar
La violencia religiosa en la Historia Eclesiástica de Teodoreto de Cirro. Violencia contra los paganos. Violencia de unos cristianos contra otros José María BLÁZQUEZ MARTÍNEZ Universidad Complutense de Madrid – Real Academia de la Historia RESUMEN Se estudia la violencia religiosa entre el concilio de Sardica y Teodosio II en la Historia Religiosa de Teodoreto de Cirro. Este trabajo es continuación de otros sobre el mismo tema, en la Historia Ecclesiastica de Sócrates y de Sozomeno. Se estudia la lucha entre arrianos y seguidores del Concilio de Nicea, entre cristianos, contra los judíos y los paganos. Se estudia la intervención, en estas luchas, de los emperadores, desde Constancio hasta Teodosio II. Se examina la convocatoria de diferentes concilios, Sardica, Rimini, Nice, Nicea, Milán, Constantinopla. La importancia de estos concilios en la lucha entre arrianos y ortodoxos. Se menciona la actuación de personajes importantes en la lucha entre arrianos y ortodoxos: Atanasio, Osio, etc. Se intercalan las actas de los concilios y cartas de Atanasio, de los emperadores, de Dámaso, etc., sobre la lucha. Se estudia la violencia en ciudades importantes del Imperio, como Alejandría y Constantinopla contra los ortodoxos, y la violencia de los arrianos contra varios personajes importantes del momento. Ocupa un lugar destacado en esta lucha, el diálogo entre Constancio y el obispo de Roma, Liberio, y su destierro. Se estudia la política anticristiana del emperador Juliano; la política favorable a los orto- doxos de los emperadores Joviano, Valentiniano I y Graciano; la política favorable a los arrianos de Valente, y la política de Teodosio I, que suprimió dentro del Imperio el paga- nismo y el arrianismo, y la destrucción de templos paganos. -
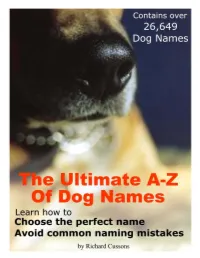
The Ultimate A-Z of Dog Names
Page 1 of 155 The ultimate A-Z of dog names To Barney For his infinite patience and perserverence in training me to be a model dog owner! And for introducing me to the joys of being a dog’s best friend. Please do not copy this book Richard Cussons has spent many many hours compiling this book. He alone is the copyright holder. He would very much appreciate it if you do not make this book available to others who have not paid for it. Thanks for your cooperation and understanding. Copywright 2004 by Richard Cussons. All rights reserved worldwide. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of Richard Cussons. Page 2 of 155 The ultimate A-Z of dog names Contents Contents The ultimate A-Z of dog names 4 How to choose the perfect name for your dog 5 All about dog names 7 The top 10 dog names 13 A-Z of 24,920 names for dogs 14 1,084 names for two dogs 131 99 names for three dogs 136 Even more doggie information 137 And finally… 138 Bonus Report – 2,514 dog names by country 139 Page 3 of 155 The ultimate A-Z of dog names The ultimate A-Z of dog names The ultimate A-Z of dog names Of all the domesticated animals around today, dogs are arguably the greatest of companions to man. -

Springer Series in Statistics
Springer Series in Statistics Advisors: P. Bickel, P. Diggle, S. Fienberg, U. Gather, I. Olkin, S. Zeger Springer Series in Statistics Alho/Spencer: Statistical Demography and Forecasting. Andersen/Borgan/Gill/Keiding: Statistical Models Based on Counting Processes. Atkinson/Riani: Robust Diagnostic Regression Analysis. Atkinson/Riani/Cerioli: Exploring Multivariate Data with the Forward Search. Berger: Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, 2nd edition. Borg/Groenen: Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications, 2nd edition. Brockwell/Davis: Time Series: Theory and Methods, 2nd edition. Bucklew: Introduction to Rare Event Simulation. Cappé/Moulines/Rydén: Inference in Hidden Markov Models. Chan/Tong: Chaos: A Statistical Perspective. Chen/Shao/Ibrahim: Monte Carlo Methods in Bayesian Computation. Coles: An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. David/Edwards: Annotated Readings in the History of Statistics. Devroye/Lugosi: Combinatorial Methods in Density Estimation. Efromovich: Nonparametric Curve Estimation: Methods, Theory, and Applications. Eggermont/LaRiccia: Maximum Penalized Likelihood Estimation, Volume I: Density Estimation. Fahrmeir/Tutz: Multivariate Statistical Modelling Based on Generalized Linear Models, 2nd edition. Fan/Yao: Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods. Farebrother: Fitting Linear Relationships: A History of the Calculus of Observations 1750-1900. Federer: Statistical Design and Analysis for Intercropping Experiments, Volume I: Two Crops. Federer: Statistical Design and Analysis for Intercropping Experiments, Volume II: Three or More Crops. Ferraty/Vieu: Nonparametric Functional Data Analysis: Models, Theory, Applications, and Implementation Ghosh/Ramamoorthi: Bayesian Nonparametrics. Glaz/Naus/Wallenstein: Scan Statistics. Good: Permutation Tests: Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses, 3rd edition. Gouriéroux: ARCH Models and Financial Applications. Gu: Smoothing Spline ANOVA Models. Györfi/Kohler/Krzyz• ak/Walk: A Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression. -

Cinéma Du Nord
A North Wind THE NEW REALISM OF THE FRENCH- WALLOON CINÉMA DU NORD A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF UNIVERSITY OF MINNESOTA BY NIELS NIESSEN IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY ADVISER: CESARE CASARINO NOVEMBER, 2013 © Niels Niessen, 2013 i ACKNOWLEDGMENTS Ideas sometimes come in the middle of the night yet they are never fully one’s own. They are for a very large part the fruits of the places and organizations one works or is supported by, the communities one lives in and traverses, and the people one loves and is loved by. First of all, I would like to acknowledge the support I received from the following institutions: the American Council of Learned Societies, the Huygens Scholarship Program of the Dutch government, the Prins Bernard Cultuurfonds (The Netherlands), and, at the University of Minnesota, the Center for German & European Studies (and its donor Hella Mears), the Graduate School (and the Harold Leonard Memorial Fellowship in Film Study), as well as the Department of Cultural Studies and Comparative Literature. As for my home department, I could not have wished for a warmer and more intellectually vibrant community to pursue my graduate studies, and I express my gratitude to all who I have worked with. A special word of thanks to my academic adviser, Cesare Casarino, who has taught me how to read many of the philosophies that, explicitly or implicitly, have shaped my thinking in the following pages, and who has made me see that cinema too is a form of thought.