Evaluation De L'installation Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Projet Arina
Jean-Pierre Bouillet, Alain Rasamindisa, Hery A. Rakotondraoelina et Serge Razafimahatratra Editeurs scientifiques Financé par l’Union européenne CAPITALISATION DES REALISATIONS ET DES ACQUIS DU PROJET ARINA Aménagement et Reboisements INtégrés dans le district d’Anjozorobe en bois-énergie Jean-Pierre Bouillet, Alain Rasamindisa, Hery A. Rakotondraoelina et Serge Razafimahatratra Editeurs scientifiques CAPITALISATION DES REALISATIONS ET DES ACQUIS DU PROJET ARINA Aménagement et Reboisements INtégrés dans le district d’Anjozorobe en bois-énergie Projet mis en œuvre par : Jean-Pierre Bouillet, Alain Rasamindisa, Hery A. Rakotondraoelina et Serge Razafimahatratra Editeurs scientifiques Financé par l’Union européenne CAPITALISATION DES REALISATIONS ET DES ACQUIS DU PROJET ARINA Aménagement et Reboisements INtégrés dans le district d’Anjozorobe en bois-énergie Ouvrage de synthèse édité à partir des résultats des travaux de recherche - action menés de 2015 à 2019 dans 3 districts et 8 communes de la région Analamanga à Madagascar. Avec la participation du Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), du Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural (FOFIFA), de l’Association PArticipation à la Gestion de l’Environnement (PARTAGE), des partenaires associés des Administrations malgaches chargées des Forêts (DGEF, DREED, CEDD), de l’Energie (MEEH) et des prestataires de service (Association LLD - Fampandrosoana Ifotony, ONG HARDI, Association Angovo Maharitra et Association YPA). Cette initiative rentre dans le cadre du contrat de subvention Union Européenne - CIRAD N° 2015/358-609 du 20 Avril 2019. Elle est issue de la réponse faite le 25/08/2014 par le CIRAD et ses partenaires FOFIFA et PARTAGE à l’appel à proposition EuropeAid/135-812/DD/ACT/MG sur le 10ème Fonds Européen de Développement. -

TDR Annexe7 Rapport Analyse 322 Communes OATF
ETAT DES LIEUX DES 319 COMMUNES POUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET CASEF Février 2019 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................ iii Liste des tableaux ......................................................................................................................... v Listes des Cartes ........................................................................................................................... v Liste des figures ............................................................................................................................vi Liste des photos ...........................................................................................................................vi I INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 II METHODOLOGIES .................................................................................................................... 2 II.1 CHOIX DES 322 COMMUNES OBJETS D’ENQUETE ............................................................... 2 II.2 CHOIX DES CRITERES DE SELECTION DES COMMUNES ........................................................ 5 II.3 METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES ET ACTIVITES ................................................. 6 -

Rep 2 out Public 2010 S Tlet Sur of Ma Urvey Rvey Adagas Repor Scar Rt
Evidence for Malaria Medicines Policy Outlet Survey Republic of Madagascar 2010 Survey Report MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE www. ACTwatch.info Copyright © 2010 Population Services International (PSI). All rights reserved. Acknowledgements ACTwatch is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This study was implemented by Population Services International (PSI). ACTwatch’s Advisory Committee: Mr. Suprotik Basu Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Rik Bosman Supply Chain Expert, Former Senior Vice President, Unilever Ms. Renia Coghlan Global Access Associate Director, Medicines for Malaria Venture (MMV) Dr. Thom Eisele Assistant Professor, Tulane University Mr. Louis Da Gama Malaria Advocacy & Communications Director, Global Health Advocates Dr. Paul Lavani Executive Director, RaPID Pharmacovigilance Program Dr. Ramanan Senior Fellow, Resources for the Future Dr. Matthew Lynch Project Director, VOICES, Johns Hopkins University Centre for Dr. Bernard Nahlen Deputy Coordinator, President's Malaria Initiative (PMI) Dr. Jayesh M. Pandit Head, Pharmacovigilance Department, Pharmacy and Poisons Board‐Kenya Dr. Melanie Renshaw Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Oliver Sabot Vice‐President, Vaccines Clinton Foundation Ms. Rima Shretta Senior Program Associate, Strengthening Pharmaceutical Systems Dr. Rick Steketee Science Director, Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa Dr. Warren Stevens Health Economist Dr. Gladys Tetteh CDC Resident Advisor, President’s Malaria -

Liste Des Communes Beneficiaires Au Financement Papsp-Fdl
LISTE DES COMMUNES BENEFICIAIRES AU FINANCEMENT PAPSP-FDL DATE Ordre de CATEG APPORT MONTANT TYPE RÉGION DISTRICT COMMUNE SOUS-PROJET MONTANT FDL MODE D'EXECUTION TYPE DE TRAVAUX SECTEUR Virement FDL vers ORIE COMMUNE TOTAL INFRASTRUCTURE TRESORS ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA CR 2 FANORENANA BIRAOM-POKOTANY AO AMBANIALA 15 000 000 480 15 000 480 TACHERON CONSTRUCTION GOUVERNANCE BUREAU FOKONTANY 26/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA CEG AO AMBATOHARANANA 9 249 000 9 249 000 TACHERON REHABILITATION EDUCATION CEG 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA LALANA 5 KM MAMPITOHY 5 751 000 5 751 000 HIMO/TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PISTE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMPARAFARAVOLA AMBATOMAINTY CR 2 FANITARANA SY FANARENANA BIRAON'NY KAOMININA 15 000 000 7 049 500 22 049 500 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE BUREAU COMMUNE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA CU FANARENANA TRANO FIVORIAN'NY KAOMININA 15 000 000 15 000 000 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE SALLE DE REUNION 28/03/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE CR 1 FANARENANA TETEZANA TELO 15 000 000 2 TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PONT 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA CR 2 FANORENANA LYCEE AO AMBATOSORATRA 15 000 000 15 730 900 30 730 900 TACHERON CONSTRUCTION EDUCATION LYCEE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO MORAMANGA AMBATOVOLA CR 2 FANARENANA CSB II AO AMBATOVOLA 15 000 000 13 018 15 013 018 TACHERON REHABILITATION SANTE CSB II 13/04/2018 -

Répartition De La Caisse-École 2020 Des Collèges D'enseignement
Repartition de la caisse-école 2020 des Collèges d'Enseignement Général DREN ALAOTRA-MANGORO CISCO AMBATONDRAZAKA Prestataire OTIV ALMA Commune Code Etablissement Montant AMBANDRIKA 503010005 CEG AMBANDRIKA 1 598 669 AMBATONDRAZAKA 503020018 C.E.G. ANOSINDRAFILO 1 427 133 AMBATONDRAZAKA 503020016 CEG RAZAKA 3 779 515 AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE 503030002 C.E.G. ANDINGADINGANA 1 142 422 AMBATOSORATRA 503040001 CEG AMBATOSORATRA 1 372 802 AMBOHIBOROMANGA 503070012 CEG ANNEXE AMBOHIBOROMANGA 878 417 AMBOHIBOROMANGA 503150018 CEG ANNEXE MARIANINA 775 871 AMBOHIBOROMANGA 503150016 CEGFERAMANGA SUD 710 931 AMBOHIDAVA 503040017 CEG AMBOHIDAVA 1 203 171 AMBOHITSILAOZANA 503050001 CEG AMBOHITSILAOZANA 1 671 044 AMBOHITSILAOZANA CEG TANAMBAO JIAPASIKA 622 687 AMPARIHINTSOKATRA 503060013 CEG AMPARIHINTSOKATRA 1 080 499 AMPITATSIMO 503070001 CEG AMPITATSIMO 1 530 936 AMPITATSIMO 503070015 CEG ANNEXE AMBOHITANIBE 860 667 ANDILANATOBY 503080025 CEG ANDRANOKOBAKA 760 039 ANDILANATOBY 503080001 CEG ANDILANATOBY 1 196 620 ANDILANATOBY 503080026 CEG ANNEXE SAHANIDINGANA 709 718 ANDILANATOBY 503080027 CEG COMMUNAUTAIRE AMBODINONOKA 817 973 ANDILANATOBY 503080031 CEG COMMUNAUTAIRE MANGATANY 723 676 ANDILANATOBY 503080036 CEG COMMUNAUTAIRE RANOFOTSY 668 769 ANDROMBA 503090005 CEG ANDROMBA 1 008 043 ANTANANDAVA 503100020 CEG ANTANANDAVA 1 056 579 ANTSANGASANGA 503110004 CEG ANTSANGASANGA 757 763 BEJOFO 503120016 C.E.G. -

Dynamique Des Reboisements En Eucalyptus Autour D'antananarivo
Dynamique des reboisements en Eucalyptus autour d’Antananarivo Présentation à l’atelier sur l’Eucalyptus Université d’Antananarivo 18-19 Juin 2013 Jeannet Rakotomalala 1 INTRODUCTION Notre « sauveur » en matière de bois énergie et bois de construction . Alternative à la fermeture de l’accès aux forêts naturelles et à la croissance exponentielle de la demande en bois énergie // avec la croissance démographique bois = principale source d’énergie domestique Région des Hautes - Terres: couverture forestière la plus faible Approvisionnement en bois des populations assuré par les plantations d’eucalyptus. Pourquoi une dynamique s’effectue –elle encore en matière de reboisements en eucalyptus autour DCP au Québec/Mercier/02-09 2 d’Antananarivo ? CADRE DE L’ETUDE Qu’est-ce qui poussent les Quels sont leurs moyens gens à encore planter ? mis en œuvre pour atteindre leurs objectifs ? Pourquoi une dynamique s’effectue –elle encore en matière de reboisement en Eucalyptus autour d’Antananarivo ? Où sont les zones où Quels sont les contraintes ? s’effectuent cette dynamique? DCP au Québec/Mercier/02-09 3 3 Choix de la zone d’étude Durée et zone d’étude: • Mois d’avril et Mai 2013 • Bassin d’approvisionnement en bois énergie aux alentours d’Antananarivo: Districts d’Anjozorobe et de Manjakandriana (hautes terres centrales). Climat: Tropical d’altitude Pluviométrie: 1 200 à 1 800 mm/an avec quatre à six mois secs Température moyenne est de 19°C. Situation topographique: Hautes terres à une altitude d’environ 1400 m. Le type de sol: Sols ferralitiques. -
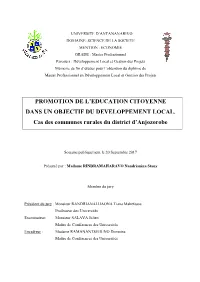
Promotion De L'education Citoyenne Dans Un Objectif
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO DOMAINE: SCIENCE DE LA SOCIETE MENTION : ECONOMIE GRADE : Master Professionnel Parcours : Développement Local et Gestion des Projets Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme de Master Professionnel en Développement Local et Gestion des Projets PROMOTION DE L’EDUCATION CITOYENNE DANS UN OBJECTIF DU DEVELOPPEMENT LOCAL. Cas des communes rurales du district d’Anjozorobe Soutenu publiquement le 20 Septembre 2017 Présenté par : Madame RINDRAMAHARAVO Nandrianina Stany Membre du jury Président du jury : Monsieur RANDRIANALIJAONA Tiana Mahefasoa Professeur des Universités Examinateur: Monsieur SALAVA Julien Maître de Conférences des Universités Encadreur : Madame RAMANANTSEHENO Domoina Maître de Conférences des Universités REMERCIEMENTS Grâce à Dieu, ce grand mémoire a pu aboutir à son terme. Tout d’abord, je tiens vivement à adresser mes plus profondes reconnaissances et mes vifs remerciements à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué à la concrétisation de ce mémoire, et ce, particulièrement à : L’Université d’Antananarivo ; Monsieur RAKOTO David Olivaniaina, Maître de Conférences des Universités, Doyen de la Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie ; Monsieur RAMAROMANANA ANDRIAMAHEFAZAFY Fanomezantsoa, Maître de Conférences des Universités, Chef de Département Economie ; Madame RAMANANTSEHENO Domoina, Maître de Conférences des Universités, mon encadreur pédagogique, toute ma profonde gratitude ; Tous les corps Enseignants et Administratifs du Département Economie ; A toute l’équipe de l’ONG Lalana pour l’accueil et les directives. Mes sincères remerciements ; A tous les adhérents, personnes enquêtées et paysans autochtones des communes rurales d’Anjozorobe sans quoi l’étude n’aurait eu lieu. Mes respects ; Enfin, je tiens à présenter toutes mes gratitudes à ma très chère famille et mes amis pour leurs soutiens et leurs encouragements tout au long de mes études. -

Table Des Matieres La Region…………………………………………………….…………………..……………….1 1 Milieu Physique
TABLE DES MATIERES LA REGION…………………………………………………….…………………..……………….1 1 MILIEU PHYSIQUE ........................................................................................................................13 1.1 RELIEF .......................................................................................................................................13 1.2 GEOLOGIE .................................................................................................................................13 1.3 CLIMAT ......................................................................................................................................14 1.3.1 Le réseau de stations météorologiques ................................................................................15 1.3.2 Température ........................................................................................................................16 1.3.3 Pluviométrie ........................................................................................................................17 1.3.4 Diagrammes ombrothermiques ...........................................................................................18 1.3.5 Cyclones ..............................................................................................................................19 1.4 HYDROLOGIE ...........................................................................................................................19 1.5 SOLS ET VEGETATIONS .........................................................................................................20 -

4-Anjozorobe
THE DODWELL TRUST MITONDRASOA Lot IBF 17 AMBATOMENA –101 ANTANANARIVO 22 301 08 – E-mail :[email protected] The Dodwell Trust emergency phone numbers : UK 24-hour emergency line: 020 8740 6302 Office in Tana: from UK: 00261 20 22 301 08 - In Mada: 020 22 301 08 - In Tana: 22 301 08 Eléo in Tana in evenings and weekends : from UK: 00261 20 24 244 35 or home: 00261 20 22 005 21 or mobile: 00261 32 02 964 50 In Mada: 020 24 244 35 or home: 020 22 005 21 or mobile: 032 02 964 50 In Tana: 24 244 35 or home: 22 005 21 or mobile: 032 02 964 50 4-ANJOZOROBE ANJOZOROBE, 2 hours north-east of Tana, a small town perched along the ridges of 2 hills. From the volunteer house, there’s a great view across a wide plain and curving river. The house is inside a small walled courtyard along with the house of host and his wife. He is a teacher of Malagasy history and folklore, and his daughter speaks good English. The area is rich in history and myths. The population of Anjozorobe is about 60 000 adults Their economy is based on agriculture, growing rice, onions, tobacco, and keeping small herds of cattle. Six kilometres from the town is a rain-forest area called “Alan’ Anjozorobe”. At 66 500 hectares, it is among the last major remnants of natural primary forest in the Malagasy highlands, and it contains various endemic fauna and flora species. “THE DOWELL TRUST” s host Agents : 1 : Mr Nasolo (Mr RANDRIANASOLO) Philosophy Teacher at FJKM School ( protestant) and history and geography teacher at Lycée d’Anjozorobe (public). -

Résultats Détaillés Antananarivo
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 1 ANTANANARIVO BV reçus: 313 sur 313 GASIKA MARINA HVM MAPAR MMM NY AREMA ASSOCI TIM RA MANGA ATION MAINTS RANO MALAG N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E O MALAZA ASY SAMBA REGION 11 ANALAMANGA BV reçus 140 sur 140 DISTRICT: 1101 AMBOHIDRATRIMO BV reçus24 sur 24 01 AMBATO 0 0 8 7 0 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 02 AMBATOLAMPY 0 0 8 8 0 8 0 1 4 1 0 0 0 0 2 03 AMBOHIDRATRIMO 0 0 10 10 0 10 0 1 8 0 0 0 0 0 1 04 AMBOHIMANJAKA 0 0 6 6 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 05 AMBOHIMPIHAONANA 0 0 6 6 0 6 0 0 3 0 0 0 0 1 2 06 AMBOHITRIMANJAKA 0 0 8 8 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 2 07 AMPANGABE 0 0 8 7 0 7 0 1 6 0 0 0 0 0 0 08 AMPANOTOKANA 0 0 8 8 0 8 0 4 2 0 1 0 0 0 1 09 ANJANADORIA 0 0 6 6 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 1 10 ANOSIALA 0 0 8 8 0 8 0 2 2 1 0 0 0 0 3 11 ANTANETIBE MAHAZA 0 0 8 8 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 2 12 ANTEHIROKA 0 0 8 6 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 1 13 ANTSAHAFILO 0 0 6 6 0 6 0 3 2 0 0 0 0 0 1 14 AVARATSENA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 FIADANANA 0 0 6 6 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 16 IARINARIVO 0 0 6 6 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 1 17 IVATO 0 0 8 8 0 8 0 1 4 2 0 0 0 0 1 18 MAHABO 0 0 6 6 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 2 19 MAHEREZA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 MAHITSY 0 0 8 8 0 8 0 4 3 0 0 0 0 0 1 21 MANANJARA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 22 MANJAKAVARADRAN 0 0 6 6 0 6 0 1 2 1 0 0 0 1 1 23 MERIMANDROSO 0 0 8 8 0 8 0 2 5 0 1 0 0 0 0 24 TALATAMATY 0 0 8 8 0 8 0 0 3 2 0 0 0 0 3 TOTAL DISTRICT 0 0 172 165 0 165 0 28 98 7 2 0 0 2 28 DISTRICT: 1102 ANDRAMASINA BV reçus14 sur 14 01 ALAROBIA VATOSOLA 0 0 8 8 0 8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 02 ALATSINAINY -

Couverture Santé Universelle
RTS REVUE TRIMESTRIELLE DE LA SANTE Ministère de la Santé Publique N° 28 du Couverture Santé Universelle NOUVEAU CHANTIER DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE CENTRE CARMMA D’ANDRIAMPAMAKY CHUGOB Fruit du Partenariat Public Privé (p. 04) Visite mémorable de l’épouse du SG des Nations Unies et de la Première Dame de Madagascar (p. 03) AUCUN CAS DE ZIKA A MADAGASCAR 02 COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (CSU) : LE NOUVEAU CHANTIER DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE La mission principale du Ministère de la Santé Publique consiste à l’amélioration de la santé de la population Mala- gasy. L’une des significations de cette amélioration vise à rendre accessibles les soins de qualité pour la population. Des progrès ont été effectués ces dernières années pour atteindre cet objectif. Néanmoins, pour aller de l’avant et toujours dans ce souci de rendre les soins de faciliter l’accès aux soins de qualité à la population, l’Etat Malagasy a lancé la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle au mois de décembre 2015. C’EST QUOI LA CSU ? La couverture santé universelle est définie comme la situation dans laquelle toutes les populations peuvent obtenir les services de santé de qualité dont elles ont besoin sans que le coût de ces services n’entraîne des difficultés financières pour les usagers. HISTORIQUE Depuis 2000, on assiste à un élan mondial en faveur de la réduction de la pauvreté à travers les Objectifs du Millénaire pour le Développement, lequel est réaffirmé dans les Objectifs de Développement Durable pour la période post 2015 jusqu’en 2030. -

La Dimension Geographique De La Pauvrete Au Sein De La Commune Rurale De Sadabe,District De Manjakandriana
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO DOMAINE ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES MENTION GEOGRAPHIE PARCOURS SOCIETE ET AMENAGEMENT LA DIMENSION GEOGRAPHIQUE DE LA PAUVRETE AU SEIN DE LA COMMUNE RURALE DE SADABE,DISTRICT DE MANJAKANDRIANA Mémoire pour l’obtention du diplôme de Master II Présenté par: RABENATOANDRO Eulie Miora Sous la direction de M. Tolojanahary ANDRIAMITANTSOA, Maître de conférences. Date de soutenance : 16 Décembre 2016 1 2 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO DOMAINE ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES MENTION GEOGRAPHIE PARCOURS 2 : SOCIETE ET AMENAGEMENT Grade : MASTER 2 -----ooOoo----- La dimension géographique de la pauvreté au sein de la Commune Rurale de Sadabe District de Manjakandriana Mémoire pour l’obtention du diplôme de Master II Elaboré par : RABENATOANDRO Eulie Miora Sous la direction de M. ANDRIAMITANTSOA Tolojanahary Maître de conférences Membres du jury : Président : Mr. James RAVALISON, Professeur Rapporteur : Mr. Tolojanahary ANDRIAMITANTSOA, Maître de conférences Juge : Mr. Pascal RAZANAKOTO, Maître de conférences Décembre 2016 Date de soutenance : 16 Décembre 2016 Année Universitaire : 2015-2016 3 REMERCIEMENTS L`élaboration du présent document n`aurait pas été réalisée sans la bienveillance de notre Seigneur et l`appui appréciable de diverses personnes, que nous tenons à remercier vivement. Ces quelques lignes leurs sont dédiées, en expression de ma reconnaissance ; Tout d`abord, à Dieu Tout Puissant, pour la santé, la force, la sagesse, le savoir et la précieuse bénédiction qu`il a eu la bonté de m’accorder afin de