L'exemple De La Langue Des Signes De Bouakako (Lasibo)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Sketch of Dialectal Variation in Mano Maria Khachaturyan University Of
Mandenkan, No. 59, 2018, pp. 31-56 A sketch of dialectal variation in Mano Maria Khachaturyan University of Helsinki [email protected] This paper1 gives a preliminary account of the dialectal situation of Mano, a South Mande language. My main descriptive focus is Guinean Mano, I have been doing fieldwork on the language since 2009 and I have spent more than 14 months in the field, mainly in the city of Nzerekore and in neighboring villages. A description of the Guinean variety can be found in Khachaturyan (2015). The information on Liberian dialects was obtained in January 2018 during a short trip to three Liberian villages, Gbanquoi, Kpein and Flumpa, as well as from written sources: two language manuals: (deZeeuw & Kruah 1981; Neal et al. 1946), a Bible translation (UBS 1978) and some literacy materials (Zarwolo 2009). The paper is organized as follows. Section 1 gives a sketch of the sociolinguistic situation. Section 2 provides some preliminary observations of the interdialectal differences in phonology. Section 3 gives some details on morphosyntactic variation. Section 4 presents differences in lexicon. The results are discussed in Section 5 where I explain, in particular, why some of the dialectal differences could be in fact an issue of contact with different languages: Kpelle, especially in the North of the Mano zone, and Dan in the South. 1 I would like to express my gratitude to the anonymous reviewers for their helpful criticism. As usual, I am thankful to Pe Mamy for his tireless help and support in (our) language research, and also for his wonderful companionship in our travels (we will have to have more Club beers to share in Liberia!). -
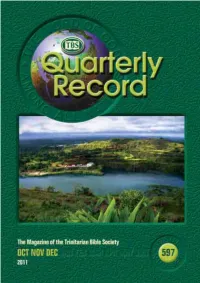
Quarterly Record Provided That Prior Permission Is Obtained and Proper Acknowledgement Is Made
Trinitarian Bible Society Founded in 1831 for the circulation of Protestant or uncorrupted versions of the Word of God Officers of the Society General Committee: General Secretary/Chief Executive: Mr. D. P. Rowland Chairman: The Rev. M. H. Watts Operations Director: Mr. D. Larlham Vice-Chairman: Mr. G. D. Buss, B.Ed. Resources Director: Mr. D. J. Broome, C.P.F.A. Vice-Presidents: The Rev. B. G. Felce, M.A. Editorial Director: Mr. P. J. D. Hopkins, M.A. Oxf. The Rev. G. Hamstra, B.A., M.Div. Mr. D. Oldham Sales, Development and Grants Manager: Mr. A. P. Clarke Treasurer: Pastor R. A. Clarke, B.Sc., F.C.A. Senior Editorial Consultant: Mr. G. R. Burrows, M.A. Mr. L. Brigden, B.Sc.(Hons.), M.Sc., B.A.(Hons.) The Rev. R. G. Ferguson, B.A. Editorial Consultants: Pastor M. J. Harley Mr. G. W. Anderson, B.A. Mr. A. K. Jones, LLB. (Hons.) Solicitor Mr. A. Hembd, M.A.C.S. The Rev. E. T. Kirkland, B.A., Dipl.Th. J. Cammenga, B.A., M.A., Ph.D. The Rev. D. Silversides G. Fox, B.A. (Hons.), D.D., Ph.D. The Rev. J. P. Thackway The Rev. W. M. Patterson Jnr., B.A., D.D. Issue Number: 595 – April to June 2011 © Trinitarian Bible Society 2011 Issue Number: 597 All rights reserved. The Trinitarian Bible Society permits October to December 2011 reprinting of articles found in our printed and online Quarterly Record provided that prior permission is obtained and proper acknowledgement is made. Contents Sabbath School Learning Prize Fund 2 2011 Commemorative Meetings 3 From the Desk of the General Secretary 4 Tom Massey 9 A Wondrous Thanksgiving 10 Editorial Report 12 The Treasury 17 New Telephones 18 The Diamond Jubilee Bible Project 19 Liberia and the Dan Bible 21 The Word of God among all Nations 30 Quarterly Record Production Team Editorial Director: P. -

A Nthropology N Ew Sletter
Special theme: Languages and Linguistics at an Ethnological Museum National Museum of Language is a window into the human mind and reflects human activities, Ethnology while linguistics is an academic field where languages are analyzed from a scientific view-point. As an ethnological museum, Minpaku has a strong focus Osaka on fieldwork, which is necessary for linguists and ethnologists to study languages and learn about human beings and their diversity. Essays in this Number 39 issue present glimpses of the thoughts of linguists at Minpaku who combine linguistic fieldwork and later analysis at their desks. What is unique to December 2014 researchers at Minpaku, however, is that we are also involved with exhibitions for the public and have everyday communication with Anthropology Newsletter anthropologists in other fields. Languages do not exist without humans and humans do not exist without language. We believe that linguistic research is a good starting point on the path to a better understanding of who we are. MINPAKU Yak and Pig, Glacier and Sea Noboru Yoshioka National Museum of Ethnology Why do many Japanese-language dictionaries contain the word yaku [jakɯ] ‘yak’? When I was in the field, this question all of a sudden struck me. To make sure that my facts were correct, I checked the desktop dictionaries that I was carrying — a pocket-size dictionary published in 1979, a student dictionary published in 1996, and one Contents published in 2008 — and confirmed that all of these actually contained Languages and Linguistics the word as I had thought. Living in at an Ethnological Museum Japan, it is hard to see real yaks. -

Iconicity As a Pervasive Force in Language: Evidence from Ghanaian Sign
Iconicity as a pervasive force in language: Evidence from Ghanaian Sign Language and Adamorobe Sign Language By Mary Edward A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of Brighton for the degree of Doctor of Philosophy School of Humanities University of Brighton 2021 Abstract In this dissertation, I investigate various manifestations of iconicity and how these are demonstrated in the visual-spatial modality, focusing specifically on Ghanaian Sign Language (GSL) and Adamorobe Sign Language (AdaSL). The dissertation conducts three main empirical analyses comparing GSL and AdaSL. The data for the analyses were elicited from deaf participants using lexical elicitation and narrative tasks. The first study considers iconicity in GSL and AdaSL lexical items. This study additionally compares the iconic strategies used by signers to those produced in gestures by hearing non-signers in the surrounding communities. The second study investigates iconicity in the spatial domain, focusing on the iconic use of space to depict location, motion, action. The third study looks specifically at the use of, simultaneous constructions, and compares the use of different types of simultaneous constructions between the two sign languages. Finally, the dissertation offers a theoretical analysis of the data across the studies from a cognitive linguistics perspective on iconicity in language. The study on lexical iconicity compares GSL and AdaSL signers’ use of iconic strategies across five semantic categories: Handheld tools, Clothing & Accessories, Furniture & Household items, Appliances, and Nature. Findings are discussed with respect to patterns of iconicity across semantic categories, and with respect to similarities and differences between signs and gestures. -

Esquisse De Grammaire Du Dan De L'est (Dialecte De Gouèta)
Mandenkan, No. 64, 2021, pp. 3-80 Esquisse de grammaire du dan de l'Est (dialecte de Gouèta) Valentin Vydrin INALCO — LLACAN — St. Petersburg State University [email protected] Table des matières 1. Informations générales ............................................................................................ 5 2. Phonologie ............................................................................................................... 7 2.1. Phonologie segmentale ......................................................................................... 7 2.1.1. Voyelles ............................................................................................................. 7 Orales ........................................................................................................................... 8 Nasales ......................................................................................................................... 8 2.1.2. Consonnes .......................................................................................................... 9 2.2. Tons......................................................................................................................10 2.3. L’organisation rythmique : pieds..........................................................................11 3. Morphologie............................................................................................................13 3.1. Parties du discours................................................................................................13 -

Sources of Variation in Mongolian Sign Language
33 Sources of Variation in Mongolian Sign Language Leah C. Geer University of Texas at Austin 1. Introduction1 During a nine month period in which data on Mongolian Sign Language (MSL) were collected in a Field Methods course, there were numerous instances of disagreement between language consultants on the correct sign for a given concept. The present paper seeks to describe these disagreements in terms of the potential sources of language variation among language consultants. The remainder of this paper is organized as follows: In section 1 we provide a sampling of previous work on language contact and language variation and describe the link between them. We then discuss the linguistic outcomes of contact situations between signed and spoken languages versus signed and signed languages as they relate to the present investigation. In section 2 we describe how data were collected and annotated and in section 3 we present our findings. Section 4 includes a discussion of these findings with respect to previous work on language contact, language variation, and language attitudes. In section 5 we close with brief mention of how to expand upon this work in the future. 1.1 Background: Language contact and language variation Several studies of lexical variation in signed languages have been undertaken: Lucas, Bayley & Valli (1991) for American Sign Language (ASL); Schembri, Johnston & Goswell (2006), Schembri & Johnston (2006, 2007) for Australian Sign Language (Auslan); and McKee & McKee (2011) for New Zealand Sign Language (NZSL), just to 1 Many thanks are in order here. First to our consultants (and in particular NB who has maintained contact with me and always been eager to answer questions), who shared their language with our group. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA, SAN DIEGO Telling, Writing And
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO Telling, Writing and Reading Number Tales in ASL and English Academic Languages: Acquisition and Maintenance of Mathematical Word Problem Solving Skills A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Arts in Teaching and Learning: Bilingual Education (ASL-English) By Alexander Zernovoj Committee in charge: Tom Humphries, Chair Bobbie M. Allen Claire Ramsey 2005 Copyright Alexander Zernovoj, 2005 All rights reserved. The thesis of Alexander Zernovoj is approved: _____________________________________ Chair _____________________________________ _____________________________________ University of California, San Diego 2005 iii DEDICATION It is difficult to imagine how I would have gone this far without the support of my family, friends, professors, teachers and classmates. They have encouraged me to pursue lifelong teaching and learning. They also have inspired me, helped me, supported me, and pushed me to become a best teacher as I can be. This thesis is dedicated to them. iv TABLE OF CONTENTS Signature Page ………………………………………………………… iii Dedication ……………………………………………………………… iv Table of Contents ……………………………………………………… v List of Figures …………………………………………………………... vi List of Tables …………………………………………………………... viii Abstract ………………………………………………………………… xi I. Introduction and Overview ………………………………...…………… 1 II. The Need for Bilingual Approaches to Education ……………............... 5 III. Assessment of Need …………………………………………………… 20 IV. Review of Existing Materials and Curricula …………………………… -

Typology of Signed Languages: Differentiation Through Kinship Terminology Erin Wilkinson
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of New Mexico University of New Mexico UNM Digital Repository Linguistics ETDs Electronic Theses and Dissertations 7-1-2009 Typology of Signed Languages: Differentiation through Kinship Terminology Erin Wilkinson Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/ling_etds Recommended Citation Wilkinson, Erin. "Typology of Signed Languages: Differentiation through Kinship Terminology." (2009). https://digitalrepository.unm.edu/ling_etds/40 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Electronic Theses and Dissertations at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Linguistics ETDs by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. TYPOLOGY OF SIGNED LANGUAGES: DIFFERENTIATION THROUGH KINSHIP TERMINOLOGY BY ERIN LAINE WILKINSON B.A., Language Studies, Wellesley College, 1999 M.A., Linguistics, Gallaudet University, 2001 DISSERTATION Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Linguistics The University of New Mexico Albuquerque, New Mexico August, 2009 ©2009, Erin Laine Wilkinson ALL RIGHTS RESERVED iii DEDICATION To my mother iv ACKNOWLEDGMENTS Many thanks to Barbara Pennacchi for kick starting me on my dissertation by giving me a room at her house, cooking me dinner, and making Italian coffee in Rome during November 2007. Your endless support, patience, and thoughtful discussions are gratefully taken into my heart, and I truly appreciate what you have done for me. I heartily acknowledge Dr. William Croft, my advisor, for continuing to encourage me through the long number of months writing and rewriting these chapters. -

Analysis of Phonological Deviation Made by Torajanese English Students in Pronouncing English Words: a Case Study at English Department
Analysis of Phonological Deviation Made by Torajanese English Students in Pronouncing English Words: A Case Study at English Department A Thesis Submitted to the Faculty of Cultural Sciences, Hasanuddin University in Partial Fulfillment for the Requirements to Obtain Sarjana Degree in English Department RESKIYANI F211 13 330 MAKASSAR 2016 ii iii iv v ACKNOWLEDGMENT All praises and honor are delivered to the Almighty God for his blessings and grace that as this thesis can be finished as expected. The thesis is a requirement to obtain higher degree in English Department, Faculty of Cultural Sciences, Hasanuddin University. The writer realizes that there are a lot of shortcomings in this thesis because of imperfectness of writer’s knowledge and experience. Therefore, every kind of constructive corrections or criticsm from anyone is welcomed in order to accomplish this thesis. In this writing process, the writer got much help, support, and advice from other. Therefore, the writer would to express her deep gratitude and high appreciation to: 1) Dr. Abidin Pammu, M. A., Dipl. TESOL. and Drs. Simon Sitoto, M. A. as the consultant I and the consultant II, who had given their guidance and advices so that this thesis can be finished: 2) The beloved parents Simon Allo and Lince Sarira who had given support and prayers, and all of the writer’s siblings and family who are loved. 3) The best friends who were consistently there for help during this thesis writing as the proof-readers (Syifa, Ilham, Nur, Mutha, Yusliana, Ines, Selvy, and Adnan). 4) The academic supervisor Karmila Mokoginta who has always helped with pleasure and given may suggestion to the writer’s. -

Chapter 2 Sign Language Types
Chapter 2 Sign language types This chapter defines four different sign language types, based on the infor- mation available in the respective sources. Before introducing the types of sign languages, I first report on the diachronic developments in the field of typological sign language research that gave rise to the distinction of the various sign language types. Sign language research started about five decades ago in the United States of America mainly due to the pioneering work of Stokoe (2005 [1960]), Klima and Bellugi (1979), and Poizner, Klima and Bellugi (1987) on American Sign Language (ASL). Gradually linguists in other countries, mainly in Europe, became interested in sign language research and started analyzing European sign languages e.g. British Sign Language (BSL), Swedish Sign Language (SSL), Sign Language of the Netherlands (NGT) and German Sign Language (DGS). Most of the in-depth linguistic descrip- tions have been based on Western sign languages. Therefore, it has long been assumed that some fundamental levels of linguistic structure, such as spatial morphology and syntax, operate identically in all sign languages. Recent studies, however, have discovered some important variations in spatial organization in some previously unknown sign languages (Washabaugh, 1986; Nyst, 2007; Marsaja, 2008; Padden, Meir, Aronoff, & Sandler, 2010). In the context of growing interest in non-Western sign languages towards the end of the 1990s and more recently, there have been efforts towards developing a typology of sign languages (Zeshan, 2004ab, 2008, 2011b; Schuit, Baker, & Pfau, 2011). Although it has been repeatedly emphasized in the literature that the sign language research still has too little data on sign languages other than those of national deaf communities, based in Western or Asian cultures (Zeshan, 2008). -

Death (G4) in Dan Culture
^tUBHAHYQf ,^fltUNIVCKVA. ^lUivVNlitlfX^ o § 1 ir^ ^ 5 ^' o ^/saaMNn-jViV*' ^iOjnvDiO'^ '^iJOjnvDjo'^ ^/583MNnjWV^ ^.OFCAllfO?^ AMEUNIVERS/a ^lOSANCfUr^ ^OFCAUFORfc ^OFCAUFOff^ AWEUNIVER% ^VOSANCEl/j> o '^Diantwcm^ Ti'/wHMwawv '//CUKiiin 1\\V ^^HIBRARYOc. ^t-UBRMYt?/, .5yEDNIVER% v^lOSANCEUrj. ^^lUBRARYOc ^lUBRARYO/r, o § 1 <<—^ ^ CO ^/iJUAINfl IftV^ *<!/0JnV3JO'*^ '^tfOJIWJO'^ \fJCElfj> ^^WEUNIVER% _^10SANCFI% ^OFCALIFOR^^ ^.OFCAIIFOR^ CO -= , • 30 -< Si ''//rin«i«in lHV ,A^ y/5.i uvvion iViN '/Pint ItIA 11 1\* .^tllBRARYO/^ ^\WEUNivn?sy4 ^-losAtiCEiEr^ ^tUBRARYQr ^lUBRARYflr^ .^WEUNIVtRi/A. ^lOSAHCELfj-^ ^ ^ *«i"^ -< -^ -5^ 1 I/-' -^ l3 a^l 1/—' o ^d/OJITVDJO'^ v/i!i3AINftJk\V ^OfCAllFORi^ ,^WE•UNIVERS/A ^lOSAHCElf/^ ^.OFCAUFORto ^OFCAtlFOff^ ^5JIE1)NIVER% ^lOSANCF^r^ ''1 uiuniuv 1 Hv/«qni^ "V/cjijAiMniuv ^lOSANCElfj> ^ILlBRARYQc^ ^5jvUIBRARYQ?. .5!t\EUNIV!RSyA >^lOSANCEier>. fjM-UBRARYQ^ ^^tllBRARYO/ 1 </-^ ^ I iiirrt :5 o KT o -I ,0^ ^<!/0jnV3J0'^ f- ^tfojiivDjo'^ ^^mmy>i^ ^OFCAIIFOSV ^OFCAllFORi^ .\«EUNIVERf/A ^lOSANCElfj, ^OFCAIIFO% ^OFCA1IFO% ''/I '>iOlHW«flln^^ TulAlUfl llW I uvl^al1.^^3^>' >'/^•lJlW)l9^•1^S* ^rjiniw^m"^ ^tUBRARY/v .^WE•UNIVERS{^. ^10SANCEI% ^tUBRARYO^ ^tUBRARYQ^ .5!AEUNIVER5/A ^lOSANCEltf. § - - ^ o o ^.!/0JllV3JO'«^ •<fJlJ3NVS01=^ %a3AINnaVkV ^/iajAiNniA^ ,^;0F CAllFOff*, AMEUNIVERSyA ^OFCAUFOJ!^ ^OFCAllFOff^ 5MEll(JIVERJ/A. ^lOSANCElfj-^ o - 'I I- 3= ^J I !• -I 5 ^— 5 5 <fJlllNvail>5^ f- ^//l JBRARYQc ^^^Wt UNIVtKVy^i. <^IUBRAKYQ^ .WtUNIVtKVA. ,^ ^\mmo^^ o o ^ ? = -^ o IJI1VJJ0'»^ ^OJUVJ-JO"^ ^/Ja3AIN(13WV ^aOJITVDJO^ ^aojiivjjo'^ %aj/ •CAllfOffx^ ^0FCA1IF0% ,5^[l)NIVERS-/A .^lOSANCElfr^ ^OFCA1IFO% ^OFCAUFOff^ .^WE•UNIVERi/A \NWi\^ >'fllHVM(ini'*^ "^/MiMnniuv UNIVERJ//, <:^tUBRARYQ< ^^^t•llBRAfiY(3< ameuniver% ^lOSMEl^ ^5^tllBRARYa^^ <^\\\ O DNVSOl^'^ ^<JOJI1VDJO'^ <f^H3NVS01^ UNIVERS//, ^10SANCEI% ^OFCAllFOff^ ^OFCAIIFOSV ^WEUNIVERS/A vj,lOSANCElfj> ^OFCAllFOff^ S OS >'/) '/fujAigniUV I HWHPinVfi' 'fi\V\tl<IK.!\V^ VruiAiun nlV IBRARYQ/: ^>NtlIBRARYQ^ AWEUNIVERJ/a ^•lOSANCElfj-;^ ^IUBRA}1YQ<. -

Prayer Cards | Joshua Project
Pray for the Nations Pray for the Nations Anii in Benin Dendi, Dandawa in Benin Population: 47,000 Population: 274,000 World Popl: 66,000 World Popl: 414,700 Total Countries: 2 Total Countries: 3 People Cluster: Guinean People Cluster: Songhai Main Language: Anii Main Language: Dendi Main Religion: Islam Main Religion: Islam Status: Unreached Status: Unreached Evangelicals: 1.00% Evangelicals: 0.03% Chr Adherents: 2.00% Chr Adherents: 0.07% Scripture: Unspecified Scripture: New Testament www.joshuaproject.net www.joshuaproject.net Source: Kerry Olson Source: Jacques Taberlet "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 Pray for the Nations Pray for the Nations Foodo in Benin Fulani, Gorgal in Benin Population: 45,000 Population: 43,000 World Popl: 46,100 World Popl: 43,000 Total Countries: 2 Total Countries: 1 People Cluster: Guinean People Cluster: Fulani / Fulbe Main Language: Foodo Main Language: Fulfulde, Western Niger Main Religion: Islam Main Religion: Islam Status: Unreached Status: Unreached Evangelicals: 0.01% Evangelicals: 0.00% Chr Adherents: 0.02% Chr Adherents: 0.00% Scripture: Portions Scripture: New Testament www.joshuaproject.net www.joshuaproject.net Source: Bethany World Prayer Center Source: Bethany World Prayer Center "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 Pray for the Nations Pray for the Nations Fulfulde, Borgu in Benin Gbe, Seto in Benin Population: 650,000 Population: 40,000 World Popl: 767,700 World