1607-E14Q2-023 Date D’Édition Du Rapport : Septembre 2018 – Version 02
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
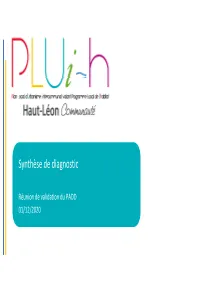
Synthèse De Diagnostic
Synthèse de diagnostic Réunion de validation du PADD 01/12/2020 SOMMAIRE 1. Les dynamique territoriales et la structuration du territoire 2. Le profil socio-démographique 3. L’habitat 4. Les modes d’urbanisation 5. L’économie 6. L’offre commerciale et d’équipements 7. Les zones d’activités sur le territoire 8. L’environnement 9. Les défis du territoire PLUi-h HLC 2 1. Les dynamiques territoriales et la structuration du territoire PLUi-h HLC 3 Ce que dit le SCoT . Le renforcement des villes et des bourgs : le développement démographique du territoire devra permettre de maintenir, voire de renforcer, le poids démographique des villes et bourgs, et éviter le report vers les villages. Les constructions nouvelles seront prioritairement implantées à l’intérieur des zones urbanisées (dents creuses, renouvellement urbain) ou en continuité directe de ces dernières, de sorte à prolonger la trame urbaine existante et la proximité avec les commerces et services. Les centralités urbaines offrant les principaux services et équipements seront renforcées, notamment les villes : Plouescat, Saint-Pol de Léon et Roscoff . Les communes favoriseront le report de l’urbanisation du front de mer dans les bourgs rétro-littoraux, de sorte à préserver les espaces naturels sensibles. Les communes favoriseront un développement perpendiculaire à la côte, de façon à ne pas élargir la façade urbaine de la mer, et favoriseront des formes urbaines denses dans le cas d’éventuelles extensions. PLUi-h HLC 4 Ce que dit le SCoT Le SCoT nomme les agglomérations et les villages -

Livret De Jeu
21 19 20 18 17 2 16 3 4 15 5 14 DÉCOUVREZ Ernée en JOUANT ! 13 Ernée 6 La ville d’Ernée te dévoile ses belles demeures des XVlle 12 en mayenne et XVllle siècles, ses maisons de granit, sa rivière, son histoire et ses anecdotes sans oublier, bien sûr, ses «enfants» célèbres qu’ils soient politiques ou artistes. 7 TOUT PUBLIC 11 Familles Parcours 1h30 juniors 7-12 ans Pédestre (2,9 kms) Accessible 9 8 Comment jouer ? 10 Vous organisez votre rallye QUAND ET AVEC QUI VOUS LE SOUHAITEZ, en 1 à 4 joueurs famille, entre amis, en équipes concurrentes... équipes de 4 conseillées. Vous pouvez faire votre rallye en plusieurs fois, commencer par la question de votre choix. Ce rallye existe aussi sur Smartphone et tablette. Il vous suffit : un rallye départ - arrivée + Place de l’Hôtel de Ville un stylo Parking pour noter (Consultez le plan pour situer le départ et l’arrivée. Voir plan au centre vos réponses du jeu) adresse Point Info Tourisme de la Ville d’Ernée 42 place R. Morlière 53500 ERNÉE Tél : 02 43 08 71 10 Tél : 06 40 09 12 86 Voir les horaires sur le site : www.ville-ernee.fr/decouvrir-ernee/tourisme/syndicat-d-initiative-d-ernee/ Liste des rallyes Randojeu : © Daniel Mc Caughan A découvrir également en jouant : La Ferté-Macé, Flers, Villedieu-les-Poêles Saint-Pair-sur-Mer, Kairon, Carentan Cherbourg : D-DAY et Maritime Baie du Cotentin, Nantes, Le Mans Bellême, Saint-Malo, Ile de Ré, Honfleur, .... ISBN 979-10-92394-43-6 ERNÉE www.randojeu.com Un rallye pour découvrir Éditeur Ludentis SAS - 53 000 Laval Dépôt légal en mai 2019 EN FAMILLE OU ENTRE AMIS BaladeS Je m’appelle Jacquou, DES 3 SUBIOU je suis gabelou ! , Ernee PATRIMOINE Sais-tu ce qu’est HISTOIRE & Question 29 Moi, je suis Sauveur, le crieur ! un gabelou ? Drôle de métier, n’est-ce pas ? Tu en sauras plus en jouant avec nous ! Ernée fut marqué par un évènement historique dont tu trouveras quelques précisions sur le panneau. -

Futur Autoroute Des Estuaires "Rennes Accepte Le Tracé Dans La Forêt"
Ouest-France 16/12/1990 Alain Girard Future autoroute des estuaires Rennes accepte le tracé dans la forêt A leur tour, les élus rennais ont donné un avis favorable pour que la route nationale 12, entre Rennes et Fougères, soit changée en autoroute. Quelques réserves sont toutefois exprimées, concernant l’impact sur le milieu forestier et la nécessité de revoir tous les schémas de déplacement à l'est et au nord-est de l'agglomération Ouverture européenne oblige, le projet de route des estuaires se précise autour de Rennes. Lundi 17, l'axe vers Nantes comprendra 10 kilomètres de voie express de plus, avec la mise en service de la déviation de Chartres. L’année 1991 s’annonce décisive pour le choix du tracé de la future autoroute entre Rennes et Avranches. Actuellement, après avoir étudié diverses variantes, les techniciens en soumettent une aux élus des communes concernées. L'autoroute contournerait Thorigné-Fouillard par le nord avant de reprendre l’actuel tracé de la nationale 12 jusqu’à jusqu'à Saint-Marc-sur-Couesnon. Elle bifurquerait alors vers le nord, direction Saint-Etienne-en-Coglès et Saint-James. Les échangeurs seraient plus rares à Thorigné (uniquement sortie vers Fougères à Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Marc, Saint-Etienne et Saint-James). Plus près de Fougères. Réunis lundi soir, les élus rennais ont donné un avis favorable à cette proposition près. Afin de « soutenir les préoccupations de Fougères », il se sont exprimés pour une solution passant plus près de cette ville, avec un échangeur à la porte de Romagné. Surtout, les conseillers rennais ont émis des réserves en ce qui concerne la traversée de la forêt entre Thorigné et Liffré : « la variante proposée est la moins traumatisante pour la forêt. -

Département De L'eure Ne Compte Aucune Voie Ferrée, Aucun Aéroport Et Aucune Agglomération Répondant Aux Critères De La Première Étape
PREFET DE L'EURE Direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure PPBE Département de l’Eure Plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'Etat Approuvé par arrêté préfectoral DDTM/2014/SPRAT/PR-26 le 27/11/2014 Directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement Table des matières 1. Bruit et santé................................................................................................................................................. 3 1.1 - Généralités sur le bruit......................................................................................................................... 3 1.1.1 - Le son.......................................................................................................................................... 3 1.1.2 - Le bruit........................................................................................................................................ 3 1.1.3 - Les principales caractéristiques des nuisances sonores de l’environnement..............................4 1.2 - Les effets du bruit sur la santé.............................................................................................................6 2. Le contexte à la base de l'élaboration du PPBE...........................................................................................6 2.1 - Cadre réglementaire général - sources de bruit concernées et autorités compétentes.......................6 2.2 - Les infrastructures concernées par le PPBE de l'État.......................................................................10 -

Centres Participants - SERVICE CONVOYAGE
Centres participants - SERVICE CONVOYAGE Contactez votre centre centre auto Feu Vert afin de prendre rendez-vous et demandez le service de convoyage. Choisissez l’adresse de votre choix et un chauffeur Feu Vert de votre centre auto vient récupérer votre véhicule, réalise les travaux demandés et vous le restitue à l'adresse intitiale dès qu'il est prêt. Code postal Centre auto Adresse Ville Téléphone 2200 FEU VERT SOISSONS ZAC de L'Archet SOISSONS 03 23 75 54 54 3000 FEU VERT MOULINS Centre Commercial Carrefour MOULINS 04 70 20 11 97 4200 FEU VERT SERVICE SISTERON Le Plan Roman SISTERON 04 92 68 34 18 6200 FEU VERT NICE 1 ST ISIDORE 21 bis avenue Gustave Eiffel NICE 04 93 18 12 80 6210 FEU VERT MANDELIEU Parking Geant Casino MANDELIEU 04 92 97 04 03 6270 FEU VERT VILLENEUVE LOUBET Avenue Maréchal De Lattre de Tassigny VILLENEUVE LOUBET 04 92 02 92 96 6300 FEU VERT NICE 2 ROQUEBILIERE 90 rue de Roquebillière NICE 04 92 00 29 50 6600 FEU VERT ANTIBES Chemin de Saint Claude ANTIBES 04 92 91 83 70 9190 FEU VERT SAINT LIZIER Route de Toulouse SAINT LIZIER 05 61 66 78 00 11000 FEU VERT CARCASSONNE FERRAUDIERE ZAC de la Ferraudiere CARCASSONNE 04 68 47 42 51 13011 FEU VERT MARSEILLE VALENTINE Route de la Sabliere MARSEILLE 04 91 89 82 94 13016 FEU VERT MARSEILLE GRAND LITTORAL ZAC de St Andre - Grand Littoral MARSEILLE 04 91 65 87 80 13097 FEU VERT AIX EN PROVENCE GEANT 210 Avenue de Bredasque AIX EN PROVENCE 04 42 29 74 18 13127 FEU VERT MARSEILLE VITROLLES Quartier du Griffon VITROLLES 04 42 77 57 90 13220 FEU VERT CHATEAUNEUF LES MARTIGUES -

Analyse Des Besoins En Logements De La Région Bretagne 1.2 Diagnostic
RAPPORTS Centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest Division Villes et Territoires Octobre 2011 Analyse des besoins en logements de la région Bretagne 1.2 Diagnostic et enjeux de l'habitat : Fiches synthétiques par pays Centre d'Études Techniques de l'Équipement de l'Ouest www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr Historique des versions du document Version Date Commentaire 1 11/10/2011 2 Affaire suivie par Bruno LE GONIDEC - DVT/ groupe connaissance des territoires Tél. : 02 40 12 84 57 / Fax : 02 40 12 84 44 Courriel : [email protected] Rédacteur Bruno LE GONIDEC - DVT Relecteur Elsa LE MOING - DVT/CT Lionel BENCHETRIT - DVT/CT SOMMAIRE PAYS D'AURAY.................................................................................................................................4 PAYS DE BREST...............................................................................................................................7 PAYS DE BROCÉLIANDE...............................................................................................................10 PAYS DE CENTRE BRETAGNE.....................................................................................................12 PAYS CENTRE OUEST BRETAGNE..............................................................................................15 PAYS DE CORNOUAILLE...............................................................................................................17 PAYS DE DINAN..............................................................................................................................19 -

Quartier 10 Rennes Villejean Plan De Quartier Beauregard
Quartier 10 Rennes Villejean Plan de Quartier Beauregard - urbanisé - départementale Boulevard R All Rue de du Verdi Prée 237 Ville Neuve All Rue de des Trait la R la Boussardière Prée Onze Journaux B8la Châtaigneraie la Verdière 9 10 RENNES - Quartier 10 (urbanisé) de la Beuchère Villejean - Beauregard RN 136 la Boutière 137 les Onze Journaux la Maison Blanche Boulevard 5 6 7 la RPt des Onze Journaux Route le Champ Verdier le Chemin Longé Boutière B4 B5 B6 B7 Route B8 les Quatre Chênes B9 B10 Chemin de la Rabelière de la Boussardière CR la Gaucherais Route le la les Quatre Chênes le Verdier N°13a - Porte de Echelle : 1:11 000 Chemin Saint-Malo la 075 150 les Balus 4 Beuchère Frougeard Echangeur des les Petits Talus Trois Epines Mètres les Grands Talus Longé C les Trois Epines Robiquette 136 Route Chemin de la Cerisaie des Frougeard Trois-Epines la Maison de des de Neuve Route la de la Bruyère de Fontaine RN VC Champs N°13b - Porte la Pilonnière Route la Grabotière de Beauregard Rue Chemin les Trois C4 6 C5 rural C6 C7 C8 C9 C10 Pilonnière Epines de la Route de Boulevard Rue La le Haut Quincé la Ctre 136 Cerisaie à comm Grd Grabotière CR RPt de Rennes Beauregard Quartier de CR 16 CR 8 2 du à la RN 137 Beauregard la Grasnière Rue RPt de la Cerisaie du Chesnay RN de chemin Tixue fer RPt l'Auge de Pierre Gaucherais de La Lande Rôtis Petits à la Grasnière la Rue des de la Beauregard Champs du Breil Prom D Saint- limite du de Pacé 17 Route de CR de Grasnière All du Pâtis la Champs la aux Rôtis Romilly Gaignoux M l'Auge de Pierre Tesgués des -

Contrat De Concession Consolidé COFIROUTE Post Avenant
Convention passée entre l’État et la société COFIROUTE pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes Texte consolidé au 28 août 2018 Avertissement Conformément à l’article L.122-4 du code de la voirie routière, les conventions de concession autoroutière et les cahiers des charges annexés sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, ainsi que les modifications qui y sont apportées par voie d’avenants en vertu de la règle du parallélisme des formes. Seules font foi et sont opposables aux tiers, les versions de ces documents publiées au Journal officiel de la République française et accessibles sur le site www.legifrance.gouv.fr. Pour ce qui concerne la société COFIROUTE, le décret approuvant la convention de concession initiale et le cahier des charges annexé ainsi que les décrets approuvant leurs avenants successifs sont listés ci-après, accompagnés des liens permettant leur accès direct sur le site Legifrance. La présente version consolidée de la convention de concession et du cahier des charges annexé constitue un outil de documentation. Compte tenu de leur volume, de leur format et de leurs caractéristiques, certaines annexes au cahier des charges ne sont pas publiées au Journal officiel ni mises à disposition du public par voie électronique. Ces pièces sont consultables sur rendez-vous sollicité par l’intéressé à l’adresse suivante : [email protected] . Le demandeur précisera notamment les pièces qu’il souhaite consulter. Cette consultation se fait dans le respect des règles applicables en matière de confidentialité des données relevant du secret industriel et commercial et dans le respect des autres secrets protégés par la loi. -

13- Page De Garde Annexe 4
CONTOURNEMENT NORD D’ERNEE LIAISON RD 31 – RD 107 DOSSIER D'AUTORISATION ANNEXE 4 BIS Résumé non technique de l’étude d’impact RD31 RD107 Contournement Nord d‘Ernée RD31 RD107 Contournement Nord d‘Ernée PICE G1 RESUME NON TECHNI UE DE L‘"TUDE D‘IMPACT REVISIONS DE CE DOCUMENT 0 21/02/2013 Premi)re émission P. RO,ERT P. RO,ERT G. GE--RO. A 03/04/2013 INDICE DATE MODIFICATIONS ETABLI PAR VERIFIE PAR APPROBATION Page 2 INGEROP RESUME NON TECHNIQUE Ind A 18/03/2013 RD31 RD107 Contournement Nord d‘Ernée PICE G1 RESUME NON TECHNI UE DE L‘"TUDE D‘IMPACT SOMMAIRE 1. LA PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L‘ENQUETE ........................................ 4 1.1. Les object fs de l‘op%rat on et les besoins auxquels il r%pond ................................................... 4 1.2. La pr%sentat on du projet ........................................................................................................... 4 2. LE DIAGNOSTIC INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ........................ 2.1. La pr%sentat on de la zone d%tude ............................................................................................. 2.2. Le m l eu physique ...................................................................................................................... 2.3. La qual t% de l‘air ....................................................................................................................... 13 2.4. Les m l eux naturels, la faune et la flore .................................................................................. -

Arrêté Du 29 Mai 2006 Portant Constitution
30 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 162 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L’ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Arrêté du 29 mai 2005 portant constitution des directions interdépartementales des routes NOR : EQUR0601152A Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, Vu le décret no 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; Vu le décret no 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes, notamment son article 6 ; Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 mai 2005, Arrêtent : Art. 1er.−Le siège de la direction interdépartementale des routes Atlantique est implanté à Bordeaux (Gironde). Son ressort territorial est constitué des sections de routes nationales et d’autoroutes décrites dans le présent article et s’étendant sur les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Deux-Sèvres et de la Vienne. – Section 1 : la route nationale 10 (située dans les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Gironde) entre l’échangeur avec l’autoroute A 10 à Croutelle et l’échangeur avec la même autoroute à Saint-André-de-Cubzac. – Section 2 : l’autoroute A 630 (située dans le département de la Gironde) entre l’échangeur avec l’autoroute A 10 à Lormont et l’échangeur avec la route nationale 230 à Bègles. -

Étude De Territorialité
ÉTUDE DE TERRITORIALITÉ Master 2 Gestion des Territoires et Développement Local 2019-2020 Sous la direction d’ Erwann Charles, Maître de conférences en Économie, Kevin Charles, Maître de conférences en Économie Département Territoires et Europe - Master GTDL Remerciements En préambule de ce rapport d’étude, la promotion de Master en Gestion des Territoires et Développement Local souhaite adresser ses remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à son avancement en y consacrant de leur temps et en apportant leur expertise afin de mieux cerner les enjeux du territoire et enrichir cette analyse. Aussi, elle tient particulièrement à remercier : • Madame SARRABEZOLLES, présidente du Conseil Départemental du Finistère ; • Monsieur HUET, directeur délégué à l’accessibilité au Conseil Départemental du Finistère ; • Les membres et leurs structures professionnelles participant au comité technique de l’étude, à savoir : le Conseil Départemental du Finistère représenté par Sandra HAUSHALTER, référente mobilité ; Brest métropole représentée par François KERAVAL aux stratégies métropolitaines et dynamiques territoriales ; la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO) représentée par Meriadec LE MOUILLOUR, son directeur général et Cédric SOULET, directeur des affaires générales et de la communication ; Investir en Finistère représentée par Françoise LELANN, directrice de l’association ; l’ADEUPa (Agence d’urbanisme Brest-Bretagne) représentée par François RIVOAL, responsable du pôle économie et prospective ; -

Quartier 10 : Villejean
Quartier 10 Rennes Villejean Plan de Quartier Beauregard Anjela Route Boulevard Chemin Chemin Jean d'Emeraude Pré Henri All R Carré R du Eric Duval Rue de la Louis R Garin Pierre RPt Jaurès Victor Rue de Moulin Robert d'Alphasis la All des Edonia Mail JeanGuéhenno Jean Rue Anita Allée 7 P 8 9 10 Chênes RENNES - Quartier 10 Rue Métrie Rue Jaurès RD la Métrie All Coupigné France Rue Mendès Conti Adélie Victoria Goulets Duchesse Jean Jaurès Rue Jean la Baudière RPt du Marais départementale Terre Terre Paul-Émile des Avenue Villejean - Beauregard All des RPt du Redones R Anne des Iles Kerguelen des des la Ponant Jardins 29 R départementale Marebaudière des All la Carnutes Rue RPt de Coupigné Rue Boulevard Bd de All Helvètes 29 de la de RD All Rue Rue Belle 29 de le Marais Gaël All Epine Route la d'Alésia Boulevard de A3 4 5 6 des Chemin Voie départementale Rue de Rue de la All Arvernes Le Pré Neuf Rue Chemin All la Belle Epine de d'Armorique Gergovie Druides le Grand Marais d'Olivet du du de Duchesse Chemin du des des ClosBouvier Verger 137 Rue du All All de des Bardes l'Arguenon RueAll Celtes de Avenue Lutèce la Mandardière Vizeule R Rue Rue Chemin des la de Ponant la R Condate Venètes de de Loysance Chemin la Trieux la Talmousière de de de communale Route R Terre Rue du Echelle : Anne R du de 1:14 250 Rue la All l'Odet de de Feu Boutière Gouet Daoulas du All Planche All l'Elorn Trieux Rue la Cosnière 095 190 Vivaldi A All RPt du Chopin All C F Champ Rabey Gounod All J-S le Champ Rabey Rue Bach All M All All Beethoven A3 Mètres A4 A5 A6 A7