Des Pays Yougoslaves Au Moyen-Age
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
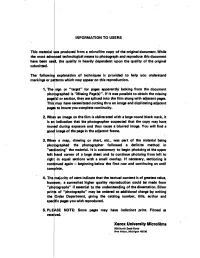
Xerox University Microfilms
INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy o f the original document. While the most advai peed technological meant to photograph and reproduce this document have been useJ the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The followini explanation o f techniques is provided to help you understand markings or pattei“ims which may appear on this reproduction. 1. The sign or “ target" for pages apparently lacking from die document phoiographed is “Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This| may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. Wheji an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is ar indication that the photographer suspected that the copy may have mo1vad during exposure and thus cause a blurred image. You will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. Wheh a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in 'sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to righj in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is continued again - beginning below the first row and continuing on until com alete. 4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, ho we ver, a somewhat higher quality reproduction could be made from "ph btographs" if essential to the understanding of the dissertation. -

Księżna Milica
POZNA ŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 5/2013 ISSN 2084-3011 Data przesłania tekstu do redakcji: 23.11.201 2 Zofia Brzozowska Data przyj ęcia tekstu do druku: 28.02.2013 [email protected] Ksi ęż na Milica – mi ędzy sakralizacj ą władzy monarszej, oficjalnym kultem cerkiewnym i narodowym mitem ABSTRACT. Brzozowska Zofia, Ksi ęż na Milica – mi ędzy sakralizacj ą władzy monarszej, oficjalnym kultem cerkiewnym i narodowym mitem (Princess Milica – the Sacralisation of Queenship, Official Sanctity and National Myth). „Pozna ńskie Studia Slawistyczne” 5. Pozna ń 2013. Adam Mickiewicz University Press, pp. 59–73. ISBN 978-83-232-2636-9. ISSN 2084-3011. This article is devoted to the one of the best known female rulers of medieval Serbia – prin- cess Milica, wife of the prince Lazar Hrebeljanovi ć, who had lost his live during the famous Battle of Kosovo Field in 1389. After the death of her husband, Milica founded the Ljubo- stinja monastery and became the nun Jevgenija. She was a close friend to the famous Serbian poet Jefimija, who accompanied princess Milica in the diplomatic mission to the Sultan’s court in 1398/1399. She died in 1405. She was canonized by the Serbian Orthodox Church. She appears also – as „tsaritsa Milica” – in Serbian folklore (epic poetry). Keywords: Milica; Lazar Hlebeljanovi ć; Serbia; Battle of Kosovo Field; holy ruler; hagio- graphy Sakralny status władców, wywodz ących si ę ze „ świ ętej dynastii” Nemanjiciów, jest jednym z najbardziej charakterystycznych fenomenów średniowiecznej kultury serbskiej, rozwijaj ącej si ę w XIII–XVII wieku pod przemo żnym i wieloaspektowym wpływem cywilizacji bizanty ńskiej. -

600 Jaar Later: De Slag Bij Kosovo in De Hedendaagse, Servische Literatuur
Universiteit Gent Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Academiejaar 2008-2009 600 jaar later: De slag bij Kosovo in de hedendaagse, Servische literatuur Verhandeling ingediend tot het behalen van de graad van Master in de Oost-Europese Talen en Culturen Promotor: Dr. S. Vervaet door: Laurens Strobbe 2 Voor de literatuur, overgevlogen uit het verre zuiden, in de handen van mijn promotor, Ik dank Aan de goden van de wereldlijke panthea, voor spirituele begeleiding, Ik dank Aan alle geliefden in mijn leven, voor hun energie, Ik dank ≈ 3 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding ................................................................................................................................................. 7 2. De veldslag bij Kosovo: De evolutie van een nationale legende ........................................... 9 3. Kosovo Polje door de ogen van de huidige schrijvers ............................................................ 13 4. In het spoor van de legendarische personages ......................................................................... 17 4.1 Lazar, prins van Servië ............................................................................................................ 17 4.1.1 De christelijke aura van Lazar ......................................................................................... 19 4.2 Miloš Obilić, de eeuwige held ................................................................................................. 23 4.2.1 De twist met Vuk Branković ........................................................................................... -

Zograf 42 10 Matic.Indd
Ktetor portraits of church dignitaries in Serbian Post–Byzantine painting (part one) Miljana М. Matić* Museum of the Serbian Orthodox Church, Belgrade UDC 75.041.5:271.22-725.1/.2](497.11)”15/16” 338.246.027:34 DOI https://doi.org/10.2298/ZOG1842181M Оригиналан научни рад Church dignitaries were often represented as ktetors in Serbian nitaries, portraits are the most reliable and sometimes the painting of the sixteenth and seventeenth centuries, primarily only testimonies for the research of individual person- in wall paintings and on icons. The first part of this paper dis- alities, clothing, and insignia, giving information on the cusses twelve ktetor representations of Serbian patriarchs and appearance of the depicted archpriests and their rank in metropolitans. By analyzing the ktetoric projects of Orthodox 2 Serbs within the Ottoman Empire, the historical framework society. Thanks to the inscriptions accompanying ktetor and description of every portrait, it explores the questions re- portraits, they are considered to be a unique epigraphic garding not only the self-referentiality of the ktetors from the treasury and an important source for studying the titles of highest circles of the clergy under the Patriarchate of Peć, the Orthodox clergy, as well as for the history of some church patterns and ways they wanted to be represented and remem- monuments and icons.3 Portraits also provide valuable bered, but also the ideological and program context as well. testimonies of fundamental ideological, political and reli- Finally, this two-part study attempts to examine the question gious views of the depicted personalities and the environ- of individual and collective identity, imagery and ideas con- structing the visual culture of clerical ktetorship in Serbian ment in which they lived. -

HIL ENICH PATM 1.Pdf
/-;0 .fL---I7~ .~-<.') - /137-/15"0 //-J q I I ~ 11:)2 (}f\ ~ p~ ~ ~?1 /~10·-1907 .Aa~/!~-d-- ~ I~~~ /15"0-058' - £~ ~r' ~ e~_ ~ ~ cl..u- 6- ~l/~ .A8- 3S fi z/{Uvrz.cu--d.- / '1 30 - 3 7 - J.j a.,...; ~-"-teft- ~~~o...- ~~~ v 44- tf'i II ~~..e-TY ~~1'UV-c'<.. ,~h-6-!'~tl.-- 11z.:;,-- 174 9 .t/-r-5~ il ~~ Ifl-o-19:Jo -;-sTfl~~~'foo,-raJUJ..T :rLj - 5" S ., f:,,-.rf;~'.e-- ~'~-(r~___ / ~ 74-/ f ? I . 5(", "~ ,'1~ .. /'6'/:>.- / Y(,/ 5'-5 (1 /1 ~ ~a...4~~' /1t,J./- Jf70 59- (Po rr $~ - f'~cr#~ llwu.!o ~. -;e~'~ .. ~~ ~ OJ- .j!h~.J:t/~ ~5 ~- ¥ ~ t:L Pcd-, .. r. du M~?~. I?-~ ~ ~ .. -~J ~ ~ ~ 1 I~~~~ .~.~.~ Pd. ~l-We...~ ~~~. -l-I.-v ~1'-!J(}~ 3~ .~ ~-c~ ~ .~~. ~ ~~ L-rm?U"~UlA.'-~ r bJurz - H - Co d-~-~ 0; ~2. a.t-jJk- ~ ~~ ~ ~ #LJL~.I' &'1-(,3 •• ,4t. ~ - 4-fh~ ~ - ~ {~ ~~ .. ~ fJ :,; 61.-(,,1 .• l(tuJ ~ ~'6-7{) •• 4J ~ Y- .j..l~n:.k - fa ~~ -7': . 1 ~ ~ .31S-" ~ ~~ 7~~n--~ 7/- 73 •• ~~ !(~~ ~ 117~. -137/- ~~ . -P~~r'- ~ ~ - ~ jJti~~ v 7;./-7(" •.. ~~ ~l ~~ "- 77~F -' .Ihff) 1ft;1 ·~~1~Gd.) 77-7'1k~ C4+ 'l7~ -13S1 «. ~~- .. ~ a~ - ~ f(k+ nUk/~ eJ 'to .. ~ ~ -/,3 7- ~ f~· ~l- ~ .. ~Cv~,~ ! ..;.. '2.. IJ\A... "-4t-!ted •_________~~' ,.~ _~ _~'._, c ',~ ,~~ -' ••-,,- , JUBILARNA SLIKA NJ. SV. PATRIJARHA GERMANA -povodom 25-godisnjice patrijaraske sluzbe- Ovu sluku uradio je protodjakon Marko Ilic, akademski slikar iz Beograda po porudzbini beogradskog svestenstva, koje je istu poklonilo Nj. Sv. Patrijarhu srpskom Germanu povodom 25-go disnjice nj:!gove patrijaraske sluzbe. -
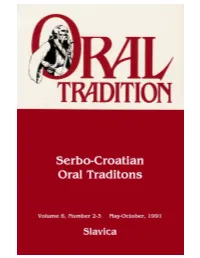
Complete Issue
_____________________________________________________________ Volume 6 May-October 1991 Number 2-3 _____________________________________________________________ Editor Editorial Assistants John Miles Foley David Henderson J. Chris Womack Whitney A. Womack Slavica Publishers, Inc. For a complete catalog of books from Slavica, with prices and ordering information, write to: Slavica Publishers, Inc. P.O. Box 14388 Columbus, Ohio 43214 ISSN: 0883-5365 Each contribution copyright (c) 1991 by its author. All rights reserved. The editor and the publisher assume no responsibility for statements of fact or opinion by the authors. Oral Tradition seeks to provide a comparative and interdisciplinary focus for studies in oral literature and related fields by publishing research and scholarship on the creation, transmission, and interpretation of all forms of oral traditional expression. As well as essays treating certifiably oral traditions, OT presents investigations of the relationships between oral and written traditions, as well as brief accounts of important fieldwork, a Symposium section (in which scholars may reply at some length to prior essays), review articles, occasional transcriptions and translations of oral texts, a digest of work in progress, and a regular column for notices of conferences and other matters of interest. In addition, occasional issues will include an ongoing annotated bibliography of relevant research and the annual Albert Lord and Milman Parry Lectures on Oral Tradition. OT welcomes contributions on all oral literatures, on all literatures directly influenced by oral traditions, and on non-literary oral traditions. Submissions must follow the list-of reference format (style sheet available on request) and must be accompanied by a stamped, self-addressed envelope for return or for mailing of proofs; all quotations of primary materials must be made in the original language(s) with following English translations. -

The Legend of Kosovo
Oral Tradition, 6/2 3 (1991):253-265 The Legend of Kosovo Jelka Ređep The two greatest legends of the Serbs are those about Kosovo and Marko Kraljević. Many different views have been advanced about the creation of the legend of Prince Lazar and Kosovo (Ređep 1976:161). The most noteworthy, however, are those of Dragutin Kostić (1936) and Nikola Banašević (1935). According to Banašević, the legends of Marko Kraljević and Kosovo sprang up under the infl uence of French chansons de geste. Kostić, however, takes a different stance. Rejecting Banašević’s interpretation along with the opinion that the legend of Kosovo arose and took poetic form in the western regions of Yugoslavia, which in the second half of the fi fteenth century had strong ties with western Europe and in which the struggle against the Turks was most intense, Kostić points out that Banašević does not distinguish between the legend and its poetic expression in the Kosovo poems. He states that “French chivalric epics did not affect the formation and even less the creation of the fi rst poem about Kosovo, not to mention the legend of Kosovo, but only modifi ed the already created and formed legend and its fi rst poetic manifestations” (1936:200; emphasis in original). It seems reasonable to accept Kostić’s opinion that the legend originated in the region in which the battle of Kosovo took place. The dramatic nature of the event itself, along with those that followed, could certainly have given rise to the beginnings of the legend soon after the Serbian defeat at Kosovo on June 15, 1389 (June 28 of the old calendar), and the canonization of Prince Lazar. -

Balkan Slavic Literatures: Reading List and Bibliography Petko Ivanov Connecticut College, [email protected]
Connecticut College Digital Commons @ Connecticut College Slavic Studies Faculty Publications Slavic Studies Department 1998 Balkan Slavic Literatures: Reading List and Bibliography Petko Ivanov Connecticut College, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.conncoll.edu/slavicfacpub Part of the Slavic Languages and Societies Commons Recommended Citation Ivanov, Petko, "Balkan Slavic Literatures: Reading List and Bibliography" (1998). Slavic Studies Faculty Publications. 13. http://digitalcommons.conncoll.edu/slavicfacpub/13 This Article is brought to you for free and open access by the Slavic Studies Department at Digital Commons @ Connecticut College. It has been accepted for inclusion in Slavic Studies Faculty Publications by an authorized administrator of Digital Commons @ Connecticut College. For more information, please contact [email protected]. The views expressed in this paper are solely those of the author. BALKAN SLAVIC LITERATURES READING LIST AND BIBLIOGRAPHIC GUIDE Petko Ivanov Department of Slavic Languages & Literature & Department of Anthropology, University of Chicago I. Defining "Balkan Slavic" The failure of the Yugoslav idea made obvious by the collapse of Yugoslavia posed the issue of developing new paradigms by which the literary and cultural legacy of the Southern Slavs can be discussed adequately in a political context now transformed. Two such paradigms are being currently proposed: the Balkan and the Central European one. This dichotomy reflects the actual split of the Southern Slavs along a borderline that separates two cultural-cum-political zones. The distinctions between these zones are traditionally articulated in several idioms: [1] in confessional terms (Eastern Orthodoxy vs. Catholicism); [2] in terms of political history (the Ottoman vs. the Austro-Hungarian empires); [3] in geographical terms (the Balkan region vs. -

Special Editions; Institute for Balkan Studies SASA
SERBISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE INSTITUT FÜR BALKANOLOGIE SONDERAUSGABE Band 44 SERBISCH — ORTHODOXE DIÖZESE FÜR WESTEUROPA BUND DER SERBEN UND AUSWANDERER SERBIENS DIE SCHLACHT AUF DEM AMSELFELD 1389 UND IHRE FOLGEN INTERNATIONALES SYMPOSIUM HIMMELSTHÜR 1989 Verantwortlicher Redakteur NIKOLA TASIC Korrespondierendes Mitglied der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste Direktor des Institutes für Balkanologie Herausgegeben von VESELIN ĐURETIĆ INHALT Nikola Tasić, V orw ort — — — — — — — — — — — — 205 Radovan Samardžić, Für das himmlische Reich — — — — — — 207 Boško Bojović, Die Genese der Kosovo-Idee in den ersten postkosovoer hagiographisch-historischen Schriften — — — — — — — — 215 Olga Zirojević, Lazars Brief an Murad oder wie es zur Kosovo-Schlacht kam — — — — — — — — — — — — — — — — 231 Momčilo Spremić, Die Kosovo-Schlacht — ein Problem des Verrats 239 Jovanka Kalić, Serbien und das Abendland 1389—1459 — — — — 255 Vasilka Tapkova Zaimova, Der Widerhall des osmanischen Vordringens in der schriftlichen Tradition des Heiligen Demetrios — — — 265 Dragoljub Dragojlović, Die Politik des Apostolischen Stuhles auf der Balkanhalbinsel vor und nach der Schlacht auf dem AmseLfeld 275 Jelka Ređep, Die Kosovo-Legende und die Geschichte über die Kosovo- Schlacht — — — — — — — — — — — — — — — 289 Dinko Davidov, Der Kult des Heiligen Fürsten Lazar und seine Gestalt in der serbischen Graphik des XVIII. Jahrhunderts — — — — 305 Dragoslav Antonijević. Der Kult des Fürsten Lazar in der Folklore tradition — — — — — — — — — — — — — — — 317 Drago Ćupić, Der Kosovo-Mythos und Montenegro — — — — — 329 Dušan T. Bataković, Die Bedeutung der mündlichen Überlieferungen über Kosovo für die Weiterexistenz des serbischen Volkes in Kosovo und Metohija im XIX. Jahrhundert — — — — — — — — 341 Tomislav Kraljačić, Der 500. Jahrestag der KosovcwSchlacht in Bosnien und Herzegowina — — — — — — — — — — — — — 355 Jovan Pejin, Die Begehung des 500. Jahrestages der Kosovo-Schlacht in Ungarn und die Verbreitung der Kosovo-Legende — — — — 363 Žarko Vidović. -

Primary Sources the Battle of Kosovo: Early Reports of Victory
Primary Sources The Battle of Kosovo: Early Reports of Victory and Defeat by Thomas A. Emmert from Kosovo: Legacy of a Medieval Battle In popular interpretation it was defeat at the Battle of Kosovo which brought about the disintegration of the medieval Serbian empire. Careful analysis of the post-Dusan era, however, demonstrates that the empire had already collapsed long before the battle. During the years of Tsar Uros's reign (1355-71) the authority which the Nemanjic dynasty represented was completely undermined by powerful lords who succeeded in governing their territories quite independently of their tsar. With Uros's death in 1371 the Nemanjic dynasty became extinct; and in the eighteen years which separate his death and the Battle of Kosovo the struggle for territorial aggrandizement among the nobility of Serbia only continued. This struggle was made more complex by the increasing danger which the Ottoman Turks posed to the region. Already in September 1371, the Ottomans defeated the strongest Serbian lords in Macedonia in a major battle on the Marica River. This victory was perhaps the Ottomans' most important success before their conquest of Constantinople in 1453, for the valley of the Marica River opened their way to the rest of the Balkans. Less than two years after the battle on the Marica the Byzantine emperor had to accept a vassal relationship with Murad I, and the ever-retreating line of defense against the Turks moved northwest to the more central regions of Serbia. The rise of the Ottoman Turks from a small warrior state on the Asian frontiers of the Byzantine Empire to a formidable empire of their own in both Asia and Europe is a phenomenal story. -

Serbian Orthodox Fundamentals: the Quest for an Eternal Identity
SERBIAN ORTHODOX FUNDAMENTALS: THE QUEST FOR AN ETERNAL IDENTITY Christos Mylonas Submitted for the degree of Doctor of Philosophy School of Slavonic and East European Studies University College London August 2001 ProQuest Number: U 144915 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest U144915 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract This study addresses the following research questions: what makes a Serb? What particular properties” or **fundamentals ” could and should be attributed to this identity? Are meaningful assumptions possible by introducing Serbian Orthodoxy as the primal point of reference? Why does religion appear to have an especially strong appeal? Does this “appeal” originate in the nature of the Orthodox faith, or rather arise from the societal framework, within which the Serbian identity is articulated? These issues have been principally explored by means of an analytical appraisal of bibliographical material -regional sources and additional treatises on Orthodoxy -
The Heavenly Kingdom in Serbia's Historic Destiny
The Heavenly Kingdom in Serbia’s Historic Destiny The Heavenly Kingdom in Serbia’s Historic Destiny Bishop Atanasije Jevtić he Serbian people began to formulate their spiritual This preference for spiritual values became an insepa- identity during the era of the Holy Brothers Cyril and rable part of the Serbian national soul, as well as its life- Methodius (9th century), and their five disciples who blood in the early stages of its history. The first evidence of Tfollowed (10th century). They are considered the first bap- this appeared among the Serbian saints, who through their tizers and enlighteners of the Serbs, as well as the other asceticism, virtues, and suffering were constructing a spir- Slavs. The fruit of their work, harvested for some two cen- itual ladder to the Kingdom of Heaven for their people and turies from Byzantium and Bulgaria to the Adriatic, includ- who exemplified through their lives the manner in which ed the gradual Christianization of the Serbs both nation- the world, the path of history, and man’s deeds within it ally and individually, the appearance of the first ascetics should be evaluated. and saints among the Serbs, and the first monuments of Thanks to the extraordinary personhood of Saint Sava Serbia’s spiritual and secular cultures. (1175–1235) and his labor among the Serbs, this Orthodox Starting with the time they accepted Orthodoxy and Christian choice became the inherent self-identity of the considering the subsequent history and behavior of the Serbian people. Saint Sava has been rightfully called the Serbs, it is easy to discern the basic nature of their spiritual all-Serbian “enlightener, the first enthroned, the Teacher of identity.