Suspendu Au Sublime / La Lettre, Manoel De Oliveira]
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Celebrations
Celebrations Alentejo Portalegre Islamic Festival “Al Mossassa” Start Date: 2021-10-01 End Date: 2021-10-03 Website: https://www.facebook.com/AlMossassaMarvao/ Contacts: Vila de Marvão, Portalegre The historic town of Marvão, in Alto Alentejo, will go back in time to evoke the time of its foundation by the warrior Ibn Maruam, in the ninth century, with an Islamic festival. Historical recreations with costumed extras, an Arab market, artisans working live, a military camp with weapons exhibition, games for children, knights in gun duels, exotic music and dance, acrobats, fire- breathers, snake charmers , bird of prey tamers and circus arts are some of the attractions. Centro de Portugal Tomar Festa dos Tabuleiros (Festival of the Trays) Date to be announced. Website: http://www.tabuleiros.org Contacts: Tomar The Festival of the Trays takes place every four years; the next one will take place in July 2023. Do not miss this unique event! The blessing of the trays, the street decorations, the quilts in the windows and the throwing of flowers over the procession of the trays carried by hundreds of young girls on their heads, is an unforgettable sight. The Procession of the Tabuleiros, heralded by pipers and fireworks, is led by the Banner of the Holy Ghost and the three Crowns of the Emperors and Kings. They are followed by the Banners and Crowns from all the parishes, and the girls carrying the trays. In the rear are the cartloads of bread, meat and wine, pulled by the symbolic sacrificial oxen, with golden horns and sashes. The girls who carry the trays have to wear long white dresses with a coloured sash across the chest. -
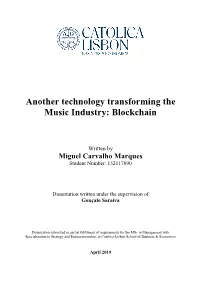
Another Technology Transforming the Music Industry: Blockchain
Another technology transforming the Music Industry: Blockchain Written by Miguel Carvalho Marques Student Number: 152117090 Dissertation written under the supervision of Gonçalo Saraiva Dissertation submitted in partial fulfilment of requirements for the MSc in Management with Specialization in Strategy and Entrepreneurship, at Católica-Lisbon School of Business & Economics April 2019 ABSTRACT Title: Another technology transforming the Music Industry: Blockchain Author: Miguel Marques The blockchain is an emerging technology, receiving increased attention due to its applicability in several different areas of business, among other reasons. One of the possible applications of blockchain is in the music industry. New ventures exploring this subject have been appearing, offering a range of different solutions to some of the most pressing issues in the industry. Past literature focused on the technology and how its specificities can help in changing a culture of lack of transparency and inefficiency in the revenue streams, ultimately harming the artists. This study starts by providing a detailed picture of the music industry, their several actors, their functions and relationships, only then framing blockchain in this network. By collecting insights from different players in the music industry, positioned along the value chain and with heterogenous interests, the research goes further in understanding their vision on the industry. It is learned that there are two contrasting dimensions in it, one of which is seemingly more accessible to the new platforms. Moreover, the pain points identified are confirmed by the music community, even though other issues seem to be more critical. Considering this, the level of attractiveness of the industry for the blockchain projects is assessed and a new limitation to its market penetration is discovered: the lack of knowledge on the subject existing in the music community today. -

O Processo De Internacionalização Da Música Portuguesa: Contexto Histórico, Desafios Atuais E Futuro
O Processo de Internacionalização da Música Portuguesa: contexto histórico, desafios atuais e futuro Joaquim Paulo da Cruz Oliveira Dissertação de Mestrado Mestrado em Empreendedorismo e Internacionalização Porto – abril de 2014 INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO O Processo de Internacionalização da Música Portuguesa: contexto histórico, desafios atuais e futuro Joaquim Paulo da Cruz Oliveira Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Contabilidade e Administração do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Empreendedorismo e Internacionalização, sob orientação do Professor Doutor Freitas Santos Porto – abril de 2014 INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO Resumo O presente trabalho aborda a problemática da internacionalização da música portuguesa, referindo o contexto histórico da sua evolução (internacional e nacional), os desafios atuais que se colocam às empresas e músicos decorrente da digitalização da música, traçando-se depois alguns cenários de futuro. Desde a sua origem e implementação como indústria que a música portuguesa tem apresentado dificuldades de se internacionalizar. Se tal se deve, em grande parte, ao isolamento a que o país esteve sujeito durante o regime do Estado Novo, a situação pouco se alterou com a revolução de 25 de abril de 1974. Era suposto que o surgimento do digital, aliado a novas tecnologias de divulgação e partilha e a menores custos de produção alterassem a situação. No entanto, num mundo cada vez mais globalizado, Portugal parece continuar a padecer do isolamento e da sua condição geograficamente periférica. O que verdadeiramente acontece é que, o verdadeiro problema, hoje e sempre, reside na falta de apoios e de estruturas profissionais que permitam alavancar a música portuguesa no seu processo de internacionalização e exportação como um bem consumível, gerador de emprego e de retorno económico. -

O Impacto Tecnológico Na Indústria Musical
Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa Mestrado em Gestão de Indústrias Criativas O Impacto tecnológico na indústria musical Indústrias Criativas 2014 Filipa Iglésias Professor Orientador: Maria Victória Rocha Novembro de 2014 Resumo O ciberespaço constitui uma fonte inesgotável de conhecimento e informação. Mas o progresso tecnológico dos últimos anos veio revolucionar todo o comércio jurídico, nomeadamente ao nível das relações contratuais em sede de direito de Autor. Pretende-se com o presente trabalho analisar o impacto das tecnologias digitais na indústria musical, mormente nas soluções encontradas para proteger e explorar conteúdos musicais. Começaremos por analisar o direito de Autor no contexto da sua prática histórica, com um foco particular sobre os princípios base que o formaram e se mantém, bem como as implicações globais para questões de direitos de Autor online surgidas com a Internet, as tecnologias móveis, as redes sociais, os serviços on-demand , o streaming e os novos conteúdos criados pelos usuários. A natureza global destas indústrias e tecnologias trouxe novas oportunidades e desafios que transcendem as fronteiras tradicionais e barreiras culturais. Ao mesmo tempo, verifica-se ainda uma assimetria entre os países com economias culturais fortes e inovadoras, e os países com economias emergentes. Situando-nos no impacto tecnológico na criação e exploração de uma Obra, utilizaremos como caso de estudo a indústria musical e os desafios que se levantam aos seus protagonistas, bem como as alternativas encontradas pelo mercado para responder à realidade prática que surgiu em adaptação à falta de regulação e leis próprias dirigidas ao consumo de música em ambiente digital. Palavras Chave: Direito de Autor, Música, Ciberespaço ii Índice de Conteúdos Lista de Figuras ....................................................................................................................................... -

Ana Moura Do Anonacidadeberço
Gabriel Martins Plano Local Jordao Cooling Systems do Voluntariado Estivemos à conversa com A empresa vimaranense está Gabriel Martins, reconhecido Guimarães perde para nomeada para os prémios empresário vimaranense Barcelona a Capital Europeia European Business Awards (EBA). da área da restauração. do Voluntariado em 2014, mas mantém programa. Ana Moura do anonaCidadeBerço. para umdosmaioresconcertos e convidaPedroAbrunhosaLuísaSobral A fadistavemaGuimarãesdia21, 08 N08 • Dezembro 2013 • Distribuição Gratuita • Diretor Eliseu Sampaio Eliseu Sampaio Diretor da Mais Guimarães Nicolis Decorreu em Guimarães 04 mais uma edição das festas Nicolinas, a festa dos estudantes. Por isso, participemos nas campanhas que visam ajudar aqueles que mais Chegamos à quadra natalícia... precisam, realizemos as nossas próprias campanhas, para amparar quem, a Aed Culturl É tempo de alegria, de entusiamo, mas determinada altura, ficou para trás. Não Saiba o que não pode perder 10 também de introspecção e meditação. aguentou o ritmo frenético, e foi em Guimarães, durante As crianças andam entusiasmadíssimas sacudido violentamente pela turbulenta o mês de Dezembro. com a chegada do natal. E é contagiante. maré que deu à nossa costa, à nossa rua, É o pinheiro em Novembro e o lá de casa e tantas vezes à nossa família. que vai ganhar de novo vida, são as extensas cartas ao pai natal, com Mas, provavelmente nem demos por Biodz conteúdo que mudam com tanta isso, pela velocidade com que tudo Guida Gama, falou à +G 18 frequência como as previsões económi- acontece, ficamos extasiados, limitados e sobre esta modalidade. cas dos governos dos últimos 5 anos. incapazes de ver quem foi cuspido por Mais que desporto, é uma forma de estar. -

Ruídos, Assimetrias E Diálogos Possíveis Na Trajetória Midiática Do Pop/Rock Luso-Brasileiro
RUÍDOS, ASSIMETRIAS E DIÁLOGOS POSSÍVEIS NA TRAJETÓRIA MIDIÁTICA DO POP/ROCK LUSO-BRASILEIRO Tiago José Lemos MONTEIRO (Mestre em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Doutorando em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense) Rio de Janeiro/RJ Resumo: Este paper, marco inicial da minha futura pesquisa de doutorado junto à Universidade Federal Fluminense, se propõe a elaborar uma breve trajetória historiográfica comparada dos gêneros populares massivos vinculados ao universo do pop/rock no Brasil e em Portugal, com vistas ao levantamento de hipóteses para a ocorrência de um intercâmbio assimétrico entre os dois países na atualidade. A despeito de Brasil e Portugal possuírem trajetórias bastante semelhantes no que diz respeito ao surgimento e à consolidação destes gêneros, a produção de bandas veteranas na cena pop/rock lusa, bem como dos novos nomes que surgiram na década de 90, alcançam uma penetração próxima de zero junto ao mercado fonográfico brasileiro, sobretudo se comparada ao prestígio de artistas mais vinculados à “tradição musical portuguesa”, consagrada entre nós, ou mesmo à popularidade desfrutada pela nossa música em Portugal. A partir dessa cartografia, confronto alguns argumentos que atribuem esta assimetria tanto a uma suposta dificuldade que nós, brasileiros, teríamos em compreender o português tal e qual falado (e cantado) em Portugal, quanto à inadequação entre a língua portuguesa e a matriz cultural anglo-americana do pop/rock – afirmações da esfera do senso comum que meu projeto de pesquisa tem a intenção de problematizar. Palavras-chave: História da Mídia Sonora; Música Popular Massiva; Relações Brasil- Portugal; Consumo Cultural Introdução As primeiras trocas sonoras sistemáticas entre Brasil e Portugal datam do século XVIII. -

As Músicas E Dedicatórias Que Passam Na Rádio Faneca São
As músicas e dedicatórias ANSELMO RALPH – NÃO ME TOCA BEIRUT – ELEPHANT GUN ANTÓNIO CALVÁRIO – CHORONA BEIRUT – NANTES que passam na Rádio ANTÓNIO CALVÁRIO – MOCIDADE BEIRUT – POSTCARDS FROM ITALY Faneca são todas AANTÓNIO MOURO – CHIQUITA BELLE & SEBASTIAN – PIAZZA, NEW MORENA YORK CATCHER escolhidas pelos ouvintes. ANTÓNIO MOURO – OH TEMPO VOLTA BELLE & SEBASTIAN – THE BOY WITH Nos dias 29, 30 e 31 de PARA TRÁS THE ARAB STRAP ANTÓNIO VARIAÇÕES – CANÇÃO DO BELLE & SEBASTIAN - FUNNY LITTLE Maio ouça a emissão em ENGATE FROG 103.9 FM ou em direto no ANTÓNIO VARIAÇÕES – ESTOU ALÉM BELLE AND SEBASTIAN – GET ME AWAY ANTÓNIO VARIAÇÕES – O CORPO É QUE FROM HERE, I'M DYING Jardim Henriqueta Maia. PAGA BELLE CHASE HOTEL – KURT WEILL TIME Eleja a música que mais ANTÓNIO VARIAÇÕES – TOMA O BELLE CHASE HOTEL – SÃO PAULO 451 COMPRIMIDO BENKING – STAND BY ME gosta e dedique-a à sua ANTÓNIO ZAMBUJO – FLAGRANTE BERLIN – TAKE MY BREATH AWAY família, aos seus amigos ou ANTÓNIO ZAMBUJO – ZORRO BEZEGOL – RUDE SENTIDO ARCADE FIRE – AFTERLIFE BILLY IDOL – REBEL YELL aos seus vizinhos! ARCADE FIRE – MODERN MAN BILLY JOEL – IN THE MIDDLE OF THE ARCADE FIRE – NEIGHBORHOOD #1 NIGHT A BANDA MAIS BONITA DA CIDADE – ARCADE FIRE – READY TO START BIRDS ARE INDIE – HIGH ON LOVE ORAÇÃO ARCADE FIRE – REBELLION SONGS A FLOCK OF SEAGULLS – WISHING ARCADE FIRE – REFLECTOR BIRDS ARE INDIE – I WILL SAY IT IN ABBA – DANCING QUEEN ARCADE FIRE – SPRAWL II YOUR FACE ABBA – FERNANDO ARETHA FRANKLIN – I SAY A LITTE BIRDS ARE INDIE – INSTEAD OF ABBA – MAMMA MIA PRAYER FOR YOU WATCHING -
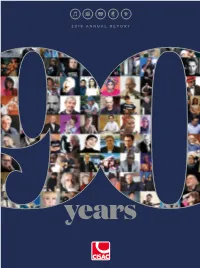
CISAC's 2016 Annual Report
2016 ANNUAL REPORT 2016 ANNUAL REPORT SERVING AUTHORS WORLDWIDE 1 CONTENTS Profile 03 PART 1 A year at PRESIDENCY ��������������������������������������������������������������������������16 a glance VICE PRESIDENTS ���������������������������������������������������������������18 Message from the President MESSAGE FROM THE DIRECTOR GENERAL �������20 “Through culture we connect people, we evoke emotions, we promote diversity.” BOARD OF DIRECTORS ���������������������������������������������������21 Jean-Michel Jarre Composer – Producer / KEY FIGURES ������������������������������������������������������������������������ 22 President of CISAC HEADLINES ����������������������������������������������������������������������������24 HIGHLIGHTS ����������������������������������������������������������������������������26 PART 2 Our BUILDING PARTNERSHIPS ��������������������������������������������46 expertise LEGAL & POLICY �����������������������������������������������������������������48 GOVERNANCE ��������������������������������������������������������������������50 Message from the Director General “Our priorities can be summed up in one phrase: BUSINESS & TECHNICAL INFRASTRUCTURE����� 52 fair remuneration for authors.” Gadi Oron COMMUNICATIONS �����������������������������������������������������������54 Director General INTERNATIONAL COUNCILS OF CREATORS ����������������������������������������������������������������������56 PART 3 Global GLOBAL REACH ������������������������������������������������������������������62 AFRICA �������������������������������������������������������������������������������������64 -

Cultural Struggles in the Lusofonia Arena: Portuguese-Speaking Migrant Musicians in Lisbon
AFRIKA FOCUS-Volume 26, Nr. I, 2013-pp. 67-88 Cultural struggles in the lusofonia arena: Portuguese-speaking migrant musicians in Lisbon Bart P. Vanspauwen Instituto de Etnomusicologia, New University of Lisbon, Portugal Approaching music as a point of social connection in the post-colonial city of Lisbon, where cultural entrepreneurs deploy the political concept oflusofonia, this study examines the ways in which local migrant musicians from Portuguese-speaking African countries (PALOPJ, as well as Brazil and East Timor, position themselves in this context. In general, the study shows that there is a lack of recognition of the contribution they make to the expressive culture of the Portuguese capital, and this is related to national preconceptions. Surprisingly, despite several existing coun ter-discourses regarding lusofonia, all interviewed musicians do see some future relevance in this concept. They appeal to both supranational institutions and national governments, asking for structural support in order to promote and disseminate all the expressive culture of Portuguese speaking African countries, indicating that the contribution of migrant musicians from these countries should be considered as an integral part of Portugal's cultural expression and heritage. Key words: Lusofonia, Portu9al, mi9rant musicians, cultural policy, postcolonialism 0 Mar foi ontem o que o idioma pode ser hoje, basta veneer algunsadamastores 1 Mia Couto 1. Introduction On 25 February 2ou, TAP, the Portuguese national airline, offering more than 70 weekly -

President Jean-Claude Juncker Wednesday, 29 June 2016 European Commission Rue De La Loi 200 1049 Brussels Belgium
President Jean-Claude Juncker Wednesday, 29 June 2016 European Commission Rue de la Loi 200 1049 Brussels Belgium Re. Securing a sustainable future for the European music sector Dear President Juncker, As recording artists and songwriters from across Europe and artists who regularly perform in Europe, we believe passionately in the value of music. Music is fundamental to Europe’s culture. It enriches people’s lives and contributes significantly to our economies. This is a pivotal moment for music. Consumption is exploding. Fans are listening to more music than ever before. Consumers have unprecedented opportunities to access the music they love, whenever and wherever they want to do so. But the future is jeopardised by a substantial “value gap” caused by user upload services such as Google’s YouTube that are unfairly siphoning value away from the music community and its artists and songwriters. This situation is not just harming today’s recording artists and songwriters. It threatens the survival of the next generation of creators too, and the viability and the diversity of their work. The value gap undermines the rights and revenues of those who create, invest in and own music, and distorts the market place. This is because, while music consumption is at record highs, user upload services are misusing “safe harbour” exemptions. These protections were put in place two decades ago to help develop nascent digital start-ups, but today are being misapplied to corporations that distribute and monetise our works. Right now there is a unique opportunity for Europe’s leaders to address the value gap. -

An Uncanny Cinema, a Cinema of the Uncanny. the Trope of the Doll In
ACTA UNIV. SAPIENTIAE, FILM AND MEDIA STUDIES, 15 (2018) 33–51 DOI: 10.1515/ausfm-2018-0002 An Uncanny Cinema, a Cinema of the Uncanny. The Trope of the Doll in the Films of Manoel de Oliveira Hajnal Király Sapientia Hungarian University of Transylvania (Cluj-Napoca, Romania) E-mail: [email protected] Abstract. I argue that the trope of the doll, recurrent throughout the films of Manoel de Oliveira, is a visual figure that beyond narrative becomes a discourse on modernity and modernism, stillness and movement, life and death. Accordingly, I propose an overview of occurences of dolls and of “dollness” throughout the work of Oliveira – from Aniki Bobó (1942) to The Strange Case of Angelica (2010) – with the aim of tracking the line of transformations of an emblematic object into an aesthetic principle, a central figure involving psychoanalytical concepts such as the Freudian “uncanny,” the fetish or the transitional object.1 Keywords: uncanny, doll, fetish, transitional object, modernity, modernism. Introduction: Defusing an Enigma Manoel de Oliveira is not only the longest lived film director of all times, active until his death, which occured at the very advanced age of 106, but also one of the most curious personalities of film history. Despite a scholarly interest in his films that used to participate regularly in prestigious European festivals, these were almost never shown in film theaters, therefore his work remains an “exquisite delicacy” for cinephiles. While praised by Serge Daney (2001), Jonathan Rosenbaum (1995) and David Bordwell (2013), just to name a few connaisseurs, most critics are puzzled when trying to discover a clue to his cinema, a task as difficult as finding out the secret of his advanced age. -

Biografia João Pedro Pais
Nasceu e viveu sempre em Lisboa. Na pré-primária já se lhe conhecia o jeito pela música, uma vez que os seus tios avós maternos eram quase todos músicos de guitarra portuguesa, viola, piano e violino. Também o desporto foi uma área a que se dedicou com afinco, durante a juventude, tendo-se tornado campeão por diversas vezes no estilo Greco-Romano. Não sendo a alta competição compatível com a vida de músico, João Pedro fez a sua última participação desportiva em 1995 no Rio de Janeiro, onde consegue o 1º lugar. Em 1997 lança finalmente o seu primeiro álbum de originais. Segredos revela-se um campeão de vendas logo à partida, onde os temas “Ninguém (é de ninguém)” e “Louco (por ti)” se tornam dos mais emblemáticos da sua carreira. Muitos espectáculos vão sendo agendados, o que o leva a ascender rapidamente no mundo da música em Portugal. Acarinhado por um público muito vasto, de norte a sul e arquipélagos, João Pedro Pais torna-se uma referência ímpar para muitos dos seus fãs. Outra Vez, o segundo disco, chega-nos em 1999. Mais uma vez consegue surpreender com a sua sonoridade ligada ao Pop/Rock, não descurando de letras genuínas e sentidas. É nomeado, pela segunda vez, para os Globos de Ouro na categoria de Melhor Interprete. O tema “Mentira” é também eleito para a categoria de Melhor Canção. Dois anos depois, Falar Por Sinais, vem consolidar o trabalho do artista que o país acompanha desde o seu início. O vídeo do tema “Um Resto de Tudo” é gravado em Barcelona e, mais tarde, “Não Há” é escolhido para banda sonora de uma telenovela portuguesa.