La Grande Borde Destin Exemplaire D’Une Campagne Lausannoise
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Administration Générale
CHAPITRE I Administration générale SECRÉTARIAT MUNICIPAL pement d’une presse indépendant en Europe centrale) a été renouvelée. Citons encore, dans un autre registre, l’adhésion renou- ACTIVITÉS GÉNÉRALES velée de la Ville aux actions de déminage et de préven- tion des accidents causés par les mines «antipersonnel» dans divers pays. La contribution Secrétariat de la Municipalité lausannoise pour l’an 2000 continue à refléter, de surcroît, la permanence de son engagement en faveur À la suite d’un départ à la retraite, une nouvelle réparti- de la défense des droits humains élémentaires dans la tion des tâches a permis une - modeste - diminution de société civile (au Mexique notamment, par le biais d’un l’effectif du personnel correspondant à 0.45 équivalent projet présenté par la FEDEVACO). Au registre de l'aide plein temps. Le recours constamment accru aux possi- humanitaire, le soutien accordé au Comité international bilités offertes par l’informatique a rendu cet ajustement de la Croix-Rouge et à l'Organisation mondiale contre la possible sans affecter l’exécution des tâches courantes torture a, de même, été reconduit. liées au secrétariat des séances de la Municipalité. Concernant les échanges en matière de «savoir-faire», Outre lesdites tâches, le Secrétariat municipal s’est la Municipalité a répondu favorablement à une demande préoccupé de divers dossiers touchant au fonctionne- provenant d’Algérie, en recevant un délégué de la mai- ment de l’administration, notamment en matière rie de Constantine pour un stage d’information d’une -

Balade Des Panoramas New.Pub
par Pierre Corajoud Ville en pente face au lac Léman et aux montagnes, Lausanne offre une série de panoramas généreux aux pro- meneurs. Cee balade en descente propose de découvrir les 10 plus beaux points de vue. Autant de perspec- ves différentes pour apprécier la ville et ses alentours. Départ : Arrêt « Lac de Sauvabelin » du bus n°16 Arrivée : Staon « Grancy » du métro m2 ou Gare-CFF Longueur : env. 6 kmDurée sans s’arrêter : 1h45 Cee balade qui passe par le centre-ville peut être fraconnée. Depuis l’arrêt du bus, suivez les flèches en bois indiquant la direcon à suivre pour rejoindre la tour en 5 minutes. 5’ (+10’ pour l’aller et retour au sommet de la tour) 1. Sur la tour de Sauvabelin Depuis le sommet de cee tour haute de 35 mètres et construite en 2003, la vue à 360° s’ouvre sur plusieurs horizons : on y découvre l’aggloméraon lausan- noise, le lac Léman et les trois régions géographiques de la Suisse ; les Alpes, le Jura et le Plateau. Cee tour a été bâe avec du bois, principalement du douglas, provenant des forêts de la Commune. Un exemple parmi d’autres qui fait de Lau- sanne une cité adepte du développement durable. Au pied de la tour, connuez par la suite de l’allée foresère goudronnée. Au bout de celle‐ci, prenez à gauche, puis descendez à droite. En bas de la descente, traversez la route au passage piéton au niveau d’un arrêt de bus, puis prenez le chemin qui passe un peu plus loin le long d’une maison à la façade orange pâle. -

Le Flon Toujours Plus Attractif
No 4_HIVER 2015 LE FLON TOUJOURS PLUS ATTRACTIF LE STCC A CINQ ANS LA MENDICITÉ NE POUR ÊTRE RENTABLE FAIBLIT PAS www.wurlod.ch Halle commerciale à Conthey Photographe : Adrien Barakat / www.dwk-photography.com Copyright : www.architectes.ch WnG Solutions WURLOD ARCHITECTES +41 21 729 93 64 [email protected] www.wurlod.ch Economie Région Lausanne est une association économique qui s’engage, par des interventions, du financement ou des articles, dans les grands dossiers dont dépend la prospérité de la région lausannoise tant en matière d’urbanisme, de mobilité que d’infra structures. O Halle commerciale à Conthey N 4 // SOMMAIRE 4 ÉDITORIAL 25 ASSOCIATION Le Flon : Inter Rush fête ses 50 ans une perpétuelle mutation ! 26 CULTURE 6 URBANISME Les promesses de la Salle Métropole Comment le quartier du Flon poursuit son développement 30 ARCHITECTURE Les défis de la rénovation 10 DISTINCTION e de la tour Bel-Air 14 concours PERL, démarquez-vous ! 11 INFRASTRUCTURES 34 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 3 Le SwissTech Convention Center sur la voie de la rentabilité DES COMMERÇANTS LAUSANNOIS Du neuf pour valoriser le commerce 18 VIE QUOTIDIENNE La mendicité à Lausanne n’a pas fini d’inquiéter 36 SICOL Une seule et même entité économique 21 PORTRAIT La FIVB, une entreprise qui 37 GASTRO LAUSANNE en appelle d’autres Plein d’idées et de projets pour 2016 23 JOJ 2020 38 SIC DE PRILLY Du rêve au projet réel Fusion avec la SICOL 24 SOCIÉTÉ Une crèche interentreprises pour les PME Photographe : Adrien Barakat / www.dwk-photography.com Copyright : www.architectes.ch Paraît 4 fois par an Secrétariat ERL et régie des annonces Impression Rue du Petit-Chêne 38 – Case postale 1215 – 1001 Lausanne Rédacteur responsable Tél. -

Lausanne, L'exposition
CANTON DE VAUD DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE (DFJC) SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES École-Musée dp • n°62–2018 Musée Historique LAUSANNE, Lausanne L’EXPOSITION PRÉAMBULE Degrés ciblés : 4e-8e P Objectif : préparer la visite de la nouvelle exposition permanente du Musée historique Lausanne en trois temps : • avant la visite avec un débat sur la ville actuelle, une initiation à la démarche historique et la présentation de certains métiers du musée constituant le fil rouge de la visite ; • pendant la visite par le biais de thématiques d’exploration à choix exploitées dans des fiches d’activités ; • après la visite avec la correction collective des fiches d’activités et des propositions de pro- longement en lien avec les métiers du musée. Domaines d’enseignement : sciences sociales – « les enjeux de la société dans leurs dimensions sociales, culturelles, économiques, politiques et environnementales », français et arts visuels. Matériel : fiches d’activités et corrigés téléchargeables sur www.lausanne.ch/mhl/Ecole- Musee-dossier. La forme masculine est uniquement utilisée dans le présent dossier, mais elle recouvre les deux formes, masculine et féminine. SOMMAIRE INFOS PRATIQUES POUR LES ÉCOLES ........................................................ 2 LE MUSÉE HISTORIQUE LAUSANNE EN QUELQUES MOTS ........................... 3 LAUSANNE, L’EXPOSITION .....................................................................................5 SE PRÉPARER ........................................................................................... -

Confection D'une Brochure
CONFECTION D’UNE BROCHURE 1 2 Plier les feuilles dans le sens de la hauteur Plier une nouvelle fois les feuilles, dans le sens (pour un meilleur rendu, vous pouvez coller de la largeur. (le plus petit numéro de page les pages après les avoir pliées). doit être à l’extérieur). 3 4 Assembler les différentes pages. Maintenez le tout à l’aide d’un élastique. Reproduction interdite, tous droits réservés Randonature Sàrl POUR EN SAVOIR PLUS Lausanne, un lieu, un bourg, une ville. Antoinette Pitteloud et Charles Duboux (dir.), Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2002. Bâtir, 75 ans, 1926 - 2001. Journal de la construction de la Suisse romande. InEdit Publications SA, Saint-Sulpice, 2001. Le jardin botanique à Lausanne. Musée et jardins botaniques cantonaux, Lausanne, 1996. www.lausanne.ch (Site officiel de la Ville de Lausanne) www.cisrl.ch (Comunauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud) http://dbserv1-bcu.unil.ch/dbbcu/persovd/centenaire.php (Centenaire du Palais de Rumine) CRÉDITS DES TEXTES ET ILLUSTRATIONS Ce sentier a été créé par Randonature Sàrl sur la base du dépliant «Lausanne Promenades». Une partie des informations présentées dans cet ouvrage est issue des ouvrages et sites internet listés ci-dessus. Textes et images © Randonature Sàrl 2007, excepté images pp. 5, 8, Randonature Sàrl ne peut être tenue pour responsable 14, 17, 23, 26, 30, 32: Musée historique de la Ville de Lausanne, p.8: de l’état des chemins, d’un accident survenu sur cet itinéraire Palais de Beaulieu, pp. 19-20: Opéra de Lausanne. Cartes: Lausanne ni du fait que vous vous y égariez. -

Confection D'une Brochure
CONFECTION D’UNE BROCHURE 1 2 Plier les feuilles dans le sens de la hauteur Plier une nouvelle fois les feuilles, dans le sens (pour un meilleur rendu, vous pouvez coller de la largeur. (le plus petit numéro de page les pages après les avoir pliées). doit être à l’extérieur). 3 4 Assembler les différentes pages. Maintenez le tout à l’aide d’un élastique. Reproduction interdite, tous droits réservés Randonature Sàrl NATURE ATTITUDE POUR EN SAVOIR PLUS • Pour votre sécurité, restez sur les chemins. Service des forêts, domaines et vignobles de la Ville de Lausanne • Les régions que vous traversez sont très fréquentées. Afin de Au Boscal préserver certaines zones de tranquillité pour la faune, veuillez Route des Corbessières 4 suivre l’itinéraire tel qu’il est décrit ici. Case postale 27 1000 Lausanne 25 • La nature vous sera reconnaissante de ne pas lui abandonner vos [email protected] déchets. Tél. +41 21 315 42 77 Fax +41 21 315 42 83 • Avant votre départ, renseignez-vous sur les conditions météo et sur l’enneigement. CRÉDITS DES TEXTES ET ILLUSTRATIONS Ce sentier a été créé par Randonature. Textes et images ©Randonature Sàrl 2009, exceptés images: pp. 6, 18 & 20 ©FODOVI; pp. 11, 12, 13, 14, 15, 16 & 17 ©Musée historique de Lausanne; p. 13 ©hublera; p. 14 ©1suisse; p. 21 ©http:// cuisinesauvage.blogspot.com: P. 22 ©Eric in SF Randonature Sàrl ne peut être tenue pour responsable de l’état des chemins, d’un accident survenu sur cet itinéraire ou du fait que vous vous y égariez. RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS ET L’utilisation de ce guide -

Lausanne Incontournables
Lausanne INcontournablEs Tout ce que vous devez absolument voir et découvrir! olympic.org/musee OUVERTURE PRINTEMPS 2017 Quai d’Ouchy 1 AQUATIS.CH 1006 Lausanne – Suisse [email protected] Partenaire officiel du Musée Olympique : 1 Bienvenue à Lausanne, ville festive et novatrice! Depuis une quinzaine d’années, la Capitale Olympique, sous l’élan de sa jeunesse cosmopolite, est devenue une destination urbaine courue. Venez découvrir ses boutiques de créateurs à foison, une vie nocturne digne des capitales européennes et une douceur de vivre incomparable. Championne du développement durable, la ville vous dévoile ses différentes facettes à la force des mollets ou en transports publics. Quartier trendy, vieille ville, bord du lac et campus universitaire, hauts forestiers, sans oublier les communes voisines… cette brochure vous emmène découvrir les lieux incontournables de Lausanne et son agglomération. Pour prolonger le plaisir, Lausanne Tourisme innove en proposant des visites virtuelles à 360°: vous avez la possibilité, grâce à votre appareil mobile, de repérer divers points d’intérêt et de rentrer dans certains commerces. A pied, en bus, en métro, sur votre tablette ou votre smartphone, les richesses de la capitale vaudoise n’auront plus aucun secret pour vous. Toute l’équipe de Lausanne Tourisme vous souhaite une visite de notre cité riche en émotions et en expériences fortes, à partager en famille, entre amis ou avec les internautes du monde entier! Steeve Pasche Directeur UNE INSTITUTION DEPUIS 150 ANS Fondée en 1867, la maison JUNOD reste aujourd’hui la plus ancienne horlogerie - bijouterie de Suisse Romande tenue par la même famille sans interruption. -

De Quelques Anciens Noms De Lieux De Lausanne
De quelques anciens noms de lieux de Lausanne Autor(en): Reymond, Maxime Objekttyp: Article Zeitschrift: Revue historique vaudoise Band (Jahr): 27 (1919) Heft 1 PDF erstellt am: 07.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-22366 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Ma femme est tres sensible a l'honneur de vostre souvenir et vous en rend de tres humbles gräces; pour moy je seray toutte ma vie avec tout {'attachement imaginable Monsieur Vostre tres humble et tres obeissant serviteur MARTIN IERE. DE QUELQUES ANCIENS NOMS DE LIEUX DE LAUSANNE Le nom de Lausanne est connu par une inscription du IP siecle et par quelques documents administratifs ä peu pres contemporains. -

Beaulieu Redevient Un Palais
Printemps o 2011 N 1 paraît 4 fois par an Beaulieu redevient un palais ÉDITO Beaulieu redevient un palais No 1 3 Sommaire Michel Berney Président SIC Fermeture du Grand Pont, Lausanne Economie: Décodage du plan d’appui au tout reste à faire ! développement économique (PADE) 04 Comme chacun l’aura appris et comme présenté à plusieurs reprises déjà dans nos colonnes, le cœur de Equipement: la ville sera profondément remodelé selon les projets de réorganisation des modes de déplacements avec Les coulisses de l’exploit en particulier, à un horizon relativement proche, la fermeture aux voitures de l’axe Grand-Pont vers la place des halles sud de Beaulieu 13 Chauderon voire de la place Saint-François. Cette dernière, dont l’importance au centre ville n’est pas à Commerçants: démontrer, est actuellement un carrefour routier de première importance. Une rencontre de début Pour moi, les restrictions de circulation dans diverses zones sont une nouvelle opportunité qu’il s’agit de sai- sir pour développer l’activité des centres villes et leur attractivité y compris pour les commerces concernés, d’année plutôt optimiste 18 à condition, bien entendu, qu’elles soient accompagnées de mesures comme de nouveaux parkings et de Evénement: nouvelles offres de transport public garantissant l’accessibilité aux nouvelles zones protégées et aux com- WG-2011, Lausanne aux merces. couleurs de 23 000 gymnastes 21 Cette importante question a été, à plusieurs reprises, un thème central des débats organisés avec les can- didats à la Municipalité. Mobilité : Si le principe même de la restitution de certaines zones aux piétons, aux transports publics et à la mobilité 1200 places pour 20000 douce ne semble pas contesté par les acteurs principaux de la vie politique et économique, il n’en est pas pendulaires, où est l’erreur? 23 de même pour le traitement du report de trafic qui sera généré. -

À La Découverte De L'art Dans L'espace Public Lausannois
GUIDE À la découverte de l’art dans l’espace public lausannois Avec ses cartes, ses descriptifs des œuvres qui vivent dans l’espace public lausannois, ses parcours et son podcast, Art en ville ouvre d’innombrables explorations potentielles. Il nous invite à parcourir la ville de biais et de travers, à nous perdre, à regarder en haut et en bas, à ouvrir le champ de notre curiosité. Alors, explorons ! Et agrémentons joyeusement les parcours proposés de toute trouvaille personnelle ou coup de cœur subjectif. Édité par le Service de la culture de la Ville de Lausanne, le guide Art en ville permet aux Lausannoises et Lausannois de jeter un regard neuf sur la richesse artistique de leur cité et aux hôtes de passage d’en avoir un fort bel aperçu. Il s’adresse à toutes et à tous : curieux, férus de culture, amateurs d’art, passionnés d’histoire, amoureux de Lausanne, urbains convaincus et promeneurs de tous âges. www.artenville.ch SOMMAIRE Avant-propos Grégoire Junod, syndic de Lausanne ........................... 07 Art en ville en bref ........................................................ 10 Un site ... et un podcast ! ............................................... 13 Une ville : cinq territoires à explorer ............................ 14 Secteur Centre ............................................................... 16 Secteur Est ..................................................................... 42 Secteur Nord .................................................................. 56 Secteur Ouest ................................................................ 68 Secteur Sud .................................................................... 82 Vos notes et dessins en chemin .................................... 100 5 LAUSANNE Musée à ciel ouvert Avec plus d’une vingtaine de musées et lieux d’art, une scène artistique en constante ébullition, l’ancrage de Plateforme 10 au cœur de la ville et l’ECAL à quelques encablures, Lausanne est une ville résolument culturelle qui dynamise depuis plus d’un siècle l’art et la création sur le plan régional et supra-régional. -
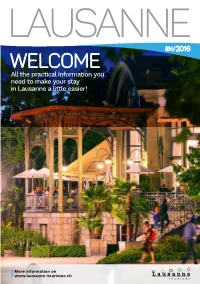
Le Vieil Ouchy OUVERT 7/7 One Country
Lausanne EN/2016 WELCOME All the practical information you need to make your stay in Lausanne a little easier! More information on www.lausanne-tourisme.ch RéSIDENCES MEUBLéES DE HAUT STANDING FIRST CLASS FURNISHED RESIDENCES Louez un studio ou un rent a studio or a fLat, appartement meubLé furnished and fuLLy et entièrement équipés, equipped, pour La durée de votre for the duration of séjour à Lausanne. you stay in Lausanne. (minimum 1 mois) (1 month at least) Vous êtes ici comme à la maison. Il ne Make yourself at home. All you need is manque que vos effets personnels… your own personal effects… serviCes personnaLisés Customized serviCes dès Chf 2’000.– from Chf 2’000.- par mois tout compris per month, all inclusive Location meublée courte ou longue durée de : studios | appartements | villas | propriétés de haut standing Rue de Bourg 27 1003 Lausanne Tel : +41 21 323 55 16 Fax : +41 21 323 89 94 [email protected] www.oklogements.ch © www.sabina.ch WELCOME... ... to Lausanne, a city that you won’t find easy to forget! In the heart of Europe, just 40 minutes from Geneva International Airport, the many attractions of the Olympic Capital will help turn your stay into a unique experience. Situated by Lake Geneva and renowned for its pleasant way of life, this city seduces both business travellers and tourists alike. It is appreciated not only for its gourmet restaurants and its palaces, but also for the trendy restaurants and boutique hotels whose numbers have increased in recent years. A packed calendar of cultural events offers entertainment all year round in the form of open-air festivals, a wide variety of museums, concerts of every kind, operas and ballets. -

L'eau En Milieu Urbain
L’eau en milieu urbain Parcours au fil du Flon et de la Vuachère L’eau en milieu urbain 1 Association Lausanne Roule Le projet Les Baladeurs est un projet de l'association à but non lucratif Lausanne Roule, créée en 2004. Reconnue d'utilité publique, elle met gratuitement des vélos à disposition à Lausanne, Renens (Ouest Roule) et Vevey (Vevey Roule). Ce projet est basé sur les principes du développement durable en promouvant la mobilité douce, l'intégration sociale et la santé. Vélo attitude Cette balade a été conçue pour s’effectuer à vélo. En utilisant ce mode de déplacement, vous faites un geste pour votre santé et pour l’environnement !Le vélo en ville peut sembler un exercice périlleux, mais tout est question d’habitude ! Prendre sa place sur la route s’apprend, même lorsqu’il n’y a pas de piste cyclable. Cela vaut la peine de persévérer, car plus il y aura d’usagères et d’usagers, mieux ils se feront respecter et plus les aménagements se développeront ! L’eau en milieu urbain 2 Règles de sécurité du cycliste urbain Roulez à droite, laissez environ 1m de distance au bord, quitte à faire ralentir les voitures derrière vous. Portez un casque. Empruntez les pistes cyclables lorsqu’il y en a. Indiquez bien vos intentions aux automobilistes. Roulez en file indienne sur les routes. Aux feux, placez-vous de façon à ce que les voitures vous voient, si possible à l’avant de la file. Anticipez toujours (une portière qui s'ouvre, un freinage brusque) et réduisez votre vitesse à l’approche des intersections.