Un Demi-Siecle D'aeronautique En France
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Home at Airbus
Journal of Aircraft and Spacecraft Technology Original Research Paper Home at Airbus 1Relly Victoria Virgil Petrescu, 2Raffaella Aversa, 3Bilal Akash, 4Juan M. Corchado, 2Antonio Apicella and 1Florian Ion Tiberiu Petrescu 1ARoTMM-IFToMM, Bucharest Polytechnic University, Bucharest, (CE), Romania 2Advanced Material Lab, Department of Architecture and Industrial Design, Second University of Naples, 81031 Aversa (CE), Italy 3Dean of School of Graduate Studies and Research, American University of Ras Al Khaimah, UAE 4University of Salamanca, Spain Article history Abstract: Airbus Commerci al aircraft, known as Airbus, is a European Received: 16-04-2017 aeronautics manufacturer with headquarters in Blagnac, in the suburbs of Revised: 18-04-2017 Toulouse, France. The company, which is 100% -owned by the industrial Accepted: 04-07-2017 group of the same name, manufactures more than half of the airliners produced in the world and is Boeing's main competitor. Airbus was Corresponding Author: founded as a consortium by European manufacturers in the late 1960s. Florian Ion Tiberiu Petrescu Airbus Industry became a SAS (simplified joint-stock company) in 2001, a ARoTMM-IFToMM, Bucharest subsidiary of EADS renamed Airbus Group in 2014 and Airbus in 2017. Polytechnic University, Bucharest, (CE) Romania BAE Systems 20% of Airbus between 2001 and 2006. In 2010, 62,751 Email: [email protected] people are employed at 18 Airbus sites in France, Germany, the United Kingdom, Belgium (SABCA) and Spain. Even if parts of Airbus aircraft are essentially made in Europe some come from all over the world. But the final assembly lines are in Toulouse (France), Hamburg (Germany), Seville (Spain), Tianjin (China) and Mobile (United States). -
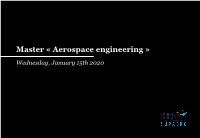
Presentation of ISAE-SUPAERO
Master « Aerospace engineering » Wednesday, January 15th 2020 Who are we ? Where are we located? Since 1909, leader of higher education in aerospace engineering Creation of l’Ecole Nationalization : Supérieure d’Aéronautique Ecole Nationale or « SUPAERO » by Supérieure Colonel Roche d’Aéronautique SUPAERO moves to Toulouse (ENSAE) Merger into a single institution, ISAE PARIS 1909 1930 1945 1961 1968 1979 2007 2015 TOULOUSE Creation of l’Ecole L’ENTA becomes L’ENICA becomes ISAE-SUPAERO on Nationale des ENICA and moves ENSICA a single campus Travaux to Toulouse (Ecole Nationale Aéronautiques Supérieure d'Ingénieurs en Constructions SUPAERO Aéronautiques) ENTA – ENITA - ENSICA ISAE -SUPAERO ISAE-SUPAERO / 3 Our alumni, pioneer engineers Henri Coanda 1910 Creator of the first jet aircraft 1913 Mikhail Gurevitch Designer of MiG-1 to MiG-25 planes André Lefèbvre 1914 Designer of Citroën Traction avant (front-wheel drive), 2CV 1922 Alexandre Kartveli and DS Designer of P-47 Thunderbolt and F-84 Thunderjet Pierre Satre 1934 Father of the « Caravelle » 1943 Jean Bertin Hovertrain creator Henri Perrier 1953 Test engineer then Concorde program manager 1978 Charles Champion A380 program manager Lionel de la Sayette 1979 Rafale program manager 1991 Christophe Robin Dyn’Aéro Light ISAE-SUPAERO / 44 planes Our alumni, leaders of industry Henri Potez 1911 Founder of Potez Aéronautique 1913 Marcel Bloch-Dassault Founder of Dassault Aviation Henri Ziegler 1931 CEO of Aerospatiale Founder of Airbus Industries 1944 René Ravaud CEO SNECMA (1971-82), Founder -

3-VIEWS - TABLE of CONTENTS to Search: Hold "Ctrl" Key Then Press "F" Key
3-VIEWS - TABLE of CONTENTS To search: Hold "Ctrl" key then press "F" key. Enter manufacturer or model number in search box. Click your back key to return to the search page. It is highly recommended to read Order Instructions and Information pages prior to selection. Aircraft MFGs beginning with letter A ................................................................. 3 B ................................................................. 6 C.................................................................10 D.................................................................14 E ................................................................. 17 F ................................................................. 18 G ................................................................21 H................................................................. 23 I .................................................................. 26 J ................................................................. 26 K ................................................................. 27 L ................................................................. 28 M ................................................................30 N................................................................. 35 O ................................................................37 P ................................................................. 38 Q ................................................................40 R................................................................ -

79952 Federal Register / Vol
79952 Federal Register / Vol. 75, No. 244 / Tuesday, December 21, 2010 / Rules and Regulations Unsafe Condition DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 1601 Lind Avenue, SW., Renton, (d) This AD was prompted by an accident Washington 98057–3356; telephone and the subsequent discovery of cracks in the Federal Aviation Administration (425) 227–1137; fax (425) 227–1149. main rotor blade (blade) spars. We are issuing SUPPLEMENTARY INFORMATION: 14 CFR Part 39 this AD to prevent blade failure and Discussion subsequent loss of control of the helicopter. [Docket No. FAA–2009–0864; Directorate We issued a supplemental notice of Compliance Identifier 2008–NM–202–AD; Amendment 39–16544; AD 2010–26–05] proposed rulemaking (NPRM) to amend (e) Before further flight, unless already 14 CFR part 39 to include an AD that done: RIN 2120–AA64 would apply to the specified products. (1) Revise the Limitations section of the That supplemental NPRM was Airworthiness Directives; DASSAULT Instructions for Continued Airworthiness by published in the Federal Register on AVIATION Model Falcon 10 Airplanes; establishing a life limit of 8,000 hours time- July 27, 2010 (75 FR 43878). That Model FAN JET FALCON, FAN JET in-service (TIS) for each blade set Remove supplemental NPRM proposed to FALCON SERIES C, D, E, F, and G each blade set with 8,000 or more hours TIS. correct an unsafe condition for the Airplanes; Model MYSTERE-FALCON (2) Replace each specified serial-numbered specified products. The MCAI states: 200 Airplanes; Model MYSTERE- blade set with an airworthy blade set in During maintenance on one aircraft, it was accordance with the following table: FALCON 20–C5, 20–D5, 20–E5, and 20– F5 Airplanes; Model FALCON 2000 and discovered that the overpressure capsules were broken on both pressurization valves. -

DASSAULT AVIATION Model Falcon 10 Airplanes
43878 Federal Register / Vol. 75, No. 143 / Tuesday, July 27, 2010 / Proposed Rules Applicability New Requirements of This AD: Actions Bulletin SBF100–27–092, dated April 27, (c) This AD applies to Fokker Services B.V. (h) Within 30 months after the effective 2009; and Goodrich Service Bulletin 23100– Model F.28 Mark 0100 airplanes, certificated date of this AD, do the actions specified in 27–29, dated November 14, 2008; for related in any category, all serial numbers. paragraphs (h)(1) and (h)(2) of this AD information. concurrently. Accomplishing the actions of Issued in Renton, Washington, on July 21, Subject both paragraphs (h)(1) and (h)(2) of this AD 2010. (d) Air Transport Association (ATA) of terminates the actions required by paragraph Jeffrey E. Duven, America Code 27: Flight Controls. (g) of this AD. (1) Remove the tie-wrap, P/N MS3367–2– Acting Manager, Transport Airplane Reason 9, from the lower bolts of the horizontal Directorate, Aircraft Certification Service. (e) The mandatory continuing stabilizer control unit, in accordance with the [FR Doc. 2010–18399 Filed 7–26–10; 8:45 am] airworthiness information (MCAI) states: Accomplishment Instructions of Fokker BILLING CODE 4910–13–P Two reports have been received where, Service Bulletin SBF100–27–092, dated April during inspection of the vertical stabilizer of 27, 2009. F28 Mark 0100 aeroplanes, one of the bolts (2) Remove the lower bolts, P/N 23233–1, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION that connect the horizontal stabilizer control of the horizontal stabilizer control unit and unit actuator with the dog-links was found install bolts, P/N 23233–3, in accordance Federal Aviation Administration broken (one on the nut side & one on the with the Accomplishment Instructions of Goodrich Service Bulletin 23100–27–29, head side). -

Appendix a Tables of Fermat Numbers and Their Prime Factors
Appendix A Tables of Fermat Numbers and Their Prime Factors The problem of distinguishing prime numbers from composite numbers and of resolving the latter into their prime factors is known to be one of the most important and useful in arithmetic. Carl Friedrich Gauss Disquisitiones arithmeticae, Sec. 329 Fermat Numbers Fo =3, FI =5, F2 =17, F3 =257, F4 =65537, F5 =4294967297, F6 =18446744073709551617, F7 =340282366920938463463374607431768211457, Fs =115792089237316195423570985008687907853 269984665640564039457584007913129639937, Fg =134078079299425970995740249982058461274 793658205923933777235614437217640300735 469768018742981669034276900318581864860 50853753882811946569946433649006084097, FlO =179769313486231590772930519078902473361 797697894230657273430081157732675805500 963132708477322407536021120113879871393 357658789768814416622492847430639474124 377767893424865485276302219601246094119 453082952085005768838150682342462881473 913110540827237163350510684586298239947 245938479716304835356329624224137217. The only known Fermat primes are Fo, ... , F4 • 208 17 lectures on Fermat numbers Completely Factored Composite Fermat Numbers m prime factor year discoverer 5 641 1732 Euler 5 6700417 1732 Euler 6 274177 1855 Clausen 6 67280421310721* 1855 Clausen 7 59649589127497217 1970 Morrison, Brillhart 7 5704689200685129054721 1970 Morrison, Brillhart 8 1238926361552897 1980 Brent, Pollard 8 p**62 1980 Brent, Pollard 9 2424833 1903 Western 9 P49 1990 Lenstra, Lenstra, Jr., Manasse, Pollard 9 p***99 1990 Lenstra, Lenstra, Jr., Manasse, Pollard -

Avions Civils
SOMMAIRE DU VOLUME I LA CONDUITE DES PROGRAMMES CIVILS AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS........................................................................... 3 PREFACE.............................................................................................................................. 5 PRESENTATION GENERALE ............................................................................................. 9 CHAPITRE 1 PRESENTATION DE L’ACTIVITE...................................................................................... 11 LE MARCHE DU TRANSPORT AERIEN .................................................................................. 11 Le passager et l’évolution du trafic.......................................................................................... 11 Les compagnies et la flotte d’avions ....................................................................................... 13 LA CONSTRUCTION DES AVIONS CIVILS .............................................................................. 14 Les caractéristiques de l’activité.............................................................................................. 14 La compétition et son évolution............................................................................................... 18 La dimension économique et monétaire ................................................................................. 20 L’ ADMINISTRATION ET SES MISSIONS ................................................................................. 22 La tutelle militaire de -

Los Motores Aeroespaciales, A-Z
Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA ISBN 978-84-608-7523-9 < aeroteca.com > Depósito Legal B 9066-2016 Título: Los Motores Aeroespaciales A-Z. © Parte/Vers: 1/12 Página: 1 Autor: Ricardo Miguel Vidal Edición 2018-V12 = Rev. 01 Los Motores Aeroespaciales, A-Z (The Aerospace En- gines, A-Z) Versión 12 2018 por Ricardo Miguel Vidal * * * -MOTOR: Máquina que transforma en movimiento la energía que recibe. (sea química, eléctrica, vapor...) Sponsored by L’Aeroteca - BARCELONA ISBN 978-84-608-7523-9 Este facsímil es < aeroteca.com > Depósito Legal B 9066-2016 ORIGINAL si la Título: Los Motores Aeroespaciales A-Z. © página anterior tiene Parte/Vers: 1/12 Página: 2 el sello con tinta Autor: Ricardo Miguel Vidal VERDE Edición: 2018-V12 = Rev. 01 Presentación de la edición 2018-V12 (Incluye todas las anteriores versiones y sus Apéndices) La edición 2003 era una publicación en partes que se archiva en Binders por el propio lector (2,3,4 anillas, etc), anchos o estrechos y del color que desease durante el acopio parcial de la edición. Se entregaba por grupos de hojas impresas a una cara (edición 2003), a incluir en los Binders (archivadores). Cada hoja era sustituíble en el futuro si aparecía una nueva misma hoja ampliada o corregida. Este sistema de anillas admitia nuevas páginas con información adicional. Una hoja con adhesivos para portada y lomo identifi caba cada volumen provisional. Las tapas defi nitivas fueron metálicas, y se entregaraban con el 4 º volumen. O con la publicación completa desde el año 2005 en adelante. -Las Publicaciones -parcial y completa- están protegidas legalmente y mediante un sello de tinta especial color VERDE se identifi can los originales. -
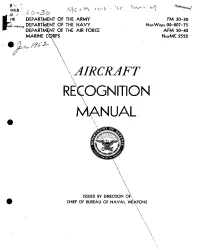
\Aircraft Recognition Manual
Jf V t 9fn I 4-'!- Vw'^ ' 'o | ^ renai; 408.$ /•> ,A1.AI / -3o FM DEPARTMENT OF THE ARMY FM 30-30 DEPARTMENT OF THE NAVY NavWeps 00-80T-75 DEPARTMENT OF THE AIR FORCE AFM 50-40 MARINE CORPS NavMC 2522 \AIRCRAFT RECOGNITION MANUAL SI ISSUED BY DIRECTION OF\ CHIEF OF BUREAU OF NAVAL WEAPONS \ \ I 4 DEPARTMENT OF THE ARMY FM 30-30 DEPARTMENT OF THE NAVY NavWeps 00-80T-75 DEPARTMENT OF THE AIR FORCE AFM 50-40 MARINE CORPS NavMC 2522 AIRCRAFT RECOGNITION MANUAL •a ISSUED BY DIRECTION OF CHIEF OF BUREAU OF NAVAL WEAPONS JUNE 1962 DEPARTMENTS OF THE ARMY, THE NAVY AND THE AIR FORCE, WASHINGTON 25, D.C., 15 June 1962 FM 30-30/NAVWEPS 00-80T-75/AFM 50-40/NAVMC 2522, Aircraft Recognition Manual, is published for the information and guidance of all concerned. i BY ORDER OF THE SECRETARIES OF THE ARMY, THE NAVY, AND THE AIR FORCE: G. H. DECKER, General, Umted States Army, Official: Chief of Staff. J. C. LAMBERT, Major General, United States Army, The Adjutant General. PAUL D. STROOP Rear Admiral, United States Navy, Chief, Bureau of Naval Weapons. CURTIS E. LEMAY, Official: Chief of Staff, United States Air Force, R. J. PUGH, Colonel, United States Air Force, Director of Administrative Services. C. H. HAYES, Major General, U.S. Marine Corps, Deputy Chief of Staff (Plans). H DISTRIBUTION: ARMY: Active Army : DCSPER (1) Inf/Mech Div Co/Btry/Trp 7-2 44-112 ACSI (1) (5) except Arm/Abn Div 7- 44-236 52 DCSLOG (2) Co/Trp (1) 8- 44-237 137 DCSOPS(5) MDW (1) 8-500 (AA- 44-446 ACSRC (1) Svc Colleges (3) AH) 44447 CNGB (1) Br Svc Sch (5) except 10-201 44^536 -

L'arsenal De L'aéronautique
L’impressionnant bimoteur prototype VG 10-02 en cours de montage durant l’hiver 1944-1945. L’Arsenal de l’aéronautique Ce devait être une société laboratoire, un modèle. Ce ne fut qu’un constructeur de plus, mais ses ingénieurs avec l’assistance des Centre d’essais mirent au point toutes les techniques modernes. 1 Capable d’enterrer les meilleures idées et les projets les plus utiles, le corbillard de la mort est un vé- hicule commandé par trois forts leviers : la bêtise, la mollesse et la fainéantise. On repère le premier à son inscription : « je ne sais pas », le second porte la mention : « je ne veux pas », le troisième : « ce n’est pas à moi de la faire ». Gérard Hartmann, 33 ans d’expérience professionnelle. 2 Une société modèle Dans les années trente, les députés (qui votent les budgets) et les dirigeants militaires français réalisent que par suite de manque de concentration et de partage des compétences, l’industrie aéronautique nationale a pris du re- tard par rapport aux grandes nations étrangè- res, Allemagne, Italie, Russie, Etats-Unis, Grande-Bretagne. C’est pourquoi ils décident de doter la France des structures adéquates. Avant même l’arrivée au pouvoir du Front po- pulaire, le rapporteur du budget de l’Air, le député socialiste Pierre Renaudel (1871-1935) défend l’idée d’une « société d’étude et de construction aéronautique modèle » (d’Etat). Ce sera L’Arsenal de l’aéronautique. La Grande soufflerie de Chalais-Meudon, inaugurée en 1934. Le Centre d’Essais des Moteurs et des Hélices de l’aviation militaire française passe sous le contrôle du ministère de l’Air. -

Andrew S. Burrows, Robert S. Norris William M
0?1' ¥t Andrew S. Burrows, Robert S. Norris William M. Arkin, and Thomas B. Cochran GREENPKACZ Damocles 28 rue des Petites Ecuries B.P. 1027 75010 Paris 6920 1 Lyon Cedex 01 Tel. (1) 47 70 46 89 TO. 78 36 93 03 no 3 - septembre 1989 no 3809 - maWaoOt 1989 Directeur de publication, Philippe Lequenne CCP lyon 3305 96 S CPPAP no en cours Directeur de publication, Palrtee Bouveret CPPAP no6701 0 Composition/Maquette : P. Bouverei Imprime sur papier blanchi sans chlore par Atelier 26 / Tel. 75 85 51 00 Depot legal S date de parution Avant-propos a ['edition fran~aise La traduction fran~aisede cette etude sur les essais nucleaires fran~aisentre dans Ie cadre d'une carnpagne mondiale de GREENPEACEpour la denuclearisation du Pacifique. Les chercheurs americains du NRDC sont parvenus a percer Ie secret qui couvre en France tout ce qui touche au nucleaire militaire. Ainsi, la France : - a effectub 172 essais nucleaires de 1960 a 1988. soil environ 10 % du nornbre total d'essais effectues depuis 1945 ; - doit effectuer 20 essais pour la rnise au point d'une t6te d'ame nuclhaire ; - effectual! 8 essais annuels depuis quelques annees et ces essais ont permis la mise au point de la bombe a neutrons des 1985 ; - a produit, depuis 1963, environ 800 tetes nuclbaires et pres de 500 sont actusllement deployees ; - a effectue pks de 110 essais souterrains a Mururoa. Les degats causes a I'atatI sont tres importants. La rbcente decision oflicielle du regroupement des essais en une seule carnpagne de tirs annuelle n'a probablement pas ete prise uniquernent pour des imperatifs econamiques ou de conjoncture internationale. -

19710017233.Pdf
PREVIOUS BIBLIOGRAPHIES IN THIS SERIES NASA SP-7037 Scptemher 1970 Jan. itug. 1970 W'ASA SP-7037 (01) Januar~197 I Scpt. Uec. 1970 NASA SP-7037 (02) AERONAUTICAL ENGINEERING A Special Bibliography Supplement 2 A selection of annotated references to unclas- sified reports and journal articles that were introduced into the NASA scientific and tech- nical information system and announced in January 1971 in Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR) International Aerospace Abstracts (IAAI. Scieirtijic atrd Techirical Iirjomratioir 0jfic-e OFFICE OF INDUSTRY AFFAIRS AND TECHNOLOGY UTILIZATION 1971 NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION This document is available from the National Technical Information Service (NTIS), Springfield, Virginia 221 51 for $3.00. INTRODUCTION Under the terms of an interagency agreement with the Federal Aviation Admin- istration this publication has been prepared by the National Aeronautics and Space Administration for the joint use of both agencies and the scientific and technical community concerned with the field of aeronautical engineering. This supplement to Aeroiiautical Eiigiiieeriiig-A Special Bibliographj. (NASA SP-7037) lists 394 reports, journal articles, and other documents originally announced in January 197 1 in Scieiitific aiid Technical Aerospace Reports (STAR)or in Iiiteriiatioiial Aerospace Abstracts (IAAI. For previous bibliographies in this series, see inside of front cover. The coverage includes documents on the engineering and theoretical aspects of design, construction, evaluation, testing, operation, and performance of aircraft (includ- ing aircraft engines) and associated components, equipment, and systems. It also in- cludes research and development in aerodynamics, aeronautics, and ground support equipment for aeronautical vehicles. Each entry in the bibliography consists of a standard bibliographic citation accom- panied by an abstract.