L'arsenal De L'aéronautique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

3-VIEWS - TABLE of CONTENTS to Search: Hold "Ctrl" Key Then Press "F" Key
3-VIEWS - TABLE of CONTENTS To search: Hold "Ctrl" key then press "F" key. Enter manufacturer or model number in search box. Click your back key to return to the search page. It is highly recommended to read Order Instructions and Information pages prior to selection. Aircraft MFGs beginning with letter A ................................................................. 3 B ................................................................. 6 C.................................................................10 D.................................................................14 E ................................................................. 17 F ................................................................. 18 G ................................................................21 H................................................................. 23 I .................................................................. 26 J ................................................................. 26 K ................................................................. 27 L ................................................................. 28 M ................................................................30 N................................................................. 35 O ................................................................37 P ................................................................. 38 Q ................................................................40 R................................................................ -

La Société Des Moteurs Gnome & Rhône K Comme
La Société des Moteurs Gnome & Rhône K comme Kellermann (1930-1936) Moteur d’aviation Gnome et Rhône de la série K, années 1930. (Collection de l’auteur). 1 La Société des Moteurs Gnome & Rhône K comme Kellermann (1930-1936) K comme Kellermann (1930-1936) 2 La Société des Moteurs Gnome & Rhône K comme Kellermann (1930-1936) Vers le sommet Au cours des années 1920 sont apparues en Compagnie Pilotes Avions Europe plusieurs formes d’aviation : les transports aériens, tout d’abord, permettent à une Air-Union 31 40 population de plus en plus nombreuse de voyager C.G.A. 50 131 plus rapidement d’une grande ville à l’autre, l’aviation privée de tourisme ensuite, où les CIDNA 18 40 appareils sont vendus à des personnalités S.G.T.A. 9 22 fortunées ou à des entreprises, allant d’un terrain en herbe à un autre, une aviation de club qui Air-Orient 15 25 démarre en France, pays où la densité des terrains 123 258 d’aviation est élevée, sans oublier l’aviation de TOTAL sport entre les mains des annonceurs et des Effectifs des compagnies aériennes françaises industriels. Ces formes très différentes du voyage subventionnées, en 1930. (Source : l’année aéronautique). aérien nécessitent des matériels adaptés. Leurs moteurs sont très différents. En 1931, les cinq compagnies françaises On voit apparaître de gros porteurs – dix subventionnées couvrent un réseau qui places et plus - à plusieurs moteurs dans les développe 40 122 km (le troisième plus long du transports aériens, de petits quadriplaces monde, après les Etats-Unis, 81.090 km, et monomoteurs dans l’aviation légère, des bolides l’Allemagne, 52.428 km, et devant l’URSS, 27.746 ultra-performants dans les compétitions. -

Avions Civils
SOMMAIRE DU VOLUME I LA CONDUITE DES PROGRAMMES CIVILS AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS........................................................................... 3 PREFACE.............................................................................................................................. 5 PRESENTATION GENERALE ............................................................................................. 9 CHAPITRE 1 PRESENTATION DE L’ACTIVITE...................................................................................... 11 LE MARCHE DU TRANSPORT AERIEN .................................................................................. 11 Le passager et l’évolution du trafic.......................................................................................... 11 Les compagnies et la flotte d’avions ....................................................................................... 13 LA CONSTRUCTION DES AVIONS CIVILS .............................................................................. 14 Les caractéristiques de l’activité.............................................................................................. 14 La compétition et son évolution............................................................................................... 18 La dimension économique et monétaire ................................................................................. 20 L’ ADMINISTRATION ET SES MISSIONS ................................................................................. 22 La tutelle militaire de -

Sommaire N°38 - Juin 2019
"Connaître nos racines, n'est-ce pas la meilleure façon de constuire notre futur ?" Philippe Camus, 1er coprésident d'EADS Sommaire N°38 - Juin 2019 1 - 4 Entretien ••MichelMichel Armbruster Président de l'Association "Les Vieilles Racines". Les Vieilles Racines •Editorial "Pour qu'il ait des tiges, 4 -6 Vie des associations il faut des racines" ••ConstructionConstruction Noratlas 2501 - Patrimoine Aéronautique Entretien avec Michel Armbruster Bourges Berry son Président. ••ArsenalArsenal VG33 - Arsenal restauration ••AmicaleAmicale des Anciens Les © les Vieilles Racines Mureaux 7 7 Vie d'AIRitage AIRitage : Quel a été votre parcours professionnel ? ••LeLe fete aerienne 2019 à La Ferté Alais Après des études supérieures au Lycée Condorcet (Paris 9ème) j’ai intégré 8 8 Dons d'Archives le Centre d’Etudes Supérieures des Techniques Industrielles (CESTI – Maintenant Supméca). Editorial J’ai effectué mon service militaire en Algérie comme attaché au bureau de de Jacques Rocca, Piste de l’Escadron de chasse 3/20 équipé de Douglas AD4 « Skyraider », le Président d'AIRitage dernier chasseur à hélice de l’Armée de l’Air française. De retour à la vie civile en 1963, je suis entré à Sud Aviation (Laboratoire Central) où j’avais fait mon stage final d’école sur l’usinage du Béryllium. Je me suis occupé alors de recherches sur les matériaux spéciaux (dont le béryllium) mais également de tribologie (Etude du frottement et de la lubrification). J’ai eu ainsi l’occasion de travailler, avec les ingénieurs et techniciens qui m’étaient rattachés, sur pratiquement tous les produits de © Airitage Sud Aviation puis d’Aerospatiale (avions, hélicoptères, missiles tactiques et balistiques, lanceurs et satellites, hydroptère ainsi que divers produits Il s’en est allé, le vendredi 14 juin, en dérivés). -

Les Avions NIEUPORT-DELAGE
Les avions NIEUPORT-DELAGE Les avions Nieuport-Delage Par Gérard Hartmann Le Nieuport-Delage NiD-29 V n° 10 vainqueur de la Coupe Gordon-Bennett 1920, piloté par Joseph Sadi-Lecointe. (Catalogue constructeur). 1 Les avions NIEUPORT-DELAGE Comme toute la construction aéronautique Nieuport-Astra française, Nieuport est frappé par les taxes de guerre votées en avril 1920 et la société est mena- En novembre 1917, les usines Nieuport cée de disparition. Des 4 200 ouvriers employés d’Issy-les-Moulineaux emploient 3 600 ouvriers dans les usines d’Issy-les-Moulineaux en octobre sur sept ateliers de 4 500 m2. Les usines Astra de 1918 ne subsistent plus que 650 personnes en Billancourt ont suivi la même évolution et 1923. Ce sont les capitaux nouveaux des action- l’atelier d’Argenteuil (ex Tellier) est devenu une naires (en particulier la famille Deutsch de la usine. En effet, en août 1918, Alphonse Tellier Meurthe), le succès du NiD-29 C1 et les ventes à dont la santé se détériore vend ses ateliers du l’étranger qui vont la sauver de la disparition. quai de Seine à Argenteuil à la Société Nieuport. Le même mois, le NiD-29 C1, meilleur appa- reil jamais réalisé à Issy-les-Moulineaux chez Nieuport, débute ses essais. Avions Nieuport utilisés par l’aviation américaine en France, 1918. Le 24 novembre 1919, Henry Deutsch de la Meurthe propriétaire de l’ensemble de ces usines meurt à 73 ans au château de Romainville à Ec- quevilly (Yvelines). Forts des licences de fabrica- tion vendues à l’étranger et des revenus pétro- liers (la famille créa la première essence Le 25 septembre 1920 à Etampes, Kirsch (1892-1969) sur Nieu- d’aviation en France, la société des pétroles Jupi- port 29 bat le record du monde de vitesse, avec 269,058 km/h. -
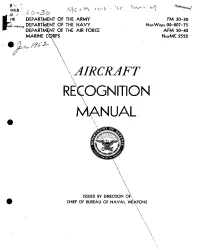
\Aircraft Recognition Manual
Jf V t 9fn I 4-'!- Vw'^ ' 'o | ^ renai; 408.$ /•> ,A1.AI / -3o FM DEPARTMENT OF THE ARMY FM 30-30 DEPARTMENT OF THE NAVY NavWeps 00-80T-75 DEPARTMENT OF THE AIR FORCE AFM 50-40 MARINE CORPS NavMC 2522 \AIRCRAFT RECOGNITION MANUAL SI ISSUED BY DIRECTION OF\ CHIEF OF BUREAU OF NAVAL WEAPONS \ \ I 4 DEPARTMENT OF THE ARMY FM 30-30 DEPARTMENT OF THE NAVY NavWeps 00-80T-75 DEPARTMENT OF THE AIR FORCE AFM 50-40 MARINE CORPS NavMC 2522 AIRCRAFT RECOGNITION MANUAL •a ISSUED BY DIRECTION OF CHIEF OF BUREAU OF NAVAL WEAPONS JUNE 1962 DEPARTMENTS OF THE ARMY, THE NAVY AND THE AIR FORCE, WASHINGTON 25, D.C., 15 June 1962 FM 30-30/NAVWEPS 00-80T-75/AFM 50-40/NAVMC 2522, Aircraft Recognition Manual, is published for the information and guidance of all concerned. i BY ORDER OF THE SECRETARIES OF THE ARMY, THE NAVY, AND THE AIR FORCE: G. H. DECKER, General, Umted States Army, Official: Chief of Staff. J. C. LAMBERT, Major General, United States Army, The Adjutant General. PAUL D. STROOP Rear Admiral, United States Navy, Chief, Bureau of Naval Weapons. CURTIS E. LEMAY, Official: Chief of Staff, United States Air Force, R. J. PUGH, Colonel, United States Air Force, Director of Administrative Services. C. H. HAYES, Major General, U.S. Marine Corps, Deputy Chief of Staff (Plans). H DISTRIBUTION: ARMY: Active Army : DCSPER (1) Inf/Mech Div Co/Btry/Trp 7-2 44-112 ACSI (1) (5) except Arm/Abn Div 7- 44-236 52 DCSLOG (2) Co/Trp (1) 8- 44-237 137 DCSOPS(5) MDW (1) 8-500 (AA- 44-446 ACSRC (1) Svc Colleges (3) AH) 44447 CNGB (1) Br Svc Sch (5) except 10-201 44^536 -

CHAMPION AEROSPACE LLC AVIATION CATALOG AV-14 Spark
® CHAMPION AEROSPACE LLC AVIATION CATALOG AV-14 REVISED AUGUST 2014 Spark Plugs Oil Filters Slick by Champion Exciters Leads Igniters ® Table of Contents SECTION PAGE Spark Plugs ........................................................................................................................................... 1 Product Features ....................................................................................................................................... 1 Spark Plug Type Designation System ............................................................................................................. 2 Spark Plug Types and Specifications ............................................................................................................. 3 Spark Plug by Popular Aircraft and Engines ................................................................................................ 4-12 Spark Plug Application by Engine Manufacturer .........................................................................................13-16 Other U. S. Aircraft and Piston Engines ....................................................................................................17-18 U. S. Helicopter and Piston Engines ........................................................................................................18-19 International Aircraft Using U. S. Piston Engines ........................................................................................ 19-22 Slick by Champion ............................................................................................................................. -

19710017233.Pdf
PREVIOUS BIBLIOGRAPHIES IN THIS SERIES NASA SP-7037 Scptemher 1970 Jan. itug. 1970 W'ASA SP-7037 (01) Januar~197 I Scpt. Uec. 1970 NASA SP-7037 (02) AERONAUTICAL ENGINEERING A Special Bibliography Supplement 2 A selection of annotated references to unclas- sified reports and journal articles that were introduced into the NASA scientific and tech- nical information system and announced in January 1971 in Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR) International Aerospace Abstracts (IAAI. Scieirtijic atrd Techirical Iirjomratioir 0jfic-e OFFICE OF INDUSTRY AFFAIRS AND TECHNOLOGY UTILIZATION 1971 NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION This document is available from the National Technical Information Service (NTIS), Springfield, Virginia 221 51 for $3.00. INTRODUCTION Under the terms of an interagency agreement with the Federal Aviation Admin- istration this publication has been prepared by the National Aeronautics and Space Administration for the joint use of both agencies and the scientific and technical community concerned with the field of aeronautical engineering. This supplement to Aeroiiautical Eiigiiieeriiig-A Special Bibliographj. (NASA SP-7037) lists 394 reports, journal articles, and other documents originally announced in January 197 1 in Scieiitific aiid Technical Aerospace Reports (STAR)or in Iiiteriiatioiial Aerospace Abstracts (IAAI. For previous bibliographies in this series, see inside of front cover. The coverage includes documents on the engineering and theoretical aspects of design, construction, evaluation, testing, operation, and performance of aircraft (includ- ing aircraft engines) and associated components, equipment, and systems. It also in- cludes research and development in aerodynamics, aeronautics, and ground support equipment for aeronautical vehicles. Each entry in the bibliography consists of a standard bibliographic citation accom- panied by an abstract. -

Confédérafion Générale Du Travail CFTC
CGT : Confédération générale du travail 1895 : Congrès constitutif de la confédération générale du travail CGT à Limoges du 23 au 28 septembre. Les principaux piliers en sont la fédération du livre et celle des cheminots, mais de nombreux métiers rejoindront la CGT par la suite. CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens 1919 : Les dirigeants du syndicat des employés du commerce et de l’industrie sont à l'initiative de la fondation de la CFTC les 1er et 2 novembre 1919, regroupant 321 syndicats et se réclamant de l’encyclique Rerum Novarum. Son objectif est de contrer la toute-puissance de la CGT dans le milieu ouvrier. CFE-CGC : Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres 1944 : La CGC a été créée le 15 octobre 1944. Catégorielle, la CGC a élargi son champ en devenant CFE-CGC en 1981, s'ouvrant aux techniciens, agents de maîtrise, ... CGT-FO : Force Ouvrière 1948 : Le 12 avril 1948 a lieu le congrès constitutif de Force Ouvrière. La décision de scission d’une branche de la CGT pour la création du syndicat Force Ouvrière a été précipité en septembre 1947 lors de la prise d’opposition de la CGT au plan Marshall (plan américain pour aider la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale). CFDT : Confédération française démocratique du travail 1964 : Après la Libération, une minorité de gauche, regroupée dans la tendance « reconstruction », anime un débat interne en faveur de la « déconfessionalisation » de la CFTC. La rupture se produit en 1964 : le congrès extraordinaire des 6 et 7 novembre transforme la CFTC en CFDT. -

La Formation
COMAERO Un demi-siècle d’aéronautique en France La formation Tome 2 L’apport de l’Industrie Aérospatiale 1 LE COMITÉ POUR L’HISTOIRE DE L’AÉRONAUTIQUE Au cours de la période 1945-1995, l'aéronautique française a vécu une aventure passionnante. Réduite à peu de choses au lendemain de la deuxième guerre mondiale, il lui fallait se reconstruire. C'est ce qu'elle a fait avec brio. Qu'il s'agisse des avions militaires, des avions civils, des hélicoptères, des missiles, des moteurs, des équipements, l'aéronautique française s'est retrouvée, en quelques décennies, à l'égal des meilleures. Elle est ainsi devenue capable de satisfaire, au niveau mondial, la plupart des besoins des utilisateurs civils et militaires. Cette réussite est due à des facteurs techniques, industriels, financiers et politiques. Elle est due, notamment, à une collaboration très étroite entre les futurs utilisateurs, les services techniques officiels, les organismes de formation et de recherche, les centres d'essais et les industriels, fournisseurs et clients étant mus par un même désir de renaissance et de réussite. C'est cette histoire que la collection d'ouvrages COMAERO veut retracer. Les rédacteurs de cette collection, membres du comité pour l'histoire de l'aéronautique (COMAERO), ont été ingénieurs d'études ou ingénieurs d'essais, puis directeurs de programme ou chefs de service, au cours de carrières particulièrement fécondes à la DGA et dans l’industrie. Au sein du comité COMAERO, ils ont effectué un travail de mémoire collectif, en faisant largement appel aux principaux acteurs des services étatiques et de l'industrie. -

The SEPR 844 Reusable Liquid Rocket Engine for Mirage Combat Aircraft H
AlAA 90-1835 IJ The SEPR 844 Reusable liquid Rocket Engine for Mirage Combat Aircraft H. Grosdemange Societe Europeene de Propulsion Vernon, FRANCE G. Schaeffer Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation Saint Cloud FRANCE AIAAISAEIASM ElASEE 26th Joint Propulsion Conference \ July 16-18, 1990 / Orlando, FL For permission to copy or republish, contact the American institute of Aeronautics and Astronautics 370 L’Enfant Promenade, S.W., Washington, D.C. 20024 AIM-90-1835 THE SEPR 844 REUSABLE LIQUID ROCKET ENGINE FOR MIRAGE COMBAT AIRCRAFT HervC GROSDEMANGE Socittt Euro@enne de Propulsion Fori3 de Vernon Vernon - FRANCE Guy SCHAEFFER Avions Marcel Dassault-Brtguet Aviation Quai Marcel Dassault Saint Cloud - FRANCE ABSTRACT The SEPR 844 rocket engine for Mirage I11 combat aircraft is the last version of a bipropellant rocket engine family developed by SEP for aircraftpropulsion. The SEPR 844 is a 15 kN thrust, single-chamber rocket engine. It operates with nitric acid and aircraft supplied kerosene. The ignition is made with a hypergolic nitric acid - TX2 combustion. Thechamber is fed by twocentrifugalpumps driven by an auxiliary shaft coming from the aircraft turbojet engine. The combustion chamber is regeneratively cooled and operates at 2.35 MPa pressure. SinceDecember 1961,275enginesoftheSEPR84class(SEPR 841 and SEPR 844) have been used operationnaly in six countries and have completed more than 10000 flights with a 99 % success rate and a high availability : These engine demonstrated more than SO ~~~ ignitions without removal and can be serviced in less than 15 Figure I :SEPR 844 Rocket engine. minutes. 1 Copyright 0 1990 American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. -
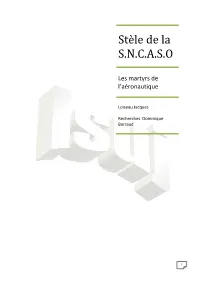
Stèle De La S.N.C.A.S.O
Stèle de la S.N.C.A.S.O Les martyrs de l’aéronautique Loiseau Jacques Recherches Dominique Barraud 1 2 Stèle SOGERMA N’oublions Jamais Ceux qui sont morts - 1 Pour que la France vive - Cette stèle fut érigée en 1946 dans le sein de la S.N.C.A.S.O de Bacalan. Elle y fut inaugurée par Charles Tillon, Ministre de l’Armement, le 16 novembre 1946. Suite aux restructurations survenant après la fin du conflit, ce monument, en 1949, fut transféré et implanté à la S.F.E.R.M.A. de Mérignac. Il ne saurait être rapproché des monuments aux morts communaux, ceux-ci ayant pour principale vocation de mettre sous le regard des habitants de la commune les noms de leurs concitoyens morts au service de la France. En effet, dans ce cas, deux conditions particulières s’imposent : 1°) un lien direct entre le défunt et la commune (lieu de naissance ou dernier lieu de résidence). 2°) L’inscription de la mention « Mort pour la France » à l’état civil de l’intéressé. La liste de noms gravée sur la stèle est constituée de soixante-dix-huit noms. Trente des individus, ainsi répertoriés, sont effectivement des Résistants fusillés au camp de Souge auxquels nous pouvons associer la mention « Mort pour la France » sans craindre de nous tromper. Tous ont œuvré à la S.N.C.A.S.O., quelques uns sont Mérignacais. Ceci peut expliquer le fait que ce monument, hommage catégoriel, puisse, aujourd’hui, faire partie du patrimoine national sans être géré par la commune et ne pas avoir à répondre aux mêmes contraintes qu’un monument aux morts.