Consulter/Télécharger
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°31-2019-132 Publié Le 13 Mai 2019
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°31-2019-132 HAUTE-GARONNE PUBLIÉ LE 13 MAI 2019 1 Sommaire Préfecture Haute-Garonne 31-2019-05-03-006 - Annexe. (80 pages) Page 3 31-2019-04-30-008 - Arrêté autorisant une manifestation aérienne sur l'aérodrome de Muret-Lherm à Muret le 11 mai 2019. (15 pages) Page 84 31-2019-05-03-004 - Arrêté fixant le plan de chasse pour le cerf élaphe, le chevreul, l'isard et le daim pour la saison 2019-2020. (2 pages) Page 100 31-2019-05-10-002 - Arrêté modifiant les lieux de certains bureaux de vote des communes de la Haute-Garonne pour toutes les élections au suffrage universel direct. (1 page) Page 103 31-2019-05-07-006 - Arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées afin de réaliser les études nécessaires à l'établissement du projet de ZAC de Piquepeyre à Fenouillet. (2 pages) Page 105 31-2019-04-30-009 - Arrêté portant nomination d'un nouveau régisseur de la régie de recettes de l'état instituée auprès de la commune de Toulouse pour percevoir le produit des contraventions au code de la route. (1 page) Page 108 31-2019-05-06-002 - Arrêté portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour les dépenses et les recettes relevant du programme n° 723 " opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'état". (2 pages) Page 110 31-2019-04-24-009 - Arrêté préfectoral autorisant la société TEREGA à construire et exploiter des déviations de la canalisation de transport de gaz naturel " DN100/80 Montréjeau - Bagnères-de-Luchon" sur le territoire des communes de Chaum et Marignac et portant accord préalable de la mise à l'arrêt définitif partiel d'exploitation par la société TEREGA des tronçons de canalisations remplacés "DN100/800 Montrjjeau-Bagnères-de Luchon " et du branchement DN50 Almamet France. -

DE LA RÉPUBLIQUE 3 :R
Aimée 1992. - No 29 A.N . I,Q) Lundi 20 1uiHiet 1992 DE LA RÉPUBLIQUE 3 :r ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 9e Législature QUESTIONS ÉCRITES REMISES A LA PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET RÉPONSES DES MINISTRES .i' ( R\ 4)1 1 '1(11`1 . 3220 ASSEMBLÉE NATIONALE 20 juillet :992 SOMMAIRE 1 . - Liste de rappel des questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai de deux mctis 3222 2. - Questions écr ies (du no 60057 au n° 60202 inclus) Index alphabétique des auteurs de questions 3226 Premier ministre 3228 Affaires étrangères 3228 Affaires européennes 3228 Affaires sociales et intégration 3229 Agriculture et forêt 3230 Anciens combattants et victimes de guerre 3232 Budget Collectivités locales 3234 Commerce et artisanat 3234 Communication 3234 Défense 3234 Droits des femmes et consommation 3235 Economie et finances 3235 Education nationale et culture 3235 Environnement 3237 Equipemen*., logement et transports 3237 Famille, personnes âgées et rapatriés 3238 Fonction publique et réformes administratives 3239 Handicapés 3239 Industrie et commarce extérieur 3239 Intérieur et sécurité publique ... .... ... .. .... ... 3240 Jeunesse et sports 3241 Justice 3242 Logement et cadre de vie 3242 Mer 3243 Postes et télécommunications 3243 Santé et action humanitaire 3243 Tourisme 3244 Transports routiers et fluviaux 3244 Travail, emploi et formation professionnelle 3244 Ville 3244 20 juillet 1992 ASSEMBLEE NATIONALE 3221 3 . - Réponses des ministres aux questions écrites Premier ministre 3248 Affaires étrangères -

Benoît XVI En Croatie Pages 21 À 23 BRÈVES
FRANCE france-catholique.fr france-catholique.fr Catholique87e année - Hebdomadaire n° 3263 - 10 juin 2011 3 € Musique : ISSN 0015-9506 Asia Bibi Liszt à Ligugé Son mari pages 10 à 16 et sa fille demandent pitié pages 8- 9 Asia Bibi condamnée à mort pour « blasphème » Benoît XVI en Croatie pages 21 à 23 BRÈVES Football : Le fonds d’inves- syrien en envoyant l’armée CôtE d’IvoiRE : Deux corps FRANCE tissement américain proprié- dans plusieurs villes ; l’Iran identifiés à Abidjan le 1er juin politiquE : Après la décision taire du PSG a décidé de aurait dépêché des instruc- sont ceux de deux Français de l’Allemagne de sortir du céder 70% de ses parts à un teurs en Syrie pour aider le enlevés le 4 avril par des nucléaire en 2022, les écolo- fonds appartenant à l’émirat gouvernement à mater les hommes de Laurent Gbagbo. gistes français font de cette du Qatar pour un montant de manifestations ; de nouveaux pRoChE-OriENt : Le ministre sortie la condition d’un accord 30 à 40 millions d’euros. tirs contre la foule ont fait français des Affaires étran- électoral avec le Parti socia- iSF : Les députés de la com- au moins 34 morts le 3 avril gères, Alain Juppé, a invité le 2 liste (sur les autres aspect du mission des Finances ont à Hama ; plus de 100 000 juin Israéliens et Palestiniens congrès de La Rochelle, lire proposé d’intégrer les œuvres personnes assistaient le len- à négocier fin juin à Paris. notre article en page 5). d’art dans la base de l’ISF. -

Listing-Recap-Livres 0220
N°Go Année Titre du Livre Dated'achat Genre Auteur mette Sortie 1 Des vents contraires 02/11/2010 Olivier ADAM 2 A Coeur Perdu 03/11/2010 Roman Elizabeth ADLER 3 Voyage à Capri 04/11/2010 Roman Elizabeth ADLER 4 A ce Soir 04/11/2010 Roman Laure ADLER 5 PS I Love You 04/11/2010 Roman Cecelia AHERN 6 Les cinq personnes que j'ai rencontrées là-haut 04/11/2010 Roman Mitch ALBOM 7 Sept mers et treize Rivière 04/11/2010 Roman Monica ALI 8 Quand le soleil était chaud 04/11/2010 Roman Josette ALIA 9 L'erreur est humaine 04/11/2010 Roman Woody ALLEN 10 Alice au pays des trop vieilles 04/11/2010 Roman Cristina ALONSO 11 Moi Nojoud, 10 ans, divorcée 04/11/2010 Roman Nojoud ALI 12 Le sang des fleurs 04/11/2010 Roman Anita AMIRREZVANI 13 Un été à Vignols 04/11/2010 Roman Sylvie ANNE 14 La maîtresse au piquet 04/11/2010 Roman Jean ANGLADE 15 Les ventres jaunes 04/11/2010 Roman Jean ANGLADE 16 Le marché des amants 04/11/2010 Roman Christine ANGOT 17 L'Ecluse 04/11/2010 Roman Sophie APERT 18 Dernière danse à Pristina 04/11/2010 Roman Julie ARMEN 19 Au bonheur du matin 04/11/2010 Roman Marie-Paul ARMAND 20 Benoît Tome 3 La courée 04/11/2010 Roman Marie-Paul ARMAND 21 Le pain rouge 04/11/2010 Roman Marie-Paul ARMAND 22 L'ami de la famille 04/11/2010 Roman Christine ARNOTHY 23 De l'autre côté de la nuit Tome 3 04/11/2010 Roman Christine ARNOTHY 24 Donnant, donnant 05/11/2010 Roman Christine ARNOTHY 25 Le Conflit la femme et la mère 05/11/2010 Roman Elisabeth BADINTER 26 Quand le mal est fait 05/11/2010 Roman Nan AUROUSSEAU 27 Don Quichotte en banlieue 05/11/2010 -

Bill Clinton, Le Président Acquitté
LeMonde Job: WMQ1202--0001-0 WAS LMQ1202-1 Op.: XX Rev.: 11-02-99 T.: 11:06 S.: 111,06-Cmp.:11,11, Base : LMQPAG 20Fap:100 No:0251 Lcp: 700 CMYK LE MONDE DES LIVRES LITTERATURES ESSAIS VENDREDI 12 FÉVRIER 1999 DIOGÈNE SAINTS ET PROPHÈTES LAËRCE AU MOYEN ÂGE La Chronique L’historien André Vauchez démontre de Roger-Pol comment la « sainteté » EDITH WHARTON Droit a été utilisée à des fins politiques Le Feuilleton page VI par la papauté et les Etats naissants page IX de Pierre Lepape LESLEY GLAISTER JUAN GOYTISOLO NADINE FRESCO page II page III page IV page VII bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb a Au sommaire : La trace, les identités floues, la mémoire «Je» trouée... Trois jeunes filles anonymes se racontent à la première personne dans le nouveau livre est une de Patrick Modiano, qui porte le jeu avec ses obsessions à un inconnue point de perfection l’oubli (1996), il s’agit d’emmener le Il n’y a évidemment pas de lecteur à la recherche d’un moment morale de l’histoire. Dans aucun de jeunesse. Comme dans Dora des récits. Ce n’est pas dans la Modiano, Wharton, Bruder (1997), Modiano pourrait manière de Modiano, qui s’est affirmer ici : « Si je n’étais pas là toujours gardé de la démagogie. pour l’écrire, il n’y aurait plus En revanche, les propos déran- aucune trace de cette inconnue. »Ce geants, provocants, non rois récits composent ce n’est pas la première fois qu’il s’en conformes, ne lui sont pas étran- curieux livre, ni roman ni recueil de va du côté des jeunes filles perdues. -

LE MONDE/PAGES<UNE>
www.lemonde.fr 58 ANNÉE – Nº 17782 – 1,20 ¤ – FRANCE MÉTROPOLITAINE --- JEUDI 28 MARS 2002 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI -- La folle tragédie de Nanterre Tout le cinéma et une sélection A l’issue du conseil municipal, un spectateur a tiré méthodiquement sur les élus : 8 morts et 8 blessés graves de sorties ALORS QUE la maire communis- f 01 h 11, mercredi, PROCHE-ORIENT te de Nanterre (Hauts-de-Seine), Jacqueline Fraysse, levait la séance Nanterre : le conseil du conseil municipal (bâtiment Le sommet de Beyrouth ci-contre), mercredi 27 mars, à municipal se termine, sans Yasser Arafat p. 2 01 h11, un spectateur s’est mis à un spectateur se met tirer méthodiquement sur les élus. SÉNÉGAL A l’aide de trois armes de poing, il à tirer sur les élus a tué huit élus et blessé une trentai- En Casamance, ne d’autres personnes, avant f Une quarantaine un conflit sans fin. d’être ceinturé. Placé en garde à vue et interrogé au Quai des Orfè- de balles, tirées avec Notre reportage p. 16 vres à Paris, Richard Durn, 33 ans, trois armes de poing RMiste, vivant chez sa mère à Nan- ÉRIC HALPHEN terre, semble avoir agi sous l’em- prise de la démence. Fréquentant f Il y a huit morts : Le juge se lance en les milieux associatifs proches de quatre élus PCF, politique et soutient la gauche, il est trésorier de la sec- Chevènement. Il dit ses tion nanterroise de la Ligue des un élu Vert et droits de l’homme qui compte raisons : entretien p. -

Drogues : Le Rapport Qui Change Tout
LeMonde Job: WMQ0801--0001-0 WAS LMQ0801-1 Op.: XX Rev.: 07-01-99 T.: 11:07 S.: 111,06-Cmp.:07,11, Base : LMQPAG 16Fap:100 No:0395 Lcp: 700 CMYK LE MONDE DES LIVRES a Des usages et du rôle du latin a « Le Monde des poches » 55e ANNÉE – No 16781 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE VENDREDI 8 JANVIER 1999 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Drogues : le rapport qui change tout Rhône-Alpes b Alcool, tabac et médicaments seront visés par le plan gouvernemental au même titre entre le FN, que l’héroïne et la cocaïne b La mission interministérielle propose la prise en charge commune Charles Millon des toxicomanes et des alcooliques b Vers une dépénalisation de fait de l’usage de stupéfiants et l’« alliance DANS UN RAPPORT remis à mort par surdose de 228 personnes Lionel Jospin, dont Le Monde révèle en 1997 et environ un millier de le contenu, la présidente de la mis- toxicomanes, se droguant par injec- JEAN BER républicaine » sion interministérielle de lutte tion, sont morts du sida depuis le contre la drogue (Mildt), Nicole début de l’épidémie. Le cannabis LA PRÉSIDENCE du conseil ré- a Le jazz sans Maestracci, propose une nouvelle n’a, à ce jour, jamais été directe- gional Rhône-Alpes, retirée à Michel Petrucciani politique de lutte contre les toxi- ment mortel. Charles Millon par la justice admi- comanies. A l’approche classique, La Mildt recommande également nistrative, était, jeudi 7 janvier, Le pianiste et compositeur est mort fondée sur la classification légale une redéfinition de la politique pé- l’enjeu d’une bataille incertaine. -

Le Monde Livres
VENDREDI 5 JANVIER 2001 L’ENFER DE TAZMAMART NIETZSCHE, Côté fiction HÉROS SOLUBLE avec Tahar Ben Jelloun La chronique dans le feuilleton de Roger-Pol Droit de Pierre Lepape page V côté document avec le témoignage d’Ahmed Marzouki page II PASCAL PIA YIRMIYAHU YOVEL LE MONDE DES POCHES page III page VI Un supplément de 16pages Symphonie astrale mer comme l’un des écrivains les d’armes en intempéries, les hommes morphoses de son style, il emboîte tous les chemins sur lesquels peut se plus importants de son époque. Et se retrouvent au Cap, puis sur l’île de Contée par le Révérend vingt romans dans un seul ensemble lancer son imagination ? « Comme l’un des plus secrets, par la même Sainte-Hélène, avant de retourner en baroque, au gré des illusions d’opti- s’il n’y avait pas un seul Destin, sup- occasion : toujours aucune photo du Amérique du Nord. Là, ils mèneront Cherrycoke, l’histoire des que, des fantasmes et des rêves de pute Mason, mais bien plutôt une pro- personnage, en dehors d’un unique à bien la besogne qui les fit, ironique- ses protagonistes. « Si un acteur ou fuse quantité de Destins possibles. » Le cliché datant de 1959 (un jeune hom- ment, entrer dans l’Histoire. A la astronomes Mason et un portrait peint peut représenter un vertige des possibles est l’apanage de me aux oreilles vaguement décol- demande du sieur Penn et de Lord personnage qui n’est plus vivant, ne cette « extrémité particulière du mon- e toutes les quali- lées), pas d’interviews, pas de rencon- Baltimore, Mason et Dixon dessine- Dixon, qui dessinèrent pourrait-il exister aussi bien d’autres de » où se déroule le roman. -

Première Conférence Commune De L'assemblée Parlementaire De La Francophonie (APF) Et De L'association Des Ombudsmans Et M
Première conférence commune de L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) Les parlementaires et les médiateurs, acteurs de la bonne gouvernance Tunis, 23-24 novembre 2017 SOMMAIRE Sommaire 2 JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 Ouverture de la Conférence 3 Introduction de la Conférence : le rôle des parlementaires, garants de la démocratie, et des médiateurs, défenseurs des droits fondamentaux, comme acteurs de la bonne gouvernance 17 Le point de vue de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe 27 Débat 29 VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 Les relations Parlements/ Médiateurs 30 Débat 39 Le renforcement de la coopération entre les parlementaires et les médiateurs, au niveau national et au niveau de la Francophonie 51 Débat 53 Clôture de la conférence 57 Avant-Propos Ce rapport reprend les débats et sujets soulevés lors de la conférence commune entre l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (AFP) et l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) qui s’est tenue à Tunis (Tunisie) les 23 et 24 novembre 2017. Certaines interventions correspondent à la retranscription des discours tels qu’ils ont été prononcés lors de la conférence, d’autres ont été rédigées et modifiées ultérieurement par les intervenants eux-mêmes. Tunis, 23-24 novembre 2017 2 Jeudi 23 novembre 2017 Ouverture de la Conférence Abdessattar BEN MOUSSA Médiateur administratif de Tunisie M. Philippe Courard, Président du Parlement de la fédération de la Wallonie-Bruxelles, M. Marc Bertrand, médiateur et Président de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie. -
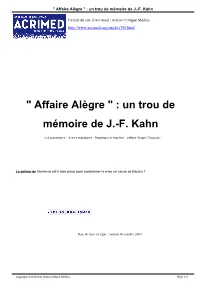
Affaire Alègre " : Un Trou De Mémoire De J.-F
" Affaire Alègre " : un trou de mémoire de J.-F. Kahn Extrait du site d'Acrimed | Action Critique Médias http://www.acrimed.org/article1799.html " Affaire Alègre " : un trou de mémoire de J.-F. Kahn - Les journalismes - Genres et pratiques - Reportages et enquêtes - L'affaire "Alègre" (Toulouse) - Le patron de Marianne est-il bien placé pour condamner la mise en cause de Baudis ? Date de mise en ligne : samedi 30 octobre 2004 Copyright © Acrimed | Action Critique Médias Page 1/3 " Affaire Alègre " : un trou de mémoire de J.-F. Kahn " Nous avons regretté, comme beaucoup, que certains médias colportent de prétendues informations sur des soirées sado-masochistes auxquelles Dominique Baudis aurait participé. D'emblée, nous n'y avons pas cru et nous avons montré que cela ne tenait pas la route. " Ainsi commence l'entretien donné par Jean-François Kahn à la revue Médias (n°2, sept. 04) à propos de la crédibilité des journalistes. Sur quatre pages, le patron de Marianne livre une réflexion qui fourmille d'exemples. Le principal concerne ainsi l' " affaire Alègre ". Les assertions mettant en cause Dominique Baudis ne tenaient pas debout, assène " JFK ". " Cinq minutes de réflexion auraient dû suffire à écarter ces rumeurs. Qu'un ancien maire [1], un centriste modéré qui a peur de son ombre, qui regarde à droite et à gauche chaque fois qu'il fait un pas, qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre, aille dans un bouge de sa ville, se livre à des horreurs devant des dizaines de personnes qui peuvent le dénoncer dès le lendemain, ça ne tient pas debout. -

Femmes De L'immigration
Ministère de la parité Ministère de la justice et de l’égalité professionnelle FEMMES DE L’IMMIGRATION ASSURER LE PLEIN EXERCICE DE LA CITOYENNETE A PART ENTIERE, A PARTS EGALES Rapport remis le 7 mars 2005 à Madame Nicole AMELINE Monsieur Dominique PERBEN Ministre de la parité Garde des Sceaux et de l’égalité professionnelle Ministre de la justice LES FEMMES DE L’IMMIGRATION A NEW YORK, au siège de l’ONU, j’ai pu, aux côtés de l’Union européenne et des pays unis dans le même combat pour les valeurs de la démocratie, faire entendre la voix de la France pour promouvoir l’égalité comme principe actif du développement. Ce rapport qui m’est remis aujourd’hui témoigne précisément de la richesse de la diversité qu’offrent les femmes de l’immigration, en compétences, expériences et performances, et de la modernité des valeurs républicaines au premier rang desquelles se situe l’égalité. L’Europe l’a bien compris pour mettre la question des femmes de l’immigration au cœur de ses politiques communautaires. Fortes de leur double appartenance culturelle, plurielles dans leurs trajectoires et leurs aspirations, les femmes de l’immigration constituent un atout majeur pour l’économie mais aussi pour la démocratie. Elles sont une chance pour l’Europe et pour la France que nous devons saisir. C’est en promouvant sans distinction de sexe ni d’origine, l’égalité des droits, l’égalité dans la vie active et l’égalité républicaine que se forge une citoyenneté moderne fondée sur la volonté du vivre-ensemble, dans la diversité et la cohésion. -

LE MONDE/PAGES<UNE>
www.lemonde.fr 57e ANNÉE – Nº 17499 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE SAMEDI 28 AVRIL 2001 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Crise au patronat français b Ernest-Antoine Seillière est de plus en plus contesté par les grands patrons b Ils lui reprochent sa stratégie d’affrontement avec les syndicats et la gestion du dossier AOM b Malgré la baisse du chômage, les menaces sur la croissance en Europe inquiètent les patrons ERNEST-ANTOINE SEILLIÈRE, environnement social et sociétal. président du Medef, est de plus en Des dirigeants préparent déjà la suc- plus contesté au sein du patronat cession de M. Seillière, qui ne français. Ses propres déboires finan- demandera pas, fin 2002, le renouvel- ciers avec ses participations dans lement de son mandat à la tête AOM ou Valeo pèsent dans cette du Medef. Bertrand Collomb, PDG fronde. Mais la crise est plus profon- de Lafarge, pourrait prendre la de. Le Monde raconte comment le présidence de l’AFEP d’ici à la fin de « patron des patrons » a été sèche- l’année. ment désavoué, le 7 février dernier, Cette crise s’inscrit dans un climat lors d’une réunion de l’Association d’inquiétude chez les chefs d’entre- française des entreprises privées prise. Selon l’Insee, « la conjoncture (AFEP) qui regroupe quatre-vingts industrielle s’est nettement dégradée des plus grands patrons français. ces derniers mois ». Malgré une bais- C’est au terme de cette rencontre se persistante du chômage (- 13 500 qu’Ernest-Antoine Seillière est reve- en mars), les patrons redoutent que nu brutalement sur sa décision d’ap- le ralentissement de la croissance peler ses pairs à un boycottage des américaine ne touche l’Europe.