Manet Van Montfrans
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
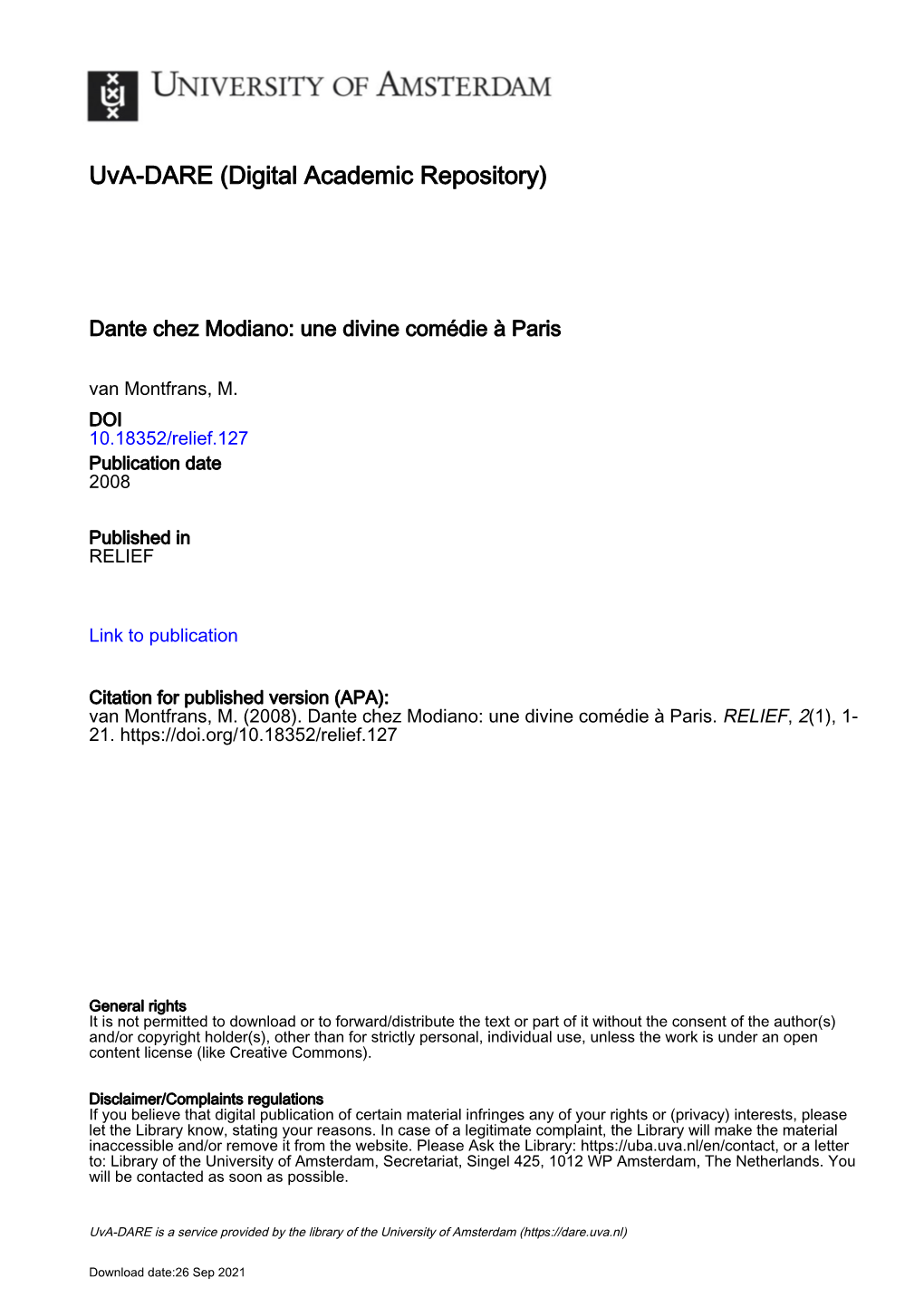
Load more
Recommended publications
-

Utrillo. La Bohème Et L'ivresse À Montmartre
UTRILLO LA BOHÈME ET L'IVRESSE A MONTMARTRE DU MÊME AUTEUR PICASSO, les femmes, les amis, l'œuvre. CHAGALL, l'amour, le rêve et la vie. MODIGLIANI, les femmes, les amis, l'œuvre. JEAN-PAUL CRESPELLE UTRILLO LA BOHÈME ET L'IVRESSE A MONTMARTRE PRESSES DE LA CITÉ PARIS © Presses de la Cité, 1970 et pour les œuvres de Suzanne Valadon et de Maurice Utrillo, S.P.A.D.E.M. Paris, 1970. Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays, y compris l'U. R. S. S. CHAPITRE PREMIER LE PETIT MONDE DE MAURICE UTRILLO « Je suis né à Paris, rue du Poteau, (je présume, mais je ne peux indiquer le numéro) le 25 décembre, jour de Noël de l'an de grâce 1883. « Ma mère, une sainte femme que dans le fond de mon âme je bénis et vénère à l'égal d'une déesse, une créature sublime de bonté, de droiture, de charité, d'abnégation, d'intelligence, de courage et de dévouement, une femme d'élite, peut-être la plus grande lumière picturale du siècle et du monde, cette femme noble m'éleva toujours dans les préceptes les plus stricts de la morale, du droit et du devoir. « Hélas ! que n'ai-je suivi ses sincères conseils ! Je me suis laissé entraîner sur la voie du vice, insen- siblement et par la fréquentation de créatures immondes et lubriques, sirènes gluantes aux yeux qu'embrase la perfidie et qui de moi, qui était un rosier un peu fané, ont fait un répugnant ivrogne, objet de la pitié et de la déconsidération publique. -

Les Secrets De La Nuit DU MÊME AUTEUR Dans Le Domaine Police/Justice
Les Secrets de la nuit DU MÊME AUTEUR Dans le domaine Police/Justice L’Œil de la Police, Crimes et Châtiments à la Belle Époque, avec Michel Dixmier, Alternatives, Paris, 2007. La Mondaine. Histoire et archives de la Police des Mœurs, Hoëbeke, Paris, 2009. Véronique Willemin Les Secrets de la nuit Enquête sur 50 ans de liaisons dangereuses : argent, sexe, police, politique, réseaux Flammarion © Flammarion, 2014. ISBN : 978-2-0813-3854-8 « Il ne peut y avoir de morale sexuelle de tous qui s’impose à la morale sexuelle de chacun. » Gisèle HALIMI Liste des sigles utilisés fréquemment dans l’ouvrage Les sigles ci-après sont, dans leur première occurrence, expliqués en note de bas de page. Pour les occurrences qui suivent, un asté- risque leur est apposé, afin que le lecteur puisse retrouver son explication dans cette liste. AFDAS : Assurance formation des activités du spectacle AMUON : Association de médiation pour un usage optimal de la nuit APUR : Atelier parisien d’urbanisme BAC : Brigade anti-criminalité BAM : Bar à ambiance musicale BCS : Bureau central des sources BDSM : Bondage et discipline/domination et soumission BRI : Brigade de recherche et d’intervention BRIF : Brigade de recherches et d’investigations financières BRP : Brigade de répression du proxénétisme BSP : Brigade des stupéfiants et du proxénétisme BT : Brigade territoriale CNAM : Conservatoire nationale des arts et métiers CNPF : Conseil national du patronat français CSCAD : Chambre syndicale des cabarets artistiques, des lieux de spectacles vivants et des discothèques -

André-Guy Robert Le Paris Des Années Folles
André-Guy Robert Le Paris des Années folles L’abondance de la documentation sur le Paris des Années folles est... affolante. Par quoi commencer? Dans l’ordre... 1. DUPASQUIER, Christophe, Paris, années folles [1 h 24 min] : https://www.youtube.com/watch?v=GH3MedBCVTs ➤ Pour un premier contact avec le Paris des Années folles, c’est le film à voir absolument. Dans ce documentaire de Fabien Béziat exclusivement constitué d’images d’époque toujours pertinentes, les scénaristes Emmanuel Blanchard et Vincent Labaume ont mis l’accent sur la joie de vivre et le progrès qui ont caractérisé l’entre-deux-guerres à Paris. Un résumé captivant. 2. ROBERT, André-Guy, Le Paris des Années folles : Chronologie. Il s’agit de ce fichier (v. page suivante). ➤ L’essentiel de ce que j’ai noté en six mois de recherches sur le Paris des Années folles, année après année : les dates importantes, les figures de proue, les œuvres marquantes, les tensions, les anecdotes... Un document unique et très précieux! Pour aller plus loin, je vous recommande la lecture de deux livres : 3. FRANCK, Dan, Bohèmes, Calman Lévy, 1988, 570 p. Cote BAnQ : 709.44361 F822b 2019. Enrichi de quelques photographies d’époque. ➤ Chronique au style brillant (l’auteur est romancier) fourmillant d’anecdotes sur le Paris culturel de 1900 à 1930. Excellente source pour connaître le point de vue de Français résidant à Paris durant la fin de la Belle Époque et la décennie des Années folles. 4. McAULIFFE, Mary, When Paris Sizzled: The 1920s Paris of Hemingway, Chanel, CoCteau, Cole Porter, Josephine Baker, and Their Friends, Rowman & Littlefield, Mary S. -

La Machine Du Moulin Rouge Revue De Presse Septembre 2011
LA MACHINE DU MOULIN ROUGE REVUE DE PRESSE SEPTEMBRE 2011 06 SEPT 11 Quotidien Paris avec dim. 25 AVENUE MICHELET OJD : 304971 93408 SAINT OUEN CEDEX - 01 40 10 30 30 Surface approx. (cm²) : 133 Page 1/1 Edition Abonnés - Oise BEAUVAIS L'Asca veut relever la tête Apres une année 2010 catastrophique et six septembre 2010 L'association a commence disposition « C'est une des raisons qui m'ont mois d'autogestion, l'Asca de Beauvais, qui 2011 avec un déficit avoisinant les 100000 € motive a postuler ici, raconte-1-il J'ai eu la regroupe I" Ouvre-boîte, le cinéma Agnes- Un bilan noir qui entraînera la démission de direction de salle qui avait une belle Varda et le Labo, a un nouveau directeur l'ancien directeur, Jean-Christophe Delcroix, diffusion mais pas de moyens autour Ici, il y Hervé Mondon Ce dernier vient de prendre a l'initiative du fameux festival, moins d'un a tout pour repeter, enregistrer, filmer et ses fonctions dans le quartier Argentine Vu an après son arrivée Sous la férule de son jouer C'est très rare Et l'idée, c'est de son parcours (il a gere des salles a Blois, nouveau patron, l'Asca va retrouver la développer cet aspect des choses en Lyon, a été tourneur, organisateur du festival politique qui lui a valu ses années de succès accueillant des groupes en résidence pour les Blue Note, et il sortait d'une mission d'un an « La programmation de l'Ouvre-boîte ne sera aider selon leurs besoins pour le filage, le et demi a Paris ou il s'est occupe de la plus elitiste, assure le nouveau directeur II son ou la lumière » Enfin, si Hervé -

La Dame Aux Éventails. Nina De Villard, Musicienne, Poète, Muse, Animatrice De Salon »
«La Dame aux éventails. Nina de Villard, musicienne, poète, muse, animatrice de salon » by Marie Boisvert A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of French University of Toronto © Copyright by Marie Boisvert 2013 « La Dame aux éventails. Nina de Villard, musicienne, poète, muse, animatrice de salon » Marie Boisvert Doctor of Philosophy Degree Département d’études françaises University of Toronto 2013 Résumé De 1862 à 1882, Nina de Villard attire chez elle à peu près tous les hommes qui laisseront leur marque dans le monde des arts et des lettres : Verlaine, Mallarmé, Maupassant, Manet et Cézanne figurent tous parmi ses hôtes. Ayant accueilli ces grands hommes, Nina et son salon trouvent, par la suite, leur place dans plusieurs livres de souvenirs et romans qui, loin de rendre leur physionomie et leur personnalité, entretiennent plutôt la confusion. Portraits fortement polarisés présentant une muse régnant sur un salon brillant d’une part, et de l’autre, une femme dépravée appartenant à un univers d’illusions perdues, ces textes construisent une image difforme et insatisfaisante de Nina et de ses soirées. Face à cette absence de cohérence, nous sommes retournée aux sources primaires en quête de la véritable Nina et de son salon. ii La première partie de notre thèse est consacrée à Nina qui, malgré des années de formation conformes à la norme, remet en question la place qui lui revient : celle d’épouse et de femme confinée à l’intérieur. Nina est avide de liberté et revendique l’identité de pianiste et une vie où elle peut donner des concerts, sortir et recevoir quand cela lui plaît. -

L'affaire Olesniak
L’Affaire Olesniak Baptiste Coulmont To cite this version: Baptiste Coulmont. L’Affaire Olesniak. Genre, sexualité & société, Ecole des Hautes Etudesen Sciences Sociales, 2009, 2, pp.document électronique. halshs-00599987 HAL Id: halshs-00599987 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00599987 Submitted on 12 Jun 2011 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. L’Affaire Olesniak 12/06/11 15:55 Genre, sexualité & société n°2 | Automne 2009 : Actualité des échanges économico-sexuels Documents L’Affaire Olesniak The case Olesniak BAPTISTE COULMONT Résumés Cet article repose sur la retranscription d'une affaire d'outrage aux bonnes mœurs : en 1969 une concierge diffusait des films pornographiques dans sa loge jusqu'à la découverte de cette activité par deux policiers. Ce « beau cas » sert de support à une description de l'état du commerce pornographique avant la libéralisation du début des années 1970. The case Olesniak This article is a close reading of the documents produced at the time of the trial for “outrage aux bonnes mœurs” (obscenity) against a female concierge in the Pigalle neighborhood of Paris. Based on his reading of the case, the author attempts to describe the state of the pornographic market before its liberalization. -

Entreprises Le Neuvième a La Cote !
MENSUEL D’INFORMATION DE LA MAIRIE DU NEUVIÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS NUMÉRO 14 NEUVIÈME PLUS VERT NEUVIÈME PLUS DYNAMIQUE NEUVIÈME VAGUE Réseau de bus du 9e Rencontre avec Valérie Pécresse Demandez votre Pass Culture Neuf — p. 7 — p. 10 — p. 20 PARISNEUF ENTREPRISES LE NEUVIÈME A LA COTE ! DATES Prochains événements ÉDITO e avec la Mairie du 9 Delphine Bürkli 6 rue Drouot Maire du 9e 01 71 37 75 09 arrondissement de Paris CONSEILS DU 9E ARRONDISSEMENT Lundis 24 avril et 22 mai à 18h30. © DR. 22/04 La Chasse aux N’œufs. Trois années utiles. Square Montholon à 10h. Vous êtes un peu plus de 60 000 habitants à avoir choisi d’élire domicile dans le 9e, un arrondissement familial et résidentiel mais aussi à forte attraction 27/04 économique, culturelle et touristique avec ses 125 000 visiteurs journaliers… Conférence "Le 1 dans le Neuf” un Paris en condensé. Il y a trois ans, quasiment jour pour jour, vous m’accordiez votre avec Erik Orsenna. confiance en m’élisant Maire. Salle Rossini à 19h30. Pour que le 9e soit définitivement tourné vers ses habitants, ses visiteurs et ses acteurs économiques, nous avons, depuis 2014, lancé de nombreux chantiers dont nous vous rendons compte régulièrement dans ces pages mais également 03/05 lors de réunions de concertation. Projection “Une histoire de fou”. Les quartiers Pigalle-Martyrs, Blanche-Trinité, Anvers Montholon, En présence de Robert Guediguian. Opéra-Chaussée d’Antin et Faubourg-Montmartre se transforment pour Salle Rossini à 19h30. rendre les rues plus agréables, propres et végétalisées, plus aisément accessibles aux piétons, favoriser la circulation des vélos et celle des véhicules propres car c’est cela, la ville de demain. -

Sex and the City
Marianne BLIDON, Sex and the City. La sexualité, une catégorie d’analyse pertinente en géographie, Feuilles de Géographie, 2007, Feuilles n°61, 26 p. Sex and the city La sexualité, une catégorie d’analyse pertinente en géographie Marianne BLIDON, UMR Géographie-cités, Université Paris 7 Comment ose-t-on montrer de telles choses ? Dessin d’Albert-Georges Badert paru dans Ici Paris, n°1347, mai 1971 (http://coulmont.com). Type : TD Niveau : L3, Master Durée : 2-3 heures Thèmes : genre, sexualité, géographie urbaine, sociale et culturelle, étude de cas. Objectifs : Dimension sociale fondamentale, mais point aveugle de nos discours, la sexualité est un élément déterminant pour comprendre le fonctionnement des sociétés humaines proches ou lointaines. Sa mise en scène comme sa dissimulation dans l’espace est un excellent révélateur des normes, des représentations et des pratiques sociales. Ce TD, sous forme de dossier documentaire, invite à analyser l’espace des sociétés dans ses dimensions sexuées et sexuelles. Il invite par la même à réfléchir au régime de visibilité dans la ville et à ce qui est socialement montrable ou pas. 1 Marianne BLIDON, Sex and the City. La sexualité, une catégorie d’analyse pertinente en géographie, Feuilles de Géographie, 2007, Feuilles n°61, 26 p. Bibliographie « Corps et sexualités », Urbanisme, n°325, 2002. « Sex and the City : Social and Economic Explorations in Urban Sexuality », Urban studies, 41/9, 2004. « Sexualités et migrations », Migrance, sous la direction de Nicole FOUCHE et Serge WEBER, n°27, 2007. « Sur la sexualité », Actes de la recherche en sciences sociales, n°128, 1999. BELL D., VALENTINE G., Mapping Desire : Geographies of Sexualities, Routledge, London, 1995. -

Réunion Du Bureau Du Conseil De Quartier Pigalle-Martyrs Compte
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs Mardi 11 décembre 18h30 Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 9e Compte-rendu Etaient présents : Amélie Alduy, Eléna Angleviel, Roger-Patrice Bernard, Agnès Catineau, Annie Fournier, Michel Güet, Emmanuel Hébrard, Joël-Yves Le Bigot, Philippe Le Carpentier, Murielle Lévy, Anick Puyoou, Daniel Steinbrunner, Fabrice Taratte, Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). Excusés : Virginie Mergoil, Laurence Ribière, Christine Rivet. Invitées : Maryse Hébrard, Laurel Conway. 1) Retour sur les Journées Françaises de la Jeunesse Points positifs : la collaboration avec la mairie du 9e, la mise en relation avec le Conseil Municipal des Enfants (CME), la diffusion des numéros d’urgence. Points à améliorer : la mobilisation des écoles du 9e ; l’engagement de certains bénévoles sur des tâches spécifiques. Engagements pris : - Étendre le CME à un conseil municipal des collégiens et des lycéens ; - Ne pas régler les problèmes à court terme sur le dos des générations futures ; - Organiser une édition en 2019 - Chaque enfant du 9e doit connaître et maitriser les numéros d’urgence qui le concernent ; le 119 pour les violences physiques et le 3020 pour le harcèlement. - Tenter d’obtenir l’extension du service « 3020 » 24h/24 + 365 j/an - Publier une plaquette sur les JFJ 2018, pour porter témoignage des réalisations 2018 et pour organiser l’édition 2019 La charge de travail a été très importante pour organiser cet événement. Il faut davantage de bénévoles et mieux structurer la répartition des tâches. Suggestions de thèmes pour l’édition 2019 : - éducation numérique : enseigner aux enfants comment se servir des outils numériques à bon escient. -

Georges Villeneuve
J ACQUES CÔTÉ DANS LE QUARTIER DES AGITÉS LES CAHIERS NOIRS DE L’ALIÉNISTE Extrait de la publication DANS LE QUARTIER DES AGITÉS LES CAHIERS NOIRS DE L’ALIÉNISTE –1 DU MÊME AUTEUR Nébulosité croissante en fin de journée. Roman. Beauport: Alire, Romans 034, 2000. Le Rouge idéal. Roman. Lévis: Alire, Romans 063, 2002. La Rive noire. Roman. Lévis: Alire, Romans 092, 2005. Le Chemin des brumes. Roman. Lévis: Alire, Romans 113, 2008. Wilfrid Derome, expert en homicides. Biographie. Montréal: Boréal, 2003. LES CAHIERS NOIRS DE L’ALIÉNISTE Dans le quartier des agités. Roman. Lévis: Alire, GF 10, 2010. Le Sang des prairies. Roman. Lévis: Alire, GF 12, 2011. Extrait de la publication DANS LE QUARTIER DES AGITÉS JACQUES CÔTÉ Extrait de la publication Illustration de couverture : BERNARD DUCHESNE Photographie : VALÉRIE ST-MARTIN Distributeurs exclusifs : Canada et États-Unis : Suisse : Messageries ADP Interforum editis Suisse 2315, rue de la Province Case postale 69 – CH 1701 Fribourg – Suisse Longueuil (Québec) Canada Téléphone: 41 (0) 26 460 80 60 J4G 1G4 Télécopieur: 41 (0) 26 460 80 68 Téléphone: 450-640-1237 Internet : www.interforumsuisse.ch Télécopieur: 450-674-6237 Courriel : [email protected] Distributeur : OLS S.A. France et autres pays : Zl. 3, Corminboeuf Case postale 1061 – CH 1701 Fribourg – Suisse Interforum editis Commandes : Immeuble Paryseine, 3 Tél. : 41 (0) 26 467 53 33 Allée de la Seine, 94854 Ivry Cedex Télécopieur : 41 (0) 26 467 55 66 Tél.: 33 (0) 4 49 59 11 56/91 Internet : www.olf.ch Télécopieur: 33 (0) 1 49 59 11 33 Courriel : [email protected] Service commande France Métropolitaine Belgique et Luxembourg : Tél.: 33 (0) 2 38 32 71 00 Interforum editis Benelux S.A. -

O\371 Est Pass\351 Le 341.Wps
CHAPITRE 1 Conducteur de bus F/H Non diplômé à niveau Bac +2 Missions et responsabilités : Professionnel(le) de la conduite, vous assurez une mission commerciale importante auprès de la clientèle. Vous êtes le "maître à bord du bus". Votre parfaite maîtrise du bus vous permet de transporter les voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité et de confort tout en veillant au respect de la réglementation à l'intérieur du bus. 1 Les activités au quotidien: Mission commerciale Répondre aux attentes des clients en leur réservant un bon accueil et en les renseignant Participer au respect, par les clients, des règles d'usages du bus Informer sur les tarifs et vendre des titres de transport Assurer un contrôle visuel des titres de transport Mission transport Transporter les clients 2 Gérer la circulation du bus en milieu urbain Assurer la continuité du service à la demande du poste de commandement local ou de la permanence bus Mission gestion des équipements Identifier et signaler les incidents mécaniques Utiliser les moyens de communication embarquée - Mère ce doit être bien, je postule. Antoine Picot était un jeune pédéraste de 20 ans très laid, introverti, dont le père escroc avait été mis en prison, seul avec sa 3 mère et destitué de l’ensemble de ses diplômes qu’il avait volé, il était devenu, un moins que rien en deux mots un pauvre type. Véritable loqueteux, sa mère avait été expulsé à coups de pieds de son appartement de la porte d’Auteuil que son mari n’avait jamais payé. Aujourd’hui vivant sous le périphérique, il fallait bien après le suicide de son fils aîné par hara-kiri que le dernier des laids trouve un travail, et c’est dans un journal trouvé dans une poubelle qu’ Antoine décida de postuler, ce qu’il ne 4 savait pas, c’est que cet emploi allait lui amener de conduire le 341, que le 341 allait amener Bardok, Isidore et Marmaduke des détectives pitoyables mais surtout que le 341 allait…disparaître. -

La Fondation Et Le Fonctionnement D´Une Agence De Voyages: Le Cas Pratique Monatour
UNIVERSITÉ PALACKÝ D’OLOMOUC FACULTÉ DES LETTRES Département des Études romanes Markéta Tu čková La fondation et le fonctionnement d´une agence de voyages: le cas pratique Monatour Mémoire de licence Directeur du mémoire : Ing. Michel Viland OLOMOUC 2009 Déclaration Je déclare que le présent mémoire est le résultat de mon propre travail et que toutes les sources bibliographiques utilisées sont citées. Olomouc, le 7 mai 2009 Signature Remerciement Le présent mémoire est le résultat d’une collaboration internationale. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation. D´abord j´aimerais bien remercier à M. Michel Viland de m’avoir encouragée tout au long de mon travail et d’avoir ensuite surveillé soigneusement la rédaction de la présente étude. Merci également à M. Roman Škrabánek de me donner son temps et les informations nécessaires pour la réalisation de ce travail. ANOTACE Příjmení a jméno: Markéta Tu čková Katedra: KRF – Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Název práce: La fondation e le fonctionnement d´une agence de voyages Foundation and functioning of a travel agency: the practical case of Název v angli čtin ě: Monatour Vedoucí práce: Ing. Michel Viland Jazyk práce: Francouzština Rok obhajoby: 2009 Po čet stran: 58 Cestovní kancelá ř, cestovní ruch výjezdový a p říjezdový, zájezd, Mo- Klí čová slova: natour, destinace, strategie Bakalá řská práce „Založení a fungování cestovní kancelá ře: praktický příklad Monatour“ zkoumá problematiku cestovního ruchu a postavení cestovních kancelá ří v České republice. Práce je člen ěna do t ří hlav- ních oddíl ů a to: „Rozvoj a organizace cestovních kancelá ří v České republice.“, dále „Socio-ekonomická studie cestovního ruchu v ČR“ a Anotace práce: „P říklad úsp ěšné cestovní kancelá ře: praktický p říklad Monatour“.