LES MORILLES Vues Par Philippe Clowez
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SMR Lettre D'informations N° 2017-05
1 Lettre d'informations n° 21 – 2017/05 Rencontres mycologiques 2017 Catherine PAYANT La Société Mycologique de Rennes organise cette année les rencontres mycologiques inter associatives. Elles se tiendront le dimanche 14 mai à partir de 9h30 à Néant-sur-Yvel et regrouperont l’Association Mycologique Ploemeur Morbihan (AMPM), le Groupe Mycologique Nazairien (GMN) et bien sûr la SMR. Le RV est au parking de Folle Pensée (Fontaine de Barenton), commune de Paimpont à 10h . De là, balade pédestre accompagnée et commentée sur les chemins enchantés de la Forêt mythique de Paimpont sous la conduite de guides. Vers 12h départ des voitures en cortège pour Tlohan près de Néant sur Yvel, à environ 7 km de la Fontaine de Barenton. Pique-nique près d'un étang, précédé d'un apéritif offert par la SMR. Pensez à apporter vos tables et chaises. En cas de mauvais temps, sur ce lieu un vaste abri couvert est à notre disposition mais les dieux de la forêt seront avec nous ! L'après-midi peut être libre ou balade vers l'Arbre d'or et, ou visite de la très jolie église de Tréhorenteuc. 22 avril 2017 : dans les dunes Plouharnel (56) Dimitri BACRO Plusieurs membres de l’association mycologique de Ploemeur Morbihan sont venus nous rendre une petite visite à l’heure du pique-nique. Nous avons pu consulter un petit inventaire des champignons récoltés dans les dunes. Parmi les espèces couramment rencontrées, une morille plutôt méridionale, Morchella dunensis . Et en dépit des conditions climatiques proches de la sécheresse, nous en avons trouvé trois ou quatre, dont la première, énorme, avait séché sur pied à l’entrée d’un terrier de lapin ! (S’il est vrai que l’urine des diabétiques favorise l’apparition des morilles, voilà qui nous interroge sur celle des lapins. -

El Género Morchella Dill. Ex Pers. En Illes Balears
20210123-20210128 El género Morchella Dill. ex Pers. en Illes Balears (1) JAVIER MARCOS MARTÍNEZ C/Alfonso IX, 30, Bajo derecha. 37500. Ciudad Rodrigo, Salamanca, España. Email: [email protected] (2) GUILLEM MIR Solleric, 76. E-07340 Alaró, Mallorca, Illes Balears, España. E-mail: [email protected] (3) GUILHERMINA MARQUES CITAB, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Departamento de Agronomía, 5001-801. Vila Real, Portugal. Email: [email protected] Resumen: MARCOS, J.; MIR, G. & G. MARQUES (2021). El género Morchella Dill. ex Pers. en Illes Balears. Se realiza una revisión de las especies del género Morchella recolectadas hasta la fecha en las Illes Balears, aportando nuevas citas, fotografías, descripciones macroscópicas y microscópicas, ecología y distribución de las especies. Además, para confirmar la identidad de las especies, se identificaron algunas muestras mediante análisis molecular. Destacan dos especies que son nuevas para el catálogo micológico de las Islas: M. galilaea Masaphy & Clowez y M. rufobrunnea Guzman & F. Tapia y dos nuevas para el catálogo de la isla de Mallorca: M. dunalii Boud. y M. dunensis (Castañera, J.L. Alonso & G. Moreno) Clowez. Palabras clave: Ascomycotina, Morchella, Islas Baleares, España. Abstract: MARCOS, J.; MIR, G. & G. MARQUES (2021). The genus Morchella Dill. ex Pers. in Balearic Island. The species of the genus Morchella collected to date in the Balearic Islands are reviewed, providing new appointments, photographies, macroscopics and microscopic descriptions, ecology and distributions of the species. Additionally in order to confirm the identity of the species some samples were identified by molecular analysis. Two species are new appointments for mycologic catalogue of the Islands: M. -

Československa Vedecka Společnost Pro Mykologii
------ ČESKOSLOVENSKA VEDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII i 2 4 ■ 1 ACADEMIA/PRAHA LEDEN 1970 I ČESKÁ MYKOLOGIE i Časopis Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické R o č n í k 2 4 Č í s 1 o 1 Leden 1970 :i Vydává Čs. vědecká společnost pro mykologii v Nakladatelství Československé akademie věd Vedoucí redaktor: člen korespondent ČSAV Albert Pilát, doktor biologických věd Redakční rada: akademik Ctibor Blattný, doktor zemědělských věd, univ. prof. Karel Cejp, doktor biologických věd, dr. Petr Fragner, MUDr. Josef Hearink, dr. František Kotlaba, kan didát biologických věd, inž. Karel Kříž, prom. biol. Zdeněk Pouzar, dr. František Šmarda Výkonný redaktor : dr. Mirko Svrček, kandidát biologických věd Příspěvky zasílejte na adresu výkonného redaktora: Praha 1, Václavské nám. 68, Národní muzeum, telefon 233541, linka 87. ; 4. sešit 23. ročníku vyšel 15. října 1969 OBSAH A. P i 1 á t : K sedmdesátinám prof. dr. Karla Cejpa, D S c . ..............................................................1 M. Svrček a Z. Pouzar: Cejpomyces gen. nov., nový rod resupinátních hymeno- mycetů ( C o r t ic ia c e a e ) ....................................................................................................................... 5 J H e r n k : Doc. inž. Antonín Příhoda padesátníkem............................................................................. 12 I F. Kotlaba: Studie o hvězdovce Pouzarově — Geastrum pouzarii V. J. Staněk . 21 J. Moravec: Morchella pragensis Smotlacha 1952 — smrž pražský, málo známý druh rodu Morchella Dill. ex St. A m a n s.............................................................................................. 32 ■ A. Příhoda: Battarrea stevenii (Lib.) Fr. v Řecku. (S barevnou tabulí č. 75; . 4 0 M. Semerdžieva a V. Musile k: Růst a vývoj slizečky slizké — Oudemansiella mucida 44 f C. -

Les Morilles En Franche-Comté
ANNEE 2016 - n° 25 - 16 - 46 TITRE DE LA THESE LES MORILLES EN FRANCHE-COMTE : Biologie, monographies, toxicité & propriétés thérapeutiques THESE présentée et soutenue publiquement le : 2 décembre 2016 pour obtenir le Diplôme d'État de DOCTEUR EN PHARMACIE PAR Marine COMOLA Née le 26 octobre 1990 à Besançon (25) (Nom) (Qualité) Président : Dominique MEILLET Professeur Directeur de la thèse : Dominique MEILLET Professeur Co-Directeur : Jean-Marc MOINGEON Chargé d’Enseignements Juge : Marine BRESSON Docteur en Pharmacie l UFR SMP 19 rue Ambroise Paré F-25030 Besançon cedex l Tél. +33 (0)3 63 08 22 00 l Fax +33 (0)3 81 66 56 83 l http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ U.F.R. DES SCIENCES MÉDICALES & PHARMACEUTIQUES DE BESANÇON DIRECTEUR P Professeur Emmanuel SAMAIN ASSESSEURS MÉDECINE Professeur Bernard PARRATTE Directeur des études Professeur Benoît de BILLY Professeur Gilles CAPELLIER Professeur Thierry MOULIN DOYEN PHARMACIE Professeur Marie-Christine WORONOFF-LEMSI Directrice Adjointe ASSESSEUR PHARMACIE Professeur Laurence NICOD Directrice des études RESPONSABLE ADMINISTRATIVE Mme Florence PRETOT MÉDECINE PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS – PRATICIENS HOSPITALIERS M. Olivier ADOTEVI IMMUNOLOGIE M. Frédéric AUBER CHIRURGIE INFANTILE M. François AUBIN DERMATO-VÉNÉRÉOLOGIE Mme Yvette BERNARD CARDIOLOGIE Mme Alessandra BIONDI RADIOLOGIE ET IMAGERIE MÉDICALE M. Hugues BITTARD UROLOGIE M. Christophe BORG CANCÉROLOGIE M. Hatem BOULAHDOUR BIOPHYSIQUE ET MÉDECINE NUCLÉAIRE M. Jean-Luc BRESSON BIOLOGIE ET MÉDECINE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA REPRODUCTION M Gilles CAPELLIER RÉANIMATION M. Jean-Marc CHALOPIN NÉPHROLOGIE Mme Catherine CHIROUZE MALADIES INFECTIEUSES M Sidney CHOCRON CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE M. Jean-Luc CHOPARD MÉDECINE LÉGALE ET DROIT DE LA SANTÉ Mme Cécile COURIVAUD NÉPHROLOGIE M. -
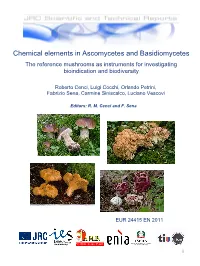
Chemical Elements in Ascomycetes and Basidiomycetes
Chemical elements in Ascomycetes and Basidiomycetes The reference mushrooms as instruments for investigating bioindication and biodiversity Roberto Cenci, Luigi Cocchi, Orlando Petrini, Fabrizio Sena, Carmine Siniscalco, Luciano Vescovi Editors: R. M. Cenci and F. Sena EUR 24415 EN 2011 1 The mission of the JRC-IES is to provide scientific-technical support to the European Union’s policies for the protection and sustainable development of the European and global environment. European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability Via E.Fermi, 2749 I-21027 Ispra (VA) Italy Legal Notice Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of this publication. Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed. A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. It can be accessed through the Europa server http://europa.eu/ JRC Catalogue number: LB-NA-24415-EN-C Editors: R. M. Cenci and F. Sena JRC65050 EUR 24415 EN ISBN 978-92-79-20395-4 ISSN 1018-5593 doi:10.2788/22228 Luxembourg: Publications Office of the European Union Translation: Dr. Luca Umidi © European Union, 2011 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Printed in Italy 2 Attached to this document is a CD containing: • A PDF copy of this document • Information regarding the soil and mushroom sampling site locations • Analytical data (ca, 300,000) on total samples of soils and mushrooms analysed (ca, 10,000) • The descriptive statistics for all genera and species analysed • Maps showing the distribution of concentrations of inorganic elements in mushrooms • Maps showing the distribution of concentrations of inorganic elements in soils 3 Contact information: Address: Roberto M. -

Morels on the Sand Dunes of the Emilia-Romagna Coast (Northwestern Adriatic Sea, Italy)
Snabl et al. Italian Journal of Mycology 48:16-25 (2019) DOI: https://doi.org/10.6092/issn.2531-7342/9374 Original paper Morels on the sand dunes of the Emilia-Romagna coast (Northwestern Adriatic Sea, Italy) Martin Snabl1, Urbano Guidori1, Carmelo Gianchino2, Mirco Iotti2, Alessandra Zambonelli3 1Italian Mycological Society (UMI), viale Fanin 44, 40127 Bologna, Italy 2Department of Health, Life and Environmental Sciences, University of L’Aquila, via Vetoio, Coppito 1, 67100 L’Aquila, Italy 3Department of Agricultural and Food Sciences, University of Bologna, via Fanin 44, 40127 Bologna, Italy Corresponding author e-mail: [email protected] Received 4/02/2019; accepted 18/04/2019. Abstract Morchella species are known as famous and prized edible fungi due to their culinary flavor and medicinal properties. The asomata are collected throughout the temperate regions of the northern hemisphere. Morchella spp. taxonomy has long been debated as a result of the high phenotypic plasticity charaterizing the genus. Most morels are considered saprobic but some species has been reported to interact with roots of many plant species forming different types of associations. In Emilia-Romagna (Italy), morels became a part of the culinary tradition, especially for the populations of the coastal areas. This work aimed to describe and identify the ascomata collected on the white dune habitat as well as to verify the extent of the interaction with plant species growing in the same area. All ascomata collected since 2001 shared a similar morphology with a range of variability mainly due to the harvesting period. Ascomata collected in 2017 were grouped within the Mes-17 clade, in the Esculenta group, based on their ITS rDNA sequences. -

Schauster Annie Thesis.Pdf (1.667Mb)
UNIVERSITY OF WISCONSIN-LA CROSSE Graduate Studies GENETIC AND GENOMIC INSIGHTS INTO THE SUCCESSIONAL PATTERNS AND REPRODUCTION METHODS OF FIRE-ASSOCIATED MORCHELLA A Chapter Style Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Annie B. Schauster College of Science and Health Biology May, 2020 GENETIC AND GENOMIC INSIGHTS INTO THE SUCCESSIONAL PATTERNS AND REPRODUCTION METHODS OF FIRE-ASSOCIATED MORCHELLA By Annie B. Schauster We recommend acceptance of this thesis paper in partial fulfillment of the candidate's requirements for the degree of Master of Science in Biology. The candidate has completed the oral defense of the thesis paper. Todd Osmundson, Ph.D. Date Thesis Paper Committee Chairperson Thomas Volk, Ph.D. Date Thesis Paper Committee Member Anita Davelos, Ph.D. Date Thesis Paper Committee Member Bonnie Bratina, Ph.D. Date Thesis Paper Committee Member Thesis accepted Meredith Thomsen, Ph.D. Date Director of Graduate Studies ABSTRACT Schauster, A.B. Genetic and genomic insights into the successional patterns and reproduction methods of fire-associated Morchella. MS in Biology, May 2020, 81pp. (T. Osmundson) Burn morels are among the earliest-emerging post-fire organisms in western North American montane coniferous forests, occurring in large numbers the year after a fire. Despite their significant economic and ecological importance, little is known about their duration of reproduction after a fire or the genetic and reproductive implications of mass fruiting events. I addressed these unknowns using post-fire surveys in British Columbia, Canada and Montana, USA in May/June of 2019. To assess fruiting duration, I collected specimens in second-year sites, where burn morels were collected the previous year, and identified them using DNA sequencing. -

Systematic Study of Fungi in the Genera Underwoodia and Gymnohydnotrya (Pezizales) with the Description of Three New South American Species
Persoonia 44, 2020: 98–112 ISSN (Online) 1878-9080 www.ingentaconnect.com/content/nhn/pimj RESEARCH ARTICLE https://doi.org/10.3767/persoonia.2020.44.04 Resurrecting the genus Geomorium: Systematic study of fungi in the genera Underwoodia and Gymnohydnotrya (Pezizales) with the description of three new South American species N. Kraisitudomsook1, R.A. Healy1, D.H. Pfister2, C. Truong3, E. Nouhra4, F. Kuhar4, A.B. Mujic1,5, J.M. Trappe6,7, M.E. Smith1,* Key words Abstract Molecular phylogenetic analyses have addressed the systematic position of several major Northern Hemisphere lineages of Pezizales but the taxa of the Southern Hemisphere remain understudied. This study focuses Geomoriaceae on the molecular systematics and taxonomy of Southern Hemisphere species currently treated in the genera Under Helvellaceae woodia and Gymnohydnotrya. Species in these genera have been identified as the monophyletic /gymnohydno trya Patagonia lineage, but no further research has been conducted to determine the evolutionary origin of this lineage or its relation- South American fungi ship with other Pezizales lineages. Here, we present a phylogenetic study of fungal species previously described truffle systematics in Underwoodia and Gymnohydnotrya, with sampling of all but one described species. We revise the taxonomy of Tuberaceae this lineage and describe three new species from the Patagonian region of South America. Our results show that none of these Southern Hemisphere species are closely related to Underwoodia columnaris, the type species of the genus Underwoodia. Accordingly, we recognize the genus Geomorium described by Spegazzini in 1922 for G. fuegianum. We propose the new family, Geomoriaceae fam. nov., to accommodate this phylogenetically and morphologically unique Southern Hemisphere lineage. -

Morchella Esculenta</Em>
Journal of Bioresource Management Volume 3 Issue 1 Article 6 In Vitro Propagation of Morchella esculenta and Study of its Life Cycle Nazish Kanwal Institute of Natural and Management Sciences, Rawalpindi, Pakistan Kainaat William Bioresource Research Centre, Islamabad, Pakistan Kishwar Sultana Institute of Natural and Management Sciences, Rawalpindi, Pakistan Follow this and additional works at: https://corescholar.libraries.wright.edu/jbm Part of the Biodiversity Commons, and the Biology Commons Recommended Citation Kanwal, N., William, K., & Sultana, K. (2016). In Vitro Propagation of Morchella esculenta and Study of its Life Cycle, Journal of Bioresource Management, 3 (1). DOI: https://doi.org/10.35691/JBM.6102.0044 ISSN: 2309-3854 online This Article is brought to you for free and open access by CORE Scholar. It has been accepted for inclusion in Journal of Bioresource Management by an authorized editor of CORE Scholar. For more information, please contact [email protected]. In Vitro Propagation of Morchella esculenta and Study of its Life Cycle © Copyrights of all the papers published in Journal of Bioresource Management are with its publisher, Center for Bioresource Research (CBR) Islamabad, Pakistan. This permits anyone to copy, redistribute, remix, transmit and adapt the work for non-commercial purposes provided the original work and source is appropriately cited. Journal of Bioresource Management does not grant you any other rights in relation to this website or the material on this website. In other words, all other rights are reserved. For the avoidance of doubt, you must not adapt, edit, change, transform, publish, republish, distribute, redistribute, broadcast, rebroadcast or show or play in public this website or the material on this website (in any form or media) without appropriately and conspicuously citing the original work and source or Journal of Bioresource Management’s prior written permission. -

Josiana Adelaide Vaz
Josiana Adelaide Vaz STUDY OF ANTIOXIDANT, ANTIPROLIFERATIVE AND APOPTOSIS-INDUCING PROPERTIES OF WILD MUSHROOMS FROM THE NORTHEAST OF PORTUGAL. ESTUDO DE PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES, ANTIPROLIFERATIVAS E INDUTORAS DE APOPTOSE DE COGUMELOS SILVESTRES DO NORDESTE DE PORTUGAL. Tese do 3º Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Doutoramento em Ciências Farmacêuticas–Bioquímica, apresentada à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Orientadora: Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira (Professora Adjunta c/ Agregação do Instituto Politécnico de Bragança) Co- Orientadoras: Maria Helena Vasconcelos Meehan (Professora Auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto) Anabela Rodrigues Lourenço Martins (Professora Adjunta do Instituto Politécnico de Bragança) July, 2012 ACCORDING TO CURRENT LEGISLATION, ANY COPYING, PUBLICATION, OR USE OF THIS THESIS OR PARTS THEREOF SHALL NOT BE ALLOWED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. ii FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO STUDY OF ANTIOXIDANT, ANTIPROLIFERATIVE AND APOPTOSIS-INDUCING PROPERTIES OF WILD MUSHROOMS FROM THE NORTHEAST OF PORTUGAL. Josiana Adelaide Vaz iii The candidate performed the experimental work with a doctoral fellowship (SFRH/BD/43653/2008) supported by the Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT), which also participated with grants to attend international meetings and for the graphical execution of this thesis. The Faculty of Pharmacy of the University of Porto (FFUP) (Portugal), Institute of Molecular Pathology and Immunology (IPATIMUP) (Portugal), Mountain Research Center (CIMO) (Portugal) and Center of Medicinal Chemistry- University of Porto (CEQUIMED-UP) provided the facilities and/or logistical supports. This work was also supported by the research project PTDC/AGR- ALI/110062/2009, financed by FCT and COMPETE/QREN/EU. Cover – photos kindly supplied by Juan Antonio Sanchez Rodríguez. -

Año Xvi Nº 2 / Abril - Junio 2021
Micobotánica-Jaén La primera revista digital de Micología y Botánica en castellano. ISSN 1886-8541 Micobotánica-Jaén no se hace responsable de los artículos publicados en esta revista, ni se identifica necesariamente con los mismos. Los autores son únicos responsables del copyright del contenido de sus artículos. AÑO XVI Nº 2 / ABRIL - JUNIO 2021 FOTO DE ABRIL FOTO DE MAYO Flammulina velutipes (Curtis) Singer Crucibulum laeve (Huds.) Kambly Autor: Miguel Olivera A. Autor: Demetrio Merino A. FOTO DE JUNIO CONTENIDO Aportaciones micológicas 46 por D. Merino Alcántara 002 Morchella exuberans Clowez, Hugh Sm. & S. Sm., una especie pirófila poco conocida en Es- paña por J. Marcos Martínez, J. Sáiz-Pérez, G. Marques & J.A. Martínez Martínez 028 Notas corológicas de la provincia de Jaén III por I. de Bellard Pecchio, J.L. Hervás Serrano & Javier Reyes Carrillo 040 Notas sobre el género Narcissus Linnaeus, 1753 (Asparagales: Amaryllidaceae): Especies endémicas de España por P. Gámez Murillo 047 Clathrus archeri (Berk.) Dring Autora: Dianora Estrada A. En este número fichas micológicas de: Coprinop- sis lagopus, Melastiza chateri, Morchella disparilis y Peziza megalochondra. Micobotánica-Jaén AÑO XVi Nº 2 ABRIL-JUNIO 2021 1 20210401 APORTACIONES MICOLÓGICAS 46 por D. Merino Alcántara e-mail: [email protected] Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 2 (2021) ISSN 1886-8541 Resumen. MERINO ALCÁNTARA, D. (2021). Aportaciones micológicas 46. Micobotánica-Jaén año XVI nº 2. Se describen 4 especies y se cita 1 más, de las que 2 podrían ser primera cita para Andalucía y 1 podría ser primera cita para la provincia de Jaén. Se aportan datos sobre la ecología y corología de las especies. -

Morchella (Kuzugöbeği) Cinsi Genetik Çeşitliliğine Katkilar
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2019 Cilt: 38-2 MOLEKÜLER YÖNTEMLERİN KULLANIMI İLE TÜRKİYE MORCHELLA (KUZUGÖBEĞİ) CİNSİ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNE KATKILAR Modeling And Comparison Of Conventional And Active Stop Voltage Regulators İsmail KESKİNKILIÇ, Hatıra TAŞKIN Biyoteknoloji Anabalim Dalı ÖZET Sunulan bu çalışmada, Türkiye Morchella (kuzugöbeği) cinsi çeşitliliğine DNA dizi analizlerine dayalı moleküler tekniklerin kullanımı ile katkılar sunulması hedeflenmiştir. Daha önce Türkiye’de yapılan çalışmalarda Morchella cinsinde önemli bir çeşitlilik yakalanmıştır. Bu çalışma ile bu çeşitliliğin artırılmasına çalışılmıştır. Türkiye’nin farklı bölge ve illerinden toplanan kuzugöbeği mantarı örnekleri ile yeni bir koleksiyon oluşturulmuştur. Bu koleksiyon, farklı gen bölgelerinin (ITS rDNA, 28S rDNA, EF-1α, RPB1 ve RPB2) DNA dizi analizlerine dayalı yöntemle analizlenmiştir. Filogenetik ağaçlar, MEGA programında Maximum Likelihood (ML) analizi ile oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda, koleksiyon içerisinde; Morchella dunensis, M. tridentina, M. importuna, M. eximia, M. dunalii, M. mediterraneensis, M. deliciosa, M. pulchella ve Mel-13 türleri tespit edilmiştir. Koleksiyonda yer alan bazı örneklerin tür adları, analizlenen tüm gen bölgelerinde tüm örnekler için kaliteli DNA dizileri elde edilemediği için sonraya bırakılmıştır. Bu örnekler; M. laurentiana, M. eohespera veya M. purpurascens türleri ile yüksek benzerlik göstermişlerdir. Filogenetik olarak bu kardeş türlerin ayırımı zor olmaktadır. Ayrıca koleksiyonda yer alan M. steppicola’nın