Menp R3M 101102 Xp6
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Accélérer La Transition Énergétique Pour Installer Le Maroc Dans La Croissance Verte
Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental Accélérer la transition énergétique pour installer le Maroc dans la croissance verte Auto-saisine n°45/2020 www.cese.ma Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental Accélérer la transition énergétique pour installer le Maroc dans la croissance verte Auto-saisine n°45/2020 Accélérer la transition énergétique pour installer le Maroc dans la croissance verte Conformément à l’article 6 de la loi organique n°128-12 relative à son organisation et à son fonctionnement, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) s’est autosaisi aux fins de produire un avis sur la transition énergétique. A cet égard, le Bureau du Conseil a confié à la Commission chargée de l’environnement et du développement durable l›élaboration dudit avis. Lors d’une session extraordinaire, tenue le 16 juin 2020, l’Assemblée Générale du CESE a adopté à l’unanimité absolue des votants l’avis intitulé « Accélérer la transition énergétique pour installer le Maroc dans la croissance verte » . 5 Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental 6 Accélérer la transition énergétique pour installer le Maroc dans la croissance verte Liste des abréviations AMEE : Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique ANRE : L’Autorité de Nationale de Régulation de l’Electricité CESE : Conseil économique, Social et Environnemental CSP : Concentrating Solar Power DEPP : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation EnR : Energies renouvelables EWEC: Emirates Water and Electricity Company GME : Gazoduc -

1008-Novembre-2018-Financement.Pdf
www.cfcim.org 56e année Numéro 1008 15 novembre - 15 décembre 2018 Dispensé de timbrage autorisation n° 956 L’INVITÉ DE CONJONCTURE NOUREDDINE BENSOUDA Les nouveaux modes de financement Quelles alternatives pour les entreprises ? Forum d’Aff aires Inauguration de L’actualité des L’actualité vue par le Maroc-France à l’incubateur du Kluster Délégations Régionales Service économique de Laâyoune CFCIM de la CFCIM l’Ambassade de France Editorial Les nouveaux modes de financement. Quelles alternatives pour les entreprises ? Philippe-Edern KLEIN Président Rétablir la confiance pour mieux soutenir les entreprises Les entreprises marocaines, notamment les TPE et PME, sont confrontées à des difficultés chroniques de financement, que ce soit pour soutenir leur développement ou tout simplement pour assurer leur cycle d’exploitation. Ce fi nancement est en eff et indispensable pour les aider à passer chaque étape clé de leur évolution. Si toutes les entreprises n’ont pas forcément accès aux prêts bancaires ou aux marchés fi nanciers du fait de leur manque d’antériorité ou en raison du risque qu’elles représentent, elles disposent aujourd’hui de nouvelles alternatives telles que le crowdfunding, la fi nance participative ou encore les business angels. Ces nouveaux dispositifs, dotés progressivement d’un cadre juridique, sont amenés à connaître un fort développement dans les prochaines années au Maroc. Ils devraient contribuer à encourager l’esprit d’entrepreneuriat, mais aussi à rétablir la confi ance entre investisseurs, fi nanciers et entreprises, et ainsi participer à l’amélioration globale du climat des aff aires. Ce mois-ci, Conjoncture revient sur un très bel événement : le Forum d’Aff aires Maroc-France de Laâyoune, organisé par la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra et la CFCIM. -

L'ambitiond'andre Azoulay Sanbar, Le Responsable De
Quand leMaroc sera islamiste Lacorruption, unsport national L'ambitiond'Andre Azoulay I'Equipement et wali de Marrakech, qui sera nomme en 200S wali de Tanger; le polytechnicien Driss Benhima, fils Durant les deux dernieres annees du regne d'Hassan II, d'un ancien Premier ministre et ministre de I'Interieur ; un vent reformateur va souffler pendant quelques mois au Mourad Cherif, qui fut plusieurs fois ministre et dirigea Maroc. Un des principaux artisans de cette volonte de tour atour l'Omnium nord-africain puis l'Office cherifien changement aura ete Andre Azoulay, le premier juif maro des phosphates - les deux neurons economiques du cain aetre nomme conseiller de SaMajeste par dahir (decret royaume -, avant d'etre nomme en mars 2006 ala tete de royal). Le parcours militant de ce Franco-Marocain, un la filiale de BNPParibas au Maroc, la BMCI ; et enfin Hassan ancien de Paribas et d'Eurocom, temoigne d'un incontes Abouyoub, plusieurs fois ministre et ancien ambassadeur. table esprit d'ouverture. Artisan constant d'un rapproche Ainsi Andre Azoulay pretendait, avec une telle garde ment [udeo-arabe, il cree en 1973 l'association Identite et rapprochee, aider le roi Hassan II dans ses velleites Dialogue alors qu'il reside encore en France. Aidepar Albert reformatrices. Sasson, un ancien doyen de la faculte de Rabat fort res Seulement, l'essai n'a pas ete transforme. Dans un pre pecte, Andre Azoulay organise de multiples rencontres mier temps, l'incontestable ouverture politique du entre juifs et Arabes.Sesliens d'amitie avec Issam Sartaoui, royaume, qui a vu Hassan II nommer ala tete du gouverne Ie responsable de l'OLP assassine en 1983, ou avec Elias ment le leader socialiste de l'USFP, s'est accompagnee d'un Sanbar, le responsable de la Revue d'etudes palestiniennes, processus d'assainissement economique. -

Morocco and the Mirages of Democracy and Good Governance
UNISCI Discussion Papers, Nº 12 (Octubre / October 2006) ISSN 1696-2206 MOROCCO AND THE MIRAGES OF DEMOCRACY AND GOOD GOVERNANCE Sami Zemni 1 Ghent University Koenraad Bogaert 2 Ghent University Abstract: The growing contrast and contradiction between the processes of radicalization and democratization in the age of global market reforms and the ‘War on Terror’ are not confined to the internal or domestic Moroccan political scene. Political movements, NGOs, the government, international institutions and foreign governments are all embedded within a growing number of international networks thus making policy a global enterprise. In the following article we want to examine the impact of US policy on the Moroccan reform process. The background for this analysis is George W. Bush’s Greater Middle Eastern Initiative. This US initiative is ambitious as it tries to devise policies that tackle what is seen as the root causes for Middle East instability, violence and/or Islamism. Morocco is seen as one of the US’s strategic allies in the region and has been solicited to join the ‘War on Terror’. Morocco is an interesting case to study simultaneously the impact of the ‘War on Terror’, the implementation of a Free Trade Agreement and good governance measures as political tools to counter terrorism through fighting poverty and, finally, the ‘Islamist question’ particularly present in Morocco. Keywords: Morocco, democratization, good governance. Resumen: El creciente contraste y la contradicción entre los procesos de radicalización y democratización en la era de las reformas del mercado global y la “Guerra contra el Terror” no se limitan a la escena política interna de Marruecos. -
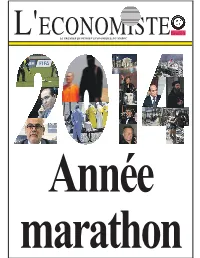
UNE RETROSPECTIVE 2014-A.Indd
Système de Management de la Qualité certifié ISO 9001 version 2008 par BUREAU VERITAS MAROC LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC Année marathon II RétRospective L’année où la diplomatie • Tournées royales d’envergure construite avec un montant de 330 mil- lions de DH. Les champs de partenariats ont également compris d’autres secteurs • Le capital immatériel fait son comme les finances, les énergies renou- velables, les infrastructures, le transport, entrée dans l’évaluation de la l’agroalimentaire, les mines, l’habitat… richesse du pays L’impact de cette tournée a été retentis- sant en termes de perception du Maroc dans le continent. En peu de temps, le • Appel à une rupture avec les Souverain a construit une image charis- matique en Afrique. La dynamique de la privilèges et l’économie de rente diplomatie royale a permis un plus grand au Sahara rapprochement avec certains Etats du Sahel, comme le Mali, qui n’étaient pas considérés traditionnellement comme des 2014 est décidément l’année bastions acquis au Maroc. Aujourd’hui, de la consécration de l’orientation afri- le renforcement du partenariat avec ces caine du Maroc. La tournée royale dans Etats se base sur une logique de com- la région, durant les premiers mois de plémentarité. Ces Etats ont demandé de cette année, a montré l’engagement du profiter de l’expertise marocaine dans Royaume en faveur du développement de plusieurs domaines, notamment dans la la coopération Sud-Sud. Le pays ne s’est promotion des ressources humaines, mais pas contenté des beaux discours, mais surtout dans l’encadrement religieux. -
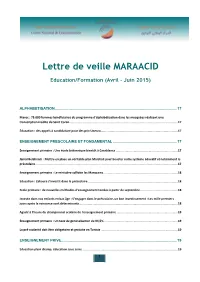
Education/Formation (Avril - Juin 2015)
Lettre de veille MARAACID Education/Formation (Avril - Juin 2015) ALPHABETISATION .................................................................................................................... 17 Maroc : 75.000 femmes bénéficiaires du programme d'alphabétisation dans les mosquées réalisent une transcription inédite du Saint Coran ..........................................................................................................................17 Éducation : des appels à candidature pour des prix Unesco .......................................................................................17 ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE ET FONDAMENTAL ............................................................. 17 Enseignement primaire : Une école britannique bientôt à Casablanca ......................................................................17 Jamal Belahrach : Mettre en place un véritable plan Marshall pour booster notre système éducatif et notamment le préscolaire .................................................................................................................................................................17 Enseignement primaire : Le ministère sollicite les Marocains ....................................................................................18 Education : Zakoura s’investit dans le préscolaire .....................................................................................................18 Ecole primaire : de nouvelles méthodes d'enseignement testées à partir de septembre ...........................................18 -

Les Modeles Economiques a L'aune De La Mondialisation
LES MODELES ECONOMIQUES A L’AUNE DE LA MONDIALISATION ET DES TERRITOIRES f CYCLE DE CONFERENCES –DEBATS JANVIER 2018-OCTOBRE 2019 AMBASSADE DU ROYAUME DU MAROC EN FRANCE 1 2 Maroc : Les modèles de développement à l’aune de la mondialisation et des territoires Dans notre région, les modèles de développement ont été marqués par différentes phases parmi lesquelles celles de la planification et de l‟industrialisation, les politiques d‟infrastructures et du développement local et territorial. Celui-ci est considéré comme l‟échelle la plus pertinente de l‟action des services publics, c‟est également une forme de gouvernance et d‟expression démocratique à un moment où le besoin de proximité se fait encore plus sentir pour mieux assurer un développement durable et inclusif. Il suppose néanmoins une évolution du rôle de l‟Etat vers la décentralisation et une intégration des dynamiques de la société civile, des corps intermédiaires, des différents groupements de développement portés par des acteurs autonomes. Et, en sus, une véritable définition de la politique de développement territoriale avec une capacité d‟organisation pour les processus de mise en œuvre pour assurer les modes de transfert idoines au développement. L‟Ambassade du Royaume du Maroc en France a organisé depuis 2014 différentes rencontres et conférences portant sur le thème « du vivre ensemble » qui a fait l‟objet d‟un ouvrage « Mieux vivre ensemble dans des sociétés en mutation, regards croisés sur les sociétés marocaine et française ». En 2017, l‟ambassade a lancé un autre cycle de conférences, toujours en regard croisés, sur le modèle de développement, les territoires et la décentralisation. -

Sans Titre-22
MERCREDI 22 février Attentat de Marrakech. 18e édition du Festival des mu- Casablanca 7 18 Report du procès en siques sacrées de Fès. Un credo: Rabat 4 18 appel >p/04 ré-enchanter le monde >p/10 , battent par la réalisation de parité au sein des institutions élues./MAP pour femmes" est une des associations féministes qui se réseau "Femmes Manifestants du mouvement du 20 février réunis à Casablanca le 3 Le du 20 février réunis à Casablanca le 3 Le Manifestants du mouvement Journal Quotidien d’Information Générale • Edition du mercredi 22 février 2012 • n°1132 • Prix: 0 Dh Égalité: L'ONU appelle le Maroc à mettre en place l'autorité pour la parité > p/03 www.aufaitmaroc.com , société p/05 Illustrationn. Une centaine de per- sonnes occupait encore Attijariwafa bank, /AUFAIT le siège de l'OFPPT à Casablanca, mardi première banque Edito marocaine > p/06 On meurt plus facilement dans nos campagnes e HCP vient de publier une note sur la mortalité au Maroc. Il en ressort claire- ment que la vie à la campagne n’est pas de tout repos. Avec un taux de morta- lité de 7,4 pour mille contre 4,7 pour mille pour le milieu urbain, la probabi- Llité de mourir en milieu rural est 57% plus élevée qu’en milieu urbain. Nos enfants vivent le même calvaire à la campagne. Le taux de mortalité infan- tile (Age inférieur à 5 ans) y est de 4,2 pour mille contre seulement 3,1 pour mille en milieu urbain. De même, on vit plus longtemps en milieu urbain. -

Liste Des Auditions, Contributions Et Activités De La Commission Spéciale Sur Le Modèle De Développement
Liste des auditions, contributions et activités de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement ANNEXE 3 AVRIL 2021 Liste des auditions, contributions et activités de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement ANNEXE 3 AVRIL 2021 SOMMAIRE PARTIE I - AUDITIONS ET CONTRIBUTIONS ...............................................................7 INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES .........................................................................9 ACTEURS PUBLICS ......................................................................................................10 PARTIS POLITIQUES ....................................................................................................13 MONDE PROFESSIONNEL ET PARTENAIRES SOCIAUX ...............................................16 TIERS SECTEUR ...........................................................................................................19 AMBASSADEURS ET ACTEURS INTERNATIONAUX ....................................................26 CONFÉRENCES LABELLISÉES .....................................................................................27 ÉCOUTES CITOYENNES ET VISITES DE TERRAIN ......................................................29 Les écoutes citoyennes : 3 formats ...............................................................................29 Table ronde ...............................................................................................................30 Cycle de Rencontres Régionales ..................................................................................30 -

CASABLANCA, Morocco Hmed Reda Benchemsi, the 33-Year-Old
Posted July 3, 2007 CASABLANCA, Morocco A hmed Reda Benchemsi, the 33-year-old publisher of the independent Moroccan weekly TelQuel, sensed someone was trying to send him a message. In a matter of months, two judges had ordered him to pay extraordinarily high damages in a pair of otherwise unremarkable defamation lawsuits. It started in August 2005, when a court convicted Benchemsi of defaming pro- government member of parliament Hlima Assali, who complained about a short article that made light of her alleged experience as a chiekha, or popular dancer. At trial, Benchemsi and his lawyer never put up a defense—because they weren’t in court. The judge had reconvened the trial 15 minutes before scheduled and, with no one representing the defense, promptly issued a verdict: two-month suspended jail terms for Benchemsi and another colleague and damages of 1 million dirhams (US$120,000). Two months later, another court convicted Benchemsi of defamation, this time after the head of a children’s assistance organization sued TelQuel and three other Moroccan newspapers for erroneously reporting that she was under investigation for suspected embezzlement. TelQuel, which had already issued a correction and apology, was ordered to pay 900,000 dirhams (US$108,000)—several times the amounts ordered against the other three publications. At the time, the damages were among the highest ever awarded in a defamation case in Morocco—and more than nine times what Moroccan lawyers and journalists say is the national norm in such cases. A puzzled Benchemsi said he learned from a palace source several months later what had triggered the judicial onslaught. -

Année 2008.Pdf
COREE -AFRIQUE Jeudi 16 Octobre 2008 ARGUMENTAIRE Forum Corée – Afrique Conférence Inter- sessionaire 2008 Rabat 16 octobre 2008 Dans le cadre de sa politique d’approche de l’Afrique ? L4AMBASSADE SUD-COR2ENNE 0 Rabat ? en collaboration avec l’Institut des Etudes africaines, Université Mohamed V- Souissi organise la Conférence Inter-sessionaire 2008 du Forum Corée – Afrique, le Jeudi 16 octobre 2008, à partir de 14h00 à la salle de conférences de l’Institut. Cette manifestation a pour objectif de consolider les liens de coopération économique et culturelle entre la Corée et les nations africaines. Cette rencontre sera certainement une plateforme de rencontre entre des experts coréens et marocains en la matière ; invités à débattre des thèmes fondamentaux de la nouvelle politique sud-coréenne envers l’Afrique : notamment la construction du réseau Corée-Afrique et la stratégie de la coopération économique Corée-Afrique. Parmi les personnalités à débattre au cours de cette manifestation : Du coté coréen Outre l’allocution d’ouverture de son Excellence l’Ambassadeur de Corée M.Jung-hee µYOO, - Pr. Won-yong SHIN de l’Université Yougan, - M. Jonggeun KIM du Ministère coréen des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, - Pr. Sang-Cheol LEE de l’Université Sung Kong Hoe, - Du coté marocain - Les allocutions d’ouverture de Monsieur Yahia ABOU EL FARAH, Directeur de l’Institut des Etudes Africaines et S.E. M. Omar HILALE secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération seront suivies par les intervention de : - Driss AIT CHEIKH du centre d’Etudes et recherches en Sciences sociales (CERSS) - Pr. Najia AL AMI de l’Université AL Akhawayn - M. -

Lavenir-De-Leurope-Est-Au-Sud.Pdf
L’AVENIR DE L’EUROPE EST AU SUD FATHALLAH SIJILMASSI L’AVENIR DE L’EUROPE EST AU SUD PRÉFACE Chacun se rappelle que « l’Union pour la Méditerranée » (l’UpM), lancée avec optimisme et éclat par le président Sarkozy en 2008, s’était heurtée aussitôt à de grandes difficultés tant la désunion était grande entre plusieurs membres de cette Union en formation, au Nord comme au Sud. A tel point qu’elle semblait mort née aux yeux de beaucoup. En réalité l’Union existe, elle est moins en vue mais elle a commencé à travailler sérieusement et son secrétaire général qui, de 2012 à 2018, a été Fathallah Sijilmassi, diplomate marocain de premier plan, nous livre dans cet essai très éclairant les réflexions et les propositions retirées de son expérience. Il démontre de façon argumentée et convaincante qu’il y a toujours autant de raisons, si ce n’est plus, pour les pays riverains de la Méditerranée, de travailler ensemble à des projets communs dans les domaines les plus variés, où les besoins sont criants, et que l’UpM peut labéliser : développement des entreprises et de l’emploi, transport et développement urbain, eau et environ- nement, affaires sociales et civiles, enseignement supérieur et recherche, énergie et action pour le climat. Bien sûr, dans tous ces secteurs, chaque pays agit déjà seul, plus ou moins efficace- ment. Mais la nécessité d’actions communes supplémentaires à un niveau plus large, euro-méditerranéen, est évident. Fathallah Sijilmassi nous apprend qu’au 31 décembre 2017, l’UpM avait labellisé 51 projets pour un total de 5,5 milliards d’euros, dont l’unité de dessalement d’eau de mer, à Gaza, la dépollution du lac de Bizerte et l’université euro-méditerranéenne de Fès.